Mep N°85.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Associació De Pagesos I Ramaders Del Principat D'andorra
Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009 Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra © Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra Dr. Vilanova núm. 9, edifici Thaïs, 4t D AD500 Andorra la Vella. Principat d’Andorra Tel.: +376 829 448 - Fax: +376 869 686 a/e: [email protected] - www.apra.ad Desembre de 2009 Edició Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra Coordinació editorial Banca Privada d’Andorra Distribució i disseny de continguts Mª Luisa Luna Fotografia de portada Mª Luisa Luna Disseny gràfic Estudi Juste Calduch Impressió Impremta Envalira Dipòsit legal AND.747-2009 Índex Salutació del president 5 Composició de la Junta Directiva 6 Organigrama 7 Presència a d’altres comissions 7 Tabac 8 Ramaderia 12 Plantes aromàtiques i medicinals 17 Trumfes de qualitat 23 Turisme rural 28 Apicultura 31 Salutació del president evolució de les explotacions agrícoles i ramaderes passa necessàriament per trobar productes que s’adaptin a un mercat cada vegada més exigent respecte a la qualitat i sostenibilitat L mediambiental, i per mantenir un just equilibri entre l’esforç fet pels treballadors del sector’ i la rendibilitat de les explotacions. Vetllar pel present i futur de l’agricultura i la ramaderia, mitjançant la millora i la diversifi cació dels productes oferts, és precisament la raó de ser primera de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra i, en aquesta tasca, esdevé transcendental el treball de qualitat i amb una òptica actual. És amb aquesta finalitat que les diferents comissions, establertes en el si de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra en els diferents àmbits d’actuació, dirigeixen i concentren els esforços en objectius concrets sense perdre la visió general de conjunt del sector agrícola i ramader. -

Parroquia Residu Zona 1 Neteja Andorra La Vella
PARROQUIA RESIDU ZONA 1 NETEJA ANDORRA LA VELLA RSU C Ciutat de Valls, C Bona vista, C Gil Torres, C Roureda de Sansa 27-mar ANDORRA LA VELLA RSU Av Princep Belloch, C Alzineret, Baixada del Moli, Casc Antic 28-mar ANDORRA LA VELLA RSU Av meritxell fins c Doctor Nequi 29-mar ANDORRA LA VELLA RSU Av Doctor Mitjavila, C Pau Claris 31-mar ANDORRA LA VELLA RSU C La Sardana, , zona Prada Ramon, Fenre, C Pere d'Urg 01-abr ANDORRA LA VELLA RSU Av Riberaigua, zona Escale,c Joan Maragall 02-abr ANDORRA LA VELLA RSU Pk Molines, C Les Canals, Prada Guillemo, La Grella 03-abr ANDORRA LA VELLA RSU La Margineda, , Av Enclar, Av Santa Coloma, Zona el Cedre 04-abr ANDORRA LA VELLA RSU Av Salou, Ctra la Comella, zona Terra Vella 05-abr ANDORRA LA VELLA RSU Av D. Mitjavila, C Pau Casals 07-abr CANILLO RSU Soldeu, Bordes Envalira 12-abr CANILLO RSU Incles, Tarter 14-abr CANILLO RSU Ransol, Aldosa, Ctra Generals fins Canillo 15-abr CANILLO RSU Canillo poble, Ctra Montaup, Meritxell 16-abr ENCAMP RSU centre Encamp 27-mar ENCAMP RSU zona pedra, Vila, Hort de Godí 28-mar ENCAMP RSU zona Les Bons, Mirador, El Tremat 29-mar ENCAMP RSU Cortals, Ctra General fons Repsol 31-mar ESCALDES-ENGORDANY RSU Ctra General 2, Av Pont de la Tosca, Av Pesssebre, Av Coprincep DeGaule, C Les Escoles 21-mar ESCALDES-ENGORDANY RSU Av Fener, Av Naciones Unides, Prat del Roure, Av Carlemany 24-mar ESCALDES-ENGORDANY RSU Av Fita i Rossell, els Vilars, zona de Caldea i Comú 25-mar ESCALDES-ENGORDANY RSU Ctra Engolasters i urbanitzacions, Sacalma 26-mar LA MASSANA RSU Aldosa, Anyòs, -

La Vida Pastoral Tradicional D'andorra I Els Cultius Segons L'altitud
1 Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre la vida pastoral tradicional a Andorra i la seva adaptació a les diferències d’altitud. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer Andorra. La vida pastoral tradicional d’Andorra i els cultius segons l’altitud La vida pastoral, la societat i l’ús del territori Un sistema coherent i integrat La vida pastoral, base principal de l’economia i de les activitats tradicionals, és alhora - la utilització d’un espai muntanyenc esglaonat en altitud i aprofitat en el seu conjunt, - el seu ordenament jurídic i la seva gestió, amb totes les normes necessàries, - la manera de viure i l’organització social que se’n deriven. És doncs una real ordenació del conjunt del territori : cada part, valls, bordes, muntanyes pasturades, beneficia d'una gestió coordenada en relació amb decisions comunes sempre pactades. Per tant és un sistema integrat fet de complementarietats i d’interaccions. És clar que el sistema pastoral, que constitueix el factor determinant d’aquesta ordenació territorial i d’aquestes normes socials, és estretament articulat amb l’agricultura, amb l’ús i la gestió dels boscos i amb tota una sèrie d’activitats complementàries. Però té sempre el paper central dins el model territorial i social, fins i tot quan la major part de l’espai privat es dedica a l’agricultura. Això condiciona el règim de propietat i els usos, privats o col·lectius, de cada part d'aquest territori. La base d'aquest sistema integrat és el Quart i la Parròquia, on es prenen les decisions i on es fixen les normes. -

Dades Personals Formació Idiomes Dades Professionals De Catalunya
Taller d’arquitectura Dades personals Nom i cognoms: Carles Puig Montanya Lloc / Data de naixement: Andorra la Vella, 05 de Novembre de 1960 Nacionalitat: Andorrana Passaport : 6164 Adreça: Camí del Currubell, nº1, 5 1ª. Andorra la Vella Telèfon: + 376 800420 Fax: +376 800 424 Mòbil: + 376 324 597 e-mail : [email protected] Formació Títol oficial d’arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Diploma de Mobilitat curs 1 i 2, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diploma Gestió de Cadastre Idiomes Català parlat i escrit Castellà parlat i escrit Francès parlat Angles parlat Dades professionals Assessor tècnic del Comú de Canillo des de l’any 1992, Febrer2008. Membre de la Comissió Tècnica d’Urbanisme del M.I. Govern d’ Andorra. Component del a Comissió del Pla Nacional de Residus d’Andorra. Col·legiat nº 35 del Col·legi Oficial ddArquitectes’Arquitectes d’Andorra COAA Col·legiat nº 43961-4 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya COAC Taller d’arquitectura Projectes realitzats Edifici d’apartaments a Prats (Canillo). – 1990. Central de Sta a Arans.- 1991. 3er premi a l’Aparcament vertical de La Massana.- 1991. Guarderia de Canillo.- 1992. Urbanització Boscos d’Ordino.- 1996. Urbanització Valira Nova (Encamp).- 1996. Ampliació i reforma hotel Cims al Pas de la Casa.-. Ampliació i reforma hotel Muntanya al Pas de la Casa.-. Vivenda unifamiliar a Escàs (La Massana).- 1995. Caserna de bombers del Pas de la casa i Centre d’Atenció Primaria : 2.665,16m2 E difici Telecabina de Canillo Edifici Pyrenees Motors BMW : 6045.10 m2 Edifici Vehicles Industrials a Aixovall : 1.455,42 m2 Mc Donald’s al Pas de la Casa: 1. -

Crònica Legislativa D'andorra. Evolució De La Situació Del Català a Andorra
CRÒNICA LEGISLATIVA D’ANDORRA Març de 1993 - juny de 2018 Evolució de la situació del català a Andorra des de l’aprovació de la Constitució Enric Revuelta Novell* Resum L’article té l’objectiu d’explicar i analitzar les polítiques lingüístiques més destacades que s’han aprovat en els últims 25 anys a Andorra (des del març de 1993 fins al juny de 2018) i analitzar els motius pels quals s’han adoptat. En el text s’analitzen les lleis, els decrets, els estudis i els edictes que fan referència a l’ús del català en els aspectes polítics, socials i econòmics d’Andorra. Es destaquen les iniciatives impulsades en els últims anys tant pel govern del Principat com pels legisladors i els diferents actors socials. A més, per entendre l’evolució de l’ús del català al país i les polítiques posteriors adoptades pel govern andorrà, també ens hem nodrit d’estudis i de capítols de llibres i d’articles publicats als mitjans de comunicació. Paraules clau: Andorra; diversitat; plurilingüisme. LEGISLATIVE REPORTS ON ANDORRA Abstract This paper is aimed to analyse and explain the most outstanding linguistic policies that have been approved throughout the last 25 years in Andorra, and to study the reasons for which they have been adopted. The text analyses the laws, or- ders, studies and edicts related to the use of Catalan language in politics and social and economic matters in Andorra. The initiatives driven in the last years by the Principality Government and Andorran legislators, as well as by different social actors, are highlighted in this document. -

Af-En-Guia General 2016-Web
Index Index Identity card 04 Historical summary 08 Geography, climate and nature 10 02 Leisure, sports and health 12 03 Culture 20 Tourist bus 24 Festivities 25 Shopping 26 Gastronomy 28 Accommodation 32 Transport 34 Business tourism 38 Special thanks Photos kindly provided by the Tourism parishes 40 Andorra National Library and Practical information 48 the Comuns de Andorra (Paris- hes of Andorra). Brochures 54 Moscow Oslo 3.592 km 2.385 km FRANCE Dublin Copenhagen 1.709 km 2.028 km Canillo London Ordino 1.257 km La Haye El Pas de la Casa Berlin 1.328 km La Massana Encamp 1.866 km Bruxelles 1.180 km Escaldes-Engordany Paris Andorra la Vella 861 km Zurich Sant Julià 1.053 km de Lòria Toulouse ESPAÑA 04 185 km 05 Madrid 613 km Andorra Lisboa Barcelona Roma 1.239 km 208 km 1.362 km We invite you to visit the Prin- Andorra is nature par excellence, Andorra is also a millenary country: live together in perfect harmony cipality of Andorra, the smallest a space of incomparable beauty, Romanesque art, museums and with comfort, modernity and the state in Europe in the heart of ideal for open-air sports activi- monuments, culture trails, festiv- latest technologies. the Pyrenees. ties both in the summer and in ities and celebrations... are just a Over 2,000 stores with the prod- the winter. Trekking and skiing small sample of its rich historical On a stage of 468 km2, you will ucts of the best trademarks, an ex- are two examples of the activi- legacy. -
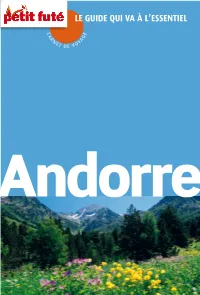
Le Guide Qui Va À L'essentiel
LE GUIDE QUI VA À L’ESSENTIEL C A E R G N A E Y T D E V O Andorre Les bonnes adresses du bout de la chambre d’hôtes chambre en Provence ? en Provence rue au bout du Seychelles ? Seychelles resort aux resort monde .com © OLEG TSCHELTZOFF - FOTOLIA © YVES LEFEVRE - FOTOLIA Benvinguts a Andorra ! E RR O « Tout un monde dans un petit pays. » Cette phrase, qui s’affiche sous nos d’And T N yeux lorsqu’on s’aventure sur le site Web EME RN de la Principauté, en dit long. Coincée E V OU entre la France et l’Espagne, la petite G U D perle catalane est simplement unique. ME Contrairement à ce que l’on peut ima- RIS OU T giner, ni française, ni espagnole, juste U D E elle, naturelle et authentique, andorrane ÈR T finalement. La vallée du Madriu classée MINIS © au patrimoine mondial de l’Unesco, le col d’Ordino avec ses pics enneigés surplombant des vallons verdoyants, les petits villages tout en pierres sur les hauteurs des paroisses, ne peuvent lais- ser le voyageur le plus rôdé indifférent. Les amoureux du grand air montagnard y pratiquent allègrement entre autres ski et randonnée, vélo et escalade. Maintenant, l’interaction homme-nature se concrétise-t-elle seulement par cette relation de loisirs ? Loin de là. Ce serait ignorer un héritage du passé omniprésent, à travers les nombreuses petites églises romanes aux tour-clochers, les maisons traditionnelles, les cabanes de berger qui se dressent fièrement dans tout le pays, au détour d’un chemin ou au cœur d’un village. -

Andorra. Anuari Socioeconòmic 2005
Fotografia coberta: Santuari de Ntra. Sra. de Meritxell. Autor: Jaume Riba Sabaté Andorra.Anuari2005 socioeconòmic ANDORRA. ANUARI SOCIOECONÒMIC 2005 Edita: Banca Privada d’Andorra Av. Carlemany, 119 ad700 Escaldes-Engordany Principat d’Andorra Direcció: Dr. Joan Vilà-Valentí Informe sobre l’economia andorrana. 2004: Dr. Xavier Sáez i Bárcena Els condicionaments del desenvolupament parroquial: Dra. Maria Jesús Lluelles i Larrosa L’administració menor local a Andorra: els quarts (ii): Pere Cavero Muñoz Deu anys de publicació d’aquest «Anuari socioeconòmic» (1996-2005): Dr. Joan Vilà-Valentí Fotografies: Jaume Riba Sabaté Disseny gràfic original: Jordi Salvany Disseny gràfic: Estudi Juste Calduch Impressió: Agpograf, s.a. ISBN: 99920-1-580-2 Dipòsit legal: B-XXXXX-05 Agraïments: BPA vol agrair de manera molt especial la col·laboració del Quart d’Ordino, per haver-nos permès reproduir en aquest Anuari la foto de l’Hotel Casamanya, alhora que la dels quarts d’Anyós i de Pal, per haver-nos permès reproduir en aquest Anuari les fotos de les seves respectives cases del Quart. Andorra. Anuari socioeconòmic 2005 – Escaldes-Engordany: Banca Privada d’Andorra, 2005. - 208 p.: il.; 28cm. Conté: Informe sobre l’economia andorrana 2004 / Xavier Sáez ; Els condicionaments del desenvolupament parroquial / M. Jesús Lluelles ; L’administració menor local a Andorra: els quarts (ii) / Pere Cavero Muñoz; Deu anys de publicació d’aquest Anuari socioeconòmic (1996-2005) / Joan Vilà-Valentí; – isbn 99920-1-580-2 1. Andorra – Condicions econòmiques – Anuaris 2. Llibres – Ressenyes. 3. Andorra –Condicions econòmiques – Història. 4. Quarts* 5. Administració local – Andorra - Història I. Banca Privada d’Andorra II. Vilà-Valentí, Joan 33(467.2)“2004”(058) Índex 5 Presentació 7 Al lector 9 Informe sobre l’economia andorrana. -

ANDORRA LA VELLA Massana Erts Sant Juliàdelòria Estanys De Coloma L’Angonella Tristaina Estanys De Santa (2300M) La Arans Ordino ANDORRA LA VELLA Aixirivall Sispony
© Lonely Planet Publications 396 lonelyplanet.com ANDORRA •• History 397 Andorra ANDORRA ANDORRA ANDORRA 0 5 km Andorra 0 3 miles ANDORRA ANDORRA Estanys de F R A N C E Tristaina To Aix-les-Thermes (21km); ORDINO Estany de l’Estany Toulouse (155km) Borda de (2339m) Sorteny Pic de la Serrera Ordino-Arcalís (2913m) Ski Area El Serrat Collada dels Meners Slip Andorra into the conversation and people may tell you, with horror or joy, that it’s all Estanys de CG3 (2713m) l’Angonella CANILLO Port de Pic de Coma Pedrosa (2300m) Llorts Pic de l’Estany skiing and shopping. They might add that it’s a one-road, one-town ministate. Riu Estany de Baiau Bordes de (2915m) N20 (2942m) Juclar Valira l'Ensegur (2756m) Refugi de Arans (2180m) L'Hospitalet They’re right to some degree, but also very wrong. Shake yourself free of the capital Coma Pedrosa El Tarter Estany de La Cortinada Soldeu del Pic de Casamanya les Truites Arinsal (2740m) Valira d’Orient Arinsal Nord Riu Andorra la Vella’s tawdry embrace to purr along one of the state’s only three secondary (2260m) Ski Area Port Canillo Segudet CG2 d’Envalira Ordino roads and you’ll discover villages as unspoilt as any in the Pyrenees. LA MASSANA Erts Soldeu-El Tarter (2408m) Coll d’Ordino Ski Area Les Bordes La (1980m) Port de Pal Massana d'Envalira A warning though: it may not be the same a few years from now. Greed and uncontrolled Cabús Col de Sispony Pas de la Casa Puymorens S P A I N Pal Ski Area Encamp CG3 CG2 Grau Roig development risk spoiling the side valleys. -

Disposició Final Primera Disposició Final Segona Llei 9/2003, Del 12 De
Núm. 55 - any 15 - 16.7.2003 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 1887 hi siguin contràries. En especial, queda El Principat d’Andorra disposa ja de le- tableix una regulació específica de l’Ar- derogat el Decret sobre el contracte de gislació de protecció del patrimoni cul- xiu Nacional i la Biblioteca Nacional. treball de 15 de gener de 1974, i els títols tural. Les ordinacions del 13 de juliol de El capítol cinquè regula les mesures de II, III, IV, V, VI, VII i IX, així com els apar- 1964, del 4 de juny de 1970 i del 5 de ju- foment i difusió. Les mesures de foment tats a) i b) de l’article 56 del Reglament liol de 1988, i la Llei de protecció del pa- pretenen, d’una banda, incentivar la con- laboral, de 22 de desembre de 1978, i les trimoni cultural-natural, del 9 de tribució de la societat en la preservació seves modificacions successives. novembre de 1983, han contribuït a la del patrimoni cultural, donant suport a conservació dels béns culturals d’Andor- les associacions especialitzades, millo- Disposició final primera ra. No obstant això, el nou marc jurídic rant la formació i la competència de pro- La present Llei entrarà en vigor als sis que va comportar l’aprovació, l’any fessionals i empreses i, de l’altra, 1993, de la Constitució del Principat mesos de la seva publicació al Butlletí compensar els titulars de béns culturals Oficial del Principat d’Andorra. d’Andorra fa convenient la promulgació de les càrregues i obligacions que la Llei d’aquesta nova Llei del patrimoni cultu- els imposa. -

Llei 18/2016, Del 30 De Novembre, De Designació De Carreteres I Gestió De La Xarxa Viària
1/14 Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2016 ha aprovat la següent: LLei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària Exposició de motius Mitjançant la Llei 7/2005, del 21 de febrer, de designació de carreteres, el Consell General va promulgar un text legal que, per primera vegada, regulava la circulació viària del Principat des d’un punt de vista global, substituint en bona part les antigues ordinacions adoptades des de finals de la dècada de 1960 i fins als inicis dels anys 1990. D’aquesta manera, s’aportaren solucions uniformes a la nomenclatura viària, designant amb claredat les carreteres generals i definint titularitats. Tanmateix, es creà la xarxa bàsica de vials i es definí la seva gestió als efectes d’ordenar el trànsit rodat des d’un punt de vista general, millorant la circulació rodada entre les parròquies i l’entrada i sortida de vehicles del Principat, especialment en aquells moments de màxima afluència. Finalment, la Llei introduí en annex el Directori de carreteres generals i el llistat de vials inclosos dins de la xarxa bàsica de vials. L’actual Llei pretén actualitzar el text legal de l’any 2005 i millorar-lo en diversos aspectes. En primer lloc, el capítol primer de la Llei precisa conceptualment el que s’entén per vies de comunicació i, dins d’aquestes, les que tenen la consideració de carreteres o carrers i, conseqüentment, queden regula- des per la Llei; es precisa igualment el règim aplicable a la titularitat, diferenciant clarament el règim jurídic aplicable a les carreteres generals i a les carreteres secundàries; i es regulen les modalitats de traspàs de titularitat de les vies de circulació, així com les amplades, en tots els casos. -

PLANIGRAFIA 14-15 ES Web.Pdf
ÁREAS INFANTILES MONTMALÚS 2781 PIC BAIX ¡NOVEDAD! 210 DEL CUBIL PIC NEGRE D’ENVALIRA 2705 KM DE PISTAS PIC DE LES ABELLETES 2822 2596 PIC BLANC PIC DE LA MENERA 2774 2639 Circuito Imaginarium Circuito Bababoom Circus CIRC DELS COLELLS EMPORTONA PIC BLANC PESSONS 2610 TK PIC BLANC G4 2307 7 p or te lla PIC CUBIL ns TK COMA III so 2470 8 es ús p COLLADA D’ENRADORT s l 15 de d 5 a camí TK CORTALS r m 2447 a COMA III t CORTALS s n ¡ i S NOVEDAD! S 2300 11 b o E2 2502 D T o t SD s m o R c LÚ s g d A è p 6 r t a l o r IS ng a COM a r MA A n t n S i l o ug SUPERTÚNEL rd a e a A t 33 OBAC DELS CORTALS o . L J n a g o BLA v cort E va c NT r a l r l D o do ió 21 s TK CORTALS II t O L NCA T ra L TS TSF 4 XAVIK i 22 D C M TSF 4 O COLL BLANC 6 LOT G3 m T K C PIC T R T 2 T K O G S F 2528 men BLA 16 L I la F4 II S er LL LAC D rt O l .I T a NC PIOLET o rí R e C 34 II 13 IL pe A ad b U an OL I. llac ta 2150 UB r C DE r li A ol IB S m Vodka C di E ENRAD n o R .