Industrie Aéronautique Et Spatiale Kechidi Talbot
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MS – 204 Charles Lewis Aviation Collection
MS – 204 Charles Lewis Aviation Collection Wright State University Special Collections and Archives Container Listing Sub-collection A: Airplanes Series 1: Evolution of the Airplane Box File Description 1 1 Evolution of Aeroplane I 2 Evolution of Aeroplane II 3 Evolution of Aeroplane III 4 Evolution of Aeroplane IV 5 Evolution of Aeroplane V 6 Evolution of Aeroplane VI 7 Evolution of Aeroplane VII 8 Missing Series 2: Pre-1914 Airplanes Sub-series 1: Drawings 9 Aeroplanes 10 The Aerial Postman – Auckland, New Zealand 11 Aeroplane and Storm 12 Airliner of the Future Sub-series 2: Planes and Pilots 13 Wright Aeroplane at LeMans 14 Wright Aeroplane at Rheims 15 Wilbur Wright at the Controls 16 Wright Aeroplane in Flight 17 Missing 18 Farman Airplane 19 Farman Airplane 20 Antoinette Aeroplane 21 Bleriot and His Monoplane 22 Bleriot Crossing the Channel 23 Bleriot Airplane 24 Cody, Deperdussin, and Hanriot Planes 25 Valentine’s Aeroplane 26 Missing 27 Valentine and His Aeroplane 28 Valentine and His Aeroplane 29 Caudron Biplane 30 BE Biplane 31 Latham Monoplane at Sangette Series 3: World War I Sub-series 1: Aerial Combat (Drawings) Box File Description 1 31a Moraine-Saulnier 31b 94th Aero Squadron – Nieuport 28 – 2nd Lt. Alan F. Winslow 31c Fraser Pigeon 31d Nieuports – Various Models – Probably at Issoudoun, France – Training 31e 94th Aero Squadron – Nieuport – Lt. Douglas Campbell 31f Nieuport 27 - Servicing 31g Nieuport 17 After Hit by Anti-Aircraft 31h 95th Aero Squadron – Nieuport 28 – Raoul Lufbery 32 Duel in the Air 33 Allied Aircraft -

3-VIEWS - TABLE of CONTENTS to Search: Hold "Ctrl" Key Then Press "F" Key
3-VIEWS - TABLE of CONTENTS To search: Hold "Ctrl" key then press "F" key. Enter manufacturer or model number in search box. Click your back key to return to the search page. It is highly recommended to read Order Instructions and Information pages prior to selection. Aircraft MFGs beginning with letter A ................................................................. 3 B ................................................................. 6 C.................................................................10 D.................................................................14 E ................................................................. 17 F ................................................................. 18 G ................................................................21 H................................................................. 23 I .................................................................. 26 J ................................................................. 26 K ................................................................. 27 L ................................................................. 28 M ................................................................30 N................................................................. 35 O ................................................................37 P ................................................................. 38 Q ................................................................40 R................................................................ -

1914/1918 : Nos Anciens Et Le Développement De L' Aviation
1914/1918 : Nos Anciens et le Développement de l’aviation militaire René Couillandre, Jean-Louis Eytier, Philippe Jung 06 novembre 2018 - 18h00 Talence 1914/1918 : Nos Anciens et le développement de l’ aviation militaire Chers Alumnis, chers Amis, Merci d’être venus nombreux participer au devoir de mémoire que toute Amicale doit à ses diplômés. Comme toute la société française en 1914, les GADZARTS, à l’histoire déjà prestigieuse, et SUPAERO, née en 1909, ont été frappés par le 1er conflit mondial. Les jeunes diplômés, comme bien d’autres ont été mobilisés pour répondre aux exigences nationales. Le conflit que tous croyaient de courte durée s’est révélé dévoreur d’hommes : toute intelligence, toute énergie, toute compétence fut mise au service de la guerre. L’aviation naissante, forte de ses avancées spectaculaires s’est d’abord révélé un service utile aux armes. Elle a rapidement évolué au point de devenir indispensable sur le champ de bataille et bien au-delà, puis de s’imposer comme une composante essentielle du conflit. Aujourd’hui, au centenaire de ce meurtrier conflit, nous souhaitons rendre hommage à nos Anciens qui, avec tant d’autres, de façon anonyme ou avec éclat ont permis l’évolution exceptionnelle de l’aviation militaire. Rendre hommage à chacun est impossible ; les célébrer collectivement, reconnaître leurs sacrifices et leurs mérites c’est nourrir les racines de notre aéronautique moderne. Nous vous proposons pour cela, après un rappel sur l’ aviation en 1913, d’effectuer un premier parcours sur le destin tragique de quelques camarades morts au champ d’honneur ou en service aérien en les resituant dans leur environnement aéronautique ; puis lors d’un second parcours, de considérer la présence et l’apport d’autres diplômés à l’évolution scientifique, technique, industrielle ou opérationnelle de l’ aviation au cours de ces 4 années. -

1/5 5 Nieuport 28
11//55 NNIIEEUUPPOORRTT 2288 V4 FLAT-FINISHED ARF RADIO CONTROL WWI MODEL AIRPLANE I N S T R U C T I O N M A N U A L Shown with optional scale machine guns, motor and propeller. Congratulations on your acquisition of Maxford USA’s Nieuport 28 ARF! The Nieuport 28 was a French biplane fighter flown during World War I, designed by Gustave Delage and built by Nieuport, also known as Nieuport-Delage – a French airplane company famous for racers before World War I and fighter aircraft during World War I and between the wars. Retaining many of the Nieuport 17’s best features, the Nieuport 28 was a lightly built, highly maneuverable fighter: It had a more powerful engine; carried twin synchronized machine guns; its ailerons were fitted only to the lower wing; and it had two- spar wings – top and bottom – in place of the earlier Nieuport types’ sesquiplane (a biplane with one long wing and one short one above or below it). The Nieuport 28 was the first aircraft to see service in any American fighter squadron. By the time the Nieuport 28 became available in early 1918, it was already considered “surplus” from the French point of view. Their SPAD XIII was a superior aircraft in most respects and had already become firmly established as the standard French fighter. (A 1/5-scale ARF SPAD XIII is also available from Maxford USA at www.maxfordusa.com.) When the Nieuport 28 was offered to the United States, it was immediately accepted by the American Expeditionary Force, and 297 Nieuport 28s were put into service in the 27th, 94th, 95th and 103rd Aero Pursuit Squadrons. -

Avions Civils
SOMMAIRE DU VOLUME I LA CONDUITE DES PROGRAMMES CIVILS AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS........................................................................... 3 PREFACE.............................................................................................................................. 5 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................. 9 CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE...................................................................................... 11 LE MARCHE DU TRANSPORT AERIEN .................................................................................. 11 Le passager et l’évolution du trafic.......................................................................................... 11 Les compagnies et la flotte d’avions ....................................................................................... 13 LA CONSTRUCTION DES AVIONS CIVILS .............................................................................. 14 Les caractéristiques de l’activité.............................................................................................. 14 La compétition et son évolution............................................................................................... 18 La dimension économique et monétaire ................................................................................. 20 L’ ADMINISTRATION ET SES MISSIONS ................................................................................. 22 La tutelle militaire de -

Les Avions NIEUPORT-DELAGE
Les avions NIEUPORT-DELAGE Les avions Nieuport-Delage Par Gérard Hartmann Le Nieuport-Delage NiD-29 V n° 10 vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett 1920, piloté par Joseph Sadi-Lecointe. (Catalogue constructeur). 1 Les avions NIEUPORT-DELAGE Comme toute la construction aéronautique Nieuport-Astra française, Nieuport est frappé par les taxes de guerre votées en avril 1920 et la société est mena- En novembre 1917, les usines Nieuport cée de disparition. Des 4 200 ouvriers employés d’Issy-les-Moulineaux emploient 3 600 ouvriers dans les usines d’Issy-les-Moulineaux en octobre sur sept ateliers de 4 500 m2. Les usines Astra de 1918 ne subsistent plus que 650 personnes en Billancourt ont suivi la même évolution et 1923. Ce sont les capitaux nouveaux des action- l’atelier d’Argenteuil (ex Tellier) est devenu une naires (en particulier la famille Deutsch de la usine. En effet, en août 1918, Alphonse Tellier Meurthe), le succès du NiD-29 C1 et les ventes à dont la santé se détériore vend ses ateliers du l’étranger qui vont la sauver de la disparition. quai de Seine à Argenteuil à la Société Nieuport. Le même mois, le NiD-29 C1, meilleur appa- reil jamais réalisé à Issy-les-Moulineaux chez Nieuport, débute ses essais. Avions Nieuport utilisés par l’aviation américaine en France, 1918. Le 24 novembre 1919, Henry Deutsch de la Meurthe propriétaire de l’ensemble de ces usines meurt à 73 ans au château de Romainville à Ec- quevilly (Yvelines). Forts des licences de fabrica- tion vendues à l’étranger et des revenus pétro- liers (la famille créa la première essence Le 25 septembre 1920 à Etampes, Kirsch (1892-1969) sur Nieu- d’aviation en France, la société des pétroles Jupi- port 29 bat le record du monde de vitesse, avec 269,058 km/h. -
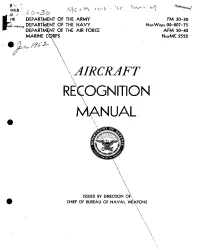
\Aircraft Recognition Manual
Jf V t 9fn I 4-'!- Vw'^ ' 'o | ^ renai; 408.$ /•> ,A1.AI / -3o FM DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 \AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL SI ISSUED BY DIRECTION OF\ CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS \ \ I 4 DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL •a ISSUED BY DIRECTION OF CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS JUNE 1962 DEPARTMENTS OF THE ARMY, THE NAVY AND THE AIR FORCE, WASHINGTON 25, D.C., 15 June 1962 FM 30-30/NAVWEPS 00-80T-75/AFM 50-40/NAVMC 2522, Aircraft Recognition Manual, is published for the information and guidance of all concerned. i BY ORDER OF THE SECRETARIES OF THE ARMY, THE NAVY, AND THE AIR FORCE: G. H. DECKER, General, Umted States Army, Official: Chief of Staff. J. C. LAMBERT, Major General, United States Army, The Adjutant General. PAUL D. STROOP Rear Admiral, United States Navy, Chief, Bureau of Naval Weapons. CURTIS E. LEMAY, Official: Chief of Staff, United States Air Force, R. J. PUGH, Colonel, United States Air Force, Director of Administrative Services. C. H. HAYES, Major General, U.S. Marine Corps, Deputy Chief of Staff (Plans). H DISTRIBUTION: ARMY: Active Army : DCSPER (1) Inf/Mech Div Co/Btry/Trp 7-2 44-112 ACSI (1) (5) except Arm/Abn Div 7- 44-236 52 DCSLOG (2) Co/Trp (1) 8- 44-237 137 DCSOPS(5) MDW (1) 8-500 (AA- 44-446 ACSRC (1) Svc Colleges (3) AH) 44447 CNGB (1) Br Svc Sch (5) except 10-201 44^536 -

L'arsenal De L'aéronautique
L’impressionnant bimoteur prototype VG 10-02 en cours de montage durant l’hiver 1944-1945. L’Arsenal de l’aéronautique Ce devait être une société laboratoire, un modèle. Ce ne fut qu’un constructeur de plus, mais ses ingénieurs avec l’assistance des Centre d’essais mirent au point toutes les techniques modernes. 1 Capable d’enterrer les meilleures idées et les projets les plus utiles, le corbillard de la mort est un vé- hicule commandé par trois forts leviers : la bêtise, la mollesse et la fainéantise. On repère le premier à son inscription : « je ne sais pas », le second porte la mention : « je ne veux pas », le troisième : « ce n’est pas à moi de la faire ». Gérard Hartmann, 33 ans d’expérience professionnelle. 2 Une société modèle Dans les années trente, les députés (qui votent les budgets) et les dirigeants militaires français réalisent que par suite de manque de concentration et de partage des compétences, l’industrie aéronautique nationale a pris du re- tard par rapport aux grandes nations étrangè- res, Allemagne, Italie, Russie, Etats-Unis, Grande-Bretagne. C’est pourquoi ils décident de doter la France des structures adéquates. Avant même l’arrivée au pouvoir du Front po- pulaire, le rapporteur du budget de l’Air, le député socialiste Pierre Renaudel (1871-1935) défend l’idée d’une « société d’étude et de construction aéronautique modèle » (d’Etat). Ce sera L’Arsenal de l’aéronautique. La Grande soufflerie de Chalais-Meudon, inaugurée en 1934. Le Centre d’Essais des Moteurs et des Hélices de l’aviation militaire française passe sous le contrôle du ministère de l’Air. -

Transports ; Direction Générale De L'aviation Civile ; Direction Programmes Aéronautiques Civils (1962-1982)
Transports ; Direction générale de l'aviation civile ; Direction programmes aéronautiques civils (1962-1982) Répertoire (19830312/1-19830312/63) Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1983 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_020707 Cet instrument de recherche a été encodé par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 19830312/1-19830312/63 Niveau de description fonds Intitulé Transports ; Direction générale de l'aviation civile ; Direction programmes aéronautiques civils Intitulé Transports ; programmes aéronautiques civils Date(s) extrême(s) 1962-1982 Localisation physique Pierrefitte DESCRIPTION Présentation du contenu SOMMAIRE TRAC, 53 T Construction aéronautique, généralités, 1975-1977. 30092-30093 611-612 Caravelle [financement, contrats, comparaison de coûts Caravelle 15], 1966-1978. 30094-30096 613-615 Mercure, 1966-1975. 30097-30104 616-623 Avions à décollage court (ADAC ou STOL), 1968-1976. 30105-30110 624-629 BAC 111, 1973-1977. 30111 630 Concorde, 1962-1976. 30112-30130 631-649 SNECMA, statuts, conseil d'administration, 1973-1979. 30131-30135 650-654 SNIAS (Aérospatiale), documents financiers et techniques, conseil d'administration, 1973-1979. 30136-30139 655-658 ONERA, Conseil d'administration, -

Aeronautical Engineering
NASA SP-7037 (36) ND AERONAUTICAL ENGINEERING A SPECIAL BIBLIOGRAPHY WITH INDEXES Supplement 36 OCTOBER 1973 ZkS&-Sp-7037 (36) EROAUTIC&L N74-14702 0GIEEG A SPCILL BIBLIOGMPHY WITH INDEXES, SUPPLENgIT 36 (N3AS) $5.25 Unclas 00/01 27136 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION ACCESSION NUMBER RANGES Accession numbers cited in this Supplement fall within the following ranges: IAA (A-10000 Series) A73-34073 -- A73-37144 STAR (N-10000 Series) N73-25997 - N 73-27884 This bibliography was prepared by the NASA Scientific and Technical Information Facility operated for the National Aeronautics and Space Administration by Informatics Tisco, Inc. The Administrator of the National Aeronautics and Space Administration has determined that the publication of this periodical is necessary in the transaction of the public business required by law of this Agency. Use of funds for printing this periodical has been approved by the Director of the Office of Management and Budget through July 1, 1974. N74-14702 AERONAUTICAL ENGINEERING - A SPECIAL BIBLIOGRAPHY (SUPPLEMENT 36) National Aeronautics and Space Administration Washington, DC Oct 73 N74-14702 1. Report No. 2. Governmmnt Accession No. 3. Recipient's Catalog No. NASA SP-7037 (36) 4. Titleand Subtitle 5. Report Date October 1973 AERONAUTICAL ENG INEERING e.Performing Organization Code A Special Bibliography (Supplement 36) 7. Author(s) 8. Performing Organization Report No. 10. Work Unit No. 9. Performing Organization Name and Address National Aeronautics and Space Administration 11. Contractor Grant No. Washington, D. C; 20546 13. Type of Report and Period Covered 12. Sponsoring Agency Name and Address 14. Sponsoring Agency Code 15. -

CHAMPION AEROSPACE LLC AVIATION CATALOG AV-14 Spark
® CHAMPION AEROSPACE LLC AVIATION CATALOG AV-14 REVISED AUGUST 2014 Spark Plugs Oil Filters Slick by Champion Exciters Leads Igniters ® Table of Contents SECTION PAGE Spark Plugs ........................................................................................................................................... 1 Product Features ....................................................................................................................................... 1 Spark Plug Type Designation System ............................................................................................................. 2 Spark Plug Types and Specifications ............................................................................................................. 3 Spark Plug by Popular Aircraft and Engines ................................................................................................ 4-12 Spark Plug Application by Engine Manufacturer .........................................................................................13-16 Other U. S. Aircraft and Piston Engines ....................................................................................................17-18 U. S. Helicopter and Piston Engines ........................................................................................................18-19 International Aircraft Using U. S. Piston Engines ........................................................................................ 19-22 Slick by Champion ............................................................................................................................. -

19710017233.Pdf
PREVIOUS BIBLIOGRAPHIES IN THIS SERIES NASA SP-7037 Scptemher 1970 Jan. itug. 1970 W'ASA SP-7037 (01) Januar~197 I Scpt. Uec. 1970 NASA SP-7037 (02) AERONAUTICAL ENGINEERING A Special Bibliography Supplement 2 A selection of annotated references to unclas- sified reports and journal articles that were introduced into the NASA scientific and tech- nical information system and announced in January 1971 in Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) International Aerospace Abstracts (IAAI. Scieirtijic atrd Techirical Iirjomratioir 0jfic-e OFFICE OF INDUSTRY AFFAIRS AND TECHNOLOGY UTILIZATION 1971 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION This document is available from the National Technical Information Service (NTIS), Springfield, Virginia 221 51 for $3.00. INTRODUCTION Under the terms of an interagency agreement with the Federal Aviation Admin- istration this publication has been prepared by the National Aeronautics and Space Administration for the joint use of both agencies and the scientific and technical community concerned with the field of aeronautical engineering. This supplement to Aeroiiautical Eiigiiieeriiig-A Special Bibliographj. (NASA SP-7037) lists 394 reports, journal articles, and other documents originally announced in January 197 1 in Scieiitific aiid Technical Aerospace Reports (STAR)or in Iiiteriiatioiial Aerospace Abstracts (IAAI. For previous bibliographies in this series, see inside of front cover. The coverage includes documents on the engineering and theoretical aspects of design, construction, evaluation, testing, operation, and performance of aircraft (includ- ing aircraft engines) and associated components, equipment, and systems. It also in- cludes research and development in aerodynamics, aeronautics, and ground support equipment for aeronautical vehicles. Each entry in the bibliography consists of a standard bibliographic citation accom- panied by an abstract.