Cahiers Du Master Genre MÉMOIRE RECHERCHE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Italian Futurism, 1909–1944: Reconstructing the Universe Published on Iitaly.Org (
Italian Futurism, 1909–1944: Reconstructing the Universe Published on iItaly.org (http://www.iitaly.org) Italian Futurism, 1909–1944: Reconstructing the Universe Natasha Lardera (February 21, 2014) On view at the Solomon R. Guggenheim Museum, until September 1st, 2014, this thorough exploration of the Futurist movement, a major modernist expression that in many ways remains little known among American audiences, promises to show audiences a little known branch of Italian art. Giovanni Acquaviva, Guillaume Apollinaire, Fedele Azari, Francesco Balilla Pratella, Giacomo Balla, Barbara (Olga Biglieri), Benedetta (Benedetta Cappa Marinetti), Mario Bellusi, Ottavio Berard, Romeo Bevilacqua, Piero Boccardi, Umberto Boccioni, Enrico Bona, Aroldo Bonzagni, Anton Giulio Bragaglia, Arturo Bragaglia, Alessandro Bruschetti, Paolo Buzzi, Mauro Camuzzi, Francesco Cangiullo, Pasqualino Cangiullo, Mario Carli, Carlo Carra, Mario Castagneri, Giannina Censi, Cesare Cerati, Mario Chiattone, Gilbert Clavel, Bruno Corra (Bruno Ginanni Corradini), Tullio Crali, Tullio d’Albisola (Tullio Mazzotti), Ferruccio Demanins, Fortunato Depero, Nicolaj Diulgheroff, Gerardo Dottori, Fillia (Luigi Page 1 of 3 Italian Futurism, 1909–1944: Reconstructing the Universe Published on iItaly.org (http://www.iitaly.org) Colombo), Luciano Folgore (Omero Vecchi), Corrado Govoni, Virgilio Marchi, Filippo Tommaso Marinetti, Alberto Martini, Pino Masnata, Filippo Masoero, Angiolo Mazzoni, Torido Mazzotti, Alberto Montacchini, Nelson Morpurgo, Bruno Munari, N. Nicciani, Vinicio Paladini -

BRUNO MUNARI, FUTURISMO E OLTRE …. AVVENIMENTI E SCRITTI 1926-1940
BRUNO MUNARI, FUTURISMO E OLTRE …. AVVENIMENTI e SCRITTI 1926-1940 Mostra futurista alla Galleria Pesaro, ogni anno era un grande avvenimento. Le ricorderete tutti, immagino. Dal 1930 al 1935 mi pare, Prampolini a sorpresa, ogni anno ci stupiva con le sue idee. E la famosa cena futurista con un tavolo che si snodava per tutte le sale della galleria. In quel periodo io esposi le mie prime macchine inutili. C'era molto entusiasmo e molta attività: Marinetti al Corso Hotel, riunioni discussioni presentazioni organizzazione di mostre di spettacoli di serate futuriste. Lavoravamo tutti sodo e con accanimento. Marinetti ogni volta ci entusiasmava, ogni volta era una polemica, ogni volta una battaglia. Eravamo allora il gruppo futurista lombardo, aeropittura aeroscultura radiopittura plastici polimaterici, macchine inutili, mandavamo a tutte le esposizioni in Italia in Francia in tutto il mondo. Ma in tutto questo fervore, in mezzo a queste girandole multicolori, il nostro punto di riferimento era Paolo Buzzi. Era il burocrate futurista, era l'uomo apparentemente come tutti gli altri uomini ma animato da un segreto violentissimo fuoco futurista. Le nostre vere vittorie non erano le mostre non erano le discussioni accanite. La nostra vera vittoria era un nostro quadro a Palazzo Monforte. Paolo Buzzi era la nostra quinta colonna, era la testa di ponte che ci permetteva di entrare nella mentalità borghese e di aprire i cervelli al nostro nuovo mondo. Pallido serio e dignitoso, apparentemente immobile ma internamente animatissimo, con milioni di immagini di argomenti di colori di sensazioni, sempre pronto ad animare e ad aiutare i giovani artisti, tu, con la tua amicizia e con la tua poesia ci hai regalato uno dei più bei periodi della nostra vita.1 Una cena futurista. -

Sintesi Futurista Della Guerra
Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Ugo Piatti SINTESI FUTURISTA El Lissitzky DELLA GUERRA SVENJA WEIKINNIS Schlagt die Weißen mit dem Roten Keil Faltblatt, Offsetdruck auf Papier, 29 x 23 cm, 1914 1919 Farblithografie 49,3 x 69,1 cm Russische Staat- »Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo, Piatti. Dal Cellulare di Milano, 20 Settembre Die Komposition des Diagramms erinnert an das Plakat Schlagt die Weißen mit dem liche Bibliothek, 1914«, mit dieser ungewöhnlichen Verortung geben die fünf Autoren des Flugblat- roten Keil von El Lissitzky, dessen avantgardistische und einprägsame Darstellung seit- Moskau tes sich zu erkennen. Bei einer interventionistischen Kundgebung in Mailand war die her mannigfaltig adaptiert wurde. Lissitzky propagierte mit ihm den russischen Bürger- Gruppe aus Künstlern und Literaten des Futurismus verhaftet worden. Als der Krieg krieg von Seiten der Roten Armee. Sein Plakat ist aber erst 1920 veröffentlicht worden, 1914 ausbrach, zögerte die italienische Regierung, sich zu beteiligen, stand sogar im weshalb die Möglichkeit besteht, dass Lissitzky die Formensprache von Sintesi futu- Bündnis mit Deutschland und Österreich. Die sogenannten »Interventisten«, deren Un- rista della guerra weiterentwickelt hat. Durch die analoge Gestaltung präzisiert sich die terstützer aus verschiedenen politischen Lagern kamen, drängten zum Kriegsbeitritt, Bildsprache beim Aufruf der futuristischen Gruppe: Der »Futurismo« dringt als Keil Künstler und Intellektuelle übernahmen eine wichtige Rolle bei dem Versuch, Kriegs- weit in den Kreis des »Passatismo« vor, um ihn aufzuspalten. Die Größenverhältnisse begeisterung in der Öffentlichkeit zu schüren. Im Gefängnis – so heißt es – entwarfen der Worte lassen keinen Zweifel offen, wer die Übermacht in diesem Krieg auf seiner die militanten Futuristen diese Proklamation in diagrammatischer Form. -

Music, Noise, and Abstraction
BYVASIL y KAND INSKY' s OWN AC co u NT, his proto-abstract canvas ImpressionIII (Konzert) (19n; plate 13) was directly inspired by a performance of Arnold Schoenberg's first atonal works (the Second String Quartet, op. ro, and the Three Piano Pieces, op. n) at a concert in Munich on January 2, r9n, attended by Kandinsky and his Blaue Reiter compatriots (plate 6). The correspondence that Kandinsky launched with Schoenberg in the days following the concert makes it clear that both the painter and the composer saw direct parallels between the abandonment of tonality in music and the liberation from representation in visual art. 1 That both construed these artistic breakthroughs in spiritual terms is equally clear. Responding to the crisis of value prompted by scientific mate rialism, Kandinsky and Schoenberg affirmed an inner, spiritual realm that promised "ascent to a higher and better order," as Schoenberg would later put it. 2 Kandinsky looked to music, "the least material of the arts," as a means to "turn away from the soulless content of modern life, toward materials and environments that give a free hand to the nonmaterial strivings and searchings of the thirsty soul." "Schoenberg's music," he insisted, "leads us into a new realm, where musical experiences are no longer acoustic, but purely spiritua/."3 But what constitutes the "abstraction" of music in general and of atonal music in particular? And might this well-worn story obscure alternative conceptions of "abstraction" and other relationships between music and art in European modernism? Contrary to the self-presentations of Schoenberg and Kandinsky, there is nothing fundamental about the analogy between abstraction and atonality which is why Paul Klee, Frantisek Kupka, Marsden Hartley, and many other early abstract painters could find inspiration in the eighteenth-century polyphony that consolidated the tonal system in the first place. -
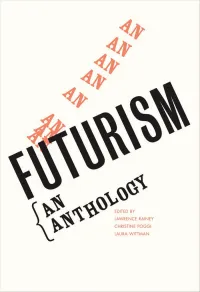
Futurism-Anthology.Pdf
FUTURISM FUTURISM AN ANTHOLOGY Edited by Lawrence Rainey Christine Poggi Laura Wittman Yale University Press New Haven & London Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Published with assistance from the Kingsley Trust Association Publication Fund established by the Scroll and Key Society of Yale College. Frontispiece on page ii is a detail of fig. 35. Copyright © 2009 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Designed by Nancy Ovedovitz and set in Scala type by Tseng Information Systems, Inc. Printed in the United States of America by Sheridan Books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Futurism : an anthology / edited by Lawrence Rainey, Christine Poggi, and Laura Wittman. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-08875-5 (cloth : alk. paper) 1. Futurism (Art) 2. Futurism (Literary movement) 3. Arts, Modern—20th century. I. Rainey, Lawrence S. II. Poggi, Christine, 1953– III. Wittman, Laura. NX456.5.F8F87 2009 700'.4114—dc22 2009007811 A catalogue record for this book is available from the British Library. This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48–1992 (Permanence of Paper). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CONTENTS Acknowledgments xiii Introduction: F. T. Marinetti and the Development of Futurism Lawrence Rainey 1 Part One Manifestos and Theoretical Writings Introduction to Part One Lawrence Rainey 43 The Founding and Manifesto of Futurism (1909) F. -

Futurismo: L'arte Degli Stati D'animo
CCoonnffiinnii Web-magazine di prospezione sul futuro Raccolta n. 47 Idee & oltre Settembre 2016 FUTURISMO: L’ARTE DEGLI STATI D’ANIMO www.confini.org Confini Webmagazine di prospezione sul futuro Organo dell’Associazione Culturale “Confini” Raccolta n. 47 - Settembre 2016 Anno XVIII + Direttore e fondatore: Angelo Romano + Condirettori: Massimo Sergenti - Cristofaro Sola + Hanno collaborato: Gianni Falcone I Futuristi + Segreteria: [email protected] [email protected] RISO AMARO 1 Referendum: il sogno americano Per gentile concessione di Gianni Falcone 2 EDITORIALE AI LETTORI Prosegue la carrellata sul Movimento Futurista. Dopo i principali manifesti, pubblicati lo scorso mese, è la volta di documenti meno noti ma non meno significativi. Essi vanno contestualizzati nel clima culturale in cui furono concepiti. Abbiamo voluto dedicare questo omaggio al Futurismo, nell’auspicio che possa nascere in Italia una destra “futurista”, proiettata verso il domani, concentrata sul futuro della nazione, capace di generare cultura, di recuperare il senso della prospettiva di lungo periodo, di rompere con gli schemi del “politicamente corretto” e con la ricerca a tutti i costi del “consenso moderato”, di coltivare un rapporto privilegiato con la scienza e le tecnologie, di non avere tabù o complessi, di essere “rivoluzionaria”, perché capace di concepire un Orizzonte e di tracciare una rotta per raggiungerlo. Dal prossimo mese ritorneremo a presidiare i confini tra il noto e l’ignoto. MONOGRAFIA/IL FUTURISMO 3 Filippo Tommaso Marinetti UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA! 1. Olà! grandi poeti incendiarî, fratelli miei futuristi!.... Olà! Paolo Buzzi, Palazzeschi, Cavacchioli, Govoni, Altomare, Folgore, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Pratella, D'Alba, Mazza! Usciamo da Paralisi, devastiamo Podagra e stendiamo il gran Binario militare sui fianchi del Gorisankar, vetta del mondo! Uscivamo tutti dalla città, con un passo agile e preciso, che sembrava volesse danzare cercando ovunque ostacoli da superare. -

Export / Import: the Promotion of Contemporary Italian Art in the United States, 1935–1969
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 Export / Import: The Promotion of Contemporary Italian Art in the United States, 1935–1969 Raffaele Bedarida Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/736 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] EXPORT / IMPORT: THE PROMOTION OF CONTEMPORARY ITALIAN ART IN THE UNITED STATES, 1935-1969 by RAFFAELE BEDARIDA A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Art History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2016 © 2016 RAFFAELE BEDARIDA All Rights Reserved ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Art History in satisfaction of the Dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy ___________________________________________________________ Date Professor Emily Braun Chair of Examining Committee ___________________________________________________________ Date Professor Rachel Kousser Executive Officer ________________________________ Professor Romy Golan ________________________________ Professor Antonella Pelizzari ________________________________ Professor Lucia Re THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT EXPORT / IMPORT: THE PROMOTION OF CONTEMPORARY ITALIAN ART IN THE UNITED STATES, 1935-1969 by Raffaele Bedarida Advisor: Professor Emily Braun Export / Import examines the exportation of contemporary Italian art to the United States from 1935 to 1969 and how it refashioned Italian national identity in the process. -

IL CINEMA RITROVATO 2008 Cineteca Del Comune Di Bologna
XXXVII Mostra Internazionale del Cinema Libero IL CINEMA RITROVATO 2008 Cineteca del Comune di Bologna XXII edizione / 22nd Edition Sabato 28 giugno - Sabato 5 luglio / Saturday 28 June - Saturday 5 July Questa edizione del festival è dedicata a Vittorio Martinelli This festival’s edition is dedicated to Vittorio Martinelli IL CINEMA RITROVATO 2008 Via Azzo Gardino, 65 - tel. 051 219 48 14 - fax 051 219 48 21 - cine- XXII edizione [email protected] Segreteria aperta dalle 9 alle 18 dal 28 giugno al 5 luglio / Secretariat Con il contributo di / With the financial support of: open June 28th - July 5th -from 9 am to 6 pm Comune di Bologna - Settore Cultura e Rapporti con l'Università •Cinema Lumière - Via Azzo Gardino, 65 - tel. 051 219 53 11 Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna •Cinema Arlecchino - Via Lame, 57 - tel. 051 52 21 75 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema Modalità di traduzione / Translation services: Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Cultura Tutti i film delle serate in Piazza Maggiore e le proiezioni presso il Programma MEDIA+ dell’Unione Europea Cinema Arlecchino hanno sottotitoli elettronici in italiano e inglese Tutte le proiezioni e gli incontri presso il Cinema Lumière sono tradot- Con la collaborazione di / In association with: ti in simultanea in italiano e inglese Fondazione Teatro Comunale di Bologna All evening screenings in Piazza Maggiore, as well as screenings at the L’Immagine Ritrovata Cinema Arlecchino, will be translated into Italian -

«UOMO+VALLATA+MONTAGNA» (+ Pecora Brentegana)
Comune di Brentonico Assessorato alla Cultura COMUNICATO STAMPA «UOMO+VALLATA+MONTAGNA» (+ Pecora Brentegana) Brentonico, 3 - 8 novembre 2015 «UOMO+VALLATA+MONTAGNA» è il titolo di una poesia composta da Umberto Boccioni sul Monte Altissimo di Monte Baldo a fine ottobre del 1915. L’autore evoca, con fiammante linguaggio ‘parolibero’ e figurazioni pittorico fotografiche, il territorio circostante, “come lo vede/percepisce/prova/sente in direzione-proiezione di parti ed organi del suo corpo”. E' stato scelto il titolo di questa mirabile lirica per una serie di eventi che vivranno a Brentonico dal 3 al 8 novembre 2015, eventi favoriti e realizzati in prevalenza da artisti, gruppi e associazioni di Brentonico. Il programma dell'iniziativa è stato illustrato oggi a Trento nell'ambito della piattaforma di comunicazione “Cultura Informa” dal sindaco di Brentonico, Christian Perenzoni e dagli assessori comunali alla Cultura, Quinto Canali, e all'Agricoltura e Turismo, Moreno Togni. Lo spunto storico è rilevante e fascinoso: il centenario della presenza sul Monte Baldo (Monte Altissimo e Dosso Casina) del “Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti” , una formazione di combattenti inviati sulla prima linea del baldense al fianco degli Alpini del “Verona”. Tra questi vi erano i “futuristi”, cioè gli esponenti di quel movimento che sovvertì vigorosamente la cultura e le arti italiane ed europee del XX secolo: Filippo Tommaso Marinetti , Umberto Boccioni , Luigi Russolo , Mario Sironi , Ugo Piatti , Anselmo Bucci , Achille Funi , Carlo Erba , Antonio Sant’Elia e tanti altri. Nel segno della creatività libera e dell’inventiva sperimentale - tratto ineluttabile dello spirito e dell’arte futurista - si è tracciato il programma di questa manifestazione che toccherà pratiche e attività musicali, pittoriche, teatrali, sportive, ricreative, storiche, documentaristiche, escursionistiche, laboratoriali, bibliografiche ed espositive. -

Marisa Mori, Le Futuriste E Il Volo
Nonostante la componente misogina di un mo- vimento che già nel manifesto di esordio del 1909 dichiarava di voler glorificare il «disprezzo della donna» e di voler «combattere contro […] il femminismo», il drappello delle artiste che aderirono al Futurismo fu assai nutrito e si infittì man mano con il passare degli anni coprendo capillarmente, con la sua presenza, l’intero ter- ritorio nazionale. Al di là di queste asserzioni provocatorie, più che altro eredi di una cultura patriarcale che collocava la figura femmine in Chiara Toti una sfera sentimental-romantica, a cui si oppo- neva, di contro, l’esaltazione della violenza e della guerra, le donne del Futurismo rimasero Marisa Mori, le futuriste e il volo infatti attratte da altre prerogative del movimen- to: così il vitalismo e l’impulso al rinnovamento fotografie archivio privato, Firenze propugnati da Marinetti vennero letti come un’opportunità di riscatto della condizione fem- Chiara Toti ha incentrato i suoi studi sull’arte della prima metà del Novecento, con minile, uno slancio verso l’emancipazione e la li- particolare attenzione al collezionismo e alle tematiche al femminile. Ha curato numerose bertà. Da parte sua Marinetti intravide presto mostre, il catalogo generale di Primo Conti e l’inventario dell’archivio cartaceo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Si è occupata di didattica dell’arte, prima presso il Polo l’enorme potenziale rappresentato dalle futuri- Museale fiorentino, poi presso la Fondazione Ragghianti con la quale collabora dal 2008. ste nella crescita e nella diffusione del movi- mento, mostrandosi dunque sempre più dispo- nibile ad accoglierle e a lodarne il lavoro. -

Downloaded 2021-09-26T23:35:06Z
Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title "The Futurist Mountains": F.T. Marinetti's experiences of mountain combat in the First World War Authors(s) Daly, Selena Publication date 2013-06-24 Publication information Modern Italy, 18 (4): 323-338 Publisher Routledge (Taylor & Francis) Item record/more information http://hdl.handle.net/10197/4507 Publisher's statement This is an electronic version of an article published in Modern Italy. Modern Italy is available online at: www.tandfonline.com//doi/abs/10.1080/13532944.2013.806289 Publisher's version (DOI) 10.1080/13532944.2013.806289 Downloaded 2021-09-26T23:35:06Z The UCD community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters! (@ucd_oa) © Some rights reserved. For more information, please see the item record link above. ‘TheFuturistmountains’:FilippoTommasoMarinetti’sexperiencesof mountaincombatintheFirstWorldWar SelenaDaly 1VCMJTIFEJO.PEFSO*UBMZ +VOF Filippo Tommaso Marinetti’s first experience of active combat was as a member of the Lombard Battalion of Volunteer Cyclists and Motorists in the autumn of 1915, when he fought in the mountains of Trentino at the border of Italy and Austria Hungary. This article examines his experience of mountain combat and how he communicated aspects of it both to specialist, Futurist audiences and to the general public and soldiers, through newspaper articles, manifestos, ‘words in freedom’ drawings, speeches and essays written between 1915 and 1917. Marinetti’s aim in all of these wartime writings was to gain maximum support for the Futurist movement. -

The Croaker: Design and Evaluation of a New Multimodal Interface
THE CROAKER: DESIGN AND EVALUATION OF A NEW MULTIMODAL INTERFACE Stefania Serafin Amalia De Gotzen Medialogy University of Verona Aalborg University Copenhagen Dept. of Computer Science Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, DK [email protected] [email protected] ABSTRACT • Screeches, creaks, rustles, buzzes, crackles and scrapes. In this paper we introduce the Croaker, a novel input de- • Noise made by percussion on metal, wood, skin, vice inspired by Russolo’s Intonarumori. We describe the stone, etc. motivations behind the design of this instrument, and its • Voices of animal and man: shouts, screams, groans, applications in human computer interaction (HCI) and mu- shrieks, howls, laughs, wheezes and sobs. sic. In this paper we introduce the Croaker, a new interface 1. INTRODUCTION shown in Figure 6 inspired by Russolo’s Intonarumori. Section 2 describes the different instruments belonging to Real-time gestural control of computer generated sounds the original Intonarumori family, Section 3 describes the has become in the past years a common trend in the com- Croaker, Section 4 describes the sound synthesis engine puter music community. A conference dedicated to this connected to the Croaker, Section 5 shows the Max/MSP topic, called NIME (which stands for New Interfaces for implementation and Section 6 presents conclusions and Musical Expression) has been created in 2001, and several future work. new input devices have been designed [14, 6]. Such devices can be classified as 1) instrument-like 2. RUSSOLO’S INTONARUMORI controllers, which try to emulate the control interfaces of existing acoustical instruments; 2) instrument-inspired Figure 1 shows Luigi Russolo and his colleague Ugo Pi- controllers, which follow characteristics of existing in- atti playing the original Intonarumori at around 1913.