Souchinda SANGKHAVONGS PRAVONG
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
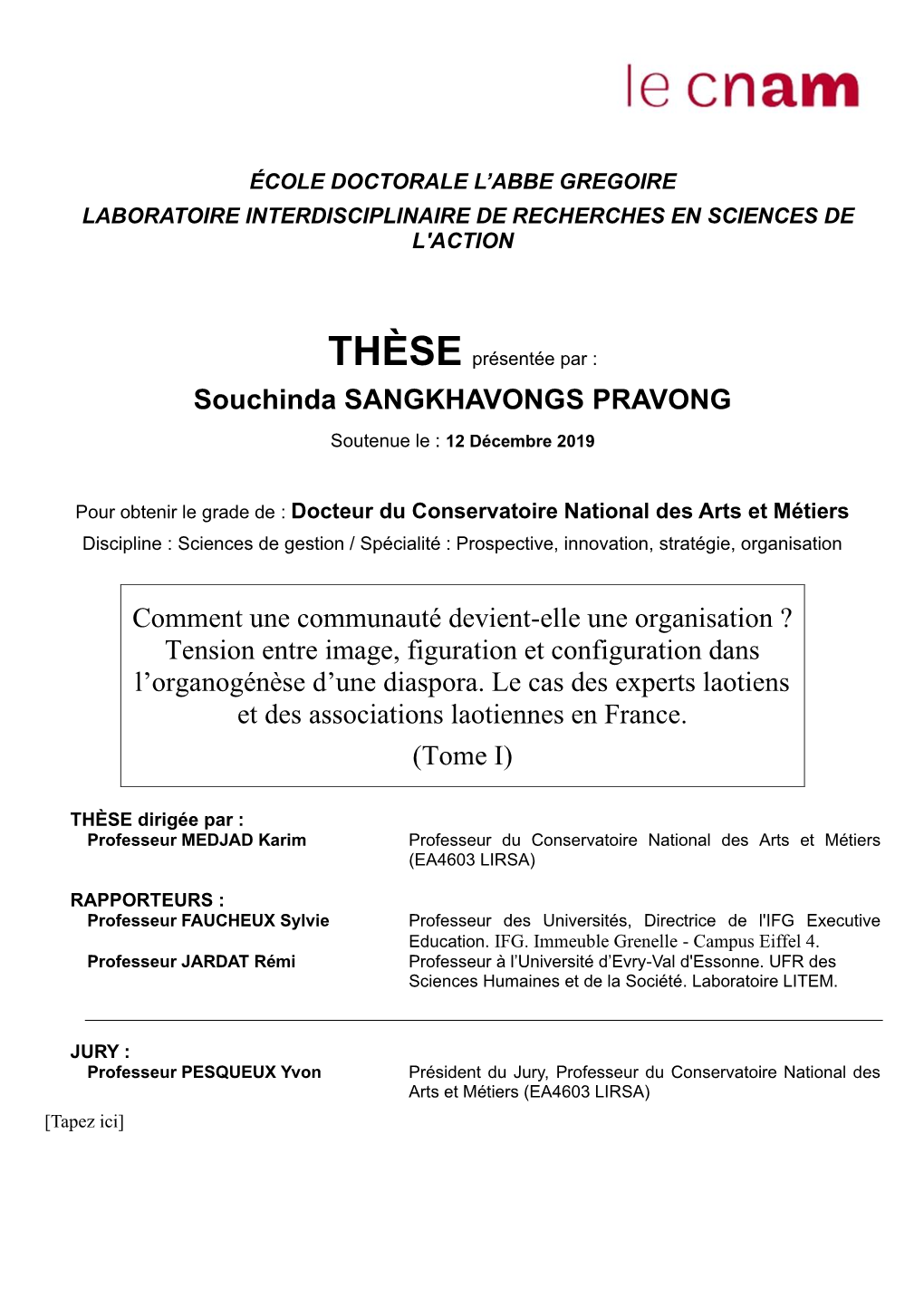
Load more
Recommended publications
-

Echoes from the Sacred Mounts: the Challenge of Female Tutelary Spirits in Luang Prabang
Echoes from the Sacred Mounts: The Challenge of Female Tutelary Spirits in Luang Prabang Thararat Chareonsonthichai Abstract—Many studies on Lao rituals focus on symbolic legitimation of the authority of the king and are written from the perspective of royalty and state leaders. This focus emphasizes the changes and reinvention of traditions in socialist Laos, with the absence of the king. By contrast, this paper, drawing on the ritual life of Luang Prabang in popular culture, or non-official context, examines Nang Kwang Hi, the legendary queen who became the great tutelary spirit of Luang Prabang, whose popularity and significance has not yet been investigated by scholarly work on Lao rituals and spirit cults. The paper argues that only by including female spirits in our analytical framework can we understand how Lao spirits are gendered, and how female gendering is significant in the study of Lao tutelary spirits. The paper also demonstrates how the traditional political and social structure of “Muang Luang Prabang”, as embodied in the female tutelary spirit cults, has persisted in contemporary Laos. Introduction This article examines the potency of female tutelary spirits in Luang Prabang, the former Lao capital. Many studies on Lao rituals focus on the perspectives and roles of royalty and political authorities, emphasizing the legitimating aspects of rituals. Such studies investigate the spirits associated with the establishment of the royal line or the mandala structure (e.g., Archaimbault 1973; Aijmer 1979; Holt 2009). In contrast, this research draws on the memories and experiences of the original townsfolk who are the main preservers and custodians of Luang Prabang traditions, especially women, who form the majority of participants in both Buddhist rituals and those relating to the spirits. -

JSS 098 0K Reviews
239 REVIEWS of the overflow has already appeared in a special issue of South East Asia Research in 2009. Rachel V. Harrison and Peter A. Jackson, Much of the weight of the first task, editors, The Ambiguous Allure of the tracing the encounter with the farang, West: Traces of the Colonial in Thailand. falls on Pattana Kitiarsa. He takes Hong Kong: Hong Kong University Edward Said’s famous proposition Press and Cornell University Southeast that the West constructed the Oriental Asia Program, 2010, xxiii + 268 pages. to suit Western purposes, and flips Hardbound: ISBN 978-962-209-121-4; it over as Occidentalism, the Thai paperbound: ISBN 978-962-209-123-8 construction of “the West” to suit Thai purposes. In mid Ayutthaya, the This ambitious book with its aptly Siamese elite found farang useful as alliterative title has at least a trio of craftsmen and engineers, but boorish agendas. First, to examine “the Thai as missionaries. In late Ayutthaya, encounter with the farang, and all that the farang disappeared and were not it constitutes,” especially over the last missed. But from the second quarter of century and a half. Second, to bring the nineteenth century, they could not Thailand into postcolonial theory which be avoided. The elite then selectively is enjoying great popularity in cultural adopted things and techniques from the studies syllabi in Western universities. farang, both in order to fend them off, And third, in order to enable the second and in order to present themselves as objective, to dispose of the mantra of more modern and thus more special than Siam/Thailand “never being colonized” the rest of the population. -

Environmental Assessment & Management Plan
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized E1050 v3 rev m Theun 2 Hydroelectric Project Na & Management Plan Environmental Assessment March 2005 annexes List of Annexes List of Annexes Annex A: References ........................................................................................A1-6 Annex B: Contributors to the EAMP ....................................................................B1-2 Annex C: Project Key Technical Data ..................................................................C1-4 Annex D: Technical Drawings of Project Infrastructure ......................................D1-18 Annex E: Hydrological Data ............................................................................. E1-10 Annex F: Simulated Dam Operations ................................................................ F1-10 Annex G: Water Quality Modelling Assumptions and Results ................................G1-4 Annex H: Forest & Vegetation Types ..................................................................H1-4 Annex I: Mammal & Bird Species of the NNT Area .............................................I1-20 Annex J: Fish Species & Migration ..................................................................... J1-8 Annex K: Head Construction Contractor’s Environmental Requirements .............. K1-18 Annex L: Pest Management Plan ..................................................................... L1-18 Annex M: Public Consultation and Disclosure Events ......................................... -

Highlights Highlights
© Lonely Planet Publications 343 L a o s HIGHLIGHTS Luang Prabang – enchanted mystical city of treasured wats, French cuisine and Indochinese villas overlooking the Mekong River ( p368 ) Luang Nam Tha and Muang Sing – taking eco-conscious treks into the feral jungle of Nam Ha National Protected Area and ethnic Akha villages ( p385 , p387 ) Si Phan Don – a lazy maze of shady islands and rocky islets, home to the rare Irrawaddy dolphin ( p400 ) Wat Phu Champasak – Khmer-era ruins perfectly placed beneath a mountain facing the peaceful riverside village of Champasak ( p399 ) Bolaven Plateau – home to the best coffee in Laos and dotted with ice-cold waterfalls to relieve the heat of the south ( p398) Off the beaten track – visiting Vieng Xai caves, the remote and forbidding home of Pathet Lao revolutionaries and the prison of the last king of Laos ( p382 ) FAST FACTS ATMs two in Vientiane, one in Luang Prabang, Vang Vieng and Pakse, all with international facilities Budget US$15 to US$20 a day Capital Vientiane Costs city guesthouse US$4-10, four-hour bus ride US$1.50, Beer Lao US$0.80 Country code %856 Languages Lao, ethnic dialects Money US$1 = 9627 kip Phrases sábąai-dii (hello), sábąai-dii (good- bye), khàwp jąi (thank you) Population 6.5 million Time GMT + seven hours Visas Thirty-day tourist visas are available arrival in Vientiane, Luang Prabang and in advance in Thailand, China, Vietnam or Pakse international airports, and when Cambodia. On-the-spot 30-day visas are crossing the border from Thailand, China available for US$30 with two photos on and Vietnam. -

I Documenting Hmong and Lao Refugee
Documenting Hmong and Lao Refugee Resettlement: A Tale of Two Contrasting Communities A PROJECT SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Saengmany Ratsabout IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF LIBERAL STUDIES May 2015 i © Saengmany Ratsabout, 2015 ii DEDICATION To my parents, Nouthong and Thonglor, thank you for your sacrifices and hard work in providing us with opportunities. Words cannot express the gratitude. To my wife, Gao Sheng, whose patience, motivation and loving support made this journey worthwhile. Thank you for being my best friend. To my children, Maekalah and Zakarin, you energy and unconditional love inspires me to do better. For you I continue to document the stories and experiences of those who came before us, and to help build a better world. iii CONTENTS List of Tables……………………………….………………………….v List of Illustrations………………………………………………..…..vi List of Tables……………………………………………………….…vi Introduction.………………………...……….........................................1 Chapter 1: Refugee Resettlement Policies……………………………..3 Chapter 2: Experiences of Hmong and Lao in Minnesota……………16 Chapter 3: Number Matters……...………………………………........38 Conclusions…………………………………………………….……..46 Appendix A……………………………………………..…………….49 Appendix B……………………………………………..…………….50 Work Cited………...………………………………………..………...51 iv TABLES Table 1 – Summary of major pieces of legislation focused on United States…………….4 immigration and refugee policies from 1948-1980 Table 2 – Arrival of Refugees from Southeast -

Grant Evans, the Last Century of Lao Royalty
272 REVIEWS Grant Evans, The Last Century of So, first to the book. To begin with, Lao Royalty: A Documentary History. there is an intriguing ambiguity in the Chiang Mai: Silkworm Books, 2009. title that is carried through into the 443 pp. 523 photos. Hardbound: ISBN content. The ‘last century’ of Lao royalty 978-974-9511-66-4 has at least three possible meanings. Since the Lao monarchy came to an end This large, beautifully produced and in 1975 when King Sisavang Vatthana lavishly illustrated book brings to life abdicated, and this volume purports to the all-but-forgotten Lao monarchy be ‘a documentary history’, the most through more than 500 photographs obvious reading would be that the ‘last and dozens of descriptions, reports, century’ refers to the period from 1875 letters and interviews with surviving to 1975. Since the book begins with members of the former royal family. the return in 1888 of King Ounkham to The photographs have been assiduously Luang Phrabang after it had been sacked collected over several years, and many the previous year by Tai and Chinese of the documents have been translated bandits, the ‘last’ century would actually from French and Lao by their compiler. cover just a ‘short’ century from 1888 To set the context for the photographs to 1975. Or the last century could refer and documents, Grant Evans provides to Lao royalty during the twentieth a longish introduction. Apart from its century, which is what it is mostly about. value to historians and anyone interested Or the last century could date from the in the history of Laos, the book should book’s publication, extended to cover appeal immensely to the worldwide Lao the ‘long’ century from 1888 to the diaspora, nostalgic for the kingdom they present. -

Copyrighted Material
INDEX See also Accommodations and Restaurant indexes, below. GENERAL INDEX Asian Adventures, 48 Blue 7 Massage (Phnom ATMs (automated-teller Penh), 85 machines), Laos, 202 Boat travel ARP, 43, 204 A Cambodia, 35, 37 Accommodations. See also Laos, 199, 200 Accommodations Index akeng Hill (Angkor), 114 Phnom Penh, 60–61 best, 4, 6 B Bamboo Train (Battambang), Sangker River (Battam- AIDS, 41 143 bang), 144 Airport (Sihanoukville), 164 Banlung, 148 Siem Reap, 94 Air travel Ban Phanom Weaving Sihanoukville, 162 Cambodia, 33, 35 Village, 280 Body Tune Spa (Siem Reap), Laos, 196, 198 Banteay Kdei (Angkor), 121 125 All Lao Services (Luang Banteay Srei, 121–122 Bokor Mountain, 172 Prabang), 258 Baphuon (Angkor), 118 Bokor Palace Casino and All Lao Travel Service (Luang Battambang, 3, 133–145 Resort (Kampot), 172–173 Prabang), 282 accommodations, 138–140 The Bolaven Plateau, 319–320 Ambre (Phnom Penh), 87 arriving in, 133–134 Bonkors (Kampot), 172 American Express, 91, 239 ATMs, 137 Bonn Chroat Preah Nongkoal Amret Spa (Phnom Penh), 85 attractions, 142–144 (Royal Plowing Angkor Balloon, 119 banks and currency Ceremony), 30 Angkor National Museum exchange, 137 Bonn Pchum Ben (Siem Reap), 124 business hours, 137 (Cambodia), 31 Angkor Night Market, 128 doctors and hospitals, 137 Books, recommended Angkor Thom, 116 food stalls, 142 Cambodia, 25 Angkor Village (Siem Reap), getting around, 136–137 Laos, 189 12, 93, 131 Internet access, 137 Boom-Boom Records dance performances, 129 nightlife, 144–145 (Sihanoukville), 163 guidelines for visiting, 113 post office, 137 Boom Boom Room (Phnom sunrises and sunsets, 119 restaurants, 140–142 Penh), 87–88 temple complex, 112–121 shopping, 144 Bopha Penh Titanic Restau- Angkor Wat, 7, 93, 113–114. -

Religion in Laos Animism Is the Term Used to Categorize the Plethora of Population 6.6 Million Localized Indigenous Religions Throughout the World
January 1 released from the body. Buddha also understood the New Year’s Day constant motion of the universe and that everything in LAOS March 8 it is subject to birth and decay. This motion is part of International Women’s Day the Dharma, the laws of nature. One of these laws is of April 14-16 cause and consequence, or karma, which implies that Pi Mai (Lao New Year) all actions have a corresponding effect. In essence, the May 1 force generated by a person’s actions is a determining Labor Day factor in the nature of his/her next life. Buddhism June 1 emphasizes five regimens: striving not to kill, not to Children’s Day steal, not to engage in sexual misconduct, not to speak falsehoods, and not to use drugs. Buddhist holidays August 13 Lao Issara (Day of the Free Laos) include Bodhi Day (December 8), which celebrates the enlightenment of Buddha under the Bodhi tree; October 12 Day of Liberation Buddha Day (April 8), which commemorates the birth of Gautama in Lumbini Garden; and Wesak (April/May), December 2 Lao National Day the holiest of Buddhist holy days, which celebrates Buddha’s birth, enlightenment, and death. Religion in Laos Animism is the term used to categorize the plethora of Population 6.6 million localized indigenous religions throughout the world. About 70 percent of all Laotians are Buddhists. Another Animists live in a world dominated by a complex Capital City Vientiane 1.5 percent believe in Christianity. The rest of the interplay of spiritual powers—those of the creator or Official Language Lao (or Laotian) population practices “unspecified” religions. -

The Special Guerrilla Units (SGU) Service History
The Special Guerrilla Units (SGU) Service History Presented by the Special Guerrilla Units Veterans and Families of USA, Inc. Enclosed is a brief background of information on the establishment of our SGU and Families of USA, Inc. We, the members of this non-profit organization, are military veterans who provided arm-services to the United States of America during the Cold War era in Southeast Asia. We served and fought on behalf of the United States inside Laos. We are proud to present you this synopsis of how the SGU was created by the United States’ CIA to participate in the Secret War inside Laos, as part of the Vietnam War. Map of Laos. The red arrows and circles represent the territory occupied by SGU forces where the red line running south is the Ho Chi Minh Trail. 2 I NTRODUCT I ON After WWII, China closed its doors to foreigners and built an alliance with Communist Russia. The two super power countries attempted to conquer Asia and Southeast Asia. Meanwhile the Westerners were preparing to return home in peace and give independence to the French-Indo China countries as the North Vietnamese Vietminh defeated the French at Dien Bien Phu in 1954. Subsequently, Laos was newly established as an independent and neutral state by the 1954 Geneva Accord. To protect United States’ principal interests in Asia, President Dwight D. Eisenhower sent the CIA to look for friendly allies and began to send troops into South Vietnam, including the United States Air Force and Navy to the South China Sea in the late 1950s. -
Evans, Grant. the Last Century of Lao Royalty: a Documentary History
Evans, Grant. The Last Century of Lao Royalty: A Documentary History. Chiang Mai: Silkworm Books, 2009. pp. 430+xv. [This review first appeared in the Aséanie vol. 23 (Juin 2009): 226-228; it has been reprinted here with their permission.] Reviewed by Justin McDaniel Associate Professor of Religious Studies, University of Pennsylvania Ever since having a chance to sit and talk with Grant Evans in 2005 in Vientiane, I have eagerly anticipated this book. This major “documentary history” of the last century of Lao Royalty has been in development for many years. It has been well-worth the wait; however, it is not what I expected. Thinking I would be reading a straightforward political history of the Lao Royal family in the late nineteenth and twentieth centuries, I approached this book for its information. I planned to read it, in Heidegger’s terms, as a “document,” not a piece that would “work” on me (i.e. spurn thought, rethink assumptions, etc.) . I was wrong. This is a provocative, often non-linear, even emotionally moving study of not just the politics, but the rituals, “symbolics,” and internal conflicts of the Lao Royal family. Furthermore, it is not just told through descriptive prose, but through hundreds of photographs, translations of interviews, rare documents, memoirs, portraits, case studies, and even political cartoons. As the author states in the introduction, this is a “recovery of memory,”(3) and he states that “more formal histories of Lao royalty are hopefully in the process of being written by others. Although I have written a short history of Laos, my interests are fundamentally anthropological.”(4) This anthropological approach to history writing is illuminating, because it takes individual voices (memoirs, interviews, rumors, family photographs) and their emotional content seriously. -
A Short History of Laos, the Land in Between
Laos—PAGES 12/4/02 2:10 PM Page i Laos—PAGES 12/4/02 2:10 PM Page ii Short History of Asia Series Series Editor: Milton Osborne Milton Osborne has had an association with the Asian region for over 40 years as an academic, public servant and independent writer. He is the author of eight books on Asian topics, including Southeast Asia: An introductory history, first published in 1979 and now in its eighth edition, and, most recently, The Mekong: Turbulent past, uncertain future, published in 2000. Laos—PAGES 12/4/02 2:10 PM Page iii Laos—PAGES 12/4/02 2:10 PM Page iv First published in 2002 Copyright © Grant Evans 2002 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. The Australian Copyright Act 1968 (the Act) allows a maximum of one chapter or 10 per cent of this book, whichever is the greater, to be photocopied by any educational institution for its educational purposes provided that the educational institution (or body that administers it) has given a remuneration notice to Copyright Agency Limited (CAL) under the Act. Allen & Unwin 83 Alexander Street Crows Nest NSW 2065 Australia Phone: (61 2) 8425 0100 Fax: (61 2) 9906 2218 Email: [email protected] Web: www.allenandunwin.com National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry: Evans, Grant, 1948– . A short history of Laos : the land in between. -
Tourism and Heritage Site Management
5NITED.ATIONS%DUCATIONAL SCIENTIFICAND#ULTURAL/RGANIZATION5.%3#/ 0ACIFIC!SIA4RAVEL!SSOCIATION0!4! 3CHOOLOF4RAVEL)NDUSTRY-ANAGEMENT 5NIVERSITYOF(AWAI@I 4HE2OYAL.ETHERLANDS%MBASSYTO4HAILAND ,AO0$2 #AMBODIA AND -YANMARIN"ANGKOK 4HAI!IRWAYS)NTERNATIONAL .ORWEGIAN!GENCYFOR$EVELOPMENT#O OPERATION 4HE.ATIONAL4OURISM!UTHORITYOF,AO0$2 4HE$EPARTMENTOF)NFORMATIONAND#ULTUREOF,UANG0RABANG ,AO0$2 ,A-AISONDU0ATRIMOINE ,UANG0RABANG ,AO0$2 .ETHERLANDS$EVELOPMENT/RGANIZATION3.6 (ISTORICAL2ESOURCES)NTERN0ROGRAM 5NIVERSITYOF#ALGARY #ANADA The effects of tourism on culture and the environment in Asia and the Pacific iii IMPACT: The Effects of Tourism on Culture and the Environment in Asia and the Pacific: Tourism and Heritage Site Management in Luang Prabang, Lao PDR. UNESCO, Bangkok, 2004. x + 130 p. 1. Cultural tourism. 2. Cultural heritage. 3.Tourism Management. 4. Community development 5. Environmental conservation. 6. Heritage conservation. 7. Luang Prabang, Lao PDR. 8. Sustainable development. 915.9404 ISBN 92-9223-033-6 Published jointly by: Office of the Regional Advisor for Culture in Asia and the Pacific, UNESCO Bangkok and School of Travel Industry Management University of Hawai‘i, USA. Printed in Thailand © UNESCO 2004 All rights reserved. No part of this publication may be copied, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise, except brief extracts for the purpose of review, and no part of this publication, including photographs and drawings, may be sold without the written permission of the publisher. The designations employed and the presentation of material throughout the publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning its frontiers or boundaries.