MEMOIRE Master 2 SOCIOLOGIE SOLEMAN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
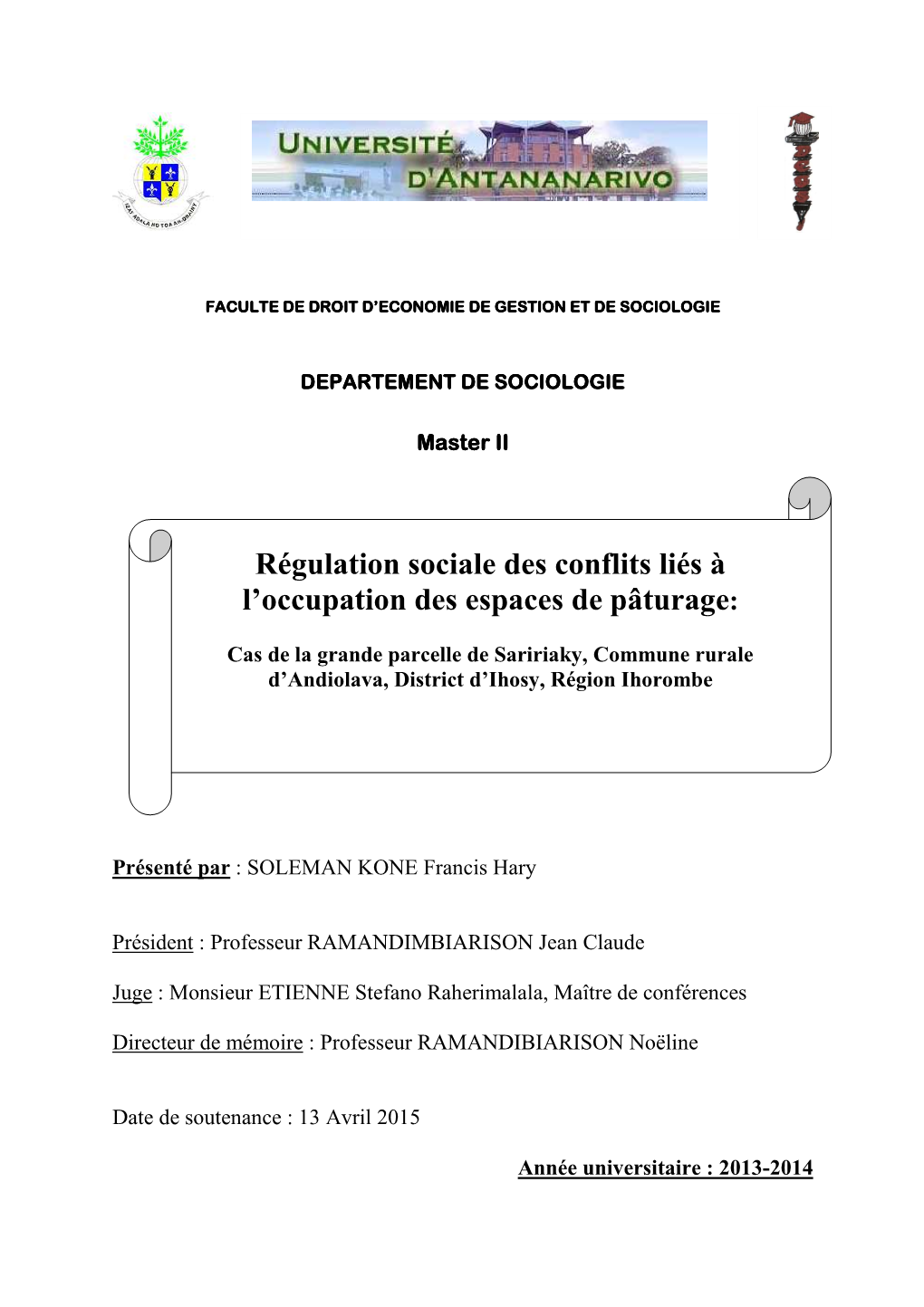
Load more
Recommended publications
-

V2 Ss Photos MDG Cell Veille Acridienne Bull N°2 2013 04 20
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR N°2 - 20 avril 2013 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation écométéorologique : page 1 Situation acridienne : page 1 Situation agro-socio-économique : page 3 Synthèse : page 4 SITUATION ECOMÉTÉOROLOGIQUE Carte de situation acridienne au 20 avril 2013 Depuis le mois de mars 2013, l’aire grégarigène s'assèche pro- gressivement. La pluviométrie enregistrée est déficitaire à hy- per-déficitaire comparée à la Plage Optimale Pluviométrique du Criquet migrateur malgache. Ce phénomène marque le début de la saison sèche dans l’aire grégarigène. Quant à la végétation, la strate herbeuse a atteint son maxi- mum de développement et la fructification des Graminées, notamment Heteropogon contortus, est en cours. Partout, le verdissement reste de l'ordre de 70 à 80 %. La hauteur moyenne de la strate herbeuse varie de 60 à 120 cm. Sur l’Horombe, le recouvrement est de 40 à 80% selon les sta- tions, pour une hauteur moyenne variant de 40 à 80 cm. SITUATION ACRIDIENNE AIRE GRÉGARIGÈNE A la fin du mois de mars 2013, des essaims ont commencé à envahir plusieurs régions de l'Aire Grégarigène Transitoire (AGT), de l'Aire de Multiplication Initiale (AMI) et de l'Aire Transitoire de Multiplication (ATM), notamment le comparti- ment nord-ouest : Ankazoabo, Manja, Befandriana-Sud, An- diolava... Parallèlement, des nouvelles bandes larvaires sont en place à Manja, sur la pénéplaine de Bekily – Fotadrevo, sur les plateaux de Belomotra et Mahafaly. Le niveau de danger varie selon les régions. Cependant, le dessèchement du tapis végétal commence, amplifiant les phénomènes de densation. Page 1 Bulletin n°2 - 20 avril 2013 AIRE GRÉGARIGÈNE 1. -

RAKOTOMANOELINA Rivo P Poly N° 1674
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT GEOLOGIE Ecole Supérieure Université d’Antananarivo Polytechnique AVANA Resources Sarl ********************** MEMOIRE DE FIN D’ETU DES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME D’INGENIEUR GEOLOGUE ««« Exploration d’uranium dans les secteurs d’irina et satrokalasatrokala,,,, district d’Ihosy, région IhorombeIhorombe»»»» Présenté par : Rakotomanoelina Rivo Soutenu publiquement le 11 Août 2009 devant la commission du jury composé de: Président : Monsieur RAKOTONDRAOMPIANA Solofo Examinateurs : Monsieur ANDRIANAIVO Lala Monsieur MANDIMBIHARISON Aurélien Jacques Monsieur RANDRIAMIHARIVELO Philibert Daniel Rapporteurs : Monsieur RAZAKAMANANA Théodore Monsieur RASAMIMANANA Georges Remerciements Avant tout, je rends grâce à Dieu qui a donné santé, courage et persévérance durant mes cinq années d’études, dont l’aboutissement est le présent travail de mémoire. Aussi, ce mémoire n’aurait pu être réalisé sans l’aide de la société AVANA RESOURCES, ainsi je tiens à présenter mes remerciements et mes reconnaissances envers la Société et ses dirigeants à Madagascar. Ces reconnaissances sont exprimées en la personne de : Madame BOARLAZA RAFIDINARIVO Lydia, directeur général de l’AVANA RESOURCES pour avoir autorisé ce sujet. Je remercie également le Général RABOTOARISON Charles Sylvain, superviseur sénior de l’AVANA RESOURCES de signer l’acceptation de l’emploi des données pour la réalisation de cet ouvrage et Mr UNDERWOOD Dave, géologue sénior, pour ces apports en matière de géologie de l’exploration durant la descente sur terrain. Je tiens à remercier les membres de jury qui ont accepté de juger ce travail et toutes les personnes qui m’ont aidé à le réaliser : Professeur RAMANANTSIZEHENA Pascal, Directeur de l’ESPA, à qui revient le bon fonctionnement de l’Ecole ; Professeur RAKOTONDRAOMPIANA Solofo, Chef de département de la filière Géologie à l’ESPA qui, par sa faculté d’organisation et de collaboration avec les enseignants, assurait la présidence de jury du présent mémoire. -

New Species and Varieties in Sesbania (Leguminosae-Papilionoideae-Robinieae) from Madagascar and the Comoro Islands
New species and varieties in Sesbania (Leguminosae-Papilionoideae-Robinieae) from Madagascar and the Comoro Islands Jean-Noël LABAT Laboratoire de Phanérogamie, Muséum national d'Histoire naturelle, 16 rue Buffon, 75005 Paris, France. [email protected] David J. DU PUY Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AB, England. [email protected] ABSTRACT KEYWORDS Morphological characters support the description of a new species and a new ^Leguminosae, variety of Sesbania Adans. from Madagascar and the Comoro Islands: Papi ìoncu^eae, Sesbania madagascariensis Du Puy & Labat and S. bispinosa var. grandiflora Madagascar. Du Puy & Labat. RESUME MOTS CLÉS L'étude des caractères morphologiques permet la description d'une nouvelle Leguminosae, espèce et d'une nouvelle variété de Sesbania de Madagascar et de l'Archipel Papilionoideae, Sesbania, des Comores : Sesbania madagascariensis Du Puy & Labat et 5. bispinosa var. Madagascar. grandiflora Du Puy & Labat. ADANSONIA, sér. 3 • 1997 • 19(1) 93 LabatJ.-N. & Du Puy D.J. Of the 21 genera recognised in the tribe pale brown, the seed chambers 5-6 mm long. Robinieae (Benth.) Hutch. (POLHILL & SOUSA Seeds ca. 3 x 2 X 2 mm, brown. 1981), only Sesbania is native to Madagascar. It is a genus of about 55 species, distributed throu S. bispinosa is widespread in Madagascar, parti ghout the tropics and subtropics, often occurring cularly in western Madagascar and the lower alti in seasonally damp or marshy habitats. The tudes of the Central Plateaux. The type variety genus is represented in Madagascar by 3 native also has a widespread distribution including the species, including 1 endemic species described Comoro Islands, the Mascarenes, E & S Africa, here. -
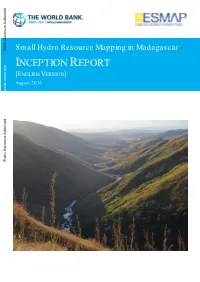
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Gingembre, Mathilde.Pdf
A University of Sussex PhD thesis Available online via Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/ This thesis is protected by copyright which belongs to the author. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Please visit Sussex Research Online for more information and further details BEING HEARD: LOCAL PEOPLE IN NEGOTIATIONS OVER LARGE-SCALE LAND DEALS. A CASE STUDY FROM MADAGASCAR MATHILDE GINGEMBRE A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Sussex for the Degree of Doctor of Philosophy in Development Studies Institute of Development Studies, University of Sussex July 2017 i Mathilde Gingembre-University of Sussex ‘Being heard: local people in negotiations over large-scale land deals. A case study from Madagascar’ SUMMARY This thesis examines local people’s voices and influence in negotiations over large-scale land deals. Drawing on ethnographic work on a case study from southern Madagascar, it highlights the variety of agropastoralists’ responses to, and experienced outcomes of, the implementation of an agribusiness project on their land. The purpose of this research was to understand the conditions under which certain local people get heard, and others silenced, in the context of corporate land access and the processes by which some of these local voices manage to influence the terms and conditions of the deal. -

Mémoire De Fin D'étude
UNIVERSITE D‟ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT : GEOLOGIE MEMOIRE DE FIN D‟ETUDES En vue de l‟obtention du diplôme d‟Ingénieur en Géologie Présenté par RAMAINTY- NOMENNORO Volaarisanta Joséphine Le Mardi 17 Décembre 2013 Promotion 2011 UNIVERSITE D‟ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT : GEOLOGIE MEMOIRE DE FIN D‟ETUDES En vue de l‟obtention du diplôme d‟Ingénieur en Géologie INITIALISATION DU CIRCUIT TOURISTIQUE MINERALIER DE VOATAVO - ZAZAFOTSY DISTRICT D’IHOSY - REGION IHOROMBE Présenté et soutenu par: RAMAINTY- NOMENNORO Volaarisanta Joséphine Le Mardi 17 Décembre 2013 DEVANT LE JURY COMPOSE DE : Président de Jury : M. RAKOTONDRAINIBE Simon Richard Encadreur pédagogique: M. ANDRIATSITOMANARIVOMANJAKA Naina Encadreur technique : M. RAZAFIMAHATRATRA Michel Examinateurs: M. MANDIMBIHARISON Aurélien Jacques M. ANDRIANAIVO Lala Promotion 2011 Remerciements Avant tout, je rends grâce à Dieu Tout Puissant qui m‟a donné la santé, le courage, la force durant mes cinq années d‟études, dont l‟aboutissement est le présent travail de mémoire. Ce mémoire n‟aurait pu être réalisé sans l‟aide de l‟association Cercle des Consultants pour la Promotion de la bonne Gouvernance de l'Exploitation Minière(CCPGEM), ainsi je tiens à présenter mes remerciements et mes reconnaissances envers l‟association et ses dirigeants. Particulièrement à Monsieur Eric Toulorge. Aussi, je tiens à exprimer mes sincères et vifs remerciements ainsi que ma profonde gratitude et reconnaissance envers : Monsieur ANDRIANARY Philippe Antoine, -

Boissiera 71
Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin n° 25 Mars 2016 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale : page 1 Situation éco-météorologique : page 3 Ministère de l’agriculture Situation acridienne : page 6 Situation antiacridienne : page 13 Synthèse : page 17 Annexes : page 19 SITUATION GÉNÉRALE Selon Fews-net, le mois de mars 2016 semble avoir été marqué par une forte pluviosité (supérieure à 150 mm) au nord du 18ème parallèle et une pluviosité moyenne, variant de 50 à 150 mm, au sud. Les relevés du Centre national antiacridien (CNA) indiquaient que la pluviosité était supérieure aux besoins du Criquet migrateur malgache dans l’Aire grégarigène transitoire Est et Centre, l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation du compartiment Nord. Elle était favorable pour son développement dans l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation des compartiments Centre et Sud. Les températures minimales et maximales moyennes restaient toujours favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito dans toute la Grande-Île. Aire grégarigène. Les compartiments Nord et Centre étaient colonisés par des populations groupées du Criquet migrateur malgache. Le compartiment Nord, où des pullulations larvaires, assorties d’une transformation phasaire, ont été observées sur deux principaux foyers (partie orientale du bassin de Manja et région de Befandriana-Sud), était moyennement infesté. Un phénomène similaire était en place dans le compartiment Centre mais, globalement, l’ampleur et l'étendue étaient moindres. Ce mois a été caractérisé par la fin du développement de la R2 du Criquet migrateur malgache et le début de celui de la R3. -

Species Selected by the CITES Plants Committee Following Cop14
PC19 Doc. 12.3 Annex 3 Review of Significant Trade: Species selected by the CITES Plants Committee following CoP14 CITES Project No. S-346 Prepared for the CITES Secretariat by United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre PC19 Doc. 12.3 UNEP World Conservation Monitoring Centre 219 Huntingdon Road Cambridge CB3 0DL United Kingdom Tel: +44 (0) 1223 277314 Fax: +44 (0) 1223 277136 Email: [email protected] Website: www.unep-wcmc.org ABOUT UNEP-WORLD CONSERVATION CITATION MONITORING CENTRE UNEP-WCMC (2010). Review of Significant Trade: The UNEP World Conservation Monitoring Species selected by the CITES Plants Committee Centre (UNEP-WCMC), based in Cambridge, following CoP14. UK, is the specialist biodiversity information and assessment centre of the United Nations Environment Programme (UNEP), run PREPARED FOR cooperatively with WCMC, a UK charity. The CITES Secretariat, Geneva, Switzerland. Centre's mission is to evaluate and highlight the many values of biodiversity and put authoritative biodiversity knowledge at the DISCLAIMER centre of decision-making. Through the analysis The contents of this report do not necessarily and synthesis of global biodiversity knowledge reflect the views or policies of UNEP or the Centre provides authoritative, strategic and contributory organisations. The designations timely information for conventions, countries employed and the presentations do not imply and organisations to use in the development and the expressions of any opinion whatsoever on implementation of their policies and decisions. the part of UNEP or contributory organisations The UNEP-WCMC provides objective and concerning the legal status of any country, scientifically rigorous procedures and services. territory, city or area or its authority, or These include ecosystem assessments, support concerning the delimitation of its frontiers or for the implementation of environmental boundaries. -
Gemstones and Geosciences in Space and Time Digital Maps to the “Chessboard Classification Scheme of Mineral Deposits”
Earth-Science Reviews 127 (2013) 262–299 Contents lists available at ScienceDirect Earth-Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/earscirev Gemstones and geosciences in space and time Digital maps to the “Chessboard classification scheme of mineral deposits” Harald G. Dill a,b,⁎,BertholdWeberc,1 a Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, P.O. Box 510163, D-30631 Hannover, Germany b Institute of Geosciences — Gem-Materials Research and Economic Geology, Johannes-Gutenberg-University, Becherweg 21, D-55099 Mainz, Germany c Bürgermeister-Knorr Str. 8, D-92637 Weiden i.d.OPf., Germany article info abstract Article history: The gemstones, covering the spectrum from jeweler's to showcase quality, have been presented in a tripartite Received 27 April 2012 subdivision, by country, geology and geomorphology realized in 99 digital maps with more than 2600 mineral- Accepted 16 July 2013 ized sites. The various maps were designed based on the “Chessboard classification scheme of mineral deposits” Available online 25 July 2013 proposed by Dill (2010a, 2010b) to reveal the interrelations between gemstone deposits and mineral deposits of other commodities and direct our thoughts to potential new target areas for exploration. A number of 33 categories Keywords: were used for these digital maps: chromium, nickel, titanium, iron, manganese, copper, tin–tungsten, beryllium, Gemstones fl Country lithium, zinc, calcium, boron, uorine, strontium, phosphorus, zirconium, silica, feldspar, feldspathoids, zeolite, Geology amphibole (tiger's eye), olivine, pyroxenoid, garnet, epidote, sillimanite–andalusite, corundum–spinel−diaspore, Geomorphology diamond, vermiculite–pagodite, prehnite, sepiolite, jet, and amber. Besides the political base map (gems Digital maps by country) the mineral deposit is drawn on a geological map, illustrating the main lithologies, stratigraphic Chessboard classification scheme units and tectonic structure to unravel the evolution of primary gemstone deposits in time and space. -

Liste Candidatures Conseillers Ihorombe
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS IAKORA BEGOGO 1 MAJAVAJIRO (Iindépendant Majavajiro) SOJA Renault GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA BEGOGO 1 RASOLOMANDIMBY Martin Miaraka @ Andry Rajoelina) INDEPENDANT HERMAN (INDEPENDANT IAKORA IAKORA 1 RASANJIFERAHASINA Andrianony Simon Herman HERMAN) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA IAKORA 1 RANDRIANANTENAINA Clara Jean Christophe Miaraka @ Andry Rajoelina) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA RANOTSARA NORD 1 MANAMBELO Dolphe Miaraka @ Andry Rajoelina) IAKORA RANOTSARA NORD 1 MMM (Antoko Malagasy Miara-miainga) RAHAJARIMANANA Rivoarisoa Myriame INDEPENDANT ADELAIDE (Independant IAKORA RANOTSARA NORD 1 KAMARA Adelaide Adelaide) INDEPENDANT FERNAND (Independant IAKORA ANDRANOMBAO 1 FERNAND Fernand) IAKORA ANDRANOMBAO 1 MMM (Antoko Malagasy Miara-miainga) TARILY GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA ANDRANOMBAO 1 ROGER Miaraka @ Andry Rajoelina) IAKORA VOLAMBITA 1 INDEPENDANT PAUL (INDEPENDANT PAUL) PAUL GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA VOLAMBITA 1 RAZAFINJAZA Herimanana Miaraka @ Andry Rajoelina) Total IAKORA 12 NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS IHOSY AMBATOLAHY 1 INDEPENDANT RAMOSE ZARA (Ramose Zara) ZARA Farassel GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IHOSY AMBATOLAHY 1 BETA Tsikohony André Miaraka Amin'ny Andry Rajoelina) IHOSY AMBIA 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RAMANANDAFY Dieu Donne GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IHOSY AMBIA 1 FENOHASINA Julien Elie Miaraka Amin'ny -
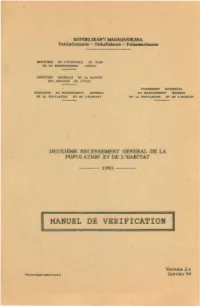
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • .