Description Générale IVS VS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
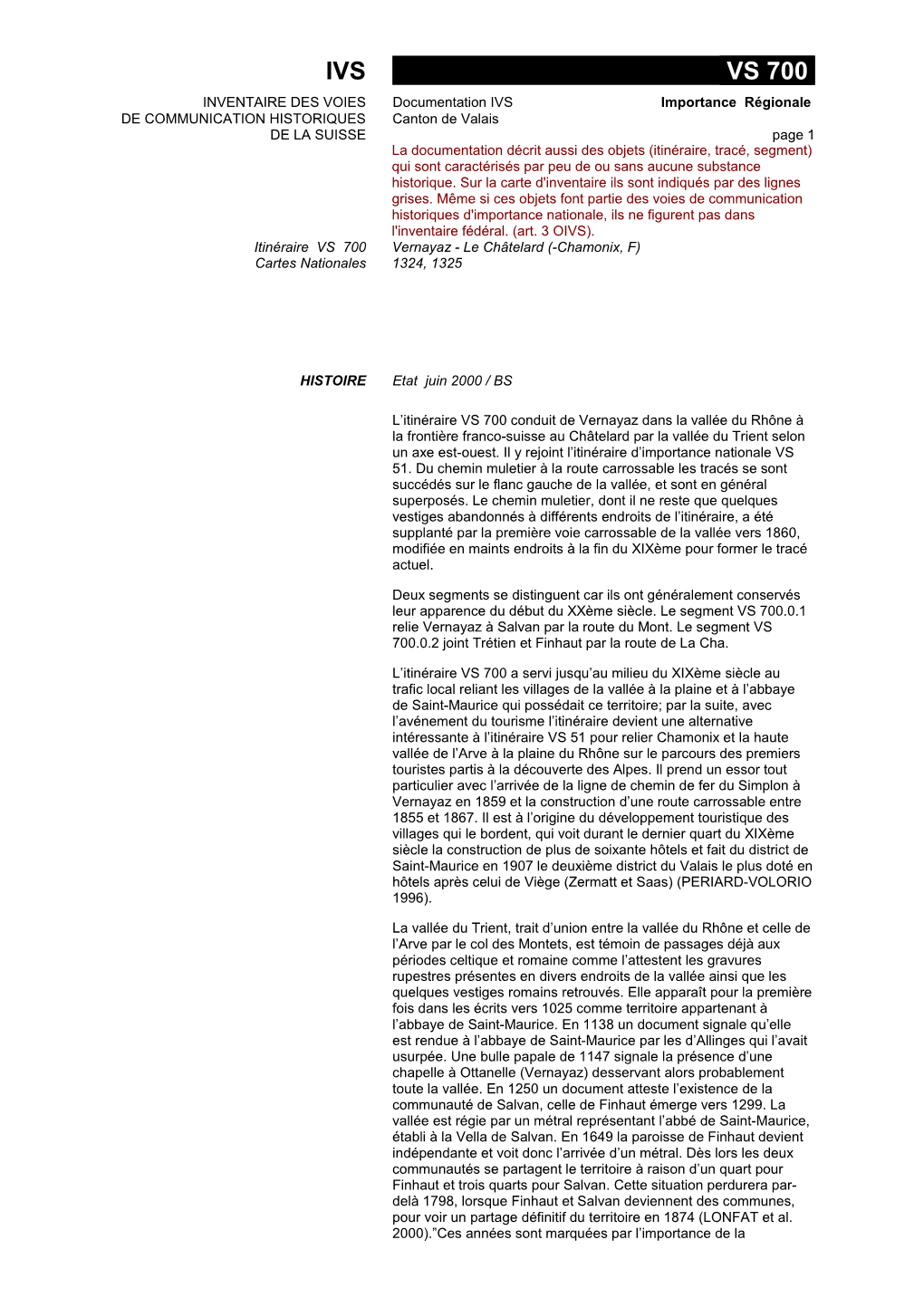
Load more
Recommended publications
-

Raiders of the Lost Ark
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 12 2020 Full Issue Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation (2020) "Full Issue," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 12. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/12 This Full Issue is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. et al.: Full Issue Swiss A1nerican Historical Society REVIEW Volu1ne 56, No. 1 February 2020 Published by BYU ScholarsArchive, 2020 1 Swiss American Historical Society Review, Vol. 56 [2020], No. 1, Art. 12 SAHS REVIEW Volume 56, Number 1 February 2020 C O N T E N T S I. Articles Ernest Brog: Bringing Swiss Cheese to Star Valley, Wyoming . 1 Alexandra Carlile, Adam Callister, and Quinn Galbraith The History of a Cemetery: An Italian Swiss Cultural Essay . 13 Plinio Martini and translated by Richard Hacken Raiders of the Lost Ark . 21 Dwight Page Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace . 41 Alex Winiger Niklaus Leuenberger: Predating Gandhi in 1653? Concerning the Vindication of the Insurgents in the Swiss Peasant War . 64 Hans Leuenberger Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California . 94 Tony Quinn A History of the Swiss in California . 115 Richard Hacken II. Reports Fifty-Sixth SAHS Annual Meeting Reports . -

Routes from the Rhône
Routes from the Rhône Objekttyp: Group Zeitschrift: Swiss express : the Swiss Railways Society journal Band (Jahr): - (2008) Heft 94 PDF erstellt am: 06.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch ROUTES FROM THE RHÔNE Mont Blanc group from Montroc. PHOTOS: Jason Sargeson Founded by the Romans between 41 and 47AD the busy cultural and commercial town of Martigny in Canton Valais lies in the Rhône valley at the point where it is joined by the ancient highway over the Grand St Bernard Pass. Martigny's Gare CFF is on the busy main line along the Rhône valley where it is a stopping place on the through services from Genève to Brig as well as on the RegionAlps local services. -

Plan De La Région
Evionnaz Cascade de la Pissevache 10 St-Maurice 1 Administration communale Vernayaz Numéros d’urgence Dorénaz 2 Bâtiment scolaire 144 urgences médicales Miéville Rhône 118 feu Crèche UAPE 3 117 police 4 Salle polyvalente 8 13 ORP Office régional de placement Foyer Ottanel Rue du Léman 29 Rue de la Gare 5 1920 Martigny Eglise 6 027/606.92.21 Rue de la Grande Charrière 7 Déchetterie Etat civil Gare CFF Rue du Léman 29 Grand-Rue 8 1920 Martigny 9 Gare TMR 027/607.12.20 Couvert de la Bourgeoisie (Miéville) 10 Permanence juridique et sociale 11 Terrain de foot Du Centre Suisses-Immigrés 16 A Monthey à la Maison du Monde, 6 Rue des Bernards 15 14 12 Salle de Sport av. du Crochetan 42 Chemin de l’Eglise Rue de la Fin 13 7 Route des Rue des Toules 3 A Martigny au centre de Loisirs et culture, 4 13 Parc de jeux diligences 1 rue des Vorziers 2 14 www.csivs.ch Rue du Collège 11 Place du Centième 2 027/323.12.16 12 15 Zone des 5 Place des Toules commerces 16 Place du Pas Trient Grand-Rue Vernayaz St-Maurice Gorges 9 Salvan du Trient Gueuroz Pont de Martigny Commune de Gueuroz Bureau de l’intégration Vernayaz 24 Saint-Maurice 17 Miéville - Gueuroz Place de la Gare Cercle des loisirs (cours de français) Rue 18 St-S igism on i t d d ue Plans de la région i oq r e B 19 Halte-garderie n z i e M o n a ha r C v u e du a i bureau de l’intégration R d u G R n i e t a l e s D . -

Table Des Matieres
1 TABLE DES MATIERES PREMIERE PARTIE............................................................................................................................ 5 CHAPITRE.1. ........................................................................................................................................ 5 PARTIE INTRODUCTIVE ET OBJECTIFS DU MEMOIRE 1.1 Introduction .............................................................................................................................5 1.2 Localisation de l’étude ............................................................................................................. 7 1.3 Problématique ..........................................................................................................................7 1.4 Objectifs du mémoire ...............................................................................................................8 1.5 Structure du travail ..................................................................................................................9 CHAPITRE.2. ...................................................................................................................................... 10 CADRE REGIONAL DE L’ETUDE : LES VALLEES DU TRIENT, DE L’EAU NOIRE ET DE SALANFE 2.1 Localisation et géographie ............................................................................................................. 10 2.1.1 Introduction ...........................................................................................................................10 -

Dureté De L'eau Dans Le Canton Du Valais
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture Service de la consommation et affaires vétérinaires Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen DuretéDépartement desde transports, l’eau de l’équipement et dedans l’environnement le canton du Valais Laboratoire cantonal et affaires vétérinaires Departement für Verkehr, Bau und Umwelt Kantonales Laboratorium und Veterinärwesen CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS Rue Pré-d’Amédée 2, 1951 Sion / Rue Pré-d’Amédée 2, 1951 Sitten Tél./Tel. 027 606 49 50 • Télécopie/Fax 027 606 49 54 • e-mail: [email protected] Les communes du Bas-Valais Districts Commune Lieu 0-7 7-15 15-25 25-32 32-42 >42 Districts Commune Lieu 0-7 7-15 15-25 25-32 32-42 >42 Sierre Ayer Nendaz Zinal Bouillet Vétroz Chalais Martigny Bovernier Chandolin Les Nids Chermignon Charrat Chippis Fully Grimentz Isérables Grône Leytron Icogne Martigny Lens Martigny-Combe Miège Riddes Mollens Saillon Montana Saxon Randogne Trient St-Jean Entremont Bagnes St-Léonhard Lourtier/Fregnoley St-Luc Le Chable Sierre Le Cotterg Venthône Bourg-St-Pierre Veyras Liddes Vissoie Le Chable Hérens Les Agettes Orsières Ayent Val Ferret superieur Anzère Rive droite Fortunoz Sembrancher Botyre Vollèges Mayens Pramousse Vollèges (font. église) Evolène St-Maurice Collonges Hérémence Dorénaz Mase Evionnaz Nax Finhaut Marbozet Massongex St-Martin Mex Vernamiège St-Maurice Vex Salvan Ypresse Vernayaz Sion Arbaz Vérossaz Grimisuat Monthey Champéry Salins Collombey-Muraz Savièse Monthey Sion -

17H00 027 606 98 00
Département de la formation et de la sécurité Heures d’ouverture du secrétariat : Service cantonal de la jeunesse Lundi à vendredi : 08h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00 Centre pour le développement et la thérapie de 027 606 98 00 / Fax : 027 606 98 04 l’enfant et de l’adolescent (CDTEA) E-Mail : pré[email protected] C D T E A MONTHEY : RÉPARTITION REGIONALE 2017 - 2 0 1 8 Fonction Collaborateur/trice Référent/e pour la région de Taux d’activité et jours de travail Responsable CDTEA Monthey Monthey : Europe/Nouveau Collège, Mabillons, Dr Beck, Tournesols, Semilles, Genêts, Arches, CO Christophe Boisset 100% : lundi à vendredi Psychologue - psychothérapeute Vionnaz : Enfantines et primaires Monthey : Gare/Vieux Collège, préscolaire, Cinquantoux Psychologue-psychothérapeute Béatrice Putallaz 50% : mardi, mercredi matin, jeudi Choex, les Giettes, CO, ECCG, SEMO, hors scolarité Troistorrents, Val d’Illiez, Champéry, Morgins, CO 70% : un lundi sur deux, mercredi, Psychologue-psychothérapeute Fabian Claeys Collombey + CO jeudi, vendredi Vouvry Cycle d’orientation, Bouveret, Saint-Gingolph, Muraz et Illarsaz (enfantines et primaires), Saint- 60% : lundi(variable), mardi(variable), Psychologue-psychothérapeute Anne-Sophie Ducommun Gingolph mercredi matin, jeudi, vendredi Saint-Maurice + CO + collège, Massongex, Mex, Vérossaz, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, Evionnaz, 50% : lundi, mardi, un mercredi sur Psychologue Daniella Fardel Epiney Vérossaz, Evionnaz, Vérossaz deux Saint-Maurice + CO + collège, Massongex, Mex, Vérossaz, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, -

Liste Des CMS
Liste des CMS COMMUNES CMS ADRESSE N° TEL / FAX COUVERTES Région de Monthey/St-Maurice MONTHEY R Centre médico-social Tél.: 024 475 78 11 Champéry, Collombey/Muraz, Monthey, Troistorrents, Val régional de Monthey Fax: 024 475 78 69 d'Illiez Av. de France 6 [email protected] 1870 Monthey ST-MAURICE Centre médico-social Tél. 024 486 21 21 Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Finhaut, Massongex, subrégional de St-Maurice Fax 024 486 21 20 Mex, St-Maurice, Vernayaz, Vérossaz Avenue du Simplon 12, entrée C secré[email protected] 1890 St-Maurice VOUVRY Centre médico-social Tél. 024 482 05 50 Port-Valais, St-Gingolph, Vionnaz, Vouvry subrégional de Vouvry Fax 024 482 05 69 Ch. des Ecoliers 4 [email protected] 1896 Vouvry Région de Martigny/Entremont MARTIGNY R Centre médico-social Tél. 027 721 26 94 Bovernier, Charrat, Fully, Martigny-Ville, Martigny-Combe, de Martigny Fax: 027 721 26 81 Salvan, Trient Rue d'Octodure 10b 1920 Martigny [email protected] ENTREMONT Centre médico-social Tél.: 027 785 16 94 Bagnes, Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher, subrégional de l'Entremont Fax: 027 785 17 57 Vollèges Route de la Gravenne 16 [email protected] 1933 Sembrancher SAXON Centre médico-social Tél.: 027 743 63 70 Isérables, Leytron, Riddes, Saillon, Saxon subrégional de Saxon Fax: 027 743 63 87 Rte du Léman 25 [email protected] 1907 Saxon Liste des CMS COMMUNES CMS ADRESSE N° TEL / FAX COUVERTES Région de Sion/Hérens/Conthey SION R Centre médico-social Tél. 027 324 19 00 Les Agettes, Salins, Sion, Veysonnaz régional de Sion Fax: 027 324 14 88 Chemin des Perdrix 20 [email protected] 1950 Sion VETROZ Centre médico-social Tél.: 027 345 37 00 Ardon, Chamoson, Conthey, Vétroz subrégional les coteaux du soleil Fax: 027 345 37 02 Rue du collège 1 / CP 48 [email protected] 1963 Vétroz HERENS Centre médico-social Tél.: 027 281 12 91 Evolène, Hérémence, Mont-Noble, St-Martin, Vex subrégional du Val d'Hérens Fax: 027 281 12 33 Route principale 4 [email protected] 1982 Euseigne COTEAU Centre médico-social Tél. -

A History of the Swiss in California
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 8 2020 A History Of The Swiss In California Richard Hacken Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Hacken, Richard (2020) "A History Of The Swiss In California," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 8. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/8 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Hacken: A History Of The Swiss In California A History of the Swiss in California by Richard Hacken1 In 1848, the same year that Switzerland’s political structure took on its present constitutional form as a modern nation-state, a Swiss settler-entrepreneur named John Sutter became aware of gold deposits at his mill in Alta California. This led directly to the California Gold Rush. Two years later, in 1850, the United States accepted the fresh- ly acquired and promising region now known as “California” into the Union as a state. Swiss immigrants enhanced the development of Cali- fornia from its very inception. Sutter, the charismatic chameleon-adventurer,2 had marketed himself at times to prospective clients and business partners as “Captain John Sutter of the Swiss Guards.”3 His contribution to the development of California, which was transitioning from being part of a sparsely populated Mexican province to a booming American state, was signifi- cant. -

HORAIRES> DU 19 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 2021 TIMETABLE
HORAIRES > DU 19 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 2021 TIMETABLE > FROM JUNE 19TH TO SEPTEMBER 12TH 2021 ORARI > DAL 19 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE 2021 MARTIGNY > CHAMONIX MONT-BLANC > ST GERVAIS-LE FAYET Numéro de circulation TMR 26202 26204 26206 26208 26210 26212 26214 26216 26218 26220 26222 26224 26252 26226 26228 26230 26232 26234 26236 26238 26240 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 1 Q Q Q Q Q 3 4 5 MARTIGNY 5.18 6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 16.56 17.18 18.18 19.18 20.18 21.18 22.18 23.18 00.18 LES FUMEAUX X 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 16.57 17.19 18.19 19.19 20.19 21.19 22.19 23.19 00.19 VERNAYAZ 5.22 6.22 7.22 8.22 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.02 17.22 18.22 19.22 20.22 21.22 22.22 23.22 00.22 SALVAN 5.32 6.32 7.32 8.32 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.13 17.32 18.32 19.32 20.32 21.32 22.32 23.32 00.32 LES MARÉCOTTES 5.36 6.36 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.18 17.36 18.36 19.36 20.36 21.36 22.36 23.36 00.36 LA MÉDETTAZ X 5.37 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.19 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37 22.37 23.37 00.37 LE TRÉTIEN X 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.22 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 00.40 FINHAUT 5.48 6.48 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.32 17.48 18.48 19.48 20.48 21.48 22.48 23.48 00.48 LE CHÂTELARD-VS X 5.55 6.55 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.39 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 00.55 LE CHÂTELARD FRONTIÈRE 5.57 6.57 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.42 17.58 18.58 19.58 20.57 21.57 22.57 23.57 00.57 VALLORCINE ARR. -

Horaires 2021 Des Bus Urbains De Martigny
bus urbains de Martigny Lignes régionales TMR et CarPostal incluses Horaire des bus Valable dès le 13 décembre 2020 www.tmrsa.ch/voyageurs Association « Bus de Martigny » Lignes 12.202 et 12.201 Martigny, Le Guercet – Martigny, Gare – Martigny-Croix,ͲƌŽŝdž͕ƌŽŝƐĠĞ Croisée û >ƵŶĚŝ Lundi au samedi, hors fêtes cantonales DĂƌƟŐŶLJ͕ >Ğ'ƵĞƌĐĞƚ ϱ͗Ϯϲ Ͳϲ͗Ϯϲϲ͗ϱϲͲϬϳ͗Ϯϲ;ΎͿ Ͳϳ͗ϱϲͲϴ͗Ϯϯ Ͳϴ͗ϱϲϵ͗ϮϲͲ DĂƌƟŐŶLJ͕ &ĂƌƋƵĞƚ ϱ͗Ϯϳ Ͳϲ͗Ϯϳϲ͗ϱϳͲϬϳ͗Ϯϳ;ΎͿ Ͳϳ͗ϱϳͲϴ͗Ϯϰ Ͳϴ͗ϱϳϵ͗ϮϳͲ DĂƌƟŐŶLJ͕ sĞƌĚĂŶϱ͗ϮϵͲϲ͗Ϯϵ ϲ͗ϱϵ Ͳ Ϭϳ͗Ϯϵ;ΎͿ Ͳϳ͗ϱϵͲϴ͗Ϯϲ Ͳϴ͗ϱϵϵ͗ϮϵͲ DĂƌƟŐŶLJ͕ &ŝŶĞƩĞƐ ϱ͗ϯϭ Ͳϲ͗ϯϭϳ͗ϬϭͲϬϳ͗ϯϭ;ΎͿ Ͳϴ͗ϬϭͲϴ͗Ϯϴ Ͳϵ͗Ϭϭϵ͗ϯϭͲ DĂƌƟŐŶLJ͕ ZŚŽĚĂŶŝĂ ϱ͗ϯϮ Ͳϲ͗ϯϮϳ͗ϬϮͲϬϳ͗ϯϮ;ΎͿ Ͳϴ͗ϬϮͲϴ͗Ϯϵ Ͳϵ͗ϬϮϵ͗ϯϮͲ DĂƌƟŐŶLJ͕ 'ĂƌĞϱ͗ϯϲͲϲ͗ϯϲ ϳ͗Ϭϲ Ͳ Ϭϳ͗ϯϲ;ΎͿ Ͳϴ͗ϬϲͲϴ͗ϯϯ Ͳϵ͗Ϭϲϵ͗ϯϲͲ ůŝŐŶĞϭϮ͘ϮϬϮ ZƉŽƵƌ^ŝŽŶ ͲͲ Ϭϳ͗ϭϴR Ͳ ϳ͗ϱϬ Ͳ Ϭϴ͗ϭϴR Ͳϴ͗ϯϴͲϬϵ͗ϭϴR ϵ͗ϱϬ Ͳ /ZƉŽƵƌ^ŝŽŶ ͲͲϲ͗ϰϬ ϳ͗ϭϬ Ͳ ϳ͗ϰϯ Ͳϴ͗ϭϬͲϴ͗ϰϯ Ͳϵ͗ϭϬϵ͗ϰϯͲ /ZƉŽƵƌ>ĂƵƐĂŶŶĞ ϱ͗ϰϯ Ͳϲ͗ϰϴϳ͗ϭϲͲϳ͗ϰϴ Ͳϴ͗ϭϲͲϴ͗ϰϴ Ͳϵ͗ϭϲϵ͗ϰϴͲ ZĚĞ^ŝŽŶ Ͳϱ͗ϱϵϲ͗ϯϮͲϳ͗Ϭϴ Ͳϳ͗ϰϮͲϴ͗Ϭϴ Ͳϴ͗ϰϮͲϵ͗Ϭϴ ϵ͗ϰϮ /ZĚĞ^ŝŽŶ ϱ͗ϭϭ ϱ͗ϰϮ ϲ͗ϭϰ ϲ͗ϰϳ Ͳ ϳ͗ϭϰ ϳ͗ϰϯ Ͳϴ͗ϭϰͲϴ͗ϰϳ Ͳϵ͗ϭϰϵ͗ϰϳ /ZĚĞ>ĂƵƐĂŶŶĞ ͲͲϲ͗Ϭϵ ϲ͗ϯϵ ϳ͗Ϭϵ Ͳϳ͗ϰϮͲϴ͗Ϭϵ Ͳϴ͗ϰϮͲϵ͗Ϭϵ ϵ͗ϰϮ DĂƌƟŐŶLJ͕ 'ĂƌĞϱ͗ϯϴϲ͗Ϭϴϲ͗ϯϴϳ͗Ϭϴϳ͗ϭϱ Ϭϳ͗ϯϴ;ΎͿ ϳ͗ϱϯ ϴ͗Ϭϴ ϴ͗Ϯϯ ϴ͗ϯϱ ϴ͗ϱϯ ϵ͗Ϭϴ ϵ͗ϯϴ ϭϬ͗Ϭϴ DĂƌƟŐŶLJ͕ WŽƐƚĞ ϱ͗ϰϬ ϲ͗ϭϬ ϲ͗ϰϬ ϳ͗ϭϬ ϳ͗ϭϳ Ϭϳ͗ϰϬ;ΎͿ ϳ͗ϱϱ ϴ͗ϭϬ ϴ͗Ϯϱ ϴ͗ϯϳ ϴ͗ϱϱ ϵ͗ϭϬ ϵ͗ϰϬ ϭϬ͗ϭϬ DĂƌƟŐŶLJ͕ ĂƐƐŝŶĚƵDĂŶŽŝƌ ϱ͗ϰϯ ϲ͗ϭϯ ϲ͗ϰϯ ϳ͗ϭϯ ϳ͗ϮϬ Ϭϳ͗ϰϯ;ΎͿ ϳ͗ϱϴ ϴ͗ϭϯ ϴ͗Ϯϴ ϴ͗ϰϬ ϴ͗ϱϴ ϵ͗ϭϯ ϵ͗ϰϯ ϭϬ͗ϭϯ DĂƌƟŐŶLJ͕ ,ƀƉŝƚĂůϱ͗ϰϰϲ͗ϭϰϲ͗ϰϰϳ͗ϭϰϳ͗Ϯϭ ϳ͗ϰϰ ϳ͗ϱϵ ϴ͗ϭϰ ϴ͗Ϯϵ ϴ͗ϰϭ ϴ͗ϱϵ ϵ͗ϭϰ ϵ͗ϰϰ ϭϬ͗ϭϰ DĂƌƟŐŶLJ͕ &ŽŶĚ͘'ŝĂŶĂĚĚĂ ϱ͗ϰϲ ϲ͗ϭϲ ϲ͗ϰϲ ϳ͗ϭϲ ϳ͗Ϯϯ ϳ͗ϰϲ ϴ͗Ϭϭ ϴ͗ϭϲ ϴ͗ϯϭ ϴ͗ϰϯ ϵ͗Ϭϭ ϵ͗ϭϲ ϵ͗ϰϲ ϭϬ͗ϭϲ ůŝŐŶĞϭϮ͘ϮϬϭ DĂƌƟŐŶLJ͕ ZƵĞĚƵĂƐƚĞů ϱ͗ϰϳ ϲ͗ϭϳ ϲ͗ϰϳ ϳ͗ϭϳ ϳ͗Ϯϰ ϳ͗ϰϳ ϴ͗ϬϮ ϴ͗ϭϳ -
Vernayaz Vernayaz ! ! Vernayaz Vernayaz
3 ème correction du Rhône Plan d'aménagement Communes de Vernayaz - Evionnaz - Dorénaz - Collonges 2008 PA-R3 projet pour information publique mai 2008 04. 17. Bases du PA-R3 Projet et emprise pour information publique Esquisses d'aménagement Danger et dégâts potentiels actuels selon carte indicative des dangers du Plan sectoriel R3 adopté en juin 2006 par le Conseil d'Etat du canton du Valais Situation générale 39 ! ! ! Fully ! ! ! Fully ! Lavey-Morcles Montants [mio CHF] Commune de Collonges ! Montants [mio CHF] ! Zone à bâtir (ZAB): 6.4 9 ! 2 Lavey-Morcles ! ! Commune de Dorénaz ! 29 Zone agricole: 3.3 ! ! Zone à bâtir (ZAB): 34.6 ! 28 Collonges Objets particuliers: 0.0 Dorénaz ! ! Exemple d'élargissement sécuritaire minimal 38 Zone agricole: 4.3 ! ! Montant total: 9.7 28 ! 30 3 ! ! Objets particuliers: 0.0 7 ! ! Montant total: 38.9 ! ! ! ! 27 ! ! 38 3 30 6 ! ! ! ! 3 Collonges 7 3 Martigny 5 31 Dorénaz Montants [mio CHF] 32 St-Maurice Commune de Evionnaz 2 7 Zone à bâtir (ZAB): 22.4 33 Zone agricole: 1.0 34 Objets particuliers: 59.9 36 Montant total: 83.3 Evionnaz Montants [mio CHF] Vernayaz Commune de Vernayaz Zone à bâtir (ZAB): 152.3 Martigny-Combe Zone agricole: 2.1 30734 Objets particuliers: 20.0 Montant total: 174.4 Mex 1 Martigny Salvan O 3 06 3 5 34584 21 2 3 1 : 25'000 St-Maurice 3 Carte indicative des dangers Rhône Périmètre d'inondation Limites communales Mètres Inondation probable pour une crue pouvant se produire Hauteur d'eau supérieure à 2 mètres et secteurs de rupture de digues 0 500 1'000 2'000 en moyenne une fois chaque 100 ans (état actuel) Hauteur d'eau inférieure à 2 mètres 3 3 Evionnaz 3 Gestion des débits et risques résiduels 4 Vernayaz 39 Martigny-Combe Il n'y a plus de danger pour la crue de dimensionnement (Qdim). -

Chemins Bibliques St-Maurice – Daviaz/ Massongex – Vérossaz
Chemins bibliques archéologiques et pédestres Le Tour du district de Saint-Maurice Valais-Suisse Internet: www.chemins-bibliques.ch E-mail: [email protected] Livret 1 St-Maurice – Daviaz/ Massongex – Vérossaz (via le tunnel St Martin – retour sur St-Maurice possible par la Poya des Cases) Vérossaz – Mex – Evionnaz – Salvan L'ABBAYE de Saint-Maurice d’Agaune, vous êtes vraiment dans À le berceau du christianisme en Suisse, puisque le martyre de Maurice et de ses compagnons a eu lieu aux alentours de la fin du troisième siècle et que depuis lors l’Abbaye éponyme en a conservé la mémoire et les reliques. Panneau blblique − Cette première image est une reproduction de la fresque « Les animaux dans la Création », une huile de 5 m sur 1m80 réalisée par l'artiste Grégory Corthay. De cette toile ont été extraits les détails figurant sur les tableaux rencontrés au long des chemins. En quittant la commune de St- Maurice, vous laisserez derrière vous, le château Stockalper de la Tour, aujourd'hui écrin à expositions. Les premières fondations remontent au 12e siècle. Le château a été reconstruit au 17e siècle pour être la douane et le péage des redevances au baron Gaspard Jodoc Stockalper (1609-1691). On peut résumer la politique étrangère de Gaspard Jodoc par les mots: sel, mercenaires, col du Simplon (Joseph Escher, ancien conseiller fédéral). La France de Richelieu et du Roi soleil, Louis XIV, avaient besoin de très nombreux soldats pour imposer par la violence leurs plans ambitieux et souvent sans scrupule. Le Valais avait depuis longtemps déjà ce qu’on appelait des compagnies 1 libres.