A35e-4C45-A71b-Bcca33f7361a.Txt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
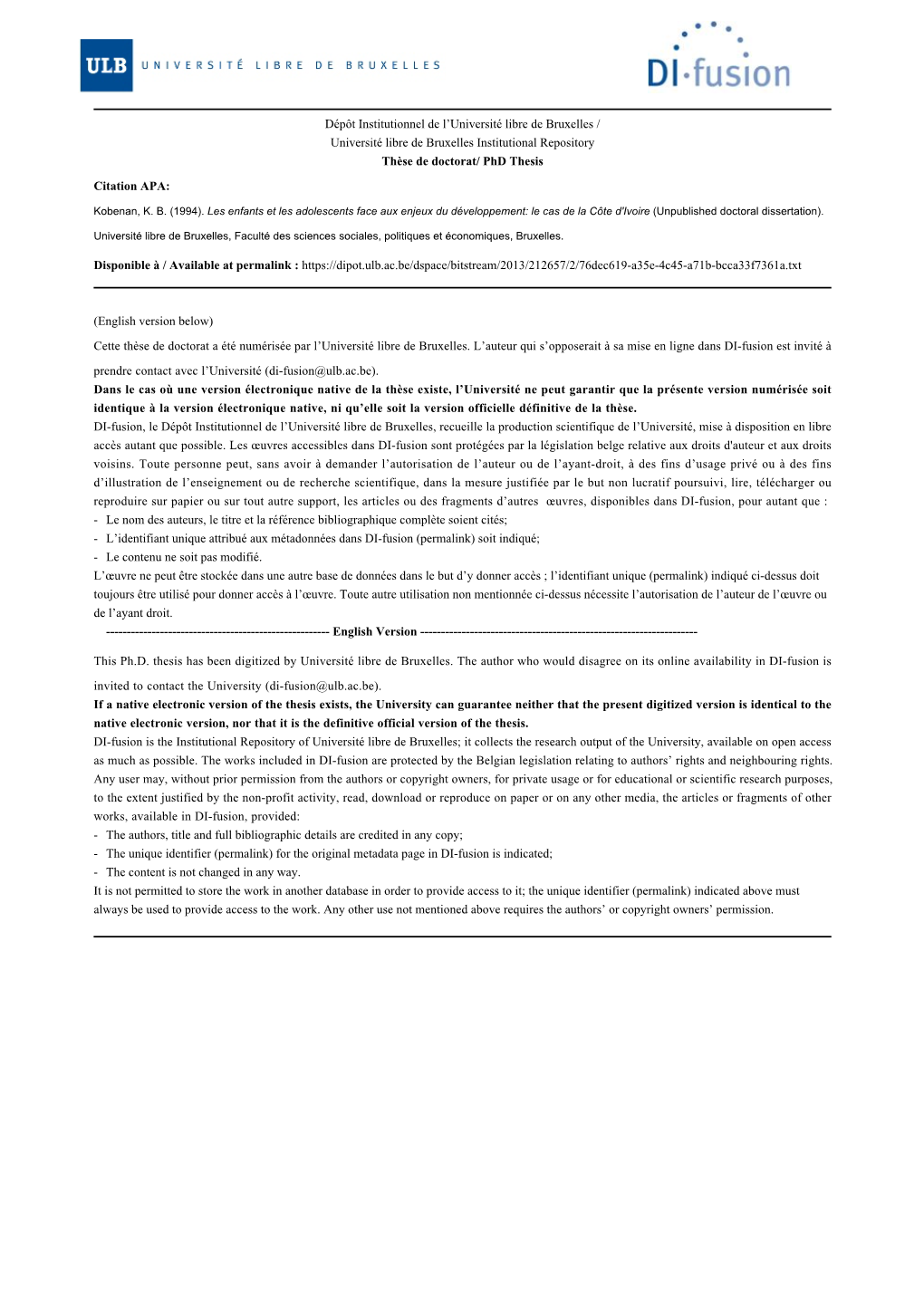
Load more
Recommended publications
-

AN INTIMATE REBUKE the Religious Cultures of African and African Diaspora People
AN INTIMATE REBUKE The Religious Cultures of African and African Diaspora People Series editors: jacob k. olupona, harvard university, dianne m. stewart, emory university, and terrence l. johnson, georgetown university The book series examines the religious, cultural, and po liti cal expres- sions of African, African American, and African Ca rib bean traditions. Through transnational, cross- cultural, and multidisciplinary approaches to the study of religion, the series investigates the epistemic bound- aries of continental and diasporic religious practices and thought and explores the diverse and distinct ways African- derived religions inform culture and politics. The series aims to establish a forum for imagining the centrality of Black religions in the formation of the New World. AN INTIMATE REBUKE female genital power in ritual and politics in West Africa Laura S. Grillo • Duke University Press Durham and London 2018 © 2018 Duke University Press. All rights reserved Printed in the United States of Amer i ca on acid- free paper ∞ Designed by Courtney Leigh Baker Typeset in Garamond Premier Pro by Westchester Publishing Services Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Names: Grillo, Laura S., [date] author. Title: An intimate rebuke : female genital power in ritual and politics in West Africa / Laura S. Grillo. Description: Durham : Duke University Press, 2018. | Series: The religious cultures of African and African diaspora people | Includes bibliographical references and index. Identifiers: lccn 2018008228 (print) | lccn 2018013660 (ebook) isbn 9781478002635 (ebook) isbn 9781478001201 (hardcover : alk. paper) isbn 9781478001553 (pbk. : alk. paper) Subjects: lcsh: Côte d’Ivoire— Religion. | Older women— Religious life— Côte d’Ivoire. | Older women— Political activity— Côte d’Ivoire. -

Project: Azito Iv Country: Ivorycoast
Language: English Original: English PROJECT: AZITO IV COUNTRY: IVORYCOAST ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT SUMMARY Date: 14th March 2018 Task Managers: Kweku KORANTENG Samir BELRHANDORIA Environmental Officer: Chimwemwe Roberta MHANGO 1 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) SUMMARY Project Title: AZITO IV POWER EXPANSION PROJECT Project Number: P-CI-F00-007 Country: Cote D’Ivoire Department: PESR Division: PESR.2 Project Category: Category 1 1. INTRODUCTION The AZITO Power Expansion Project stems from a memorandum of understanding between Azito Energie and the government of Côte d’Ivoire to install an additional capacity of approximately 250 - 335 MWe at the Azito facility. Azito Energie proposes to expand its existing 430MW combined cycle gas turbine (CCGT) power plant (Phase I, II and III) in the district of Azito, in the city of Abidjan, Côte d’Ivoire. The expansion (Phase IV) consists of adding one gas turbine, one heat recovery steam generator (HRSG), and one steam turbine with air cooled condenser on a 1-1-1 configuration with a combined additional output of approximately 250 – 335 MW. This expansion will increase the overall plant output to approximately 680 765 MWe. This Project will increase long-term delivery of electricity in Côte d’Ivoire and contribute to developing a more effective power supply in the country. AfDB is considering financing the project with other co-lenders. The other co-lenders that are considering financing of the Azito IV Expansion project include: IFC, Proparco, FMO, DEG, BIO, EAIF and BOAD. The project has been categorized as a Category 1 project because it is a 235MW Thermal Power Plant that will involve construction and operation activities that will induce irreversible adverse environmental impacts. -

LCSH Section T
T (Computer program language) T cell growth factor T-Mobile G1 (Smartphone) [QA76.73.T] USE Interleukin-2 USE G1 (Smartphone) BT Programming languages (Electronic T-cell leukemia, Adult T-Mobile Park (Seattle, Wash.) computers) USE Adult T-cell leukemia UF Safe, The (Seattle, Wash.) T (The letter) T-cell leukemia virus I, Human Safeco Field (Seattle, Wash.) [Former BT Alphabet USE HTLV-I (Virus) heading] T-1 (Reading locomotive) (Not Subd Geog) T-cell leukemia virus II, Human Safeco Park (Seattle, Wash.) BT Locomotives USE HTLV-II (Virus) The Safe (Seattle, Wash.) T.1 (Torpedo bomber) T-cell leukemia viruses, Human BT Stadiums—Washington (State) USE Sopwith T.1 (Torpedo bomber) USE HTLV (Viruses) t-norms T-6 (Training plane) (Not Subd Geog) T-cell receptor genes USE Triangular norms UF AT-6 (Training plane) BT Genes T One Hundred truck Harvard (Training plane) T cell receptors USE Toyota T100 truck T-6 (Training planes) [Former heading] USE T cells—Receptors T. rex Texan (Training plane) T-cell-replacing factor USE Tyrannosaurus rex BT North American airplanes (Military aircraft) USE Interleukin-5 T-RFLP analysis Training planes T cells USE Terminal restriction fragment length T-6 (Training planes) [QR185.8.T2] polymorphism analysis USE T-6 (Training plane) UF T lymphocytes T. S. Hubbert (Fictitious character) T-18 (Tank) Thymus-dependent cells USE Hubbert, T. S. (Fictitious character) USE MS-1 (Tank) Thymus-dependent lymphocytes T. S. W. Sheridan (Fictitious character) T-18 light tank Thymus-derived cells USE Sheridan, T. S. W. (Fictitious -

Socio-Anthropologie De La Gestion Du Foncier Chez Abidjan En Côte D'ivoire
UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA (ex- Université de Bouaké) il UFR Communication Milieu et Société Département de Sociologie et d’Anthropologie Socio-anthropologie de la gestion du foncier chez les Ebrié : le cas de la ville d’Abidjan en Côte d’ivoire THESE NOUVEAU REGIME Pour l’obtention du grade de Docteur en Sociologie-Anthropologie Présenté par : ADOU Paul Venance Directeur de thèse : Pr. KOUASSI N’Goran François , Jury PRÉSIDENT DU JURY : Pr KOUAKOU N’GUESSAN FRANÇOIS, Professeur titulaire, Président honoraire de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké i Pr KOUASSIN’GORAN FRANÇOIS, Maître de recherches à l'Université Alassane Ouattara Je Bouaké. Pï SA IfA SI YÜUZAN DANIEL, Professeur titulaire à l'Université Félix Houphouët Boi^ny d’Abidjan Pr NONEISSIANA, Maître de conférences à l'Université Alassane Ouattara Je Bouaké Pr KOMi KOSSl-TlTRlKOU EMMANUEL, Professeur titulaire à l'Université de Lomé fTogo) 3^ CVC UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA (ex- Université de Bouaké) UFR Communication Milieu et Société Département de Sociologie et d’Anthropologie Socio-anthropologie de la gestion du foncier chez les Ebrié : Le cas de la ville d’Abidjan en Côte d’ivoire par A . o 'i ADOU Paul Venance A to - - ---- Directeur de thèse : Pr. KOUASSI N’Goran François Thèse nouveau régime Pour l’obtention du grade de Docteur en Sociologie-Anthropologie Option : socio-économie du développement Jury PRÉSIDENT DU JURY : Pr KOUAKOU N’GUESSAN FRANÇOIS, Professeur titulaire, Président honoraire de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké Pr KOUASSI N’GORAN FRANÇOIS, -
![Akan Studies Council [ASC] Newsletter, No. 1](https://docslib.b-cdn.net/cover/2047/akan-studies-council-asc-newsletter-no-1-4952047.webp)
Akan Studies Council [ASC] Newsletter, No. 1
AKAN STUDIES COUNCIL NEWSLETTER NUMBER 1 September 1989 CO-CHAIRS' STATEMENT This first issue of the Newsletter is being sent by to everyone on the original list, as we really do Judith Timyan and want to include the widest audience possible. Raymond A. Silverman However, beginning with the next issue only mem bers (i.e. those who have returned a completed Here, finally, is the first issue of the Akan questionnaire) will receive Akan Studies Council Studies Council Newsletter. As we promised, we correspondence. What we are really after is have made Akan history the thematic focus of this information on the scholars, specialists and gen inaugural issue, with statements on the current eral audience who make up the Akan constituency, state of research in the various regions. We would so this is not intended as an exclusionary move like to thank Robert Addo-Fening, Jean-Noel but rather as an incentive for you to send in your Loucou, Gareth Austin, Dolly Maier, Jean-Pierre completed questionnaires. Chauveau and Claude-Helene Perrot for taking the As stated in our earlier correspondence, it is time to prepare their state-of-the-field statements. due to the generosity of Peter Shinnie, who has The inevitable difficulties involved in getting a agreed to bear the cost of duplicating and mailing new organization started are undoubtedly com the Newsletter, that we do not have to request pounded by the facts that we are addressing a dues from all of our members at this point in time. multi-national, multi-regional membership and are Nevertheless, it was decided at the 1988 Akan attempting to make the Newsletter bilingual. -
L'élément Portugais Dans Les Univers Linguistique Et Onomastique Du Golfe De Guinée : Étude De
L'´el´ement portugais dans les univers linguistique et onomastique du Golfe de Guin´ee: ´etudede cas Tougbo Koffi To cite this version: Tougbo Koffi. L'´el´ement portugais dans les univers linguistique et onomastique du Golfe de Guin´ee: ´etudede cas. Linguistique. Universit´ede la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2010. Fran¸cais. <NNT : 2010PA030095>. <tel-01355697> HAL Id: tel-01355697 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01355697 Submitted on 24 Aug 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3 ECOLE DOCTORALE 122 – EUROPE LATINE AMERIQUE LATINE En Cotutelle avec UNIVERSITE DE COCODY/ ABIDJAN, UFR DES LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS THESE DE DOCTORAT NOUVEAU REGIME Discipline : Etudes du monde lusophone Auteur : Tougbo KOFFI Titre : L'ELEMENT PORTUGAIS DANS LES UNIVERS LINGUISTIQUE ET ONOMASTIQUE DU GOLFE DE GUINEE: ETUDE DE CAS Thèse dirigée par Mme le Prof. Jacqueline PENJON et Codirigée par M. le Prof. François ASSI ADOPO Thèse soutenue le 09 Octobre 2010 Jury : M. le Prof. François ASSI ADOPO (Abidjan) Mme le Prof Jacqueline PENJON (Paris3) Mme le Prof. Maria Helena ARAUJO CARREIRA (Paris 8) M. Nicolas QUINT, Dir. -

Issn 1817-5627
ISSN 1817-5627 34 2019 SOMMAIRE ISSN 1817-5627 Rev Iv Hist 2019 ; 34. Joseph Abo KOBI. Du territoire ivoirien à l’internationalisation de la lutte syndicale des planteurs africains (1944-1960) ............................5 BAYALA VIVIANE. La conception du pouvoir politique chez les Lyela précoloniaux...................................................................................19 Hugues Marcel BOTEMA. Analyse critique des ruses attribuées à Conon, d’après les stratagèmes de Polyen...............................................30 Katiénéffooua Adama OUATTARA. Les tensions politiques après la mort du président Félix Houphouët-BOIGNY : le début de l’instabilité politique en Côte d’Ivoire (1994-2000)...................................46 M’BRAH Kouakou Désiré. Bilan de la recherche archeologique et historique sur le peuplement de la Côte d’Ivoire de 1987 à 2018.............61 Serge MBOYI BONGO. La confrerie mystique comme socle d’un anticolonialisme (fin du xixè et début de xxe siècle) : cas de la tidjaniyya d’El Hadj Umar Tall dans le sahel et le bwiti dans la colonie du Gabon..............................................................................79 Edwige Salomé MOUSSOUNDA NDENGA, Joachim E. GOMA- THETHET. Les musiciens anti-apartheid et la libération de Nelson Mandela, au cours de la décennie 1980......................................97 NOGBOU M’domou Eric, N’CHO Anin Patricia-Claire. Déclin religieux et déconstruction de la vie politique dans le Bilad Al-Soudan, une interprètation de la chute de l’empire Soninké du ghana (1077-1203)...................................................................................114 -

Meyan Djeya Ange Océane Meyan Planning an Onomasiological
Universidade do Minho Instituto de Letras e Ciências Humanas t Meyan Djeya Ange Océane Meyan y Coas he Ivor Planning an Onomasiological Dictionary for Atchan - An Endangered Language of the Ivory Coast y for Atchan - An Endangered Language of t Planning an Onomasiological Dictionar yan ya Ange Océane Me yan Dje Me UMinho|2020 November 2020 Universidade do Minho Instituto de Letras e Ciências Humanas Meyan Djeya Ange Océane Meyan Planning an Onomasiological Dictionary for Atchan - An Endangered Language of the Ivory Coast Master's Dissertation European Master in Lexicography Supervised by Professora Idalete Maria da Silva Dias November 2020 Direitos de Autor e Condições de Utilização do Trabalho por Terceiros Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos. Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada. Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho. Licença concedida aos utilizadores deste trabalho Atribuição CC BY https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ii Thanks At the end of the realization of this master thesis, I would like to address special thanks to: Prof. Dr. Idalete Maria da Silva Dias, on the one hand, for her physical, moral and academic support during the whole career as an EMLex student and, on the other hand, for her consistent instructions for the achievement of the thesis; Prof. -

Les Sept Matriclans Et La Tradition Alimentaire Chez Des Nzéma : Essai D’Interprêtations Historique
RÉFÉRENCE DE CET ARTICLE : ALLOU Kouamé René (2011). Les sept matriclans et la tradition alimentaire chez des nzéma : essai d’interprêtations historique. REV. HIST. ARCHÉOL. AFR., GODO GODO, N° 21 - 2011 LES SEPT MATRICLANS ET LA TRADITION ALIMENTAIRE DES NZEMA : ESSAIS D’INTERPRETATIONS HISTORIQUE Pr. ALLOU Kouamé René Maître de Conférences. Université de Cocody-Abidjan. UFR des Sciences de l’Homme et de la Société. F ilière des Sciences Historiques Email : [email protected] RÉSUMÉ La tradition orale des Nzema raconte l’histoire des sept matriclans et dit comment chacun d’eux a découvert un aliment ou même simplement contribué par son action à améliorer le patrimoine culinaire du peuple. La présente communication veut interpréter le contenu de ces traditions qui parlent des découvertes des matriclans nzema en matière d’alimentation. L’honnêteté scientifi que nous amène à reconnaître que ces essais d’interprétations histo- riques sont forcément relatifs, partiaux et partiels. Mots clés : Les sept matriclans nzema-les découvertes alimentaires. ABSTRACT The oral traditions of the Nzema talk about the history of the seven matrilineal clans and say how each of them discovered a nutriment or simply by his action contribute to improve the culin patrimony of the people. This dissertation want elucidate that oral traditions which talk about the discoveries of nzema matrilineal clans in matter of feeding. The scientifi c uprightness make us recognize that those historical explanations trials, are perforce, relatives, partials and unfi nished. 108 © EDUCI 2011. Rev. hist. archéol. afr., GODO GODO, ISSN 18417-5597, N° 21 - 2011 INTRODUCTION L’histoire et le récit des hauts faits des matriclans nzema, sont rappelés par la tradition au moment de la célébration de l’Abissa/Koundoum, festivités qui marquent l’année nouvelle. -

La Enseñanza De La Lengua Española a Hablantes Ivorienses De Diversas Lenguas Autóctonas: Dificultades Y Problemas Que Plantea
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Española I LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA A HABLANTES IVORIENSES DE DIVERSAS LENGUAS AUTÓCTONAS: DIFICULTADES Y PROBLEMAS QUE PLANTEA MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Seydou Koné Bajo la dirección de la doctora Alicia Puigvert Ocal Madrid, 2005 ISBN: 978-84-669-2759-8 AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... 13 INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................................................ 18 ÍNDICE DE LA FAMILIA DE LENGUAS................................................................ 18 PARTE I............................................................................................................................36 DIVERSIDAD CULTURAL Y CONTACTO LINGUAL............................................ 37 CAPÍTULO I.....................................................................................................................37 LENGUAS, HABLAS E IDIOMAS TANTO MATERNAS Y PRIMERAS COMO SEGUNDAS Y EXTRANJERAS............................................................................ 37 I. DEFINICIONES.............................................................................................. 37 1. EL IDIOMA.............................................................................................................37 2. LA LENGUA...........................................................................................................39 3. -

Les Dockers Du Port D'abidjan, 1950-2000
Revue Ivoirienne des Sciences Historiques N° 6, Décembre 2019 Revue d’Histoire, d’Art et d’Archéologie de l’Université Jean LorougnonRevue Ivoirienne Guédé des Sciencesde Daloa Historiques- Côte d’Ivoire ISSN( RISH2520- ) 9310 RevueSite: Ivoirienne www.histoire des Sciences - univdaloa.net Historiques Courriel : revue ris( hR [email protected] ) Adresse Bp 150 Daloa (Côte d’Ivoire) DIDIER Photo de couverture : le Gloko, pagne traditionnel1 bété fait d’écorce d’arbre battu, à l’aide d’une massue. Rev. ivoir. sci. hist.,n°006 DÉCEMBRE 2019, ISSN 2520-9310 Revue électronique spécialisée en Histoire, Archéologie et Art 1 , n°001, juin 2017 Revue élec troniquespécialisée en Histoire, Archéologie et Art i b é t é f a i t REVUE IVOIRIENNE DES SCIENCES HISTORIQUES (RISH) Revue d’Histoire, d’Art et d’Archéologie de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa Revue électronique ISSN 2520-9310 2 Rev. ivoir. sci. hist.,n°006 DÉCEMBRE 2019, ISSN 2520-9310 Revue électronique spécialisée en Histoire, Archéologie et Art Administration de la revue Directeur de publication Directeur de rédaction adjoint KOUADIO Guessan, ALLOU Kouamé Réné, Professeur des Universités, Professeur titulaire d’histoire africaine, Université Félix Secrétariat de rédaction Houphouët-Boigny. Dr. Jean- Baptiste SEKA Dr. Angela OSSORO Directeur de rédaction Dr. Adoffi Ange BARNABE YAO-BI GNAGORAN Ernest, Maître de conférences Trésorier d’histoire religieuse, Université Félix Houphouët- Dr. ETTIEN Comoé Fulbert Boigny d’Abidjan- Cocody ; Comité scientifique Pr. KONÉ Issiaka, Professeur des Universités, Pr. ALLOU Kouamé Réné, Professeur des Professeur titulaire, Université Jean Lorougnon Universités, Professeur titulaire d’histoire Guédé, Daloa ; africaine, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr.