Journée De Récollection Du Monastère Invisible FRANZ STOCK (1904-1948)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'abbe FRANZ STOCK, Séminaire Des Barbelés, Chartres
PROPOSITION DE LECTURES - Franz Stock passeur d’âme. J.F. VIVIER (Denoël) : Bande dessinée. - Prier 15 jours avec Franz Stock, apôtre de la réconciliation (Nouvelle Cité) Franz Stock, aumônier de l'enfer, René Closset (Le Sarment Fayard) « Dieu appelle sans cesse des ouvriers pour sa moisson et le Christ - 3 hommes de paix, Robert Schumann, Edmond Michelet, Franz Stock. nous a demandé de prier pour que l’oreille du cœur s’ouvre à cet appel. Jacques PERRIER (Nouvelle Cité) Vous êtes ceux qui portent cette prière. » Monseigneur Michel Aupetit - Evêque de Nanterre L’ABBE FRANZ STOCK, Séminaire des barbelés, Samedi 27 Janvier 2018 Journée de récollection du Monastère Invisible à Chartres. Chartres. De 8h30 à 18h en car Visite du séminaire des Barbelés et de la Cathédrale de Chartres. (Inscription via le bulletin d’inscription joint avant le 10 janvier 2018) "Ce furent des années dures, mais riches de vie et de travail bien fait. Ce fut long mais fructueux, exaltant et enrichissant. Ce fut souvent amer, mais en même temps Vendredi 6 avril 2018 si plein de promesses que les étapes du chemin de croix que nous parcourions Veillée diocésaine pour les Vocations disparaissaient lentement devant la lumière qui irradiait notre vie. à Notre Dame de Boulogne, à partir de 20h Le prisonnier était pauvre, privé de tout éclat extérieur, un miséreux de Dieu, mais, intérieurement, tellement riche de la plénitude de l'Esprit et de l'expérience vécue en commun. Samedi 2 juin 2018 Ce fut un noviciat très dur, une école très austère. Bientôt nous allons sortir, -

Conférence « Franz Stock Et Les Voies Vers L'europe » Eglise Saint
Conférence « Franz Stock et les voies vers l’Europe » Eglise Saint Maurice, Strasbourg mercredi 11 mai 2016 19 h Comment Franz Stock a-t-il ouvert les voies vers l’Europe ? A quel titre mérite-t-il la reconnaissance de l’Union Européenne d’aujourd’hui ? Comment son exemple peut-il aider à construire et à parfaire celle-ci ? Telles sont les questions auxquelles je voudrais essayer de répondre ici, ce soir, en l’Eglise Saint-Maurice de Strasbourg, qui abrite la première exposition sur Franz Stock ayant reçu le patronage du Parlement Européen. Franz Stock voit le jour à Neheim en Westphalie en 1904. Comment se présente l’Europe de 1904 ? Franz, ainé d’une famille de neuf enfants, est sujet de l’Empereur Guillaume II. Nicolas II est tsar autocrate de toutes les Russies ; François- Joseph règne sur l’empire austro-hongrois. La France a l’œil fixé sur la ligne bleue des Vosges. L’enfant qu’il est encore ne fait que le soupçonner, mais les nationalismes que Franz Stock, au milieu des décombres qu’ils avaient causés, qualifiera, en 1947, de « ridicules comme un vieux costume de zouave », sont à leur apogée. Franz Stock a dix ans lorsqu’éclate la première guerre mondiale, et quatorze lorsqu’elle se termine par la défaite de son pays. Il vit la guerre sans son père, qui est mobilisé mais qui en reviendra. Il a la chance d’habiter dans une partie de l’Allemagne ou les tendances revanchardes se manifesteront peu, et où se fait même jour un courant en faveur de la réconciliation avec la France. -

Die Geschichte Unserer Gemeine Sankt-Albertus-Magnus Paris (Kurzfassung)
Die Geschichte unserer Gemeine Sankt-Albertus-Magnus Paris (Kurzfassung) 17. Jahrhundert Auf Bestreben der Herzogin von Brabant gewährte König Ludwig XIII bereits 1626 deutschen und flämischen Bürgern die Möglichkeit, in der Kirche Saint-Hippolyte im Faubourg Saint- Marceau, dem heutigen 13. Bezirk in Paris, Gottesdienste in ihrer Sprache abzuhalten. Im folgenden Jahr wurde dort die „Société Catholique des Nations Flamande et Allemande“ gegründet. Da sich diese Gemeinde damals weit außerhalb der Pariser Stadtgrenze befand, zog sie 1631 nach Saint-Germain-des-Prés, wo deutsche Gottesdienste bis 1718 nachweisbar sind. x18. Jahrhundert Im 18. Jahrhundert sind Messen mit deutschsprachigen Predigten in verschiedenen Pariser Kirchen nachweisbar, hauptsächlich jedoch bei den Kapuzinern in der Rue Saint-Honoré. x19. Jahrhundert Mitte des 19. Jahrhunderts kamen durch massive Wanderbewegungen zahlreiche Handwerker und Arbeiter nach Paris, sodass man 1853 etwa 100.000 Menschen deutscher Sprache in Paris zählte! Da sie oft in sozial schlechten Situationen lebten, versuchte man eine eigene Seelsorge aufzubauen. 1825 begann der deutsche Priester Pater Bervenger in verschiedenen Pariser Kirchen zu wirken. Dies fand jedoch mit der Julirevolution 1830 bald wieder ein Ende. Am 12. November 1837 wurde Abbé Joseph Axinger Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in der Sankt-Bonifatius-Mission, die von Jesuiten nach seinem Tode weitergeführt wurde, bis 1848 der Jesuitenpater Joseph Chable die „Mission Catholique de Langue Allemande“ in der heutigen Rue Lhomond übernahm. Da die Not der deutschsprachigen Bevölkerung im damaligen Vorort La Villette noch größer war, beschloss er dorthin umzuziehen. Nach längerem Suchen erwarb er dort ein Grundstück, auf dem er eine Kirche mit Schule erbauen ließ: Saint-Joseph-des-Allemands. -

Kontakt Nr. 14 / Mai 2019 2 MB
14 / Mai 2019 Mai / 14 Partnerschaftskomitee Parsberg / Vic-le-Comte Liebe Freunde der deutsch - französischen Partnerschaft, Europa wähl1...wähl1... am 26. Mai sind die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands aufgeru- fen, ihre Vertreter in das Europäi- Verbraucherschutz sche Parlament zu wählen. Ange- sichts der populistischen Strömun- gen in Europa und dem Erstarken Frieden nationalistischer Parteien, die die Europäische Gemenschaft in Fra- ge stellen, ist diese Wahl eine Energiesicherheit Schicksalsfrage für Europa. Jede Stimme für Europa ist wich- tig. Gerade die jungen Europäer Arbeitsplätze Werte sind aufgefordert, sich für ein star- kes Europäisches Parlament einzu- setzen. Die Folge, wenn man nicht an wichtigen Abstimmungen teil- nimmt, zeigt beispielhaft die Brexit- Entscheidung in Großbritannien. Umweltschutz Viele, die aus Desinteresse oder Gleichgültigkeit der Abstimmung damals ferngeblieben sind, bedau- ern heute den Brexit und dessen Wettbewerb Folgen Freizügigkeit Aber auch wir Älteren sind gefor- dert. Mehr als 70 Jahre hat die Eu- Sicherheit ropäische Gemeinschaft für ein friedliches Zusammenleben der Völ- ker Europas gesorgt.Trotz mancher Gehör in der Welt Unzulänglichkeiten ist die EU ein Garant dafür, dass sich Europa wirt- schaftlich, sozial und ökologisch entwickelt hat. Nur gemeinsam kön- Gerechtigkeit nen wir die Herausforderugen der Zukunft meistern. Der große euro- päische Gedanke ist keine Selbst- verständlichkeit und muss immer Sozialer Ausgleich wieder mit Leben erfüllt werden. Darum heißt es: Wählen gehen! Jede -

Dokumentation Chronik 2001-2002'
Dokumentation Chronik 2001-2002' 2001 Juli 1.-3.7. Bei seiner Russlandreise trifft Staatspräsident Jacques Chirac neben Prä• sident Wladimir Putin auch dessen Amtsvorgänger Boris Jelzin. Haupt themen der Gespräche sind Fragen der Sicherheit in Europa sowie die Wirtschafts beziehungen. Chirac begrüßt den - trotz einiger Meinungs unterschiede in der Tschetschenienfrage - mit Putin existierenden neuen Schwung in den französisch-russischen Beziehungen. 9.7 Die grüne Umweltministerin Dominique Voynet verlässt die Regierung, um sich vollständig ihrem Amt als Nationalsekretärin der Grünen zu widmen, in das sie knapp drei Wochen zuvor gewählt worden war. Neuer Umweltminister wird der Grüne Yves Cochet. Bei seinem Besuch in Washington trifft Verteidigungsminister Alain Richard seinen amerikanischen Amtsko\1egen Donald H. Rumsfeld. Hauptgesprächsthemen sind die amerikanischen Pläne zur Errichtung ei nes Raketenabwehrschildes (NMD) sowie die Lage in Mazedonien. 20.-22.7. Staatspräsident Chirac und Premierminister Jospin nehmen am G 8- Gipfel in Genua teil. Die Proteste von rund 200.000 Globalisierungskriti kern, in denen Gesundheitsminister Bernard Kouchner einen sich anbah nenden weltweiten Mai '68 erkennen will, sollen nach Meinung von Staatspräsident Chirac ernst genommen werden, da sie die Ängste der Leute gegenüber der Globalisierung widerspiegeln. 26.7. Der Sprecher der Sozialisten (PS), Vincent Peil/on, bedauert in einem In terview mit "Le Nouvel Observateur", dass keine Vertreter seiner Partei zu den Demonstrationsteilnehmern in Genua gehörten, da die dort vertre tenen Werte auch die des PS seien. Die ihm zufolge reformistischen De monstranten hätten außerdem zu Recht die grundsätzliche Legitimität der G 8-Gipfel in Frage gestellt, da diese kein klares Mandat hätten. 26.-28.7. Zu Beginn seiner dreitätigen Baltikum-Reise bekräftigt Staatspräsident Chirac gegenüber dem litauischen Präsidenten Valdas Adamkus die Un terstützung Frankreichs für einen EU-Beitritt Litauens, den er im Jahr 2004 für möglich hält. -

Die Geschichte Unserer Gemeine Sankt-Albertus-Magnus Paris
Die Geschichte unserer Gemeine Sankt-Albertus-Magnus Paris (Detaillierte Fassung) 17. Jahrhundert Historische Dokumente belegen, dass in Paris bereits im 17. Jahrhundert katholische Gottesdienste in deutscher Sprache gehalten wurden. Im Jahr 1627 wurde eine „Société Catholique des Nations Flamande et Allemande“ gegründet, die ihren Sitz in der Kirche Saint-Hippolyte auf dem Faubourg Saint-Marceau hatte. Bereits 1626 hatte König Ludwig XIII. den „Nations Belgiques et Teutoniques“ auf Bestreben der Herzogin von Brabant diese Kirche zugewiesen, damit diese dort Gottesdienste in ihrer Sprache abhalten konnten. Da sich diese Gemeinde damals weit außerhalb der Pariser Stadtgrenze befand, zog sie 1631 nach Saint-Germain-des-Prés, wo deutsche Gottesdienste bis 1718 nachweisbar sind. X18. Jahrhundert Allerdings gab es nachweislich auch noch im 18. Jahrhundert bis zur Französischen Revolution deutsche Predigten in verschiedenen Kirchen in Paris. Diese fanden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vor allem bei den Kapuzinern in der Rue Saint- Honoré statt. x19. Jahrhundert Mitte des 19. Jahrhunderts kamen durch massive Wanderbewegungen zahlreiche Handwerker und Arbeiter nach Paris, sodass man 1853 etwa 100.000 Menschen deutscher Sprache in Paris zählte! Da sie oft in sozial schlechten Situationen lebten, versuchte man eine eigene Seelsorge aufzubauen. 1825 begann der deutsche Priester Pater Bervenger in verschiedenen Pariser Kirchen zu wirken. Dies fand jedoch mit der Julirevolution 1830 bald wieder ein Ende. Am 12. November 1837 wurde Abbé Joseph Axinger Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in der Sankt-Bonifatius-Mission, die von Jesuiten nach seinem Tode weitergeführt wurde, bis 1848 der Jesuitenpater Joseph Chable die „Mission Catholique de Langue Allemande“ in der heutigen Rue Lhomond übernahm. -

Un Allemand Au Chevet De La Résistance Française ! Franz Stock, Allemand, Prêtre, Est Aumônier Des Prisons De Paris Entre 1940 Et 1945
Parution FRANZ STOCK octobre 2016 PASSEUR D’ÂMES Scénario : Jean-François Vivier Dessins : Denoël Couleurs : Joël Costes Un Allemand au chevet de la Résistance française ! Franz Stock, allemand, prêtre, est aumônier des prisons de Paris entre 1940 et 1945. Il accompagne ainsi plus de mille résistants fusillés au Mont Valérien. Après la guerre, il dirige l’expérience unique du Séminaire des barbelés, près de Chartres, où sont rassemblés les prisonniers de guerre allemands se préparant à la prêtrise. Marqué par les mouvements pour la paix, il est l’un des artisans de la réconciliation franco-allemande. Passionné de BD et d'Histoire, Jean-François Vivier développe la collection BD pour le groupe Artège après avoir créé il y a quelques années le label éditorial Rêves de bulles au profit d'œuvres humanitaires. Scénariste, il a déjà publié les biographies en image de Tom Morel et d'Hélie de Saint Marc, ainsi que l'adaptation du best-seller de Frison-Roche, Premier de cordée. En tandem avec Denoël, il a sorti l'an dernier une fiction historique intitulée Herr Docktor. Denoël, de son vrai nom Régis Parenteau- Denoël, est né en 1970 à versailles, après le CFT Gobelins, il devient profesionnel dans le storyboard de séries tv animées. En 1997 il publie son 1er album chez Glénat, Ombres et Lumière. En 2011, les éditions Une Idée Bizarre publient Sur les Pas dell’Arte. Depuis il enchaîne les albums aux éditions Artège : Cathelineau (2013), Herr Doktor (2015) et Franz Stock qui paraîtra en octobre 2016. Une passionnante biographie en image de l'aumônier des martyrs de la Résistance Déjà auteurs de la fiction historique Herr doktor dans Des mêmes auteurs laquelle apparaissait Franz Stock, Jean-François Vivier et Denoël nous font découvrir ici une vie d'une rare intensité. -
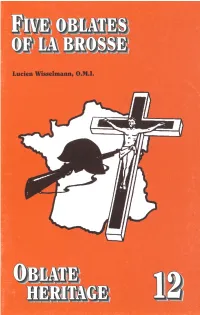
Five Oblates of La Brosse
Lucien Wisselmann, O.M.I FIVE OBLATES OF LA BROSSE by Lucien Wisselmann, O.M.I. 12 Oblate Heritage Series O.M.I. General Postulation Rome, Italy 1998 Translated by: James M. FitzPatrick, O.M.I. Cover: Claude Tardiff, O.M.I. Printed by: Tip. Citta Nuova Largo Cistina di Svezia, 17 00165 Roma (Italia) FIVE OBLATES OF LA BROSSE On July 24, 1944, five Oblates were killed in full view of The Victims the community of La Brosse-Montceaux. The three groups in the scholasticate, priests, professors, scholastics, brothers, were all represented. Fathers Christian Gilbert and Albert Piat were professors, Lucien Perrier and Jean Cuny were scholastics, and Joachim Nio was a brother. Fr. Christian Father Christian Gilbert, aged 32, from Asnieres, near Gilbert Paris, was professor of moral theology. He was well-liked O.M.I. as a spiritual director and confessor. He was also director of the choir. Learned and reserved, he was a man of holiness. Those seated near him in the chapel recalled seeing him wrapped in devotion, holding his oblation cross, during thanksgiving after Mass. He had the desire to be a martyr, and he once wrote, “We have the right to know the limits of our strength and to know how to go even beyond them” This found fulfilment on July 24. Fr. Albert Fr. Albert Piat, 35, was from Roubaix, in the north, and was Piat professor of Scripture. Each week he traveled to Paris to O.M.I. follow courses at the “Catholic Institute”. It seems that it was there that he first had contact with the publishers of the underground journal “Christian Witness”, and he made it known to his acquaintances. -

Friedensbemühungen Im Quickborn Von Meinulf Barbers
Friedensbemühungen im Quickborn von Meinulf Barbers Der Quickborn entwickelte sich aus Zirkeln abstinenter höherer Schüler, die sich ab 1909 in verschiedenen Orten Deutschlands bildeten. Ausgangspunkte waren die Erkenntnis der sozialen Not, des Elendsalkoholismus, und die Sorge für den Frieden. In der Nachfolge des hl. Franziskus strebten die jungen Leute Einfachheit, Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit an. In Schlesien engagierten sich besonders für den Frieden drei Priester, die für den jungen Bund, der ab 1913 auch Mädchen aufnahm, prägende Bedeutung bekamen. Bernhard Strehler (*1872 in Lissau/Westpreußen / + 11.12.1945 in Bad Charlottenbrunn / Niederschlesien) arbeitete seit der Jahrhundertwende an der Zeitschrift „Friedensblätter“ mit und übernahm zeitweise die Redaktion. Die Hefte wollten den Frieden und das religiöse Leben fördern. Seit 1903 war er Präfekt eines Konviktes in Neisse; von 1920 bis 1926 ließ er sich von seinem Bischof für die Arbeit auf Burg Rothenfels als gewählter „Bundesführer des Quickborn“ und Burgleiter beurlauben. Gerade auch der deutsch-polnischen Aussöhnung diente insbesondere der von Bernhard Strehler 1914 gegründete Heimgarten in Neisse, den in gleicher Weise auch Klemens Neumann mitprägte. Als Volksbildungshaus nach dem Vorbild dänischer Volksbildungsheime, als Mädchen-, Bauern- und Arbeitervolkshochschule und als Grenzlandvolkshochschule gab das Haus wichtige Anstöße für die Friedensarbeit. Klemens Neumann (* 28.11.1873 in Tütz / Westpreußen / + 5.7.1928 in Neisse) besuchte ein deutsch-französisches Gymnasium mit Internat in Antwerpen. Hier traf er Flamen und Wallonen, Franzosen, Engländer und auch weitere Deutsche und übte toleranten Umgang mit Menschen anderer Länder, deren Sprachen er intensiv erlernte. Nach der Priesterweihe 1899 und der Staatsprüfung in Religionslehre, Französisch und Hebräisch wurde er Religions- und Oberlehrer am Realgymnasium in Neisse und leitete dann auch den Kirchenchor und den Musikverein der Schule. -

Abbé Franz Stock (1904–1948)
Die Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr Soldat in Welt und Kirche 04I18 101. Katholikentag 2018 Suche Frieden Reportage vor Ort: Nachruf „Was kommt nach dem Krieg? zum Tod von Die Suche nach Frieden“ Karl Kardinal Lehmann ISSN 1865-5149 Editorial © KS / Doreen Bierdel Liebe Leserinnen und Leser. Für die Ausgabe April, die sich einen Monat vor Beginn des Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der deutschen 101. Deutschen Katholikentags in Münster mit dessen Leit- Sektion Pax Christi und Ordensleute für den Frieden ein- motto „Suche Frieden“ befasst und damit einen Beitrag aus schließlich der Initiative Kirche von unten (IKvu) verstanden Sicht der Katholischen Militärseelsorge leisten möchte, ist sich dabei als Teil der damaligen Friedensbewegung. Die es lohnenswert, 35 Jahre zurückzublicken. Katholikentage 1982 in Düsseldorf und 1984 in München gaben davon beredtes Zeugnis. Am 18. April 1983 veröffentlichten die Katholischen Bischö- fe das Wort der Deutschen Bischofskonferenz „Gerechtig- Die damals von Helmut Kohl (CDU) geführte Bundesregie- keit schafft Frieden“. Was bewegte die Bischöfe vor nun rung bezog unmittelbar nach dem Erscheinen des Bischofs- 35 Jahren, sich in einem eigenen Hirtenwort sowohl an die worts Stellung: „Das Hirtenwort nimmt von hoher theologi- Christgläubigen als auch an die Politik in Deutschland zu scher und ethisch-moralischer Warte Stellung zum zentralen wenden? Es zielte u. a. auf den Beschluss der Außen- und Problem unserer Zeit, der Wahrung und der Sicherung des Verteidigungsminister -

™ American Ecclesiastical Review
™ AMERICAN ECCLESIASTICAL REVIEW A MONTHLY PUBLICATION FOR THE CLERGY Cum Approbatione Superiorum VOL. CLIV JANUARY-JUNE, 1966 'Ei» ivl Tvebfiari, fuq. ifwxfi avvaffhovvTCS r% vlara rod diayyeklov Phil. 1:27 Published by THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA PRESS CONTENTS FOR VOLUME CLIV JANUARY Articles An Interview—Robert McAfee Brown: The Ecumenical Venture Dom Patrick Granfield 1 Collegial Responsibility for the Needy Churches Eugene Burke, C.S.P. 20 A "Piety Void"? Daniel L. Lowery, C.SS.R. 31 The Great Challenge to Church Musicians Johannes Somary 39 In Review 48 Answers to Questions Francis J. Connell, CSS.R. Interest on Stipends S3 Capital Punishment S3 Misuse of Headlines 54 Boo\ Reviews Personal Faith, by Carlos Cirne-Lima Translated by G. Richard Dimler, SJ. 57 Enciclopedia de orientacion bibliografica. Vols I and II. Director Thomas Zamarriego, SJ. 58 Philippine Duchesne: 1769-1852, by Louise Callan, R.S.C.J. 59 The Benedictine Nun, by Hubert van Zeller, O.S.B. 59 Christianity and Social Progress, by John F. Cronin, S.S. 60 Moral Philosophy, by Jacques Maritain 61 A World to Win, by Joseph A. Grassi, MM. 62 The Modern Mission Apostolate, edited by William J. Richardson, MM. 62 Steps to Christian Unity, edited by John A. O'Brien 63 The Mother of God. Her Physical Maternity: A Reappraisal, by Cletus Wessels, O.P. 64 The Catholic Church and Nazi Germany, 631 Guenter Lewy 65 Catholicism in English-Speaking Lands, by Mother Peter Carthy, OS.U. 66 The Art of the Canterbury Tales, by Paul G. Ruggiers 67 Lexikon fur Theologie und Kirche. -

Franz Stock Flyer Zur Person En
Further information has been published on the Reply Sheet/Form Internet under www.franz-stock.org/en (Please return to our mentioned addresses) Franz Stock My Address Your can reach us directly: Last Name, First Name ____________________________________________ Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V. Hauptstr. 11, D-59755 Arnsberg Street Tel. +49 (0) 2932 22050, Fax 02932 25468 or Rathausplatz 1, D-59759 Arnsberg ____________________________________________ Tel. +49 (0) 2932 9318804, Fax 02932 9318805 [email protected] Zip Code, City ____________________________________________ LES AMIS DE FRANZ STOCK Telephone Mairie du COUDRAY ____________________________________________ 32, Rue du Gord F-28630 LE COUDRAY Fax [email protected] ____________________________________________ Email Account for Donations Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V. ____________________________________________ Konto 19 010 008 ( ) I am requesting your call back BLZ 466 500 05 Sparkasse Arnsberg-Sundern ( ) I am .requesting you to send to me Books and Materials about Abbé Stock. Int. Bank Account Number: ( ) I want to become a Member and request DE85 46650005 0019010008 sending of corresponding documentation . Swift-Bic: WELADED1ARN ( ) I request Information about : ____________________________________________ ____________________________________________ English "Abbé Franz Stock – this is no name, it is a program“. Many resistance fighters, for instance Edmond Miche- The first public commemoration ceremony for Franz Nuncio Roncalli, the later Pope John XXIII, declared on let, Jean de Pange, Robert d´Harcourt, Gabriel Péri Stock was already conducted in 1949 in a cathedral February 28, 1948. and Honoré d'Estiennes d'Orves, paid homage to him. for the disabled in Paris. Never before has there Today the locality in front of the "Mémorial de la Fran- been a German so honored.