Automne 1956 Revuefolklore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Did Glooskap Kill the Dragon on the Kennebec? Roslyn
DID GLOOSKAP KILL THE DRAGON ON THE KENNEBEC? ROSLYN STRONG Figure 1. Rubbing of the "dragon" petroglyph Figure 2. Rock in the Kennebec River, Embden, Maine The following is a revised version of a slide presentation I gave at a NEARA meeting a number of years ago. I have accumulated so many fascinating pieces of reference that the whole subject should really be in two parts, so I will focus here on the dragon legends and in a future article will dwell more on the mythology of the other petroglyphs, such as thunderbirds. This whole subject began for me at least eight years ago when George Carter wrote in his column "Before Columbus" in the Ellsworth American that only Celtic dragons had arrows on their tails. The dragon petroglyph [Fig. 1] is on a large rock [Fig. 2] projecting into the Kennebec river in the town of Embden, which is close to Solon, in central Maine. It is just downstream from the rapids, and before the water level was raised by dams, would have been a logical place to put in after a portage. The "dragon" is one of over a hundred petroglyphs which includes many diverse subjects - there are quite a few canoes, animals of various kinds, human and ‘thunderbird’ figures. They were obviously done over a long period of time since there are many layers and the early ones are fainter. They are all pecked or ‘dinted’ which is the term used by archaeologists. The styles and technique seem to be related to the petroglyphs at Peterborough, Ontario, which in turn appear to be similar to those in Bohuslan, Sweden. -

Dragones Meridionales Que Mueven a Risa. Rito, Humor E Ingeniería
REA | Nº 0 | Marzo de 2015 05 ISSN: 2387-1555 DRAGONES MERIDIONALES QUE MUEVEN A RISA. RITO, HUMOR E INGENIERÍA José Antonio González Alcantud* © INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS DE CASTILLA Y LEÓN, Salamanca | 2015. Recebido em 03/12/2014 e aceito em 15/12/2014. Resumo: As tentativas do autor, enquanto antropólogo, Resumen: Los intentos del autor en tanto antropólogo para modernizar festas tradicionais que dão uma dimensão por modernizar fiestas tradicionales dándoles una de modernidade, colidiu quinze anos atrás com a dimensión de modernidad chocaron hace tres lustros con la incompreensão política. No entanto, em 2008, quase que incomprensión política. Sin embargo en el año 2008, casi por acaso, pude experimentar a concepção de engenharia por azar, pudo experimentar su concepción de la ingeniería cultural na condução da irmandade "Mediterrânea" das cultural llevando a cabo el hermanamiento “mediterráneo” tarascas de Tarascon- Arles, no sul da França, com a de de las tarascas de Tarascón-Arles, en el sur de Francia, con Granada, no sul da Espanha. O fio condutor desta la de Granada, en el sur de España. El hilo conductor de "engenharia" foi o clima festivo, que é a supremacia da esta “ingeniería” fue el humor festivo, la supremacía del linguagem carnavalesca. lenguaje carnavalesco. Palavras-chave: Tarascón, Arlés, Granada, humos, ritual, Palabras claves: Tarascón, Arlés, Granada, Tarasca, regionalismo, agressão. humor, ritual, regionalismo, agresión. “El que los politeísmos paganos hayan salido tiempo que propongo darle un giro practicista a siempre perdedores (...) se debe, entre otras la antropología cultural, no tanto por razones de razones, a su excepcional virtud de tolerancia. -

ICMA News...And More Spring 2020, No
Spring 2020, no. 1 ICMA NEWS...AND MORE Spring 2020, no. 1 Melanie Hanan, Editor Contents: FROM THE PRESIDENT, NINA ROWE ICMA News 1 Dear ICMA Members, From the President, Nina Rowe 1 I am honored to write to you as the newly elected President of the International Center of Member News 3 Medieval Art. We are at an exciting moment for the study of medieval art history and I am opti- Awards mistic about the direction of the field. Our community is engaged in initiatives both academic Books Appointments and public-facing, launching projects aimed at broadening the scope of our inquiry and wel- coming a range of voices to the conversation. This issue of ICMA News chronicles the strength Commemorations: 7 of our history as well as the promise of our work going forward—with a suite of memorials David Jacoby, 1928 – 2018 for long-time friends of the organization and notices about innovative projects undertaken by Danielle Valin Johnson, a crop of rising scholars. 1938 – 2019 Martin Warnke, 1937 – 2019 But this is also a time of uncertainties. As I write, concern over the spread of the COVID-19 Georgia Wright, virus has led many colleges and universities to shift away from face-to-face instruction, tran- 1937 – 2019 sitioning to online teaching. Conferences and lectures around the world are being canceled or Member Events: 12 postponed. And many of us are preoccupied with caring for loved ones who are vulnerable. At Special Features 20 the ICMA we will do what we can to offer resources and guidance to help you through this dif- Reflection:HBK ficult period. -

A Survey of the Drama of Colonial Mexico
Loyola University Chicago Loyola eCommons Master's Theses Theses and Dissertations 1943 A Survey of the Drama of Colonial Mexico Edward Aloysius Dwyer Loyola University Chicago Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/luc_theses Part of the Latin American Literature Commons Recommended Citation Dwyer, Edward Aloysius, "A Survey of the Drama of Colonial Mexico" (1943). Master's Theses. 580. https://ecommons.luc.edu/luc_theses/580 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 1943 Edward Aloysius Dwyer A SURVEY OF THI DRAMA OJ .' OOLONIAL MIXIOO ,;., .A. Thesis ,. Present ed to the Faculty of the Graduate School Loyola University I n Par t 1 al Ful f i 11m e nt of the Requirements tor the Degree Mast er of Art 8 by Edward Aloysius Dwyer December 1943 • •• VI TA ••. .' The candidate was born on May 18th, 1904, in Rutland Township, Kane County, Illinois, the son of Edward Dwyer and Catherine Clinnin Dwyer. The paternal grandparents, Richard Dwyer and Ellen !arry Moore Dwyer, ~were the first to possess the land after the aboriginal inhabitants. Illen !arry was a cousin of Captain Jack !arry, the,. first Naval Officer ap pointed by George Washington after the Declaration of Inde- pendence and therefore the founder of the Navy of the United States of America. -

A Janus-Faced Sea: Contrasting Perceptions and Experiences of the Mediterranean
A Janus-faced Sea: Contrasting Perceptions and Experiences of the Mediterranean Henk Driessen Institute for Cultural and Social Anthropology, Mediterranean Studies, University of Nijmegen, The Netherlands [email protected] Abstract This article makes a plea for more systematic attention in maritime anthropology to the under researched topic of how people perceive and relate to the sea. More specifically, it deals with different perceptions and experiences of the Mediterranean. At its core is an account told by a clandestine Moroccan immigrant about his experience of crossing the Strait of Gibraltar. The agonistic image of the sea arising from this contemporary narrative is discussed against the historical back- ground of changing attitudes towards the sea and contrasted to the tourist image of a benevolent Mediterranean that has become so pervasive over the past fifty years. A sailor drowned in the sea’s depths. Unaware, his mother goes and lights a tall candle before the ikon of our Lady, praying that he’ll come back quickly, that the weather may be good – her ear cocked always to the wind. While she prays and supplicates, the ikon listens, solemn, sad, knowing the son she waits for never will come back. (C.P. Cavafy, ‘Prayer’) Introduction Over the past fifteen years there has been a shift in maritime anthropology from general ethnographic themes to policy-oriented topics such as over fishing, man- agement systems, legal pluralism, coping strategies and sustainability of marine resources (van Ginkel 2003). This trend reinforces the one-sided focus in maritime studies on the instrumental aspects of the relationships people, almost exclusively fishermen, maintain with the sea. -

On the External Relations of Purepecha: an Investigation Into Classification, Contact and Patterns of Word Formation Kate Bellamy
On the external relations of Purepecha: An investigation into classification, contact and patterns of word formation Kate Bellamy To cite this version: Kate Bellamy. On the external relations of Purepecha: An investigation into classification, contact and patterns of word formation. Linguistics. Leiden University, 2018. English. tel-03280941 HAL Id: tel-03280941 https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-03280941 Submitted on 7 Jul 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/61624 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Bellamy, K.R. Title: On the external relations of Purepecha : an investigation into classification, contact and patterns of word formation Issue Date: 2018-04-26 On the external relations of Purepecha An investigation into classification, contact and patterns of word formation Published by LOT Telephone: +31 30 253 6111 Trans 10 3512 JK Utrecht Email: [email protected] The Netherlands http://www.lotschool.nl Cover illustration: Kate Bellamy. ISBN: 978-94-6093-282-3 NUR 616 Copyright © 2018: Kate Bellamy. All rights reserved. On the external relations of Purepecha An investigation into classification, contact and patterns of word formation PROEFSCHRIFT te verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus prof. -
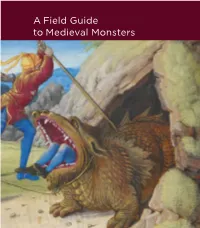
A Field Guide to Medieval Monsters Unicorns
A Field Guide to Medieval Monsters Unicorns. Griffins. Dragons. Sirens. Some of these monsters you may recognize from fairy July 7–October 6 tales, Greek and Roman mythology, or books about your favorite boy wizard. In the Middle Ages, these monsters and many more made their way onto the pages of illuminated manu- scripts. These handwritten texts, which include bibles, books of hours, and books of psalms, were often decorated with elaborate designs and images. This exhibition, Medieval Monsters: Terrors, Aliens, Wonders, explores how images of monsters played a complex role in medi- eval society and operated in a variety of ways, often instilling fear, revulsion, devotion, or wonderment. Medieval Monsters is organized by the Morgan Library & Museum, New York. Supporting Sponsor: The Womens Council of the Cleveland Museum of Art Media Sponsor: Before you start You are ready to go! Use exploring, there is some this field guide to identify monster terminology monsters you encounter you may need to know. throughout the exhibition. Anthropomorphic a creature or object having humanlike Basilisk a reptile or serpent who can Livre des merveilles du monde (Book of Marvels of the World), characteristics cause death with a glance, often described in French, c. 1460. Illuminated by the Master of the Geneva as a crested snake or as a rooster with a Boccaccio. France, Angers. Ink snake’s tail. Here, the basilisk appears in an and tempera on vellum. The Cryptozoology the study of hidden creatures, which aims to Morgan Library & Museum, image that is supposed to represent Ethiopia. Purchased by Pierpont Morgan prove the existence of beasts from folklore (1837–1913), 1911, MS M.461 (fol. -

La Tarasque, Et Sainte Marthe, Qui Fig- Ure Parmi La Liste Des Saints Sauroctones (Saint Vainqueur D'un Dragon Ou D'un Serpent)
TARASQUE , COMINGET CIE Tarasque de la Effigie Museon Arlaten. © S. Normand, coll. >MUSEO ÇA PARLE DE : #TARASQUESOON #MONSTRE #LÉGENDAIRE #GRAPHIERHÔNE # CROYANCE #FÊTES ETHNO Une des plUs célèbres légendes provençales met en scène Un LOGIE dragon anthropophage, la tarasqUe, et sainte marthe, qUi fig- Ure parmi la liste des saints saUroctones (saint vainqUeUr d'Un dragon oU d'Un serpent). cette histoire Unissant Une ville à Un animal monstrUeUx et Un saint libérateUr n'est pas exclUsive- ETHNOLOGIEment provençale. eMUSEOGRAPHIEn effet, en france, on dénombre près de 40 villes dont l'histoire est associée à Un dragon. Selon la tradition... ... l'histoire commenceETHNOLOGIE lorsque Marthe arrive de Palestine. En COMING SOONremontant le Rhône, elle s'arrête à Tarascon et y trouve des villageois terrorisés. Un monstre hante les bords du Rhône. Ce dragon amphibie à six pattes et à la carapace hérissée de piquants, est armé de griffes et de dents qui ravagent la régione et dévore troupeaux et population. Marthe s'avance jusqu'à la grotte qui abrite la Tarasque et dompte COMING SOONl'animal. Avec sa ceinture, elle la conduit jusqu’à la foule qui s'empresse de la mettre à mort. Marthe devient la patronne de la ville. « [...] un dragon moitié animal, moitié poisson, plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval avec des dents semblables à des épées et grosses comme COMING SOONdes cornes, qui était armé de chaque côté de deux boucliers [...] » Jacques de Voragine, La légende dorée (vers 1255). Au 15e siècle, le roi René d'Anjou hérite du royaume de Provence et vient y séjourner. -

The Role and Symbolism of the Dragon in Vernacular Saints' Legends, 1200
THE ROLE AND SYMBOLISM OF THE DRAGON IN VERNACULAR SAINTS' LEGENDS, 1200-1500 BY PATRICIABROWN A thesis submitted to the Faculty of Arts of the University of Birmingham for the degree of DOCTOROF PHILOSOPHY School of English Faculty of Arts The University of Birmingham July 1998 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT This thesis looks at the role and function of the dragon in the saint's encounter with the monster in hagiographictexts, written primarily in the vernacular, between 1200 and 1500. Those connotationsaccrued by the dragonwhich are relevantto this thesis are traced from their earliestbeginnings. Although by the middle ages the multi-valencyof the dragon is reducedto one primary symbolic valency, that of evil and significantly, the evil of paganism, the dragon never loses completely its ancient associations and they help to colour its function within the narrative. The symbolic use of the dragon in vernacular saints' lives is generally consistent, althoughallowing for differentdidactic emphases. However,the two legends on which this thesis concentrates are those of St George from Caxton's Golden Legend and St Margaretfrom the KatherineGroup. -

Arles, St-Martin-De-Crau and Tarascon Business
16 LIVING & WORKING in PROVENCE Arles, St-Martin-de-Crau and Tarascon Business Parks On the left bank of the Rhône, between the Mediterranean and the Alpilles Nature Park, you will fi nd the Arles, St-Martin-de-Crau and Tarascon business parks. They offer convenient access to an array of charming recreational destinations such as the La Crau plain, fruit and vegetable farms, the lagoons of the Camargue and historical sites. Création : Arc en ciel Marseille - Crédits photo : Provence Promotion - Couverture : © Fotolia Provence Promotion - Couverture : Arc en ciel Marseille - Crédits photo : Création : www.investinprovence.com ARE YOU GOING TO WORK IN ONE OF THE BUSINESS PARKS AT ARLES, TARASCON OR ST. MARTIN DE CRAU? CHOOSE YOUR LIFESTYLE! DO YOU LIKE CITIES WITH A HUMAN DIMENSION? Arles is a city of extraordinary cultural wealth; it has many preserved Roman monuments that are listed on the UNESCO World Heritage list. The city beats to the rhythm of its many celebrations, including the famous Rencontres d’Arles photography festival and its entertaining Feria bull festivals. Arles is a university town with over 1,300 DO YOU PREFER students. It is less than 30 minutes from Tarascon, a historic town with its Tarasque celebrations, THE COUNTRYSIDE? and from St Martin- de-Crau, a modern city with plenty of sports and cultural resources. You will love Fontvieille, Le Paradou and Maussane - picturesque Provencal villages set against the backdrop of the Alpilles Massif. They open up to splendid landscapes: rolling mountains covered in scrub, pine and oak forests, LA PROVENCE, olive groves and lush green plains. -

La Tarasque, Selon Un Tableau Xviiie Provenant De L'hôtel Baroncelli-Javon, Dit "Le Palais Du Roure", À Avignon
LL*IDIôm TAMSQUE Louis Renard É Q U i M • X E A la mémoire de Jean-Baptiste-François Renard et de Marthe Cart ailler, mes chers parents. L. R. Illustration de couverture : La Tarasque, selon un tableau XVIIIe provenant de l'hôtel Baroncelli-Javon, dit "Le Palais du Roure", à Avignon. On remarquera les symboles francs-maçons. Le tombeau marqué Gehova, l'étoile avec l'initiale de ce nom, les colonnes renversées du Temple de Salomon (portant les lettres BJ), le compas et l'équerre d'Hyram son architecte. Le château de Tarascon en arrière-plan ajoute un intéressant document iconographique à cette très inhabituelle représentation de la Tarasque qui lie, pour en faire mieux res- sortir toutes les origines mystérieuses, légende chthonienne et ésotérisme. Tableau conservé dans la famille. Cliché 4e de couverture : Daniel Bounias S ÉDITIONS DE L'ÉQUINOXE. 1991 Mas du Sacré-Cœur, 30320 Marguerittes ISBN 2-908209-13-6 Préface En cette Provence sacrée et mythique s'éternisent les Hadès ou Enfer, que vont anéantir ou asservir héros, saints légendes. Racines profondes de notre humanisme gréco- ou preux de la geste épique ou du cycle arthurien. latin se glissant dans le monde médiéval et chrétien. Inter- Louis Renard remonte ainsi l'histoire et la tradition pour pénétration du paganisme et du christianisme que nous mieux éclairer l'une des plus célèbres légendes du midi retrouvons dans la geste des héros de l'Antiquité et dans de la France. En ce Tarascon-sur-Rhône revivent, grâce à celle des saints victorieux, dans nos pèlerinages où se mê- son talent, la Tarasque et sainte Marthe. -

La Procesión Del Corpus En Sevilla. Influencias
A PROCESIÓN DEL CORPUS EN SEVILLA. INFLUENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS EN LLA EVOLUCIÓN DEL CORTEJO MARÍA JESÚS SANZ Departamento de Historia del Arte. Universidad de Sevilla Abstract: This paper deals about the changes happened in the procession of the Corpus Christi in Seville. We have news of that from 1363, and along the following centuries, but the most interesting is the way the procession is represented by two series of drawings one from 1747, and the other from 1866. This two series allow us to see the differences between them, that were due mainly to the politic, social, and reli- gious changes. Key words: Eucharistic feast / procession / brotherhoods / sculpture / social change. Resumen: Se trata en este artículo sobre los cambios ocurridos en la procesión del Corpus Christi en Sevilla. La primera noticia es de 1363, y a partir de esta fecha se conocen bastantes acontecimientos en los siglos siguientes, pero lo más interesante es la manera en que se representa la procesión en dos series de dibu- jos, uno de 1747, y el otro de 1866. Estas dos series nos permiten apreciar las diferencias entre ellos, que se debieron principalmente a los cambios, políticos, sociales y religiosos. Palabras clave: Fiesta eucarística / procesión / hermandades / esculturas / cambio social. La procesión del Corpus, celebrada siempre en pero en el último tercio del siglo se han realizado jueves, según la liturgia tradicional, ha cambiado bastantes más.2 en los últimos años al domingo siguiente al dicho En lo que respecta a la difusión popular, algunos jueves, debido a las necesidades del mundo con- temporáneo.