Downloaded from Pubfactory at 09/23/2021 08:23:36PM Via Free Access 186 Les Modernes D’Egypte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arabic Language and Literature 1979 - 2018
ARABIC LANGUAGEAND LITERATURE ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE 1979 - 2018 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE A Fleeting Glimpse In the name of Allah and praise be unto Him Peace and blessings be upon His Messenger May Allah have mercy on King Faisal He bequeathed a rich humane legacy A great global endeavor An everlasting development enterprise An enlightened guidance He believed that the Ummah advances with knowledge And blossoms by celebrating scholars By appreciating the efforts of achievers In the fields of science and humanities After his passing -May Allah have mercy on his soul- His sons sensed the grand mission They took it upon themselves to embrace the task 6 They established the King Faisal Foundation To serve science and humanity Prince Abdullah Al-Faisal announced The idea of King Faisal Prize They believed in the idea Blessed the move Work started off, serving Islam and Arabic Followed by science and medicine to serve humanity Decades of effort and achievement Getting close to miracles With devotion and dedicated The Prize has been awarded To hundreds of scholars From different parts of the world The Prize has highlighted their works Recognized their achievements Never looking at race or color Nationality or religion This year, here we are Celebrating the Prize›s fortieth anniversary The year of maturity and fulfillment Of an enterprise that has lived on for years Serving humanity, Islam, and Muslims May Allah have mercy on the soul of the leader Al-Faisal The peerless eternal inspirer May Allah save Salman the eminent leader Preserve home of Islam, beacon of guidance. -

I Did Not Know the Levant in Its Heyday, I Arrived Too Late, All That
1 I did not know the Levant in its heyday, I arrived too late, all that was left of the spectacle was a tattered backcloth, all that remained of the banquet were a few crumbs. But I always hoped that one day the party might start up again, I did not want to believe that fate had seen me born into a house already condemned to demolition. My people have built many houses, from Anatolia to Mount Lebanon, to coastal cities and the valley of the Nile, only to abandon them, one after another. I feel a nostalgia for them, unsurprisingly, and also a little stoic resignation when confronted by the vanity of things. Never become attached to something you might miss when the day comes that you must leave! It was in Beirut that I was born, on February 25, 1949. The news was announced the following day, as was once cus- tomary, via a paragraph in the newspaper where my father worked: Mother and child are both doing well. The country and the region, on the other hand, were doing badly. Few realized it at the time, but the descent into hell had already begun. Egypt, the adoptive country of my mother’s family, was in turmoil. On February 12, two weeks before my birth, Hassan al-Banna, founder of the Muslim Brotherhood, had been assassinated. He had gone to meet with one of his political allies; as he left the building, a car drew up and a gunman fired. Although shot in the chest, he did not collapse and the wound did not seem serious. -

Download Download
3 2 1 Indian Journal of ijll2 ARTICLE LANGUAGE AND LINGUISTICS VIEW RE ARTICLE RESEARCH Review on the Child in Modern Iraqi Poetry DOI: 10.34256/ DOI: a, * Muna Salah Hasan a Department of Arabic, College of Education for Girls, Kufa University, Iraq. *Corresponding author Email: [email protected] DOI: https://doi.org/10.34256/ijll2123 Received: 30-05-2021, Revised: 27-06-2021; Accepted: 28-06-2021; Published: 30-06-2021 Abstract: The image of the child in its various shades is one of the common images in Arabic poems from the pre- Islamic era to the modern era, but it did not receive the attention of scholars, and it was not studied in depth showing its connotations and symbols. Hence came my study entitled "The Child in Contemporary Iraqi Poetry", which is an attempt to clarify the symbols of the word (the child) and what it indicates according to the context in which they are mentioned, as well as the statement of the aesthetic aspects of how to employ these symbols through the selection of poetic texts of modern poets in which the image of the child was mentioned Where this image was linked to the intellectual and political framework of the trends of Iraqi poets to create with it multiple connotations that were in harmony with the successive conflicts and revolutions that the poet employed to express intellectual, political and artistic positions. Modern Iraqi poetry by this expression means what many poets wrote in a non-traditional or traditional (classical) poetry curriculum in the literature of their languages. -

The Nile and the Egyptian Revolutions: Ecology and Culture in Modern Arabic Poetry 2015
International Journal of Research in Humanities and Social Studies Volume 2, Issue 5, May 2015, PP 84-95 ISSN 2394-6288 (Print) & ISSN 2394-6296 (Online) The Nile and the Egyptian Revolutions: Ecology and Culture in Modern Arabic Poetry 2015 Hala Ewaidat Assistant Professor of English Literature, Department of English, Faculty of Education, Mansoura University, Egypt ABSTRACT For more than thirty years the River Nile has been deteriorating as a result of the industrial activities, economic expansion, pollution, population growth and the destructive policies of the government of the former president Hosni Mubarak. The primary concern of this study is to introduce the profound connection of environmental changes on the River Nile and the culture of the Egyptian society that is reflected through the medium of twentieth century Arabic poetry. Beginning with excerpts of poems from the ancient period, the paper traces the relevance and meaning of the underlying cultural aspects of Egyptian society through representation of the Nile in comparison to the way these cultural attitudes are depicted in poetry written during the three major revolutions in twentieth century Egypt: the 1919 Revolution, 1952 Revolution, and the 25 January 2011 Revolution. Keywords: ecology, pollution, culture, revolutions, Arabic poetry For more than thirty years the River Nile has deteriorated as a result of the industrial activities, economic expansion, pollution, population growth and destructive policies of the regime of the former president Hosni Mubarak (1981-2011). The primary concern of this study is to examine the profound connection between the image of the River Nile in ancient and modern Egyptian poetry and its relation to the ecological changes to the River during the three major revolutions in Egypt: the 1919 Revolution, 1952 Revolution, and the 25 January 2011 Revolution. -

Thesis Submitted in Accordance with the Requirements for the Degree Of
Modern Arabic Literary Biography: A study of character portrayal in the works of Egyptian biographers of the first half of the Twentieth Century, with special reference to literary biography BY WAHEED MOHAMED AWAD MOWAFY Thesissubmitted in accordancewith the requirementsfor the degreeof Doctor of Philosophy The University of Leeds The Department of Arabic and Middle Eastern Studies June 1999 I confirm that the work submitt&d is my own and that appropriate credit has been given where referenceshave been made to the work of others ACKNONNILEDGEMENTS During the period of this study I have received support and assistýncefrom a number of people. First I would like to expressmy sincere gratitude and appreciation to my supervisor Dr. A. Shiviiel, who guided me throughout this study with encouragement, patience and support. His generoushelp was always there whenever neededand he undoubtedly easedmy task. I also acknowledgemy indebtednessto the Faculty of Da*ral-ýJlýrn, Cairo University, PP) OW Op 4t or and in particular to Profs. Raja Jabr and al-Tahir Ahmed Makki and Abd al-Sabur 000 SIýZin for inspiring me in my study of Arabic Literature. Next I would like to thank the Egyptian EducationBureau and in particular the Cultural Counsellorsfor their support. I also wish to expressmy gratitudeto Prof Atiyya Amir of Stockholm University, Prof. C Ob 9 Muhammad Abd al-Halim of S. 0. A. S., London University, Prof. lbrlfrim Abd al- C Rahmaonof Ain ShamsUniversity, Dr. Muhammad Slim Makki"and Mr. W. Aziz for 0V their unlimited assistance. 07 Finally, I would like to thank Mr. A. al-Rais for designing the cover of the thesis, Mr. -

National University Archive
NATIONAL UNIVERSITY Syllabus Department of Arabic One Year Master’s Course Effective from the Session: 2013-2014 National University Subject: Arabic Syllabus for One-Year Master’s Course Effective from the Session: 2013-2014 Paper Code Paper Title Credits 311201 Classical Prose 4 311203 Classical Poetry 4 311205 Modern Prose 4 311207 Modern Poetry 4 311209 History of Middle East 4 311211 History of Islamic Civilization 4 311213 Arabic Calligraphy 4 311214 Term Paper 2 311216 Viva-Voce 2 Total = 32 2 Detailed Syllabus Paper Code 311201 -------- Credits: 4 Class Hours: 120 hrs. Paper Title: Classical Prose a. Al-Qur`n 1. Muhammad Ali Al-Sabuni : Safwat al-Tafsir: Suratu Yasin. b. Al-Hadith 1. Al-Jabidi : TajridulBukhari:Kitabul Ate’ema, Kitabul Adab c. Litterature 1. Al- Zahej : Al-Bukhala: Qissatu Jabidah Bin Hamid Paper Code 311203 -------- Credits: 4 Class Hours: 120 hrs. Paper Title: Classical Poetry Books Prescribed: 1. Antara : Al- Moallaqa (1-30 Verses) 2. Abu tammam : Diwan al-Hamasah, Bab al-Hamasah (1-30 Verses) 3.Abu Nuwas : Bab al-Sadis fi al-Zuhd (1-52 Verses) Paper Code 311205 -------- Credits: 4 Class Hours: 120 hrs. Paper Title: Modern Prose Books Prescribed: 1. Taha hosain : Al-Ayyam. 2. Al-Aqqad : Athar al- Arab fi al-Hadarat al- Uruwwiyya Paper Code 311207 -------- Credits: 4 Class Hours: 120 hrs. Paper Title: Modern Poetry Books Prescribed: Ahmed Shawqi Beg : Diwan Ahmad shawqi: Qasidato Nahj al-Burdah Hafez Ibrahim : Diwan Hafez Ibrahim: Qasidato Rithau al-Ustaj al-Imam Al-Saekh Mohammad Abduhu. Al- Rusafi : Diwan: Ummul Yeatim. Book Recommended: Dr. Mohammad Fozlur Rahman: Avie gbxlv. -

M.A. in Arabic
ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR DEPARTMENT OF ARABIC M.A. PROGRAMME IN ARABIC (CBCS) SYLLABUS (Effective from July 2021) 1 SYLLABUS FOR M.A. PROGRAMME IN ARABIC (CBCS) (Effective from July 2021) C0NTENTS Semester Course Code Course Title Page No. ARBCC-101 Grammar : Principles and Practice 4 ARBCC-102 Classical Prose (From pre-Islamic to Abbasid period) 5 I ARBCC-103 History of Arabic Literature-I 6 ARBCC-104 Classical Poetry (From pre-Islamic to Abbasid period) 7 ARBCC-105 Arabic for Communication-I 8 ARBCC-201 Modern Prose 9 ARBCC-202 Modern Poetry 10 II ARBOC-203 (a) Arab Contribution to World Culture and Civilization 11 (b) Arabic for Beginners 12 ARBOC-204 Arabic for Communication-II 13 ARBCC-205 Rhetoric, Prosody and Linguistics 14 ARBCC- 301 Translation : Theory & Practice 15 ARBCC- 302 Fiction 16 III ARBCC- 303 Literary Theory and Criticism 17 ARBCC- 304 History of Arabic Literature-II 18 ARBCC- 305 Arabic for Communication-III 20 ARBCC- 401 Fundamentals of Academic Writing 20 ARBCC- 402 Drama 22 IV ARBCC- 403 Indian Writings in Arabic 23 ARBCC- 404 Arab Culture and Civilization 24 ARBCC- 405 Computer Application and ICT Tools for Arabic Learning 26 2 Specifications/Common Features of the Courses Each course is divided into five equal units. Each course has 6 (six) credit points and 100 marks with 6 contact hours per week (4 hours of lectures, 2 hours of tutorial and other activities). The internal assessment carries 30 marks, while the end-semester examination carries 70 marks. In the end semester examination, a unit of each course carries 14 marks and in each course the questions for 30-35 marks are to be answered compulsorily in Arabic. -

Re-Defining the Image of Beirut in Modern Arabic Literature
Nebula 8.1 , December 2011 Re-defining The Image of Beirut in Modern Arabic Literature. By Saddik M. Gohar Abstract Subverting the conspiracy theory advocated by some Arab critics who claim that the establishment of modern Arab cities was threatening to the Euro-American project of cultural, political, economic and military colonization in the Middle East, the paper explores the image of Beirut in contemporary Arabic literature – particularly in the poetry of Khalil Hawi, Nizar Qabbani and Mahmoud Darwish – in order to investigate several issues of trans-cultural and geo-political significance. The paper argues that there is no similarity between the Arab city and its western counterpart, where human relationships are disrupted by the intervention of the machine and where the poet witnesses the collapse of human relationships. It is obvious that the Arab city does not have the complicated technology or industrial infrastructure which would dehumanize the poet or put pressure on his psyche and consciousness as in the West . Therefore, it is significant to argue that in Arabic literature, there are no city poets in the western sense because Arab cities unfortunately failed to create poets like Eliot, Baudelaire, Pound, Whitman, Ginsberg, and others. However, the Arab city has other oppression mechanisms such as persecution, torture and denial of human rights. These elements are sufficient to generate hostility on the part of the poet toward the city and its dwellers. Introduction In The Culture of Cities , Lewis Mumford states that "cities cause men and women to behave in various patterns, not always to their betterment (Mumford 1969: 34 1). -
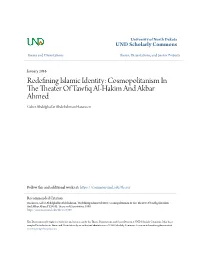
Cosmopolitanism in the Theater of Tawfiq Al-Hakim and Akbar Ahmed Gaber Abdelghaffar Abdelrahman Hasaneen
University of North Dakota UND Scholarly Commons Theses and Dissertations Theses, Dissertations, and Senior Projects January 2016 Redefining Islamic Identity: Cosmopolitanism In The Theater Of Tawfiq Al-Hakim And Akbar Ahmed Gaber Abdelghaffar Abdelrahman Hasaneen Follow this and additional works at: https://commons.und.edu/theses Recommended Citation Hasaneen, Gaber Abdelghaffar Abdelrahman, "Redefining Islamic Identity: Cosmopolitanism In The Theater Of Tawfiq Al-Hakim And Akbar Ahmed" (2016). Theses and Dissertations. 1899. https://commons.und.edu/theses/1899 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, and Senior Projects at UND Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UND Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. REDEFINING ISLAMIC IDENTITY: COSMOPOLITANISM IN THE THEATER OF TAWFIQ AL-HAKIM AND AKBAR AHMED by Gaber Abdelghaffar Abdelrahman Hasaneen Bachelor of Arts, Assiut University, 2000 Master of Arts, Assiut University, 2004 A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the University of North Dakota in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Grand Forks, North Dakota May 2016 PERMISSION Title Redefining Islamic Identity: Cosmopolitanism in the Theater of Tawfiq Al- Hakim and Akbar Ahmed Department English Degree Doctor of Philosophy In presenting this dissertation in partial fulfillment of the requirements for a graduate degree from the University of North Dakota, I agree that the library of this University shall make it freely available for inspection. I further agree that permission for extensive copying for scholarly purposes may be granted by the professor who supervised my dissertation work or, in his absence, by the Chairperson of the department or the dean of the School of Graduate Studies. -

The Place of North African Literature in African Literary Canon
Greener Journal of Language and Literature Research Vol. 6(1), pp. 1-10, 2020 ISSN: 2384-6402 Copyright ©2020, the copyright of this article is retained by the author(s) https://gjournals.org/GJLLR The Place of North African Literature in African Literary Canon Oluwatoyin Umar Plateau State University, Bokkos Plateau State University, Bokkos ARTICLE INFO ABSTRACT Article No.: 030620047 This study is an evaluation of North African literature, aimed at Type: Research contributing to the few available discourses on the rather “silent” voices of writers from North Africa in mainstream African literary studies. Within the theoretical framework of New Historicism, the study examines the influence of Arab nationalism, colonialism, as well as literary trends and Accepted: 18/03/2020 movements on the development of modern North African literature. The Published: 20/05/2020 study provides textual analyses of selected works of Driss Chraibi, Tayeb Salih, Nawal El Saadawi, Tawfiq Al-Hakim, Abdelkader Alloula, Kateb *Corresponding Author Yacine, Ahmed Shawqi, Al-Qasim Al-Shabbi and Muhammad Al-Fayturi, Oluwatoyin Umar which are available in English translations from Arabic or French. This E-mail: funtofe3@ gmail. com work identifies themes of anti-colonialism, cultural identity, quest for Phone: 08060870823 freedom, leadership problems and patriarchy, as recurring themes in North African poetry, prose and drama. The study traces and locates the place of North African literature in African literature, and concludes that Keywords: North Africa; North African literature is both Arab and African. colonialism; Arab INTRODUCTION African countries. Mazurui, quoted in Soghayroon has argued that Sudan is an “African country in a racial North African literature developed from sense and an Arab country in a cultural sense ... -

A Saudi Representation of America and the Americans an Imagological Study of Ghazi Al-Gosaibi’S Works
1 A Saudi Representation of America and the Americans An Imagological Study of Ghazi Al-Gosaibi’s Works A thesis submitted by Mohammed Faia Asiri For the degree of Doctor of Philosophy in Arab and Islamic Studies The University of Exeter The Institute of Arabic and Islamic studies January 2020 This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all content in this thesis, which is not my work, has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. ..................................... (Signature) 2 Abstract Distinct images of America and Americans began to emerge in Saudi culture and literature after the discovery of oil in the Arabian Peninsula since 1938. This historical event not only brought American oil companies to the region but also raised substantial cultural questions about the self and the Other. Later on, the continuous American presence has come for economic and political purposes in Saudi Arabia, such as in the Arabian American Oil Company (ARAMCO, which is called now Saudi ARAMCO), and the Gulf War in 1990-1991. This presence has been reflected in Saudi literature, both poetry and narrative prose. This thesis sets out to study the image of America in Saudi novels in order to understand its dimensions, structures and techniques. The study centres its data and analysis on one significant contemporary Saudi author, Ghazi Al-Gosaibi (1940-2010) who engages consistently with the American theme in most of his writings as characters, spaces, speeches and culture for various purposes. -

Poetic Oppositions (Imitation)In the Poetry Collection of Amir
Journal of University of Shanghai for Science and Technology ISSN: 1007-6735 Poetic Oppositions (Imitation)In The Poetry Collection Of Amir Al-Bayan ShakibArslan Mr. KhalidMohammedYaseen Anbar University - Iraq Assist. Prof. Dr. Ahmed Abdulazeez Awad Anbar University - Iraq Abstract: This Research focuses on a literary poetic art well known to Arab poets, both ancient and modern, and we chose Prince ShakibArslan's poetry collection to study this phenomenon in it and mention his oppositions and their types with a statement of his distinction in it over his peers. Poetry, both word and meaning was achieved by our poet Shakib Arslan. Key words: poetic opposition, the poet Shakib Arslan Introduction: Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon the master of all creations, Mohammed Al-TahirAl-Amin, his family and Companions. I was concerning with the poetry of Amir al-Bayan ShakibArslan to touch some of the various literary arts in it, and among the most prominent of these arts is the art of oppositions, which formed a phenomenon in the poet’s office, even though it is a small collection in size compared to the poetry collections of his generation, and what prompted me to study this phenomenon with this poet It is the reluctance of researchers to study and research the Emir of the Bayan’s poetry and the lack of eating his poetry or a phenomenon of his poetry. Therefore, this study came to shed light on this poet and to open the way for other researchers, hoping that they might find other phenomena in Prince Shakeeb’s court that deserve study.