Rp-69920-Fr Oca-Hydrosed-Lateste.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
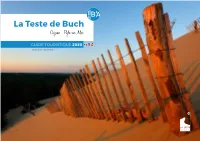
Guide-Touristique-2020-1.Pdf
La Teste de Buch Cazaux - Pyla sur Mer GUIDE TOURISTIQUE 2020 Touristic guide - Guía turística SOMMAIRE [ La Teste de Buch - Dune du Pilat ] Les rendez-vous 04 De l’été SE DIVERTIR NAVIGUER Les 6 incontournables SUR LE BASSIN du bassin 24 06 26 Glisser sur l’eau 28 Profiter du bassin autrement DÉCOUVRIR La meilleure vue est celle du ciel 30 LES SITES 32 Garder la forme 08 EMBLÉMATIQUES 34 Varier ses loisirs Rester gourmand… 10 Les plages de 36 La Teste de Buch 38 Où manger, où sortir... 12 Les plages océanes Pyla sur Mer 14 SÉJOURNER 40 Dormir sous les pins Poser ses valises 16 Le lac de Cazaux 42 18 Les secrets de l’ostréiculture 20 Le port ostréicole 22 Les Prés Salés Ouest S’ORGANISER tourisme-latestedebuch.com ville.latestedebuch villelatestedebuch 44 Trouver le bon numéro 49 Faire le tour de La Teste UN WEEK-END À LA TESTE DE BUCH Au cœur d’une des plus grandes communes de France, laissez-vous porter par une multitude de paysages somptueux et profitez de vos vacances au beau milieu de sites exceptionnels. De la Dune du Pilat au Bassin d’Arcachon, de la célèbre Île aux Oiseaux au lac de Cazaux, en passant par les étendues de plages ou de forêts de pins, savourez un moment hors du temps, où convivialité et détente riment avec panoramas et vacances sportives. SAMEDI EN AMOUREUX P.09 P.14 POUR TOUS ESCAPADE LE PYLA SUR MER EN BATEAU Après l’incontournable ascension Pour une première découverte des de la Dune du Pilat, on profite d’une paysages du Bassin d’Arcachon, pause goûter sur la plage attenante rien de mieux qu’un tour en bateau ou à l’ombre des pins de la forêt pour découvrir l’Île aux Oiseaux, usagère. -

Abatilles Water
press pack SOURCE DES ABATILLES 157 bld de la Côte d’Argent • 33120 Arcachon • France www.sourcedesabatilles.com Press contact: Agence Hello T. +33 785 194 518 e-mail: [email protected] Maxime Castillo, professional bodyboarder Abatilles quick facts DRINK WELL, EXPORTS TO 000 000 30 COUNTRIES DRINK LOCAL 50 BOTTLES/YEAR BETWEEN SINCE x3 2013 GLASS AND 1925 2019 in Arcachon 100% recyclable employees50 The spring only draws of the volume permitted 472metres by the local authorities (1,549 feet) 38% (2018 figures) local starred 2,000 restaurants in France 17 restaurants Contents Drawing water Light Abatilles water: responsibly and pure good for everyone Water is a gift Where does it come from? La Bordelaise Our CSR policy Lovely balance • Fine eating and drinking Local & responsible Low mineral content Everyday drinking Zero nitrates Mineral content and purity guaranteed 100 years Our partners Mineral water of history science, tours Discovery - roaring twenties - 1923 & heritage The spa years - 1926 to 1964 Industrialisation - 1961 to 2013 A new breath of fresh air - since 2013 Drawing water responsibly Water is a gift 6 Our CSR policy 6 Local & responsible 7 Drawing water responsibly - page 6 Reasonable quantities: only 38% of the volume permitted Water is a gift by the local authorities Optimised bottling process to reduce energy consumption More than being an industrial mineral (40% less since 2008) water producer, the Abatilles Spring is a precious resource, part of nature’s heritage and a real gift that Fully recyclable bottles and caps, recovered we must protect accordingly. and reprocessed Every day we strive to balance the production-preservation equation. -

High Resolution Sampling of Methane Transport in the Columbia River Near-Field Plume: Implications for Sources and Sinks in a River- Dominated Estuary
LIMNOLOGY and Limnol. Oceanogr. 00, 2015, 00–00 OCEANOGRAPHY VC 2015 Association for the Sciences of Limnology and Oceanography doi: 10.1002/lno.10221 High resolution sampling of methane transport in the Columbia River near-field plume: Implications for sources and sinks in a river- dominated estuary A. S. Pfeiffer-Herbert,†* F. G. Prahl, B. Hales, J. A. Lerczak, S. D. Pierce, M. D. Levine 1College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, Oregon Abstract Examining fluxes of biogeochemical constituents at the mouth of an estuary is necessary for assessing the modification of terrigenous-source materials in the estuary prior to reaching the ocean. In many rivers and estuaries, including the Columbia River estuary (CRE), methane is highly enriched with respect to oceanic concentrations and the equilibrium solubility of the atmospheric gas. We developed a methane budget for the CRE to examine the potential for significant modification of the estuarine methane budget by lateral exchange with peripheral tide flats. We accomplished the challenging task of constraining the net transfer through the estuary-ocean interface using novel instrumentation: a rapid methane analyzer combined with a membrane-contactor interfaced with a pumped-sampling undulating towed vehicle. Transport of riverine methane into the CRE was essentially balanced by losses due to flux to the atmosphere (42%), microbial oxi- dation in the water column (21%), and transport to the ocean (32%), suggesting limited net effect of lateral tide flat processes on the CRE methane budget. Estimated uncertainty bounds constrained lateral sink/source terms within 230% to 120% of the primary river input. -

Press Kit 2021 Contents Elegant Natural
BORDEAUX PRESS KIT 2021 CONTENTS ELEGANT NATURAL MOODBOARD 03 BORDEAUX THE SERENE 04 VISIT & ADMIRE HISTORIC ELEGANCE 06 & CONTEMPORARY AUDACITY ENJOY PORT OF THE MOON 08 BORDEAUX, FOR THE 26 A VIBRANT CULTURAL LIFE 10 FOOD LOVERS THE CITÉ DU VIN, 12 A FESTIVE CITY 28 A SYMBOL OF BORDEAUX SUSTAINABLE TOURISM 30 FLUVIAL SUSTAINABLE COMMITMENT EXPLORE THE INTERNATIONAL WINE CAPITAL 14 STAY APPRECIATING NATURE 16 THE CITY OF 1001 NIGHTS 32 UN AIR DE BORDEAUX, 18 THE WEBZINE FOR LOCAL TRAVEL GATHER ALTERNATIVE BORDEAUX 20 BORDEAUX, INTERNATIONAL 34 GOLF DESTINATION 22 BUSINESS DESTINATION BORDEAUX, GATEWAY 24 AN EPICENTRE OF INNOVATION 36 TO THE SOUTHWEST FRANCE CALENDAR 38 PRACTICAL INFORMATION 42 Key figures Press contacts ALTERNATIVE FOODIE CULTURAL BORDEAUX 2021 Bordeaux Fête le Vin - 4 days of celebrating, tasting and Bordeaux, Die Programmierung der Bassins de Lumières learning about wine! Das größteBORDEAUX digitale Kunstzentrum IN 2021 der Welt, die Lichterbecken, The Bordeaux Fête le Vin wine festival is back for its 11th wurde im Juni 2020 eröffnet und bietet ein immersives Erleb- edition, in a format adapted to the health situation. From the Serene nis durchLes BassinsSoundeffekte de Lumières und Projektionen, im Inneren eines 17 to 20 June, the Festival will be celebrated throughout BunkersThis aus amazing dem Zweiten new venue Weltkrieg. is devoted Ab Februar to immersive werden zwei the Bordeaux metropolis with tastings and special wine-the- Go somewhere different, get a change of air, set off on BORDEAUX INTERNATIONAL CAPITAL OF WINE neue digitalAusstellungen exhibitions, angeboten: consisting „Monet, of sound Renoir...Chagall, and visual med tours, as well as numerous events in partner restaurants a voyage across the sea.. -

CRT Nouvelle-Aquitaine
NOUVELLE-AQUITAINE Sales Manual - 2018 www.visit-nouvelle-aquitaine.com Copyright : F. Roch ; S. Charbeau ; Camus ; Le Studio Photographique ; Charente Tourisme/C.Mariot ; S. Ouzounoff ; S. Laval ; St Gelais ; Villa Claude ; OT Rochefort Océan/M. Domenici ; F. Marzo ; Images et émotion ; Ile d'Oléron Marennes Tourisme ; Aquarium La Rochelle ; Mer et forêt ; CDCHS/V.Sabadel ; F. Giraudon ; J. Chauvet ; Montgolfière du Pinson ; Novotel ; J. Villégier ; T. Richard ; Laurent REIZ ; Pau Pyrénées Tourisme ; Cité du vin ; OTEM ; M. Turin ; Dominique Guillemain ; Romann RAMSHORN ; Eric Roger ; CRT Limousin/Bruno Chanet ; Guillaume Villégier; Ph. Labeguerie ; J.L. Kokel ; A. Dang ; J. Damase ; Mon nuage ; A. Pequin ; C. Marlier B. Bloch ; J.J. Brochard ; C. Fialeix ; G. De Laubier ; L. Aubergarde ; C. Boute ; Casson Mann; A. Pequin 2 Nouvelle-AquitaineTourist Board - Sales Manual 2018 Editorial Nouvelle-Aquitaine spirit L'esprit "Nouvelle vague" Nouvelle-Aquitaine is the largest region in France. It is as diverse as it is surprising, with nature, the great outdoors, vibrant cities and legendary beaches. So, no matter what type of holidays you’re looking for, there’s bound to be a destination for you. Nouvelle-Aquitaine conjures up famous places, like Bordeaux and the city of wine, Lascaux and the Dordogne Valley (which attracted more than 500,000 visitors in its very first year after ope- ning), Biarritz and the Basque Country, Poitiers and Futuroscope (where visitor numbers grew by 6%), Cognac, Pau and the Pyre- nees, or Limoges and its skilled craftsmanship. But there is also 750 km of fine sandy coastline, with ports from Michel DURRIEU Bayonne to La Rochelle, or the 110-metre-high Dune du Pilat and islands like the Ile de Ré and the Ile d’Oléron. -

Présentation Du Patrimoine Naturel Marin Du Bassin
Projet de parc naturel marin sur le bassin d’Arcachon et son ouvert Sommaire LE BASSIN D’ARCACHON : UN ÉCOSYSTÈME LAGUNAIRE AU FONCTIONNEMENT PARTICULIER ......................................................................................................................... 7 LES TRANSPORTS HYDRO-SÉDIMENTAIRES, À L’ORIGINE DU BASSIN ET DE SON REMODELAGE PERMANENT ................................................................................................................................ 8 UNE MOSAÏQUE D’HABITATS ET DE PAYSAGES SOUS INFLUENCE TERRESTRE ET OCÉANIQUE . 16 DES FONCTIONS ÉCOLOGIQUES, DES SERVICES POUR L’HOMME ............................................. 36 UN PATRIMOINE NATUREL D’EXCEPTION ............................................................................ 45 LES HERBIERS DE ZOSTÈRES : LE POUMON DU BASSIN .............................................................. 46 DES MARAIS MARITIMES ASSURANT DES FONCTIONS VITALES ................................................ 54 DES SUBSTRATS DURS D’ORIGINE HUMAINE ............................................................................. 64 SITE MÉTROPOLITAIN MAJEUR POUR DEUX ESPÈCES D’HIPPOCAMPES.................................... 70 UN SITE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE POUR LES OISEAUX ............................................... 78 LES MAMMIFÈRES MARINS ET LES TORTUES ............................................................................. 88 LA QUALITÉ DE L’EAU : UNE QUESTION COMPLEXE, UN ENJEU MAJEUR .............................. 95 DES CONDITIONS -

Self-Guided Bike Tour Along the Atlantic 8-Day Tour Through Dunes and Pine Woods
Info sheet Bike tour along the Atlantic « Basque Country » Self-guided bike tour along the Atlantic 8-Day tour through dunes and pine woods Ride out to meet man, nature, heritage and culture of the “Gironde, Landes and Basque Country”! Explore spectacular landscapes along the Velodyssée, the longest cycling routes in France and Europe, and enjoy the wonderful tranquility all along the coast! The six legs of this trip will lead you from « Bordeaux », a UNESCO World heritage site, to the famous seaside town of « Biarritz ». You will cycle between lake and ocean going through the vast forested area of the Landes de Gascogne. Discover a variety of landscapes: salt marshes, dunes, forests, large beaches surrounded by pine trees and secluded lakesides along your trip. Breathe in the sea air, the perfume of the pine trees, mimosa and brooms. Conviviality is surely one of the main features of this cycling holiday. There is a range of restaurants and bars where oyster and duck specialties await you, as there are opportunities to meet and chat with people. After each day’s program, you will be warmly welcomed in the best hotels (2 or 3-star) and charming bed-and- breakfasts of the area… Your holiday at a glance Bike La Vélodyssée cycling route and France's greenways Experience breathtaking landscapes Visit Bordeaux: a UNESCO cultural heritage site Luggage transfers throughout the program Arrival: Bordeaux Departure: Biarritz, after breakfast *Please indicate in our online inquiry if you wish to extend your stay before or after the bike tour. Info sheet Bike tour along the Atlantic « Basque Country » Table of Contents Self-guided bike tour along the Atlantic ............................................................................................................. -

Press Kit 2020 Summary
PRESS KIT 2020 SUMMARY BORDEAUX MOODBOARD BORDEAUX THE SERENE BORDEAUX FROM RICH PAST P. 2 P. 3 TO MODERN LEGACY P. 4 BORDEAUX PORT AND GATEWAY BORDEAUX GATEWAY TO THE LA CITÉ DU VIN, TO THE WORLD VINEYARDS A SYMBOL OF BORDEAUX P. 6 P. 8 P.10 CULTURAL ATTRACTIONS THE OTHER BORDEAUX BORDEAUX BY NIGHT IN BORDEAUX P.14 P.16 P.12 FINE DINING IN BORDEAUX NATURE IN THE CITY UN AIR DE BORDEAUX, THE P.18 P.20 WEBZINE FOR LOCAL TRAVEL P.22 A COMMITMENT TO ACCOMMODATION BORDEAUX, AN INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM P.26 BUSINESS DESTINATION P.24 P.28 BUSINESS TOURISM, AN ARCHITECTURE, DESIGN BORDEAUX - EPICENTER OF INFORMATION AND URBAN PLANNING GOLF DESTINATION P.30 P.32 P.34 BORDEAUX GATEWAY TO THE CALENDAR 2020 BORDEAUX BY FIGURES GREAT SOUTHWEST REGION P.38 P.40 P.36 PRESS CONTACTS P.41 1 MOODBOARD ALTERNATIVE CULTURAL ELEGANT FLUVIAL FOODIE AUDACIOUS GREEN SUSTAINABLE 2 BORDEAUX THE SERENE An historic city famous for its beautiful stone façades on foot, in a group or a personal tour... An opportunity to and fine wines, Bordeaux has in recent years also been experience a powerful heritage and strong characters, and attracting visitors with its dynamic urban environment, its to taste the resulting wines! Wine is naturally very much part gastronomy and its vibrant cultural life. Combining UNESCO of the city’s identity! La Cité du Vin is an excellent example, world heritage status, new districts, a magnificent waterfront, offering a unique experience in terms of both its architecture numerous pedestrian streets, all accessible by bike or on and its fascinating interactive exhibits. -

© Pho Voir/C D T Gironde
© Phovoir/CDT Gironde le littoral médoc nord le littoral médoc sud le tour du bassin d’arcachon du bassin d’arcachon au canal de garonne de bordeaux à lacanau de bordeaux à sauveterre-de-guyenne © Philippe ROY / CIVB / ROY Philippe © BORDEAUX OPT LE DR Sommary BoRDEAUX Page 3 Arcachon bay & the Médoc coast Page 6 Wine tourisme Page 13 Wanderings Page 17 UNESCo & heritage Page 20 Estuary Page 23 Events Page 28 Contact : Photo de couverture : Couple dans les vignes - Phovoir/CDT Gironde Karin LABARDIN Anne QUIMBRE Réalisé par le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde. + 33 (0)5 56 48 91 27 + 33 (0)5 56 48 68 16 Directeur de Publication : Jean-Marie Darmian, Président délégué du Comité Départemental du Tourisme de la Gironde. [email protected] [email protected] Rédaction : Les Pipelettes Conception graphique et cartographie : E. Parent Impression : Graphit’s © Phovoir/CDT Gironde © Phovoir/CDT Bordeaux “A Sunday morning on the Quais des Chartrons. The weather is good, it’s a market day. People everywhere: along the stalls, on the quays, roller-skating or cycling along the quays. Oyster farmers offer tasting sessions: I wait for my oysters, bathed in sunshine, listening to a small jazz orchestra. A holiday feeling.”. Bordeaux is a rebirth – just like its quays given back to the Bordelais, its river rediscovered, classical façades that have regained their fairness. A miracle of elegance that, since 2007, has been on the UNESCo World Heritage List: a listed area of 1,810 hectares, the 18th- century heart of the city, the stalls quarter, the Mériadeck quarter and its 1970s buildings, and wet docks. -
Bassin D'arcachon O E Chapelle
couverture guide OT 2018 19x27.pdf 1 25/01/2018 09:20 V2-170-05.pdf 1 15/11/2016 10:08:55 Édito Sommaire Contents Les grands rendez-vous « Agenda .................................................................................................................. 4 Arcachon est une ville « Histoire d’Arcachon où on se sent bien... History of Arcachon ................................................... 5 Bienvenue à Arcachon ! Nous vous souhaitons un agréable Les lieux à ne pas rater séjour et vous remercions de votre visite. Pour profiter du Must see heritage .................................................. 6-9 meilleur de notre ville et pour vivre une expérience unique au bord du bassin d’Arcachon, nous avons rassemblé dans ce guide Plan touristique ........................................... 10-11 touristique l’essentiel des informations pouvant vous intéresser. Les visites guidées Guided visits ....................................................... 12-13 Vous le découvrirez au fil de vos balades : Arcachon est une ville où on se sent bien, où qualité de vie et environnement préservé À proximité d’Arcachon ne sont pas de vains mots. C’est aussi une cité dynamique à vivre Near Arcachon ................................................... 14-17 et à aimer toute l’année, dans chacun de nos quartiers, avec des activités culturelles et ludiques et des idées de sorties pour tous Activités nautiques les goûts et tous les âges. Water sports ....................................................... 18-24 Laissez-vous séduire par son patrimoine remarquable, -

Response of the Coastline to Climate Change Response
-•• Vi-, t! Response of the Coastline to Climate change Specific Report for the RESPONSE Project LIFE- Environment programm: Evolution of coastal risk (erosion and marine flooding) for the Aquitaine yfr, v and Languedoç-Roussillon pilot regions BRGM/RP-54718-FR • ',v- September, 2006 Response 3 5000 00055613 3 brgGeoscienceformj sustainable Earth Response of the Coastline to Climate change Specific Report for the RESPONSE Project LIFE- Environment programm: Evolution of coastal risk (erosion and marine flooding) for the Aquitaine and Languedoc-Roussillon pilot regions Final report BRGM/RP-54718-FR September, 2006 Study conducted as part of research projects 2003-2006 RISCOTE18/PC3 C. Vinchon, D. Idier, M. Garcin, Y. Balouin, C. Mallet, S. Aubié, L. Closset With the collaboration of C. Oliveros, R. Pedreros and N. Le nôtre Checked by: Approved by: Original signed by: Original signed by: Name: C. OLIVEROS Name: H. MODARESSI Date: 30/10/2006 Date: 30/10/2006 Signature: .Signature: The quality management system of BRGM is certified according to AFAQ ISO 9001:2000. BJR G 2 1 NOV. 2006 Geosciencefora sustainable Earth BIBLIOTHEQUE brgm Keywords: Climate change, Coastal risk, Coastal erosion, Marine flooding, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Change in hazards, Assets at risk. Change in risk, Hotspots. In bibliography, this report should be cited as follows: Vinchon C, Idler D., Garcin M., Balouin Y., Mallet C, Aubié S., Closset L. with the collaboration of Oliveros C, Pedreros R. and Lenôtre N. (2006) - Response of the Coastline to Climate Change. Specific Report for the RESPONSE Project LIFE-Environment programm: Evolution of coastal risk (erosion and marine flooding) on the Aquitaine and Languedoc- Roussillon pilot regions. -

The Arcachon Bay Estuary: a ''Collage'' of Landscapes
The Arcachon Bay estuary : a ”collage” of landscapes Frédéric Bertrand To cite this version: Frédéric Bertrand. The Arcachon Bay estuary : a ”collage” of landscapes. Landscapes and Landforms of France, Springer Verlag, p. 71-80, 2013. hal-01067267 HAL Id: hal-01067267 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01067267 Submitted on 24 Sep 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Arcachon Bay Estuary: A “Collage” of Landscapes 8 Frédéric Bertrand Abstract The Arcachon Bay is a typical semi-sheltered lagoon located on the Atlantic coast of France, facing the wave-dominated shelf of the Bay of Biscay. Its long-term evolution was controlled by the development of the Cap Ferret barrier spit and the establishment of a tide ebb-dominant barrier system leading to a spatial split of the bay in two parts: (a) the inner lagoon mostly composed of tidal fl ats and (b) the outer lagoon with higher hydrological capacities where a large-scale tidal inlet is bordered by the largest coastal dune in Europe. The identifi cation of major interactive sedimentary environments with reference to their representative and complementary characteristics leads to a deductive selection of fi ve landforms supporting oyster cultivation and various recreational (sportfi shing, sailing, ecotourism) activities of both economic and landscape value.