TRIPTYQUE 3 Tritonis / a La Recherche Des Amazones
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

"Genetic Heterogeneity Between Berbers and Arabs" In
Genetic Heterogeneity Advanced article Article Contents between Berbers and • Introduction • Genetic Diversity in Berber and Arab Groups Arabs • Related Articles Lara R Arauna, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Departament de Ciències Online posting date: 15th September 2017 Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain David Comas, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain The human population history of North Africa ∼45 000 ya) (Smith et al., 2007). The Aterian is the first prehis- has been different from the rest of the conti- toric industry characterised in North Africa (Barton et al., 2009), nent, and it has been characterised by population which has been suggested to have started around 120 000 ya. replacements, extensive continuous gene flow, Although paradoxical, the Sahara desert has been reported to be a corridor for the movement of people during the ‘green Sahara’ and differential admixture from neighbouring periods thanks to its watercourses. The old dates of AMH remains regions. This complex demographic landscape has and the Sahara corridor leave many open questions about the role yielded a large degree of genetic heterogeneity of North Africa in the origin of modern humans and their disper- among North African populations. Recent histori- sal out of the continent. Different hypotheses have been proposed: cal admixture processes have been inferred from Was North Africa just a stop on the road out of Africa, or did it genome-wide data; no correlation between genet- play a more important role in the evolution of modern humans? ics and ethnic groups has been described, pointing No clear connections have been established between this first to a lack of genetic differentiation between Berber human industry and subsequent cultures in the region, such as the and Arab groups in North Africa. -

Formation Des Cités
FORMATION DES CITÉS CHEZ LES POPULATIONS SÉDENTAIRES DE L’ALGÉRIE (Kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l’Arouas, Beni Mezâb) PAR E. MASQUERAY THÈSE PRÉSENTÉE A LA FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS PARIS ERNEST LEROUX, ÉDITEUR 28, RUE BONAPARTE, 28 1886 Livre numérisé en mode texte par : Alain Spenatto. 1, rue du Puy Griou. 15000 AURILLAC. [email protected] ou [email protected] D’autres livres peuvent être consultés ou téléchargés sur le site : http://www.algerie-ancienne.com Ce site est consacré à l’histoire de l’Algérie. Il propose des livres anciens, (du 14e au 20e siècle), à télécharger gratuitement ou à lire sur place. INTRODUCTION « Africains » employé de préférence à « Berbers ». Invasions suc- cessives qui ont formé la population actuelle de l’Afrique septentrionale. Confusion des races. Point de vue d’où les mœurs actuelles des Africains veulent être considérées. Sédentaires et Nomades. Principaux groupes des sédentaires: Kabyles, Chaouïa, Beni Mezâb. C’est à dessein que j’ai substitué dans la suite de ce travail le nom général d’Africains à celui de Berbers qu’on applique d’ordinaire à toutes les populations de l’Afrique septentrionale regardées comme autochtones. Ce nom était inconnu dans l’antiquité grecque et romaine, et a paru pour la première fois chez les écrivains arabes. « Quand Sidi Oqbah fut parvenu près de Tanger, raconte En Noweiri(1), il demanda au comte Julien (Yulîan) où il pourrait trouver les chefs des Roum et des Berbers. « Les Roum, répondit Yulîan, tu les as laissés derrière toi, mais devant toi sont les Berbers et leur cavalerie ; Dieu seul en sait le nombre. -

The Two Mauretaniae: Their Romanization and The
THE TWO MAURETANIAE: THEIR ROMANIZATION AND THE IMPERIAL CULT by CLAUDIA GIRONI submitted in fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in the subject ANCIENT HISTORY at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR : PROF. U.R.D. VOGEL JOINT SUPERVISOR : DR M. KLEIJWEGT Date submitted November 1996 SUMMARY The 'Romanization' of the African provinces of Mauretania Tingitana and Mauretania Caesariensis was in fact a two-way process of exchange between Roman and African elements which resulted in a uniquely Romano-African civilization. The imperial cult highlights issues common to all Romanization processes, such as ruler-subject interaction and the role of local initiative in bringing about change, as well as unique issues such as the impact of politics on emperor-worship. The success of the imperial cult was hampered by the fact that only a select few - notably the wealthy local elite - derived direct benefit from the process, and by the fact that, because the pre-Roman Mauretaniae had no established ruler-cults, the imperial cult failed to assimilate with local tradition. As a result, the cult was unable either to make a decisive impact on the Romanization of the Mauretanians, or to achieve any real religious unity among them. KEY TERMS Romanization; Imperial cult; North African history; Roman empire; Mauretania Tingitana; Mauretania Caesariensis; Mauri; Religious syncretism; Roman gods; Roman priests; African religion, ancient. DECLARATION I declare that "The two Mauretaniae : their Romanization and the imperial cult" is my own work and that all the sources that I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references. -

01- Cristina Kormikiari
GRUPOS INDÍGENAS BERBERES NA ANTIGÜIDADE: A DOCUMENTAÇÃO TEXTUAL E EPIGRÁFICA Maria Cristina N. Kormikiari Doutora em Arqueologia-MAE/USP Resumo A pesquisa desenvolvida neste artigo foi realizada durante um traba- lho de organização da documentação epigráfica e textual referente aos grupos berberes norte-africanos na Antigüidade. Oportunamente, dis- cutimos as especificidades da documentação à disposição do pesqui- sador desta área: arqueológica, epigráfica e textual e apresentamos nossa contribuição para a definição do conceito teórico tribo, normal- mente utilizado de maneira vaga e pouco fundamentada. Abstract The research developed in this article was carried out during the organizing of textual and epigraphic document refering to the North- African Berbers of Antiquity. Opportunely, we discussed the proper uses of the documentation available for the researcher working in this field: archaeological, epigraphic and textual, and we also present here our contribution for defining the theoretical concept of tribe, usually applied vaguely and with little depth. Palavras-Chave Berbere – Norte da África – Antigüidade – Roma – Grupos Indígenas Keywords Berber – North Africa – Antiquity – Rome – Indigenous Groups Maria Cristina N. Kormikiari / Revista de História 145 (2001), 09-60 1 Introdução O Norte da África, enquanto laboratório de transformações culturais impostas por mudanças históricas, constitui um campo de análise extremamente rico para o cientista humano. Esta região pode ser considerada, geograficamente, uma “ilha”, 2 pois encontra-se separada da Europa pelo mar e do resto da África pelo deserto . De fato, sua ligação física mais direta é com o Oriente, esse mesmo Oriente com o qual grande parte de sua História se mescla. No entanto, apesar das barreiras físicas, a Península Ibérica em especial, mas igualmente a região mediterrânica central, desde tempos os mais remotos, estabeleceram uma série de contatos e intercâmbios hu- 3 manos, culturais e econômicos com a região norte-africana . -

1 Ties of Resistance and Cooperation. Aedemon, Lusius
1 Ties of Resistance and Cooperation. Aedemon, Lusius Quietus and the Baquates. Wouter Vanacker Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent, Belgium [email protected] Abstract Gaius’ decision to dissolve the protectorate of Mauretania and to depose its client king, Ptolemaeus, led to the outbreak of the Revolt of Aedemon (AD 40). This paper will develop a number of innovative thoughts and hypotheses concerning the extent of this rebellion and its possible impact on the deposition of Ptolemaeus, as well as the role of the Romans in its suppression. The main aim is to explore the connection between this revolt, Trajanus’ famous general Lusius Quietus (cos. AD 117?), and the Baquates, an indigenous Mauretanian tribe. I will suggest that Lusius Quietus was descended from a chief of a (semi-)nomadic tribe who supported the Roman cause during the Revolt of Aedemon. Considering the setting and dimension of this revolt, as well as the unrest in Mauretania at the time of Lusius Quietus’ execution by Hadrianus, I argue that this tribe can be identified as the Baquates. This reconstruction suggests a long-lasting and particularly positive relationship between this tribe and Rome. It allows for a further reconsideration of the relationship between (semi-)nomadic and Roman/sedentary groups in Roman North Africa, to the detriment of one-sided analytical schemes that stress endemic hostility. Keywords Aedemon, Lusius Quietus, Baquates, Mauretania, nomads, insurgence Body Text 1. Aedemon and the Inhabitants of Mauritania It has long been believed that the execution of Ptolemaeus in AD 40 had tremendous consequences in Mauretania.1) The ensuing uprising of Aedemon, a freedman of the client king, has been perceived as a widespread revolt. -

Préhistoires Méditerranéennes, 10-11 | 2002 Gabriel Camps 2
Préhistoires Méditerranéennes 10-11 | 2002 Varia Gabriel Camps 1927- 2002 Marceau Gast Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/pm/288 ISSN : 2105-2565 Éditeur Association pour la promotion de la préhistoire et de l'anthropologie méditerrannéennes Édition imprimée Date de publication : 1 septembre 2002 Pagination : 237-252 ISSN : 1167-492X Référence électronique Marceau Gast, « Gabriel Camps », Préhistoires Méditerranéennes [En ligne], 10-11 | 2002, mis en ligne le 22 avril 2009, consulté le 20 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/pm/288 Ce document a été généré automatiquement le 20 avril 2019. Tous droits réservés Gabriel Camps 1 Gabriel Camps 1927- 2002 Marceau Gast 1 Le Professeur Gabriel Camps nous a quittés le 6 septembre 2002, emporté par les suites d’une grave maladie. 2 Né le 20 mai 1927 à Misserghin, en Oranie, il affirma très jeune de grandes capacités intellectuelles. Dès l’âge de huit ans, il se passionnait déjà à identifier des collections de pièces romaines. Son père, ingénieur à la Société Nationales des Chemins de fer algériens, sut favoriser sa curiosité concernant l’histoire antique de l’Afrique du Nord. Après des études secondaires au lycée d’Oran, il passa ses baccalauréats à Alger en latin, grec (1944), puis en philosophie en 1945. Après son année de propédeutique il termina sa licence d’histoire et géographie en 1947 et fréquenta dès 1949 le petit laboratoire de Préhistoire que venait de créer Lionel Balout dans un local du Musée du Bardo. De ce modeste laboratoire allait sortir une pépinière de chercheurs qui fondèrent ce qu’on appela « l’école d’Alger » et dont Gabriel Camps fut l’un des plus brillants, surtout à partir de la création par Lionel Balout (devenu Doyen de la Faculté des Lettres d’Alger) du Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques (CRAPE) en décembre 1955. -

The Grand Strategy of the Roman Empire from the First Century CE to the Third
The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century CE to the Third REVISED AND UPDATED EDITION Edward N. Luttwak |( >1111 ! I • 'i >( II! I imriMlx I ’less © 1976. ' 979i 2016 Johns Hopkins University Press All rights reserved. Published 2016 Printed in the United States of America on acid-free paper 98765432 1 Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland 21218-4363 www.press, jhu.edu Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Luttwak, Edward, author. Title: The grand strategy of the Roman Empire : from the first century CE to the third / Edward N. Luttwak. Description: Revised and updated edition. I Baltimore .- Johns' Hopkins University Press, 2016. I Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2015030270I ISBN 9781421419442 (hardback) I ISBN 9781421419459 (paperback) I ISBN 9781421419466 (electronic) Subjects: LCSII: Rome—Army. I Strategy. I Military history, Ancient. I BISAC: HISTORY / Ancient / General. I HISTORY / Military / Strategy. Classification: LCC U35 .L8 2016 I DDC 355/033537—dc23 LC record available at http://lccn.l0c.g0v/2015030270 A catalog record for this book is available from the British Library. Special discounts are available for bulk purchases of this book. For more information, please contact Special Sales at pio-pi6-6p^6 or speaalsales®press .jhu.edu. Johns Hopkins University Press uses environmentally friendly book materials, including recycled text paper that is composed of at least 30 percent post-consumer waste, whenever possible. -
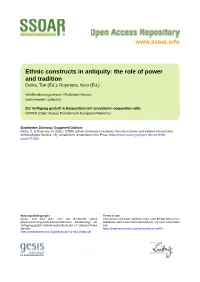
Fc Omslag AAS13 V3:V3
www.ssoar.info Ethnic constructs in antiquity: the role of power and tradition Derks, Ton (Ed.); Roymans, Nico (Ed.) Veröffentlichungsversion / Published Version Sammelwerk / collection Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Derks, T., & Roymans, N. (Eds.). (2009). Ethnic constructs in antiquity: the role of power and tradition (Amsterdam Archaeological Studies, 13). Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-271832 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de [eds] the role of power and tradition Ethnic Constructs in Antiquity Archaeological Studies Ton Derks & Nico Roymans & Nico Derks Ton Amsterdam University Press 13 Amsterdam Amsterdam Ethnic Constructs in Antiquity 13 Editorial Board: Prof. dr. E.M. Moormann Prof. dr. W. Roebroeks Prof. dr. N. Roymans Prof. dr. F. Theuws Other titles in the series: N. Roymans (ed.): From the Sword to the Plough Three Studies on the Earliest Romanisation of Northern Gaul ISBN 90 5356 237 0 T. Derks: Gods, Temples and Ritual Practices The Transformation of Religious Ideas and Values in Roman Gaul ISBN 90 5356 254 0 A. Verhoeven: Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland (8e – 13e eeuw) ISBN 90 5356 267 2 F. -

The Roman Army, 31 BC–AD 337
The Roman Army, 31 BC–AD 337 The Roman imperial army was unrivalled until recent times in its professional structure, efficient training, detailed organization, and ordnance support. It was remarkable in an age of poor communications and limited technological advance. The army sustained a great empire militarily and politically. First, its skill and success ensured Rome’s domination, and second the loyalty of the troops ensured the political survival of the emperors, who sought to preserve the fabric of government and make it work. The army was therefore a vital element in the subsequent development of Western Civilization. The large number of soldiers and their associated dependants meant that they had significant impact socially, economically, and culturally on the settlements that grew up round the camps and on some of the communitites where they settled after discharge. The privileges of the soldiers set them apart from other men of their social class, and the enhanced position of veterans established them as a very important group in their own right, an integral part of the whole phenomenon of Roman ‘government’. The study of the Roman army therefore embraces not only military but also political, social and economic history. This source book collects literary and epigraphic material, and papyri and coins which illustrate the varied aspects of army life both at war and at peace, and it takes account of evidence made available by recent archaeological investigations in many parts of the empire. Subjects covered include training, officers, the role of the emperor, fighting, community life, politics, and veterans. The introductions to each section and the linking passages provide a narrative structure and explain difficulties of the source material. -

Africa and Africans Brent D. Shaw
Princeton/Stanford Working Papers in Classics Who Are You? Africa and Africans Version 1.3 September 2011 Brent D. Shaw Princeton University Abstract: This is the third revised version of a chapter that is being prepared for the Wiley-Blackwell Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean. © Brent D. [email protected] 2 Who Are You? Africa and Africans Brent D. Shaw In a letter written to his former teacher from the city of Madauros, the Christian bishop Augustine of Hippo addressed the rhetor Maximus by saying, ‘well now, as one African writing to another African, and since we are both from Africa...’ (Aug. Ep. 17.2 = CCL 31: 41; 390 CE). His deliberate seeking of common ground in being ‘African’ was, it should be confessed, a rhetorical gambit. It was a powerful ploy because the identity to which appeal was made was a strong one of real substance. Not only among Christians like Augustine, but also among non-Christian interlocutors of the time like Maximus, being African had become an identity that they shared in common. How this came to be was the result of a long process of changes and responses. As late as the first century CE, no persons of Punic background, or any indigenous inhabitants of the land, or any Italian, Etruscan, or Greek settlers living in the region that we today call North Africa ever thought of themselves as ‘African,’ even if the matrix for this new identity was beginning to be formed all around them. The process of creating the new identity followed a path that ethnic labelling had often travelled in the past. -

Quelques Hypothèses Sur Les Dynamiques De Peuplement Du Rif Occidental *
Quelques hypothèses sur les dynamiques de peuplement du Rif occidental * La géographie ethnonymique Grigori Lazarev ([email protected]) La géographie historique de l’onomastique tribale, entendons par là la localisation, dans l’espace et le temps, des ethnonymes qui ont désigné ou * Communication désignent encore des groupements tribaux, constitue l’une des bases possibles présentée au colloque de pour saisir la complexité des dynamiques de peuplement dans le nord du Chaouen, Maroc, 4-7 mai 2011. Version originale Maroc. Un ethnonyme, localisable actuellement ou à d’autres périodes de révisée en novembre l’histoire, constitue en effet une trace de passage ou d’implantation dans un 2011 et novembre 2012. territoire. Pour autant, cette trace ne donne aucune indication sur son contenu Cette dernière révision a notamment tenu compte démographique, et elle n’implique pas d’identification à une population plus des riches observations ou moins homogène qui correspondrait au (ou descendrait du) groupe social de Jacques Vignet Zunz, fondateur qu’il a pu désigner à un moment ou un autre. Les amalgames, ancien de l’IREMAM et animateur du colloque de les fusions, les apports migratoires ont en effet constamment remanié le Chaouen. Ses remarques contenu des groupes sociaux qui ont occupé les territoires du Maghreb, de ont en particulier porté sur telle sorte que les désignations ethnonymiques ne sont plus, le plus souvent, les sens que l’on pouvait donner à l’appellation de que des “emblèmes onomastiques” – pour reprendre l’expression de Jacques -

Livre Brassage Amazigh Hassanifinal.Pdf
䰀䔀 䈀刀䄀匀匀䄀䜀䔀 䐀䔀 䰀䄀 䌀唀䰀吀唀刀䔀 䄀䴀䄀娀䤀䜀䠀䔀 䔀吀 䐀䔀 䰀䄀 䌀唀䰀吀唀刀䔀 䠀䄀匀匀䄀一䤀䔀 䰀攀甀爀 刀攀氀愀琀椀漀渀 愀瘀攀挀 氀攀猀 䌀甀氀琀甀爀攀猀 匀甀戀ⴀ匀愀栀愀爀椀攀渀渀攀猀 匀漀甀猀 氀愀 䐀椀爀攀挀琀椀漀渀 搀攀 㨀 䴀漀栀愀 䔀渀渀愀樀椀 䠀漀洀 洀 愀最攀 䜀栀椀琀愀 䔀氀 䬀栀愀礀愀琀 ☀ 䴀椀挀栀愀攀氀 倀攀礀爀漀渀 伀甀瘀爀愀最攀 瀀甀戀氀椀 瀀愀爀 氀攀 䌀攀渀琀爀攀 匀甀搀 一漀爀搀 瀀漀甀爀 氀攀 䐀椀愀氀漀最甀攀 䤀渀琀攀爀挀甀氀琀甀爀攀氀 攀琀 氀攀猀 䔀琀甀搀攀猀 猀甀爀 氀愀 䴀椀最爀愀琀椀漀渀 愀瘀攀挀 氀攀 䌀漀渀挀漀甀爀猀 搀攀 氀愀 刀最椀漀渀 䘀猀ⴀ䈀漀甀氀攀洀 愀渀攀 LE BRASSAGE DE LA CULTURE AMAZIGHE ET DE LA CULTURE HASSANIE Leur Relation avec les Cultures Sub- sahariennes Sous la Direction de Moha Ennaji Hommage à Ghita El Khayat et Michael Peyron Ouvrage publié par le Centre Sud Nord pour le Dialogue Interculturel et les Etudes sur la Migration avec le Concours de la Région Fès-Boulemane LE BRASSAGE DE LA CULTURE AMAZIGHE ET DE LA CULTURE HASSANIE Leur Relation avec les Cultures Sub- sahariennes Sous la Direction de Moha Ennaji Hommage à Ghita El Khayat et Michael Peyron Ouvrage publié par le Centre Sud Nord pour le Dialogue Interculturel et les Etudes sur la Migration avec le Concours de la Région Fès-Boulemane Titre de l’ouvrage : Le brassage de la culture amazighe et de la culture hassanie Série : Colloques et Séminaires Direction : Moha Ennaji Editeurs : Centre Sud Nord Tirage : Imprimerie IPN, Fès Copyright : ©Réservé à Moha Ennaji Dépôt légal : 2016MO2083 ISBN : 978-9954-9089-6-2 1ère édition : 2016 TABLE DES MATIERES Moha Ennaji Introduction………………………………………………….……... 1 Fatima Boukhris Témoignage en l’honneur du Professeur Michael Peyron ….……7 Jean Ferrari Témoignage en l’honneur du Docteur Rita El Khayat……….….11 Anissa Derrazi Témoignage en l’honneur du Docteur Rita El Khayat…………..13 Michael Peyron Allocution………………………………………..…………....…….19 Rita El Khayat Allocution…………………………………………………..………..21 Amazighité, Langues et Identités Maati Kabbal Le Paradigme Amazigh de Fès……………………………………..29 Moha Souag Agora……………..………………………….