Feuilles De Natitingou (6), Porga
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

B E N I N Benin
Birnin o Kebbi !( !( Kardi KANTCHARIKantchari !( !( Pékinga Niger Jega !( Diapaga FADA N'GOUMA o !( (! Fada Ngourma Gaya !( o TENKODOGO !( Guéné !( Madécali Tenkodogo !( Burkina Faso Tou l ou a (! Kende !( Founogo !( Alibori Gogue Kpara !( Bahindi !( TUGA Suroko o AIRSTRIP !( !( !( Yaobérégou Banikoara KANDI o o Koabagou !( PORGA !( Firou Boukoubrou !(Séozanbiani Batia !( !( Loaka !( Nansougou !( !( Simpassou !( Kankohoum-Dassari Tian Wassaka !( Kérou Hirou !( !( Nassoukou Diadia (! Tel e !( !( Tankonga Bin Kébérou !( Yauri Atakora !( Kpan Tanguiéta !( !( Daro-Tempobré Dammbouti !( !( !( Koyadi Guilmaro !( Gambaga Outianhou !( !( !( Borogou !( Tounkountouna Cabare Kountouri Datori !( !( Sécougourou Manta !( !( NATITINGOU o !( BEMBEREKE !( !( Kouandé o Sagbiabou Natitingou Kotoponga !(Makrou Gurai !( Bérasson !( !( Boukombé Niaro Naboulgou !( !( !( Nasso !( !( Kounounko Gbangbanrou !( Baré Borgou !( Nikki Wawa Nambiri Biro !( !( !( !( o !( !( Daroukparou KAINJI Copargo Péréré !( Chin NIAMTOUGOU(!o !( DJOUGOUo Djougou Benin !( Guerin-Kouka !( Babiré !( Afekaul Miassi !( !( !( !( Kounakouro Sheshe !( !( !( Partago Alafiarou Lama-Kara Sece Demon !( !( o Yendi (! Dabogou !( PARAKOU YENDI o !( Donga Aledjo-Koura !( Salamanga Yérémarou Bassari !( !( Jebba Tindou Kishi !( !( !( Sokodé Bassila !( Igbéré Ghana (! !( Tchaourou !( !(Olougbé Shaki Togo !( Nigeria !( !( Dadjo Kilibo Ilorin Ouessé Kalande !( !( !( Diagbalo Banté !( ILORIN (!o !( Kaboua Ajasse Akalanpa !( !( !( Ogbomosho Collines !( Offa !( SAVE Savé !( Koutago o !( Okio Ila Doumé !( -

Pdf Projdoc.Pdf
Tanguieta Toucountouna Benin Natitingou Perma Intervention areas: child protection, hunger and health Abomey Condji - Lokossa Cotonou Project “Nurse Me” This project stems from the need to support the children hosted in three of our accommodation centres in Benin, through the supply of powder milk. ‘Nurse me’ involves undernourished, motherless, neglected children or whose mothers are HIV positive, and who for these reasons can’t be breastfed during the first months of their lives. The project develops in the regions of Zou and Atacora, two areas in which inhabitants live mainly in rural villages. The health situation in these regions is alarming: childbirth mortality rate is extremely high and newborns are often underweight. Moreover, breastfeeding without blood ties is not contemplated in Benin’s culture. This factor, together with malnutrition, lack of hygiene, and the rampant plague of AIDS, causes several deceases. In addition to this, international aid has decreased, because of two issues: 1) the global economic crisis has led governments to reduce the aid to the countries of the South; 2) the World Food Programme has diminished the food aid in favour of Benin, in order to allocate more in support of countries at war. Insieme ai bambini del mondo Project objectives - Promote the right to life and health; - Prevent babies’ premature death caused by the impossibility of breastfeeding. Project beneficiaries - Undernourished, motherless, neglected children or whose mothers are HIV positive, who are hosted in our accommodation centres or monitored by the nutritional centre; - Families living in rural areas around our accommodation centres, which can benefit from a free health and nutritional service for their children. -

The Dynamic Gravity Dataset: Technical Documentation
The Dynamic Gravity Dataset: Technical Documentation Lead Authors:∗ Tamara Gurevich and Peter Herman Contributing Authors: Nabil Abbyad, Meryem Demirkaya, Austin Drenski, Jeffrey Horowitz, and Grace Kenneally Version 1.00 Abstract This document provides technical documentation for the Dynamic Gravity dataset. The Dynamic Gravity dataset provides extensive country and country pair information for a total of 285 countries and territories, annually, between the years 1948 to 2016. This documentation extensively describes the methodology used for the creation of each variable and the information sources they are based on. Additionally, it provides a large collection of summary statistics to aid in the understanding of the resulting Dynamic Gravity dataset. This documentation is the result of ongoing professional research of USITC Staff and is solely meant to represent the opinions and professional research of individual authors. It is not meant to represent in any way the views of the U.S. International Trade Commission or any of its individual Commissioners. It is circulated to promote the active exchange of ideas between USITC Staff and recognized experts outside the USITC, professional devel- opment of Office Staff and increase data transparency by encouraging outside professional critique of staff research. Please address all correspondence to [email protected] or [email protected]. ∗We thank Renato Barreda, Fernando Gracia, Nuhami Mandefro, and Richard Nugent for research assistance in completion of this project. 1 Contents 1 Introduction 3 1.1 Nomenclature . .3 1.2 Variables Included in the Dataset . .3 1.3 Contents of the Documentation . .6 2 Country or Territory and Year Identifiers 6 2.1 Record Identifiers . -

Benin Electricity Access Scale-Up Project
The World Bank Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project (P173749) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Project Information Document (PID) Appraisal Stage | Date Prepared/Updated: 09-Apr-2021 | Report No: PIDA31110 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Mar 12, 2021 Page 1 of 17 The World Bank Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project (P173749) BASIC INFORMATION OPS_TABLE_BASIC_DATA A. Basic Project Data Country Project ID Project Name Parent Project ID (if any) Benin P173749 Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project Region Estimated Appraisal Date Estimated Board Date Practice Area (Lead) AFRICA WEST 21-Apr-2021 14-Jun-2021 Energy & Extractives Financing Instrument Borrower(s) Implementing Agency Investment Project Financing Republic of Benin Ministry of Energy Proposed Development Objective(s) The PDO is to increase access to electricity services for households, enterprises, and public facilities Components Component 1: On-grid electrification Component 2: Policy and regulatory actions to implement the national electrification strategy and related investment programs Component 3: Technical Assistance and Implementation Support PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions) SUMMARY-NewFin1 Total Project Cost 200.00 Total Financing 200.00 of which IBRD/IDA 200.00 Financing Gap 0.00 DETAILS-NewFinEnh1 World Bank Group Financing International Development Association (IDA) 200.00 IDA Credit 200.00 Mar 12, 2021 Page 2 of 17 The World Bank Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project (P173749) Environmental and Social Risk Classification Moderate Decision The review did authorize the team to appraise and negotiate Other Decision (as needed) B. Introduction and Context Country Context 1. Benin is a lower-middle income country with significant economic growth but persistent poverty levels. -

The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte D'ivoire, and Togo
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Public Disclosure Authorized Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon Public Disclosure Authorized 00000_CVR_English.indd 1 12/6/17 2:29 PM November 2017 The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon 00000_Geography_Welfare-English.indd 1 11/29/17 3:34 PM Photo Credits Cover page (top): © Georges Tadonki Cover page (center): © Curt Carnemark/World Bank Cover page (bottom): © Curt Carnemark/World Bank Page 1: © Adrian Turner/Flickr Page 7: © Arne Hoel/World Bank Page 15: © Adrian Turner/Flickr Page 32: © Dominic Chavez/World Bank Page 48: © Arne Hoel/World Bank Page 56: © Ami Vitale/World Bank 00000_Geography_Welfare-English.indd 2 12/6/17 3:27 PM Acknowledgments This study was prepared by Nga Thi Viet Nguyen The team greatly benefited from the valuable and Felipe F. Dizon. Additional contributions were support and feedback of Félicien Accrombessy, made by Brian Blankespoor, Michael Norton, and Prosper R. Backiny-Yetna, Roy Katayama, Rose Irvin Rojas. Marina Tolchinsky provided valuable Mungai, and Kané Youssouf. The team also thanks research assistance. Administrative support by Erick Herman Abiassi, Kathleen Beegle, Benjamin Siele Shifferaw Ketema is gratefully acknowledged. Billard, Luc Christiaensen, Quy-Toan Do, Kristen Himelein, Johannes Hoogeveen, Aparajita Goyal, Overall guidance for this report was received from Jacques Morisset, Elisée Ouedraogo, and Ashesh Andrew L. Dabalen. Prasann for their discussion and comments. Joanne Gaskell, Ayah Mahgoub, and Aly Sanoh pro- vided detailed and careful peer review comments. -

Proposal for Benin, Burkina Faso, Niger
AFB/PPRC.22-23/14 6 June 2018 Adaptation Fund Board Project and Programme Review Committee PROPOSAL FOR BENIN, BURKINA FASO, NIGER AFB/PPRC.22-23/14 Background 1. The strategic priorities, policies and guidelines of the Adaptation Fund (the Fund), as well as its operational policies and guidelines include provisions for funding projects and programmes at the regional, i.e. transnational level. However, the Fund has thus far not funded such projects and programmes. 2. The Adaptation Fund Board (the Board), as well as its Project and Programme Review Committee (PPRC) and Ethics and Finance Committee (EFC) considered issues related to regional projects and programmes on a number of occasions between the Board’s fourteenth and twenty-first meetings but the Board did not make decisions for the purpose of inviting proposals for such projects. Indeed, in its fourteenth meeting, the Board decided to: (c) Request the secretariat to send a letter to any accredited regional implementing entities informing them that they could present a country project/programme but not a regional project/programme until a decision had been taken by the Board, and that they would be provided with further information pursuant to that decision (Decision B.14/25 (c)) 3. In its eighth meeting in March 2012, the PPRC came up with recommendations on certain definitions related to regional projects and programmes. However, as the subsequent seventeenth Board meeting took a different strategic approach to the overall question of regional projects and programmes, these PPRC recommendations were not included in a Board decision. 4. In its twenty-fourth meeting, the Board heard a presentation from the coordinator of the working group set up by decision B.17/20 and tasked with following up on the issue of regional projects and programmes. -
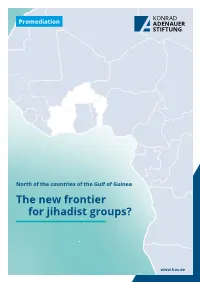
The New Frontier for Jihadist Groups?
Promediation North of the countries of the Gulf of Guinea The new frontier for jihadist groups? www.kas.de North of the countries of the Gulf of Guinea The new frontier for jihadist groups? At a glance At a glance tion has led to increased competition for access to However, these efforts are still not enough. In natural resources and to rising tensions between addition to operational or material flaws in the several communities. security network, there is also a weakness in terms of political and military doctrine. Since In 2020, armed jihadist groups in Sahel faced the authorities believe that the unrest on their Burkina Faso’s southern border is also of inter- jihadist insurgencies have developed in the increased pressure in their strongholds in Mali, northern borders will eventually spill over into est to the jihadists because it is a very profitable Sahara- Sahel region, no state has yet found an Niger and Burkina. their territory. No attacks have yet been carried area for all kinds of trafficking. Both to the east adequate response to contain them. Priority is out on Beninese soil, but incursions by suspected and west, this border has been known for several given to the fight against terrorism, often to the While the Support Group for Islam and Muslims jihadists are on the increase. Côte d’Ivoire was years as an epicentre for the illicit trade in arms, detriment of dialogue with communities and the (JNIM) and the Islamic State in the Greater Sahara first attacked in the north in June 2020. Jihadists gold, drugs, ivory, or goods such as cigarettes and search for local solutions. -

Caractéristiques Générales De La Population
République du Bénin ~~~~~ Ministère Chargé du Plan, de La Prospective et du développement ~~~~~~ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Résultats définitifs Caractéristiques Générales de la Population DDC COOPERATION SUISSE AU BENIN Direction des Etudes démographiques Cotonou, Octobre 2003 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1: Population recensée au Bénin selon le sexe, les départements, les communes et les arrondissements............................................................................................................ 3 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de KANDI selon le sexe et par année d’âge ......................................................................... 25 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de NATITINGOU selon le sexe et par année d’âge......................................................................................... 28 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de OUIDAH selon le sexe et par année d’âge............................................................................................................ 31 Tableau G02A&B :Population Résidente recensée dans la commune de PARAKOU selon le sexe et par année d’âge (Commune à statut particulier).................................................... 35 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de DJOUGOU selon le sexe et par année d’âge .................................................................................................... 40 Tableau -

The Cross-Border Transhumance in West Africa Proposal for Action Plan
Food and Agricultural Organization of the United Nations in collaboration with Economic Community of West African States The cross-border transhumance in West Africa Proposal for Action Plan June 2012 TABLE OF CONTENT TABLE OF CONTENT ...................................................................................................................................... 2 EXECUTIVE SUMMARY.................................................................................................................................. 5 Acronyms and Abbreviations ....................................................................................................................... 7 1. Introduction ........................................................................................................................................ 10 2. Background of livestock in West Africa .................................................................................................. 12 2.1. Increasing livestock numbers .......................................................................................................... 12 2.2. Many animal breeds but some endangered ................................................................................... 12 2.3. Livestock production systems in West Africa .................................................................................. 15 2.3.1. Pastoral systems ....................................................................................................................... 15 2.3.2. Urban and peri-urban livestock -

Dendrometric Characteristics As Indicators of Pressure of Afzelia Africana Sm
Biodiversity and Conservation 13: 1555–1570, 2004. # 2004 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Dendrometric characteristics as indicators of pressure of Afzelia africana Sm. dynamic changes in trees found in different climatic zones of Benin B. SINSIN1,*, O. EYOG MATIG2, A.E. ASSOGBADJO1, O.G. GAOUE´ 2 and T. SINADOUWIROU1 1Laboratoire d’Ecologie Applique´e, Faculte´ des Sciences Agronomiques, Universite´ d’Abomey-Calavi, Benin; 2International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI); *Author for correspondence (e-mail: [email protected]; fax: þ229-30-30-84) Received 5 November 2002; accepted in revised form 2 June 2003 Key words: Afzelia africana, Benin, Regeneration, Threats, Tree size Abstract. Afzelia africana is a forest species used by local inhabitants for various purposes, especially as forage to feed cattle, as medicinal plant and its wood is used to make furniture or for cooking. Its utilisation in its current form constitutes a threat to this species. However, the lack of data on this species is a hindrance towards drawing up an efficient program for its sustainable management. In order to fill in some gaps in the knowledge of A. africana tree populations, dendrometric characteristics of this species were studied within different climatic zones where it occurs in Benin. Data collected on each of them included height and diameter, and with regard to the levels of pressure, five categories were defined namely: null, weak, moderate, severe and very severe. As far as diameter is concerned every size was taken into consideration in all the climatic zones. However, average diameter and height of the A. africana individuals varied significantly according to climatic zones. -

Programme D'actions Du Gouvernement 2016-2021
PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 INNOVATION ET SAVOIR : DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE DE L’INNOVATION ET DU SAVOIR, SOURCE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE – © BAI-AVRIL 2019 A PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 2 Sommaire 1. Avant-propos p. 4 2. Le PAG en bref p. 8 3. État d’avancement des réformes p. 14 4. Mise en œuvre des projets p. 26 TOURISME p. 30 AGRICULTURE p. 44 INFRASTRUCTURES p. 58 NUMÉRIQUE p. 74 ÉLECTRICITÉ p. 92 CADRE DE VIE p. 110 EAU POtaBLE p. 134 PROTECTION SOCIALE p. 166 CITÉ INTERNatIONALE DE L’INNOVatION ET DU SaVoir – SÈMÈ CITY p. 170 ÉDUCatION p. 178 SPORT ET CULTURE p. 188 SaNTÉ p. 194 5. Mobilisation des ressources p. 204 6. Annexes p. 206 Annexe 1 : ÉLECTRICITÉ p. 210 Annexe 2 : CADRE DE VIE p. 226 Annexe 3 : EAU POTABLE p. 230 SOMMAIRE – © BAI-AVRIL 2019 3 1 4 RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 Avant-propos RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 5 Avant-propos Les équipes du Président Patrice TALON poursuivent du PAG. Il convient de souligner que ces fonds ont été résolument la mise en œuvre des projets inscrits dans affectés essentiellement au financement des infrastruc- le Programme d’Actions du Gouvernement PAG 2016– tures nécessaires pour impulser l’investissement privé 2021. Dans le présent document, l’état d’avancement (énergie, routes, internet haut débit, attractions, amé- de chacun des projets phares est fourni dans des fiches nagement des plages,…). -

BENIN-2 Cle0aea97-1.Pdf
1° vers vers BOTOU 2° vers NIAMEY vers BIRNIN-GAOURÉ vers DOSSO v. DIOUNDIOU vers SOKOTO vers BIRNIN KEBBI KANTCHARI D 4° G vers SOKOTO vers GUSAU vers KONTAGORA I E a BÉNIN N l LA TAPOA N R l Pékinga I o G l KALGO ER M Rapides a vers BOGANDÉ o Gorges de de u JE r GA Ta Barou i poa la Mékrou KOULOU Kompa FADA- BUNZA NGOURMA DIAPAGA PARC 276 Karimama 12° 12° NATIONAL S o B U R K I N A GAYA k o TANSARGA t U DU W o O R Malanville KAMBA K Ka I bin S D É DU NIGER o ul o M k R G in u a O Garou g bo LOGOBOU Chutes p Guéné o do K IB u u de Koudou L 161 go A ZONE vers OUAGADOUGOU a ti r Kandéro CYNÉGÉTIQUE ARLI u o KOMBONGOU DE DJONA Kassa K Goungoun S o t Donou Béni a KOKO RI Founougo 309 JA a N D 324 r IG N a E E Kérémou Angaradébou W R P u Sein PAMA o PARC 423 ZONE r Cascades k Banikoara NATIONAL CYNÉGÉTIQUE é de Sosso A A M Rapides Kandi DE LA PENDJARI DE L'ATAKORA Saa R Goumon Lougou O Donwari u O 304 KOMPIENGA a Porga l é M K i r A L I B O R I 11° a a ti A j 11° g abi d Gbéssé o ZONE Y T n Firou Borodarou 124 u Batia e Boukoubrou ouli A P B KONKWESSO CYNÉGÉTIQUE ' Ségbana L Gogounou MANDOURI DE LA Kérou Bagou Dassari Tanougou Nassoukou Sokotindji PENDJARI è Gouandé Cascades Brignamaro Libant ROFIA Tiélé Ede Tanougou I NAKI-EST Kédékou Sori Matéri D 513 ri Sota bo li vers DAPAONG R Monrou Tanguiéta A T A K O A A é E Guilmaro n O Toukountouna i KARENGI TI s Basso N è s u Gbéroubou Gnémasson a Î o u è è è É S k r T SANSANN - g Kouarfa o Gawézi GANDO Kobli A a r Gamia MANGO Datori m Kouandé é Dounkassa BABANA NAMONI H u u Manta o o Guéssébani