Etapes De L'histoire Du Peuplement Dans La Region
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

B E N I N Benin
Birnin o Kebbi !( !( Kardi KANTCHARIKantchari !( !( Pékinga Niger Jega !( Diapaga FADA N'GOUMA o !( (! Fada Ngourma Gaya !( o TENKODOGO !( Guéné !( Madécali Tenkodogo !( Burkina Faso Tou l ou a (! Kende !( Founogo !( Alibori Gogue Kpara !( Bahindi !( TUGA Suroko o AIRSTRIP !( !( !( Yaobérégou Banikoara KANDI o o Koabagou !( PORGA !( Firou Boukoubrou !(Séozanbiani Batia !( !( Loaka !( Nansougou !( !( Simpassou !( Kankohoum-Dassari Tian Wassaka !( Kérou Hirou !( !( Nassoukou Diadia (! Tel e !( !( Tankonga Bin Kébérou !( Yauri Atakora !( Kpan Tanguiéta !( !( Daro-Tempobré Dammbouti !( !( !( Koyadi Guilmaro !( Gambaga Outianhou !( !( !( Borogou !( Tounkountouna Cabare Kountouri Datori !( !( Sécougourou Manta !( !( NATITINGOU o !( BEMBEREKE !( !( Kouandé o Sagbiabou Natitingou Kotoponga !(Makrou Gurai !( Bérasson !( !( Boukombé Niaro Naboulgou !( !( !( Nasso !( !( Kounounko Gbangbanrou !( Baré Borgou !( Nikki Wawa Nambiri Biro !( !( !( !( o !( !( Daroukparou KAINJI Copargo Péréré !( Chin NIAMTOUGOU(!o !( DJOUGOUo Djougou Benin !( Guerin-Kouka !( Babiré !( Afekaul Miassi !( !( !( !( Kounakouro Sheshe !( !( !( Partago Alafiarou Lama-Kara Sece Demon !( !( o Yendi (! Dabogou !( PARAKOU YENDI o !( Donga Aledjo-Koura !( Salamanga Yérémarou Bassari !( !( Jebba Tindou Kishi !( !( !( Sokodé Bassila !( Igbéré Ghana (! !( Tchaourou !( !(Olougbé Shaki Togo !( Nigeria !( !( Dadjo Kilibo Ilorin Ouessé Kalande !( !( !( Diagbalo Banté !( ILORIN (!o !( Kaboua Ajasse Akalanpa !( !( !( Ogbomosho Collines !( Offa !( SAVE Savé !( Koutago o !( Okio Ila Doumé !( -

Pdf Projdoc.Pdf
Tanguieta Toucountouna Benin Natitingou Perma Intervention areas: child protection, hunger and health Abomey Condji - Lokossa Cotonou Project “Nurse Me” This project stems from the need to support the children hosted in three of our accommodation centres in Benin, through the supply of powder milk. ‘Nurse me’ involves undernourished, motherless, neglected children or whose mothers are HIV positive, and who for these reasons can’t be breastfed during the first months of their lives. The project develops in the regions of Zou and Atacora, two areas in which inhabitants live mainly in rural villages. The health situation in these regions is alarming: childbirth mortality rate is extremely high and newborns are often underweight. Moreover, breastfeeding without blood ties is not contemplated in Benin’s culture. This factor, together with malnutrition, lack of hygiene, and the rampant plague of AIDS, causes several deceases. In addition to this, international aid has decreased, because of two issues: 1) the global economic crisis has led governments to reduce the aid to the countries of the South; 2) the World Food Programme has diminished the food aid in favour of Benin, in order to allocate more in support of countries at war. Insieme ai bambini del mondo Project objectives - Promote the right to life and health; - Prevent babies’ premature death caused by the impossibility of breastfeeding. Project beneficiaries - Undernourished, motherless, neglected children or whose mothers are HIV positive, who are hosted in our accommodation centres or monitored by the nutritional centre; - Families living in rural areas around our accommodation centres, which can benefit from a free health and nutritional service for their children. -

The Dynamic Gravity Dataset: Technical Documentation
The Dynamic Gravity Dataset: Technical Documentation Lead Authors:∗ Tamara Gurevich and Peter Herman Contributing Authors: Nabil Abbyad, Meryem Demirkaya, Austin Drenski, Jeffrey Horowitz, and Grace Kenneally Version 1.00 Abstract This document provides technical documentation for the Dynamic Gravity dataset. The Dynamic Gravity dataset provides extensive country and country pair information for a total of 285 countries and territories, annually, between the years 1948 to 2016. This documentation extensively describes the methodology used for the creation of each variable and the information sources they are based on. Additionally, it provides a large collection of summary statistics to aid in the understanding of the resulting Dynamic Gravity dataset. This documentation is the result of ongoing professional research of USITC Staff and is solely meant to represent the opinions and professional research of individual authors. It is not meant to represent in any way the views of the U.S. International Trade Commission or any of its individual Commissioners. It is circulated to promote the active exchange of ideas between USITC Staff and recognized experts outside the USITC, professional devel- opment of Office Staff and increase data transparency by encouraging outside professional critique of staff research. Please address all correspondence to [email protected] or [email protected]. ∗We thank Renato Barreda, Fernando Gracia, Nuhami Mandefro, and Richard Nugent for research assistance in completion of this project. 1 Contents 1 Introduction 3 1.1 Nomenclature . .3 1.2 Variables Included in the Dataset . .3 1.3 Contents of the Documentation . .6 2 Country or Territory and Year Identifiers 6 2.1 Record Identifiers . -

Benin Electricity Access Scale-Up Project
The World Bank Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project (P173749) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Project Information Document (PID) Appraisal Stage | Date Prepared/Updated: 09-Apr-2021 | Report No: PIDA31110 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Mar 12, 2021 Page 1 of 17 The World Bank Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project (P173749) BASIC INFORMATION OPS_TABLE_BASIC_DATA A. Basic Project Data Country Project ID Project Name Parent Project ID (if any) Benin P173749 Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project Region Estimated Appraisal Date Estimated Board Date Practice Area (Lead) AFRICA WEST 21-Apr-2021 14-Jun-2021 Energy & Extractives Financing Instrument Borrower(s) Implementing Agency Investment Project Financing Republic of Benin Ministry of Energy Proposed Development Objective(s) The PDO is to increase access to electricity services for households, enterprises, and public facilities Components Component 1: On-grid electrification Component 2: Policy and regulatory actions to implement the national electrification strategy and related investment programs Component 3: Technical Assistance and Implementation Support PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions) SUMMARY-NewFin1 Total Project Cost 200.00 Total Financing 200.00 of which IBRD/IDA 200.00 Financing Gap 0.00 DETAILS-NewFinEnh1 World Bank Group Financing International Development Association (IDA) 200.00 IDA Credit 200.00 Mar 12, 2021 Page 2 of 17 The World Bank Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project (P173749) Environmental and Social Risk Classification Moderate Decision The review did authorize the team to appraise and negotiate Other Decision (as needed) B. Introduction and Context Country Context 1. Benin is a lower-middle income country with significant economic growth but persistent poverty levels. -

The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte D'ivoire, and Togo
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Public Disclosure Authorized Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon Public Disclosure Authorized 00000_CVR_English.indd 1 12/6/17 2:29 PM November 2017 The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon 00000_Geography_Welfare-English.indd 1 11/29/17 3:34 PM Photo Credits Cover page (top): © Georges Tadonki Cover page (center): © Curt Carnemark/World Bank Cover page (bottom): © Curt Carnemark/World Bank Page 1: © Adrian Turner/Flickr Page 7: © Arne Hoel/World Bank Page 15: © Adrian Turner/Flickr Page 32: © Dominic Chavez/World Bank Page 48: © Arne Hoel/World Bank Page 56: © Ami Vitale/World Bank 00000_Geography_Welfare-English.indd 2 12/6/17 3:27 PM Acknowledgments This study was prepared by Nga Thi Viet Nguyen The team greatly benefited from the valuable and Felipe F. Dizon. Additional contributions were support and feedback of Félicien Accrombessy, made by Brian Blankespoor, Michael Norton, and Prosper R. Backiny-Yetna, Roy Katayama, Rose Irvin Rojas. Marina Tolchinsky provided valuable Mungai, and Kané Youssouf. The team also thanks research assistance. Administrative support by Erick Herman Abiassi, Kathleen Beegle, Benjamin Siele Shifferaw Ketema is gratefully acknowledged. Billard, Luc Christiaensen, Quy-Toan Do, Kristen Himelein, Johannes Hoogeveen, Aparajita Goyal, Overall guidance for this report was received from Jacques Morisset, Elisée Ouedraogo, and Ashesh Andrew L. Dabalen. Prasann for their discussion and comments. Joanne Gaskell, Ayah Mahgoub, and Aly Sanoh pro- vided detailed and careful peer review comments. -

Proposal for Benin, Burkina Faso, Niger
AFB/PPRC.22-23/14 6 June 2018 Adaptation Fund Board Project and Programme Review Committee PROPOSAL FOR BENIN, BURKINA FASO, NIGER AFB/PPRC.22-23/14 Background 1. The strategic priorities, policies and guidelines of the Adaptation Fund (the Fund), as well as its operational policies and guidelines include provisions for funding projects and programmes at the regional, i.e. transnational level. However, the Fund has thus far not funded such projects and programmes. 2. The Adaptation Fund Board (the Board), as well as its Project and Programme Review Committee (PPRC) and Ethics and Finance Committee (EFC) considered issues related to regional projects and programmes on a number of occasions between the Board’s fourteenth and twenty-first meetings but the Board did not make decisions for the purpose of inviting proposals for such projects. Indeed, in its fourteenth meeting, the Board decided to: (c) Request the secretariat to send a letter to any accredited regional implementing entities informing them that they could present a country project/programme but not a regional project/programme until a decision had been taken by the Board, and that they would be provided with further information pursuant to that decision (Decision B.14/25 (c)) 3. In its eighth meeting in March 2012, the PPRC came up with recommendations on certain definitions related to regional projects and programmes. However, as the subsequent seventeenth Board meeting took a different strategic approach to the overall question of regional projects and programmes, these PPRC recommendations were not included in a Board decision. 4. In its twenty-fourth meeting, the Board heard a presentation from the coordinator of the working group set up by decision B.17/20 and tasked with following up on the issue of regional projects and programmes. -
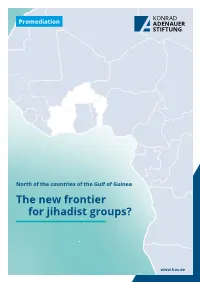
The New Frontier for Jihadist Groups?
Promediation North of the countries of the Gulf of Guinea The new frontier for jihadist groups? www.kas.de North of the countries of the Gulf of Guinea The new frontier for jihadist groups? At a glance At a glance tion has led to increased competition for access to However, these efforts are still not enough. In natural resources and to rising tensions between addition to operational or material flaws in the several communities. security network, there is also a weakness in terms of political and military doctrine. Since In 2020, armed jihadist groups in Sahel faced the authorities believe that the unrest on their Burkina Faso’s southern border is also of inter- jihadist insurgencies have developed in the increased pressure in their strongholds in Mali, northern borders will eventually spill over into est to the jihadists because it is a very profitable Sahara- Sahel region, no state has yet found an Niger and Burkina. their territory. No attacks have yet been carried area for all kinds of trafficking. Both to the east adequate response to contain them. Priority is out on Beninese soil, but incursions by suspected and west, this border has been known for several given to the fight against terrorism, often to the While the Support Group for Islam and Muslims jihadists are on the increase. Côte d’Ivoire was years as an epicentre for the illicit trade in arms, detriment of dialogue with communities and the (JNIM) and the Islamic State in the Greater Sahara first attacked in the north in June 2020. Jihadists gold, drugs, ivory, or goods such as cigarettes and search for local solutions. -

Feuilles De Natitingou (6), Porga
P. FAURE NOTICE EXPLICA’TIVE No 66 (6 et 8) CARTE PEDOLOGIQUE DE RECONNAISSANCE de la République Populaire du Bénin A 1/200.000 NATITINGOU (6) FEUILLES DE PORGA (8) OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIWJE ET TECHNIQUE OUTRE-MER PARIS 1977 NOTICE EXPLICATIVE No 66 (6 et 8) CARTE PEDOLOGIQUE DE RECONNAISSANCE de la RepubliquePopulaire du Bénin à l /200.000 NATITINGOU (6) FEUILLES DE PORGA (8) P. FAURE ORSTOM PARIS 1977 @ ORSTOM 1977 ISBN 2-7099-0423-3 (édition compl8te) ISBN 2-7099-0434-9 SOMMAI RE INTRODUCTION ........................................ 3 I . GENERALITES SUR LE MILIEU ET LA PEDOGENESE .......... 5 Localisationgéographique ............................ 5 Les conditions de milieu 1. Le climat ................... 7 2 . Le substratumgéologique ........ 10 3 . Lemodelé et l’hydrographie ...... 12 4 . La végétation ................. 14 Les matériauxoriginels et la pédogenèse .................. 16 1. Les matériauxoriginels .......... 16 2 . Lesprocessus pédogénétiques ...... 18 II-LESSOLS .......................................... 21 Classification 1. Principesde classification ........ 21 2 . Lalégende .................. 22 Etudemonographique 1. Les sols minérauxbruts .......... 24 2 . Les sols peuévolués ............ 25 , 3 . Les vertisols .................. 28 4 . Les sols ferrugineuxtropicaux ..... 28 5 . Les sols ferraIlitiques ........... 51 6 . Les sols hydromorphes .......... 55 CONCLUSION ......................................... 59 . Répartition des sois . Importancerelative . Caractères d’utilisation . 59 Les principalescontraintes pour la miseen valeur ............ 63 BIBLIOGRAPHIE ........................................ 67 2 IL _. O I l Ii I 3; 3 INTRODUCTION Les cartes pédologiques de reconnaissance, feuilles NA TlTlNGOU etPORGA, font partie d'un ensemble de neuf coupures imprimées couvrant la totalité du terri- toire de la République Populaire du Bénin. Les travaux de terrain de la couverture générale ont été effectués de 1967 à 1971 par les quatre pédologues de la Section de Pédologie du Centre ORSTOM de Cotonou : D. -

1- Etat Et Structure De La Population De L'atacora 2
REPUBLIQUE DU BENIN ------------------- MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ------------------- Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Synthèse des principaux résultats du RGPH-4 de l’ATACORA 1- Etat et structure de la population de l’Atacora Evolution de la population de l’Atacora de 2002 à 2013 DIVISIONS RGPH4-2013 RGPH3-2002 Taux Poids ADMINISTRATIVES d'accroissement démographique intercensitaire en % en 2013 en % (2002- Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin 2013) BENIN 10 008 749 4 887 820 5 120 929 6 769 914 3 284 119 3 485 795 3,52 ATACORA 772 262 380 448 391 814 549 417 270 504 278 913 3,06 7,7 Boukoumbé 82 450 40 479 41 971 60 568 29 523 31 045 2,77 10,7 Cobly 67 603 32 784 34 819 46 660 22 421 24 239 3,34 8,8 Kérou 100 197 49 963 50 234 62 632 31 397 31 235 4,25 13,0 Kouandé 111 540 55 558 55 982 80 261 40 132 40 129 2,96 14,4 Matéri 113 958 55 676 58 282 83 721 40 255 43 466 2,77 14,8 Natitingou 103 843 50 968 52 875 75 620 37 388 38 232 2,85 13,4 Péhunco 78 217 39 147 39 070 55 082 27 546 27 536 3,15 10,1 Tanguiéta 74 675 36 431 38 244 54 719 27 120 27 599 2,79 9,7 Toucountouna 39 779 19 442 20 337 30 154 14 722 15 432 2,48 5,2 En 2013, le département de l’Atacora compte 772 262 habitants soit 7,7% de la Evolution de la structure par âge de la population de l'Atacora aux RGPH-1992, RGPH- population béninoise. -

Rapport Final De L'enquete Steps Au Benin
REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA SANTE Direction Nationale de la Protection Sanitaire Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles RAPPORT FINAL DE L’ENQUETE STEPS AU BENIN Juin 2008 EQUIPE DE REDACTION Pr. HOUINATO Dismand Coordonnateur National / PNLMNT Dr SEGNON AGUEH Judith A. Médecin Epidémiologiste / PNLMNT Pr. DJROLO François Point focal diabète /PNLMNT Dr DJIGBENNOUDE Oscar Médecin Santé Publique/ PNLMNT i Sommaire RESUME ...........................................................................................................1 1 INTRODUCTION....................................................................................... 2 2 OBJECTIFS ................................................................................................ 5 3 CADRE DE L’ETUDE: (étendue géographique).........................................7 4 METHODE ............................................................................................... 16 5 RESULTATS ............................................................................................ 23 6 Références bibliographiques...................................................................... 83 7 Annexes ii Liste des tableaux Tableau I: Caractéristiques sociodémographiques des sujets enquêtés au Bénin en 2008..... 23 Tableau II: Répartition des sujets enquêtés en fonction de leur niveau d’instruction, activité professionnelle et département au Bénin en 2008. ................................................................ 24 Tableau III : Répartition des consommateurs -

Evaluation Design Report for the Benin Power Compact's Electricity Generation Project and Electricity Distribution Project
FINAL REPORT Evaluation Design Report for the Benin Power Compact's Electricity Generation Project and Electricity Distribution Project March 7, 2018 Christopher Ksoll Kristine Bos Arif Mamun Anthony Harris Sarah Hughes Submitted to: Millennium Challenge Corporation 1099 14th Street, NW Suite 700 Washington, DC 20005 Project Monitor: Hamissou Samari Contract Number: MCC-16-CON-0058 Submitted by: Mathematica Policy Research 1100 1st Street, NE, 12th Floor Washington, DC 20002-4221 Telephone: (202) 484-9220 Facsimile: (202) 863-1763 Project Director: Sarah Hughes Reference Number: 50339.01.200.031.000 This page has been left blank for double-sided copying. BENIN ENERGY II: EVALUATION DESIGN REPORT MATHEMATICA POLICY RESEARCH CONTENTS ACRONYMS ............................................................................................................................................... VII I. INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 1 II. OVERVIEW OF THE COMPACT, GENERATION ACTIVITY, AND DISTRIBUTION ACTIVITY ......................................................................................................................................... 5 A. Overview of the Benin Power Compact ..................................................................................... 5 B. Overview of the theory of change .............................................................................................. 9 C. Economic rate of return and -

Laws of Attraction Northern Benin and Risk of Violent Extremist Spillover
Laws of Attraction Northern Benin and risk of violent extremist spillover CRU Report Kars de Bruijne Laws of Attraction Northern Benin and risk of violent extremist spillover Kars de Bruijne CRU Report June 2021 This is a joint report produced by the Conflict Research Unit of Clingendael – the Netherlands Institute of International Relations in partnership with the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). June 2021 © Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Cover photo: © Julien Gerard Unauthorized use of any materials violates copyright, trademark and / or other laws. Should a user download material from the website or any other source related to the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, or the Clingendael Institute, for personal or non-commercial use, the user must retain all copyright, trademark or other similar notices contained in the original material or on any copies of this material. Material on the website of the Clingendael Institute may be reproduced or publicly displayed, distributed or used for any public and non-commercial purposes, but only by mentioning the Clingendael Institute as its source. Permission is required to use the logo of the Clingendael Institute. This can be obtained by contacting the Communication desk of the Clingendael Institute ([email protected]). The following web link activities are prohibited by the Clingendael Institute and may present trademark and copyright infringement issues: links that involve unauthorized use of our logo, framing, inline links, or metatags, as well as hyperlinks or a form of link disguising the URL. About the author Kars de Bruijne is a Senior Research Fellow with the Clingendael’s Conflict Research Unit and a former Senior Researcher at ACLED.