Etude D'impact Environnemental Et Social Et Du Plan De Gestion Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SITUATION REPORT 9 – 15 July 2007
SITUATION REPORT 9 – 15 July 2007 UNITED NATIONS NATIONS UNIES Office for the Coordination of Bureau de Coordination des Humanitarian Affairs in Burundi Affaires Humanitaires au Burundi http://ochaonline.un.org/Burundi http://ochaonline.un.org/Burundi ACTIVITIES AND UPDATES Update on repatriation Last week, UNHCR reported the return of 840 Burundian refugees who arrived from Tanzania through the entry points of Kobero / Muyinga province (182), Gisuru /Ruyigi province (248) and Mabanda / Makamba province (410). This is the first repatriation which has taken place since new measures to promote the return of Burundians from northwestern camps in Tanzania were announced. Nonetheless, statistics of previous years reveal that the present increase in the number of returnees is normal during this time of the year. Since the beginning of the UNHCR facilitated repatriation process in April 2002, the number of returnees normally starts increasing from May and peaks in August due to the end of the school year and harvests. The impact of the cash grant programme will be better evaluated through returnee caseloads starting from late September. During the period under review, 462 DRC refugees were transferred from Bujumbura to Musasa transit center (Ngozi province). To date, the total number of DRC refugees transferred to Gasorwe refugee camp and Musasa transit center in 2007 is 4,287. Update on Burundians expelled from Tanzania Expelled persons continue to arrive from Tanzania. During the reporting week, the Government project for the reintegration of war-affected persons (PARESI) registered 414 persons (205 families) expelled from Tanzania: 356 at the entry point of Kobero (Muyinga) and 58 in Mishiha (Cankuzo). -

Integrated Regional Information Network (IRIN): Burundi
U.N. Department of Humanitarian Affairs Integrated Regional Information Network (IRIN) Burundi Sommaire / Contents BURUNDI HUMANITARIAN SITUATION REPORT No. 4...............................................................5 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 26 July 1996 (96.7.26)..................................................9 Burundi-Canada: Canada Supports Arusha Declaration 96.8.8..............................................................11 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 14 August 1996 96.8.14..............................................13 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 15 August 1996 96.8.15..............................................15 Burundi: Statement by the US Catholic Conference and CRS 96.8.14...................................................17 Burundi: Regional Foreign Ministers Meeting Press Release 96.8.16....................................................19 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 16 August 1996 96.8.16..............................................21 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 20 August 1996 96.8.20..............................................23 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 21 August 1996 96.08.21.............................................25 Burundi: Notes from Burundi Policy Forum meeting 96.8.23..............................................................27 Burundi: IRIN Summary of Main Events for 23 August 1996 96.08.23................................................30 Burundi: Amnesty International News Service 96.8.23.......................................................................32 -

Date 02 June 2006
Emergency Report 2006-22 World Food Programme Emergency Report 2006 Issued Weekly by the United Nations World Food Programme Report No. 22 / 2006 - Date 02 June 2006 (A) Highlights (B) Middle East,Central Asia and Eastern Europe: (1) Afghanistan (2) Occupied Palestinian Territories (3) Russian Federation (Caucasus) (C) East & Central Africa: (1) Burundi (2) Congo (3) Congo, DR (4) Ethiopia (5) Rwanda (6) Somalia (7) Sudan (8) Tanzania (9) Uganda (D) West Africa: (1) Chad (2) Guinea (3) Liberia (4) Mauritania (E) Asia: (1) Indonesia (F) Latin America and Caribbean: (1) Colombia (2) Cuba (3) Ecuador (4) Guatemala (5) Nicaragua (A) Highlights (a) In Indonesia, WFP has reached at least 173,515 beneficiaries in Bantul and Klaten districts since its immediate response to the earthquake on 27 May. (b) Between 1 to 28 May, WFP dispatched a total amount of 40,167 tons of food from logistical hubs to the Darfur region in Sudan. (c) In Uganda, over 20,000 Internally Displaced Persons (IDPs) returning to their villages in Lira district received a 3-month resettlement ration. (d) In DR Congo, over 12,700 returnees from the Republic of Congo are expected to arrive in Mbandaka and surrounding areas by the end of December 2006. (e) During the heavy rains in May and April around 4,500 houses and nearly 1,400 hectares of various farm crops were destroyed in Burundi. (f) Food transportation to Somali region in Ethiopia is becoming increasingly difficult due to heightened insecurity, poor road infrastructure and low transportation capacity. (g) On 21 May 2006, close to 148,000 people in East and Central African countries joined hundreds of thousands of their fellow citizens around the globe to participate in Walk the World to call for the end of child hunger. -

Burundi Page 1 of 17
Burundi Page 1 of 17 Burundi Country Reports on Human Rights Practices - 2007 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor March 11, 2008 Burundi is a constitutional republic with an elected government and a population of 8.3 million. In August 2005, following local and parliamentary elections, the country's two houses of parliament indirectly elected as President, Pierre Nkurunzia, a member of the National Council for the Defense of Democracy–Forces for the Defense of Democracy (CNDD-FDD) political party. International observers reported that the elections, which ended a four-year transitional process under the Arusha Peace and Reconciliation Agreement, were generally free and fair. Although the CNDD-FDD party dominated parliament and the government, other major parties, notably the Burundian Front for Democracy (FRODEBU) and the Union for National Progress (UPRONA), were also represented. In September 2006 the government concluded a cease-fire agreement with the Party for the Liberation of the Hutu National Liberation Front (PALIPEHUTU-FNL or FNL), with which it had been engaged in hostilities since 1994, and began demobilizing an estimated 3,000 former FNL combatants. The government continued to integrate members of former rebel groups, including the CNDD-FDD, into the National Defense Forces (FDN). From 2004 to December 2007 the government demobilized more than 24,400 former combatants that included members of the regular army, some former rebels, and more than 3,000 child soldiers. Both sides generally adhered to the cease-fire agreement with the exception of a December 28 incident, in which the FNL attacked three military positions in Bubanza, resulting in several injuries and one death among government soldiers. -
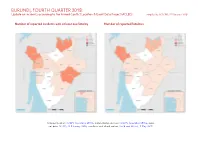
BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Compiled by ACCORD, 25 February 2020
BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 25 February 2020 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; incid- ent data: ACLED, 22 February 2020; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 FEBRUARY 2020 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 136 28 58 Conflict incidents by category 2 Protests 23 0 0 Development of conflict incidents from December 2016 to December 2018 2 Riots 17 10 10 Strategic developments 8 0 0 Methodology 3 Battles 7 3 7 Conflict incidents per province 4 Explosions / Remote 5 1 3 violence Localization of conflict incidents 4 Total 196 42 78 Disclaimer 6 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 22 February 2020). Development of conflict incidents from December 2016 to December 2018 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 22 February 2020). 2 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 FEBRUARY 2020 Methodology GADM. Incidents that could not be located are ignored. The numbers included in this overview might therefore differ from the original ACLED data. -

Dep Ar Tement De La Population Republique Du Burundi Ministere De L'interieur Departement De La Population
REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DE L'I1'!TERIEUR DEP AR TEMENT DE LA POPULATION REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DE L'INTERIEUR DEPARTEMENT DE LA POPULATION Centre Français sur 1 et le Dé ppement 15, rue ,'Ecole de Médecine 70 PARIS CEDEX 06 Tél. (1) 46 33 9941 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A O'U T 1 979 TOME II Volume VIII RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROVINCE DE NGOZI Bujumbura, Octobre 1983 " -3- RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A 0 U T 1 979 SOMMAIRE PAGES Ayant-propos 4 1. Introduction 5 2. principaux Résultats 6 2.1- Effectifs et Densités 6 2.2- Lieu de Naissance et Lieu de Résidence 9 2.3- Sexe et Age 11 2.4- Alphabétisation et Scolarisation 15 2.5- population Active et Inactive 17 2.6- Professions et Branches d'Activité 18 2.7- Ménage et Rugo 21 3. Conclusion 23 4. Annexes 24 4.1- Liste des tableaux 24 4.2- Résultats Bruts 28 -4- AVANT·-PROPOS Comme pour toutes les autres publications sur les Résultats définitifs du Recensement général de la Population effectué en 1979, le présent rapport se réfère aux anciennes limites de la Province de NGOZI avant la nouvelle déli mitation du territoire Burundais. Après une brève introduction, le lecteur y trouvera les principaux résultats sur les effectifs et densité, le lieu de naissance et le lieu de ré sidence, le sexe et l'âge, l'alphabétisation et la scolarisation, la population active et inactive, les professions et les branches d'activités, les ménages et rugo et enfin des annexes contenant la liste des tableaux bruts. -

BURUNDI: Carte De Référence
BURUNDI: Carte de référence 29°0'0"E 29°30'0"E 30°0'0"E 30°30'0"E 2°0'0"S 2°0'0"S L a c K i v u RWANDA Lac Rweru Ngomo Kijumbura Lac Cohoha Masaka Cagakori Kiri Kiyonza Ruzo Nzove Murama Gaturanda Gatete Kayove Rubuga Kigina Tura Sigu Vumasi Rusenyi Kinanira Rwibikara Nyabisindu Gatare Gakoni Bugabira Kabira Nyakarama Nyamabuye Bugoma Kivo Kumana Buhangara Nyabikenke Marembo Murambi Ceru Nyagisozi Karambo Giteranyi Rugasa Higiro Rusara Mihigo Gitete Kinyami Munazi Ruheha Muyange Kagugo Bisiga Rumandari Gitwe Kibonde Gisenyi Buhoro Rukungere NByakuizu soni Muvyuko Gasenyi Kididiri Nonwe Giteryani 2°30'0"S 2°30'0"S Kigoma Runyonza Yaranda Burara Nyabugeni Bunywera Rugese Mugendo Karambo Kinyovu Nyabibugu Rugarama Kabanga Cewe Renga Karugunda Rurira Minyago Kabizi Kirundo Rutabo Buringa Ndava Kavomo Shoza Bugera Murore Mika Makombe Kanyagu Rurende Buringanire Murama Kinyangurube Mwenya Bwambarangwe Carubambo Murungurira Kagege Mugobe Shore Ruyenzi Susa Kanyinya Munyinya Ruyaga Budahunga Gasave Kabogo Rubenga Mariza Sasa Buhimba Kirundo Mugongo Centre-Urbain Mutara Mukerwa Gatemere Kimeza Nyemera Gihosha Mukenke Mangoma Bigombo Rambo Kirundo Gakana Rungazi Ntega Gitwenzi Kiravumba Butegana Rugese Monge Rugero Mataka Runyinya Gahosha Santunda Kigaga Gasave Mugano Rwimbogo Mihigo Ntega Gikuyo Buhevyi Buhorana Mukoni Nyempundu Gihome KanabugireGatwe Karamagi Nyakibingo KIRUCNanika DGaOsuga Butahana Bucana Mutarishwa Cumva Rabiro Ngoma Gisitwe Nkorwe Kabirizi Gihinga Miremera Kiziba Muyinza Bugorora Kinyuku Mwendo Rushubije Busenyi Butihinda -

IFAD to Boost Agricultural Transformation the Regional
IFAD to boost agricultural transformation The Regional Director of East and Southern Africa at the International Fund for Agricultural Development visited, on 30 January, different projects financed by IFAD in Bubanza province. Beneficiaries appreciate the step made in rural transformation. Sara Mbago Bhunu, Regional Director of the East and Southern Africa at the International Fund for Agricultural Development -IFAD is in Burundi since 28 January. “I really want to have a deep understanding about the IFAD portfolio in Burundi,” she says adding that she has held discussions with international partners, government and other stakeholders involved in the agricultural sector. On 30 January, the Regional Director of East and Southern Africa at IFAD met beneficiaries supported by IFAD in six different projects in Bubanza province. She also met a group of rice farmers in Musenyi zone, in Mpanda commune. About 219 members including 133 women and 87 men grouped into “Twizigirane” cooperative work together to grow rice and easily harvest about 700 tones per agricultural season. “Our objective is to achieve 2000 tones,” says Marie-Louise Baranyikwa, chairwoman of the cooperative. She says their cooperative can easily earn BIF 20 million depending on the market and each member can receive BIF 100,000 after saving in the cooperative. The Regional Director of East and Southern Africa at IFAD has also visited a Nutrition, Learning and Rehabilitation Center – FARN. It was set up on Nyabikere hill in Mpanda commune by PROPA-O. FARN is a meeting place in hill households where cooking demonstrations and sensitization to good nutrition, health and hygiene are conducted. -
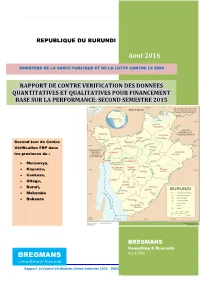
Second Semestre 2015
P a g e | 1 REPUBLIQUE DU BURUNDI Aout 2016 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA RAPPORT DE CONTRE VERIFICATION DES DONNEES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES POUR FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE: SECOND SEMESTRE 2015 Second tour de Contre Vérification FBP dans les provinces de : Muramvya, Kayanza, Cankuzo, Gitega, Bururi, Makamba Bubanza BREGMANS Consulting & Research BREGMANS Aout 2016 Consulting & Research Rapport de Contre Vérification: IIième Semestre 2015; BREGMANS Consulting & Research P a g e | 2 Carte du Burundi Rapport de Contre Vérification: IIième Semestre 2015; BREGMANS Consulting & Research P a g e | 3 Rapport de Contre Vérification: IIième Semestre 2015; BREGMANS Consulting & Research P a g e | 4 Note de remerciements : Ce travail de contre vérification a pu aboutir à ce point grâce aux efforts combinés des personnes compétentes qui ont su mettre à profit leurs connaissances en termes techniques, en termes d’organisation et en conseils pertinents pour le bon déroulement des activités. Nos remerciements sont adressés aux responsables du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida au Burundi et aux membres de la Cellule Technique Nationale pour le Financement Basé sur la performance (FBP) qui ont bien pris le temps d’exprimer leurs attentes concernant le choix des structures constituant l’échantillon de notre travail de terrain. Leurs avis techniques et leurs discussions constructives nous ont permis d’harmoniser nos vues sur la finalité du travail de contre vérification. Nos sincères remerciements vont aussi à l’endroit des acteurs de terrain dans les différentes provinces visitées. Ils nous ont facilité l’accès aux structures sanitaires et aux données malgré les temps difficiles que le pays traverse. -

World Bank Document
SFG4111 REPUBLIQUE DU BURUNDI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PROJET DE RESTAURATION DES PAYSAGES ET DE RESILIENCE AU BURUNDI (PRPR-BURUNDI) CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) Public Disclosure Authorized RAPPORT DEFINITIF Public Disclosure Authorized Janvier, 2018 TABLE DES MATIERES ACRONYMES ................................................................................................................................................................. iv EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................................. v RESUME EXECUTIF ...................................................................................................................................................... vii LISTE DES FIGURES........................................................................................................................................................ x LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................................... xi 1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 1 1.1. Contexte et objectifs du Projet de Restauration des Paysages et de Résilience et de l’étude du cadre de gestion environnementale et sociale ............................................................................................ -

MFA-MAGAZINE Nber 61 of 21St Febr 2020 Ministère Des Affaires Etrangères
REPUBLIQUE DU BURUNDI MFA-MAGAZINE Nber 61 of 21st Febr 2020 Ministère des Affaires Etrangères Bujumbura: The Head of State meets Representatives of reli- Sommaire page gious denominations in a moralization session Bujumbura: Head of State meets representa- tives of religious de- 1 nominations in a mor- alization session Bubanza: CNDD-FDD party members urged to 2 remain calm before, during and after 2020 elections The Minister of Foreign Affairs invited to na- 3 tional assembly in ple- nary session on oral issues he Head of State, His Excellency Pierre Nkurunziza, hosted the fourth ses- Coronavirus: China's T sion of moralization of the society on Friday, 21 February 2020 in Bujum- Ambassador to Burundi bura City Hall, towards certain Representatives of religious denominations tranquilizes parents with 5 students in China grouped within the African Ministry of compassion MAC. The Reverend Pastor Denise Nkurunziza took part in this session. At the end of the closed-door session, the Deputy Spokesperson of the Presi- dent of the Republic, Mr Alain Diomède Nzeyimana, said that these Religious Elections 2020: valida- tion of the insignia of Confessions set themselves the goal of working according to the theme ''unity in political parties and 6 the diversity'' coalitions ( source: www.rtnb.bi) CNL: Hon. Agathon Rwasa nominated for 7 2020 presidential candi- date st Page 2 MFA-MAGAZINE Nbr 61 OF 21 Febr 2020 Bubanza: CNDD-FDD party members urged to remain calm before, during and after 2020 elections the Sangwe cooperative on that hill. In Gihanga com- mune, the Bagumyabanga inaugurated the hillperma- nences of Gihungwe, Buringa, Village 2, Village 3, Vil- lage 5 and the Gihanga Centre. -

農村JR13064 農業セクター.Indb
第3章 ブルンジにおける農業の現状(コメを中心として) 3-1第3 章インボ灌漑地域における灌漑稲作 ブルンジにおける農業の 現状(コメを中心として) 3-1-1 営農形態と農民及びその組織の技術レベル 3-1(1)営農形態 インボ灌漑地域 における灌漑稲作 3- 1インボ灌漑地域においては、農民は灌-1 営農形態と農民及びその組織の技術漑水田で稲作を行うとともに、周辺部レベル (の畑地で、バナナ、キャッサバ、トウモ1)営農形態 ロコシ、ラッカセイ、ソルガム、ダイ ズ、野菜類、アマランサスなどを栽培していインボ灌漑地域においては、農民は灌漑水田でる。インボ灌漑地域は稲作を行うとともに、周辺Bubanza、部の畑地で、 Bujumbura-Ruralバナナ、キャッサ 及びバ、ト Bujumbura-Mairieウモロコシ、ラッカ のセ 3イ 県にまたがった地域であるが、そ、ソルガム、ダイズ、野菜類、アマラ のうちの最大の面積を占めるンサスなどを栽培している。イ Bubanzaンボ灌漑 県の作物生産を見ると(図地域は Bubanza、Bujumbura-Rur 3-1)al 及び、バナナBujumbura- の生産量が最大で、次いでコメとキャッサバが同程度で、これらMairie の 3 県にまたがった地域であるが、そのうちの最大の面積を占め 3る 作物が最もBubanza 県の作 重要な食料源になっている。そのほかに物生産を見ると(図3-1)、バナナの生産、わずかながらタロイモ、トウモロコ量が最大で、次いでコメとキャッサバが同程 シ、インゲンマメ、サツマイモ、ジャガ度で、これら 3 作物が最も重要な食料源になイモ、ソルガム、エンドウマメが生産っている。そのほかに、わずかながらタロイ されている。また、換金作物として、稲モ、トウモロコシ、インゲンマメ、サツマイのほか、アブラヤシ、ワタ、トマトなモ、ジャガイモ、ソルガム、エンドウマメが どが栽培されている。主要作物について生産されている。また、換金作物として、稲、インボ灌漑地域を含むインボ平野全のほか、アブラヤシ、ワタ、トマトなどが栽 培されている。主要作物について、インボ灌漑地域を含むインボ平野全体の栽培歴を図3 体の栽培歴を図 3-2 に示す。水の消費量の大きい稲を大雨期に、より少ないト -2に示す。水の消費量の大きい稲を大雨期に、より少ないトウモロコシを小雨期に、ま ウモロコシを小雨期に、また、インゲンマメやトマトは年に 2 回作付けするな た、インゲンマメやトマトは年に 2 回作付けするなど、気象条件に応じた作付け体系がみ ど、気象条件に応じた作付け体系がみられる。 られる。 なお、稲作農民からの聞き取りによると、コメ以外の農作物のほとんどは自 なお、稲作農民からの聞き取りによると、コメ以外の農作物のほとんどは自給用で、畑 給用で、畑地面積の小さい農家では、コメの自家消費量も多く、コメを売って 地面積の小さい農家では、コメの自家消費量も多く、コメを売ってキャッサバ粉などの食 キャッサバ粉などの食料を購入していることもある。 料を購入していることもある。 250,000 エンドウマメ 200,000 ソルガム ジャガイモ 150,000 サツマイモ インゲンマメ 100,000 トウモロコシ タロイモ キャッサバ 50,000 コメ バナナ 0 2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 出典:Country Stat Burundi 図 3-1 Bubanza 県の作物生産の推移図3-1 Bubanza 県の作物生産の推移 出典:Country