3 Heures Avec Le Père-Lachaise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport D'activité 2019 Musées D'orsay Et De L'orangerie
Rapport d’activité 2019 Musées d’Orsay et de l’Orangerie Rapport d’activité 2019 Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie Sommaire Partie 1 Partie 3 Les musées d’Orsay Le public, au cœur de la politique et de l’Orangerie : des collections de l’EPMO 57 exceptionnelles 7 Un musée ouvert à tous 59 La vie des collections 9 L’offre adulte et grand public 59 Les acquisitions 9 L’offre de médiation famille et jeune Le réaccrochage des collections permanentes 9 public individuel 60 Les inventaires 10 L’offre pour les publics spécifiques 63 Le récolement 22 L’éducation artistique et culturelle 64 Les prêts et dépôts 22 Les outils numériques 65 La conservation préventive et la restauration 23 Les sites Internet 65 Le cabinet d’arts graphiques et de photographies 25 Les réseaux sociaux 65 Les accrochages d’arts graphiques Les productions audiovisuelles et numériques 66 et de photographies 25 Le public en 2019 : des visiteurs venus L’activité scientifique 30 en nombre et à fidéliser 69 Bibliothèques et documentations 30 Des records de fréquentation en 2019 69 Le pôle de données patrimoniales digitales 31 Le profil des visiteurs 69 Le projet de Centre de ressources La politique de fidélisation 70 et de recherche 32 Les activités de recherche et la formation des stagiaires 32 Partie 4 Les colloques et journées d’étude 32 L’EPMO, Un établissement tête de réseau : l’EPMO en région 33 un rayonnement croissant 71 Les expositions en région 33 Les partenariats privilégiés 34 Un rayonnement mondial 73 Orsay Grand Département 34 Les expositions -

P22 445 Index
INDEXRUNNING HEAD VERSO PAGES 445 Explanatory or more relevant references (where there are many) are given in bold. Dates are given for all artists and architects. Numbers in italics are picture references. A Aurleder, John (b. 1948) 345 Aalto, Alvar (1898–1976) 273 Automobile Club 212 Abadie, Paul (1812–84) 256 Avenues Abaquesne, Masséot 417 Av. des Champs-Elysées 212 Abbate, Nicolo dell’ (c. 1510–71) 147 Av. Daumesnil 310 Abélard, Pierre 10, 42, 327 Av. Foch 222 Absinthe Drinkers, The (Edgar Degas) 83 Av. Montaigne 222 Académie Française 73 Av. de l’Observatoire 96 Alexander III, Pope 25 Av. Victor-Hugo 222 Allée de Longchamp 357 Allée des Cygnes 135 B Alphand, Jean-Charles 223 Bacon, Francis (1909–92) 270 American Embassy 222 Ballu, Théodore (1817–85) 260 André, Albert (1869–1954) 413 Baltard, Victor (1805–74) 261, 263 Anguier, François (c. 1604–69) 98, Balzac, Honoré de 18, 117, 224, 327, 241, 302 350, 370; (statue ) 108 Anguier, Michel (1614–86) 98, 189 Banque de France 250 Anne of Austria, mother of Louis XIV Barrias, Louis-Ernest (1841–1905) 89, 98, 248 135, 215 Antoine, J.-D. (1771–75) 73 Barry, Mme du 17, 34, 386, 392, 393 Apollinaire, Guillaume (1880–1918) 92 Bartholdi, Auguste (1834–1904) 96, Aquarium du Trocadéro 419 108, 260 Arc de Triomphe 17, 220 Barye, Antoine-Louis (1795–1875) 189 Arc de Triomphe du Carrousel 194 Baselitz, Georg (b. 1938) 273 Arceuil, Aqueduct de 372 Bassin du Combat 320 Archipenko, Alexander (1887–1964) Bassin de la Villette 320 267 Bastien-Lepage, Jules (1848–84) 89, Arènes de Lutèce 60 284 Arlandes, François d’ 103, 351 Bastille 16, 307 Arman, Armand Fernandez Bateau-Lavoir 254 (1928–2005) 270 Batignolles 18, 83, 234 Arp, Hans (Jean: 1886–1966) 269, 341 Baudelaire, Charles 31, 40, 82, 90, 96, Arras, Jean d’ 412 108 Arsenal 308 Baudot, Anatole de (1834–1915) 254 Assemblée Nationale 91 Baudry, F. -

Paris Fashion Week Bulletin
City Guides x Emilie Meinadier Consulting Paris Fashion Week Bulletin #4 Winter 2017-18 Eat & Drink Carbón La Fidelité Le Vin des Pyrénées BAR / COCKTAILS / MODERN EURO / SMALL PLATES COCKTAILS / MODERN FRENCH BAR / BREAKFAST / BRUNCH / MODERN EURO / From the oysters to the duck breast The epicurean crew from the Entrée des NON-STOP / TERRACE / WINE BAR and burrata, everything at this stylish, Artistes in Pigalle are now taking care of this The historic Marais wine bar has been rejigged contemporary bistro is smoked with beech glamourous old brasserie by the Gare de l’Est into a modern all-day bistro with an atmosphere wood or hay, or cooked over the Josper grill. with its chandeliers and moldings, and flickering conjuring a stylish but timeless Paris, a few Swedish chef David Kjellstenius works at candlelight on white tablecloths. The menu minutes walk from the Place des Vosges. Open channeling the essence of each ingredient via focuses on French ingredients and recipes via every day from early to late, it’s a reliable spot simple and succulent dishes to share. The wine reworked classics like celery remoulade or eggs to drop in for a morning coffee, a meal, or an list is all natural, and there’s a secret cocktail mayonnaise, while the cocktail menu spotlights excellent cocktail in the moody little bar upstairs, bar La Mina in the basement too. forgotten French spirits and aperitifs. the 1905 (a nod to the spot’s birthday). 14 rue Charlot, 75003 | 01.42.72.49.12 | Noon-2pm, 12 rue de la Fidélité, 75010 | 01.47.70.85.77 | 25 rue Beautreillis, 75004 | Daily, 7am-2am | 7pm-2am. -

Mardi 26 Juin 2018 Expert Thierry Bodin Syndicat Français Des Experts Professionnels En Œuvres D’Art Les Autographes 45, Rue De L’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél
ALDE 185 mardi 26 juin 2018 Expert Thierry Bodin Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art Les Autographes 45, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél. 01 45 48 25 31 - Facs 01 45 48 92 67 [email protected] Arts et Littérature nos 1 à 148 Histoire et Sciences nos 149 à 249 Exposition privée chez l’expert Uniquement sur rendez-vous préalable Exposition publique à l’ Hôtel Ambassador le mardi 26 juin de 10 heures à midi Abréviations : L.A.S. ou P.A.S. : lettre ou pièce autographe signée L.S. ou P.S. : lettre ou pièce signée (texte d’une autre main ou dactylographié) L.A. ou P.A. : lettre ou pièce autographe non signée En 1re de couverture no 125 : Niki de SAINT PHALLE (1930-2002). L.A.S. « Niki », avec dessin original, à Mme Claude Pompidou. En 4e de couverture no 40 : Théophile GAUTIER (1811-1872). Quatre poèmes autographes montés dans Émaux et Camées. ALDE Maison de ventes spécialisée Livres-Autographes-Monnaies Lettres & Manuscrits autographes Vente aux enchères publiques Mardi 26 juin 2018 à 14 h 15 Hôtel Ambassador Salon Mogador 16, boulevard Haussmann 75009 Paris Tél. : 01 44 83 40 40 Commissaire-priseur Jérôme Delcamp ALDE Belgique ALDE Philippe Beneut Maison de ventes aux enchères Boulevard Brand Withlock, 149 1, rue de Fleurus 75006 Paris 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél. 01 45 49 09 24 - Fax 01 45 49 09 30 [email protected] - www.alde.be [email protected] - www.alde.fr Tél. +32 (0) 479 50 99 50 Agrément 2006-587 6 8 13 19 Arts et Littérature 2 1. -

Highlights of a Fascinating City
PARIS HIGHLIGHTS OF A FASCINATING C ITY “Paris is always that monstrous marvel, that amazing assem- blage of activities, of schemes, of thoughts; the city of a hundred thousand tales, the head of the universe.” Balzac’s description is as apt today as it was when he penned it. The city has featured in many songs, it is the atmospheric setting for countless films and novels and the focal point of the French chanson, and for many it will always be the “city of love”. And often it’s love at first sight. Whether you’re sipping a café crème or a glass of wine in a street café in the lively Quartier Latin, taking in the breathtaking pano- ramic view across the city from Sacré-Coeur, enjoying a romantic boat trip on the Seine, taking a relaxed stroll through the Jardin du Luxembourg or appreciating great works of art in the muse- ums – few will be able to resist the charm of the French capital. THE PARIS BOOK invites you on a fascinating journey around the city, revealing its many different facets in superb colour photo- graphs and informative texts. Fold-out panoramic photographs present spectacular views of this metropolis, a major stronghold of culture, intellect and savoir-vivre that has always attracted many artists and scholars, adventurers and those with a zest for life. Page after page, readers will discover new views of the high- lights of the city, which Hemingway called “a moveable feast”. UK£ 20 / US$ 29,95 / € 24,95 ISBN 978-3-95504-264-6 THE PARIS BOOK THE PARIS BOOK 2 THE PARIS BOOK 3 THE PARIS BOOK 4 THE PARIS BOOK 5 THE PARIS BOOK 6 THE PARIS BOOK 7 THE PARIS BOOK 8 THE PARIS BOOK 9 ABOUT THIS BOOK Paris: the City of Light and Love. -

Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Casting Rodin’s Thinker Sand mould casting, the case of the Laren Thinker and conservation treatment innovation Beentjes, T.P.C. Publication date 2019 Document Version Other version License Other Link to publication Citation for published version (APA): Beentjes, T. P. C. (2019). Casting Rodin’s Thinker: Sand mould casting, the case of the Laren Thinker and conservation treatment innovation. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:07 Oct 2021 Chapter 2 The casting of sculpture in the nineteenth century 2.1 Introduction The previous chapter has covered the major technical developments in sand mould casting up till the end of the eighteenth century. These innovations made it possible to mould and cast increasingly complex models in sand moulds with undercut parts, thus paving the way for the founding of intricately shaped sculpture in metal. -
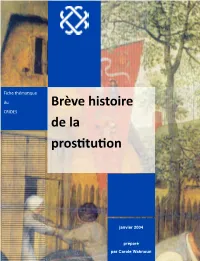
Brève Histoire De La Pros Tu On
Fiche théma+que du Brève histoire CRIDES de la pros0tuon janvier 2004 préparé par Carole Wahnoun COURTISANE ET SON CLIENT, PÉLIKÉ ATTIQUE À FIGURES ROUGES DE POLYGNOTE, V. 430 AV. J.-C., MUSÉE NATIONAL ARCHÉOLOGIQUE D'ATHÈNES 1 LES DÉBUTS : L'HOSPITALITÉ SEXUELLE ET LA PROSTITUTION SACRÉE Il n'est pas certain que la prostitution soit "le plus vieux métier du monde" ; durant la colonisation, les Européens la feront admettre. Il existait toutefois, dans certaines sociétés primitives européennes, une prostitution liée à la notion d'hospitalité : les différentes femmes de la maison sont offertes aux hô- tes de passage. Cette coutume existait en Chaldée, en Inde, en Egypte et dans tout l'Orient. Parfois même, l'hospitalité sexuelle implique un aspect religieux que les prêtres de certaines divinités organi- sent et dont ils bénéficient. Les prostituées sacrées n'étaient pas toutes considérées de la même fa- çon et certaines spécialisaient leurs tâches en fonction de ce qui était décidé chez les grands prê- tres. Pourtant la prostitution s'est bientôt réduite à un rituel sexuel prenant son vrai visage durant les Saturnales et autres orgies à caractère religieux. Aussi, bien que le rite demeure, la prostitution de- vient un phénomène social et commence à se désacraliser. En plus de la prostitution sacrée, les grandes courtisanes existèrent en Orient, non seulement en Inde, mais aussi en Birmanie et en Corée et surtout au Japon. En Chine si, au départ, les prostituées ressemblaient aux hétaïres grecques, la prostitution s'y organise très vite commercialement. Chez les Hébreux et les Musulmans, elle fut toujours considérée avec répulsion et n'était pratiquée que par les étrangères ou les esclaves. -

The French Law of April 13 2016 Aimed at Strengthening the Fight Against the Prostitutional System and Providing Support For
The French law of April 13 2016 aimed at strengthening the fight against the prostitutional system and providing support for prostituted persons Principles, goals, measures and adoption of a historic law. 1 CAP international, March 2017 www.cap-international.org Authors: Grégoire Théry, Executive director of CAP international Claudine Legardinier, Journalist Graphic design: micheletmichel.com Translation: Caroline Degorce Contents Presentation of the law of April 13, 2016 > Introduction ................................................................................................................................................p.5 > Content of the law ....................................................................................................................................p.5 French law following the adoption of the new Act > The fight against procuring and pimping .......................................................................................p.8 > Prohibition of the purchase of sex acts .......................................................................................... p.9 > Protection, access to rights and exit policy for victims of prostitution, pimping and trafficking .......................................................................................................................p.10 The spirit of the law > Philosophical foundation ....................................................................................................................p.13 > Adoption of the parliamentary resolution of December -

The Ecumenical Movement and the Origins of the League Of
IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by James M. Donahue __________________________ Mark A. Noll, Director Graduate Program in History Notre Dame, Indiana April 2015 © Copyright 2015 James M. Donahue IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 Abstract by James M. Donahue This dissertation traces the origins of the League of Nations movement during the First World War to a coalescent international network of ecumenical figures and Protestant politicians. Its primary focus rests on the World Alliance for International Friendship Through the Churches, an organization that drew Protestant social activists and ecumenical leaders from Europe and North America. The World Alliance officially began on August 1, 1914 in southern Germany to the sounds of the first shots of the war. Within the next three months, World Alliance members began League of Nations societies in Holland, Switzerland, Germany, Great Britain and the United States. The World Alliance then enlisted other Christian institutions in its campaign, such as the International Missionary Council, the Y.M.C.A., the Y.W.C.A., the Blue Cross and the Student Volunteer Movement. Key figures include John Mott, Charles Macfarland, Adolf Deissmann, W. H. Dickinson, James Allen Baker, Nathan Söderblom, Andrew James M. Donahue Carnegie, Wilfred Monod, Prince Max von Baden and Lord Robert Cecil. -

Film Producer Buys Seacole Bust for 101 Times the Estimate
To print, your print settings should be ‘fit to page size’ or ‘fit to printable area’ or similar. Problems? See our guide: https://atg.news/2zaGmwp ISSUE 2454 | antiquestradegazette.com | 15 August 2020 | UK £4.99 | USA $7.95 | Europe €5.50 koopman rare art antiques trade KOOPMAN (see Client Templates for issue versions) THE ART M ARKET WEEKLY [email protected] +44 (0)20 7242 7624 www.koopman.art Face coverings Film producer buys Seacole now mandatory at auction rooms bust for 101 times the estimate across England A terracotta sculpture of Mary Seacole by Alex Capon (1805-81) sparked fierce competition at Dominic Winter. Wearing a face covering when Bidding at the South Cerney auction house attending an auction house in England began with 12 phones competing for the has now become mandatory. sculpture of Seacole, who nursed soldiers The updated guidance also applies to visitors to galleries and museums. during the Crimean War. Since July 24, face coverings have been It eventually came down to a final contest compulsory when on public transport as involving underbidder Art Aid and film well as in supermarkets and shops including producer Billy Peterson of Racing Green dealers’ premises and antique centres. The government announced that this Pictures, which is currently filming a would be extended in England from August biopic on Seacole’s life. 8 to include other indoor spaces such as Peterson will use the bust cinemas, theatres and places of worship. as a prop in the film. It will Auction houses also appear on this list. then be donated to the The measures, brought in by law, apply Mary Seacole Trust Continued on page 5 and be on view at the Florence Nightingale Museum. -

Tuula Vaarakallio Department of Social Sciences and Philosophy/ Political Science University of Jyväskylä
Copyright © , by University of Jyväskylä ABSTRACT Vaarakallio, Tuula ”Rotten to the Core”. Variations of French nationalist anti-system rhetoric. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2004, 194 p. (Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research) ISSN 0075-4625; 250) ISBN 951-39-1991-9 Finnish summary Diss. One of the main components (topoi) of the politics of the French nationalists since the late 19th century has been the rhetoric against the existing ”system,” that is the discourse against the representative form of democracy, the parliamentary form of government and the political establishment. This study focuses on the nationalist anti-system rhetoric at the turn of the 20th and the turn of the 21st centuries, namely on Boulangism (1886-1889) and its representative Maurice Barrès (1862- 1923), the nationalist Charles Maurras (1868-1952), and the contemporary radical right movement, the Front National (1972-). This study aims to carry out a detailed and politically oriented exploration of the changes that can be detected in this rejection from the time of Boulanger to that of the Front National. Methodologically, the study is neither strictly rhetorical nor historical but is instead located somewhere between these two approaches. The main objective is to distinguish the political assumptions and commitments that lie behind the terminology of the political programs not only by analyzing the attack against parliamentarism and the ”deteriorated” establishment but also by examining the ”political alternative” provided, that -

Une Voix Du Père-Lachaise Ou Ses Inscriptions Jusqu'en 1853.Pdf
UNE VOIX DU PÈRE-LACHAISE OU SES INSCRIPTIONS JUSQU’EN 1853, PAR PROSPER, CONDUCTEUR. rary U12 iv,o.f ïll. I pass’tl wilh a melancholy tasle, Throu<*b ail those beaps of fate.... Tbey like me once life possessM 53 Time wilf be "ben 1 sball resl. a / 91 Harvey. 1 — 4~ ■ - PARIS CHEZ L’AUTEUR, RUE DE LA ROQUETTE, 150; Et chez les Concierges et Conducteurs du Cimetière. 4853 • » » 4 * UNE VOIX DU PERE-LACHAISE PARIS. — TYPOGRAPHIE DE M*ne \e DONDEY-DliPRL rue Saint-Louis, 46, au Marais. UKtV£R8lTV OF ICUNOid URBANK a ABELLARD HÉLOÏSE . UNE VOIX DU PÈRE-LACHAISE SES INSCRIPTIONS JUSQU'EN 1853, PAR PROSPER, CONDUCTEUR. 1 pass’d witli a melaucholy taste, Tlnough ail those lieaps of fate.... Tliey like me once life possessM Time will be xvhen 1 shall rest. Harvey. PARIS CHEZ L’AUTEUR, RUE DE LA ROQUETTE, 13(i, Et chez les Concierges et Conducteurs du Cimetière. Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign Alternâtes https://archive.org/details/unevoixduperelacOOpros PRÉFACE. Après avoir parcouru dix-neuf ans ce vaste champ de repos, il me sera peut-être permis d’en parler. La tâche que je m’impose me sera donc rendue facile par ce long laps de temps qui doit m’avoir familiarisé avec son site pittoresque, et ce qui est de quelque intérêt pour les visiteurs ; mais une chose à montrer aux étrangers dont ils sont souvent acides, les inscriptions les plus remarquables, m’a toujours été impossible, ce que l’on comprendra facilement.