Première Partie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
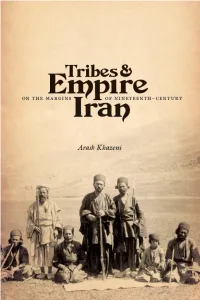
Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-Century Iran
publications on the near east publications on the near east Poetry’s Voice, Society’s Song: Ottoman Lyric The Transformation of Islamic Art during Poetry by Walter G. Andrews the Sunni Revival by Yasser Tabbaa The Remaking of Istanbul: Portrait of an Shiraz in the Age of Hafez: The Glory of Ottoman City in the Nineteenth Century a Medieval Persian City by John Limbert by Zeynep Çelik The Martyrs of Karbala: Shi‘i Symbols The Tragedy of Sohráb and Rostám from and Rituals in Modern Iran the Persian National Epic, the Shahname by Kamran Scot Aghaie of Abol-Qasem Ferdowsi, translated by Ottoman Lyric Poetry: An Anthology, Jerome W. Clinton Expanded Edition, edited and translated The Jews in Modern Egypt, 1914–1952 by Walter G. Andrews, Najaat Black, and by Gudrun Krämer Mehmet Kalpaklı Izmir and the Levantine World, 1550–1650 Party Building in the Modern Middle East: by Daniel Goffman The Origins of Competitive and Coercive Rule by Michele Penner Angrist Medieval Agriculture and Islamic Science: The Almanac of a Yemeni Sultan Everyday Life and Consumer Culture by Daniel Martin Varisco in Eighteenth-Century Damascus by James Grehan Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, edited by Sibel Bozdog˘an and The City’s Pleasures: Istanbul in the Eigh- Res¸at Kasaba teenth Century by Shirine Hamadeh Slavery and Abolition in the Ottoman Middle Reading Orientalism: Said and the Unsaid East by Ehud R. Toledano by Daniel Martin Varisco Britons in the Ottoman Empire, 1642–1660 The Merchant Houses of Mocha: Trade by Daniel Goffman and Architecture in an Indian Ocean Port by Nancy Um Popular Preaching and Religious Authority in the Medieval Islamic Near East Tribes and Empire on the Margins of Nine- by Jonathan P. -

In the Eyes of the Iranian Intellectuals of The
“The West” in the Eyes of the Iranian Intellectuals of the Interwar Years (1919–1939) Mehrzad Boroujerdi n 1929, after a lecture by Arnold Toynbee (from the notes of Denison Ross, the fi rst director of the School of Oriental and African Studies) on the subject of the modern- ization of the Middle East, a commentator said, Persia has not been modernized and has not in reality been Westernized. Look at the map: there is Persia right up against Russia. For the past hundred years, living cheek by jowl with Russia, Persia has maintained her complete independence of Russian thought. Although sixty to seventy percent of her trade for the past hundred years has been with Russia, Persia remains aloof in spirit and in practice. For the past ten years, Persia has been living alongside the Union of Socialist Soviet Republics, and has remained free from any impregnation by their basic ideas. Her freedom is due to her cultural independence. For the safety of Persia it is essential, if she is to continue to develop on her own lines, that she should not attempt modernization, and I do not think that the attempt is being made. It is true that the Persians have adopted motor-cars and in small way railways. But let us remember that the Persians have always been in the forefront in anything of that sort. The fi rst Eastern nation to enter the Postal Union and to adopt a system of telegraphs was Persia, which country was also among the fi rst of the Eastern nations to join the League of Nations and to become an active member. -

Khomeinism, the Islamic Revolution and Anti Americanism
Khomeinism, the Islamic Revolution and Anti Americanism Mohammad Rezaie Yazdi A thesis submitted to the University of Birmingham For the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY School of Political Science and International Studies University of Birmingham March 2016 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract The 1979 Islamic Revolution of Iran was based and formed upon the concept of Khomeinism, the religious, political, and social ideas of Ayatullah Ruhollah Khomeini. While the Iranian revolution was carried out with the slogans of independence, freedom, and Islamic Republic, Khomeini's framework gave it a specific impetus for the unity of people, religious culture, and leadership. Khomeinism was not just an effort, on a religious basis, to alter a national system. It included and was dependent upon the projection of a clash beyond a “national” struggle, including was a clash of ideology with that associated with the United States. Analysing the Iran-US relationship over the past century and Khomeini’s interpretation of it, this thesis attempts to show how the Ayatullah projected "America" versus Iranian national freedom and religious pride. -

Contemplation on Jurisprudence Principles and Necessities of Sheikh Fazlollah Nouri's Legitimate Constitutional Theory
Athens Journal of History XY Contemplation on Jurisprudence Principles and Necessities of Sheikh Fazlollah Nouri's Legitimate Constitutional Theory By Ali Mohammad Tarafdari The victory of Constitutional Revolution during Muzaffareddin Shah Qajar is considered as one of the biggest political-religious developments in Iranian contemporary history during which the Shiite Ulema (clergymen) by their serious involvement in this movement and acceptance of its leadership created a modern era of various views about the constitutional political structure through using the huge legacy of the Shiite political jurisprudence. Meanwhile, a group of these Ulema by bringing up the issue of legitimate constitution tried to present a new reading of the Shiite political thinking concerning the criteria of the legitimacy or non-legitimacy of the constitutional system. Sheikh Fazlollah Nouri is considered one of the most leading religious figures whose jurisprudential thinking regarding the Iranian constitutional movement has been reviewed and analyzed in this article historically and jurisprudentially. The main point/question in the article is that why and under what religious and historical necessities a group of the Ulema, particularly Sheikh Fazlollah Nouri, stood against the constitutional system and started to bring up the plan of Legitimate Constitutional Theory? The findings of this study show that the Legitimate Constitutional Theory was formed as a result of the Shia jurisprudential necessities and the historical conditions of that period, and that based on the Nouri's viewpoint analyzed in his main works, he in the position of religious authority and religious jurist believed he was defending the bases of Islamic religion, while the sources of pro-constitutionalists have considered Nouri's defense of Islam as the result of his support for autocracy. -

JIPS Volume 1
Archive of SID Journal of Islamic Political Studies JIPS Volume 1. Issue 2. September 2019 DOI: 10.22081/JIPS.2019.68401 (pp. 151-175) The Idea of “Law” in the Iranian Tanzimat Period Dr. Mohammad Hadi Ahmadi PhD of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. [email protected] Received: 28/02/2019 Accepted: 02/09/2019 Abstract To seek the intellectual roots of the Iranian constitutionalism, one has to be back to the pre- constitutionalism epoch. Indeed, in that time, Iranian elites had recognized the "deterioration" as the main crisis of Iran, which was rooted in the problem of “despotism.” Their strategy to overcome this crisis was the “Law.”However, the key point was that the majority of intellectual elites had thoughtcodifying the law is the only job that has to be done. Nevertheless, they did not pay attention to the mechanism of how to move from traditional legal logic to the new one in Iran. In the Iranian Tanzimat period, considering the two concepts of law in the European lands (the political and the rational concepts), the idea of law seems to base on the rational concept. In that time, debates were on the explanation, justification, and interpretation of the law. All the utterances were about: which law is the right one? What is the proper criterion to pass a legal regulation? Must the law be written based on nature, the tradition, the practices, or the divine Sharia? This article is going to assess the represented hypothesis by investigating some works of intellectual elites and historical documents of Iranian pre-constitutionalism. -

The Historical Relationship Between Women's Education and Women's
The Historical Relationship between Women’s Education and Women’s Activism in Iran Somayyeh Mottaghi The University of York, UK Abstract This paper focuses on the historical relationship between women’s education and women’s activism in Iran. The available literature shows that education is consid- ered to be one important factor for Iranian women’s activism. The historical anal- ysis of women’s demand for education helps us to gain an understanding of the past in order to relate it to the future. This paper analyzes Iranian women’s active participation in education throughout the Safavid period (1501-1722) and the Qajar period (1794-1925). Women’s demand for education continued into the twentieth century and by the time of the constitutional revolution (1905-1911), during which Iranian women participated immensely in political affairs, the alliance of elite and non-elite women was clearly visible around educational issues. Women’s demand for education gained particular visibility; however, the focus shifted from modernization based on Westernization during the Pahlavi period (1925-1979), towards Islamization from 1979 onwards. This paper analyzes the ways in which, during different eras, women have been treated differently regard- ing their rights to education and at some points they faced difficulties even in exercising them; therefore, they had to constantly express their demands. Key words Iran, Education, Women’s movement, Historical perspective Introduction The historical analysis of women’s activism in Iran shows that educa- tion has always been considered an important factor for Iranian women and something that they have always demanded. The right to education is non-negotiable, embedded in the teaching of Islam as well as in hu- ㅣ4 ❙ Somayyeh Mottaghi man rights provisions. -

Azerbaijan Democratic Party: Ups and Downs (1945-1946)
Revista Humanidades ISSN: 2215-3934 [email protected] Universidad de Costa Rica Costa Rica Azerbaijan Democratic Party: Ups and Downs (1945-1946) Soleimani Amiri, PhD. Mohammad Azerbaijan Democratic Party: Ups and Downs (1945-1946) Revista Humanidades, vol. 10, no. 1, 2020 Universidad de Costa Rica, Costa Rica Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498060395015 DOI: https://doi.org/10.15517/h.v10i1.39936 Todos los derechos reservados. Universidad de Costa Rica. Esta revista se encuentra licenciada con Creative Commons. Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Costa Rica. Correo electrónico: [email protected]/ Sitio web: http: //revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 International. PDF generated from XML JATS4R by Redalyc Project academic non-profit, developed under the open access initiative PhD. Mohammad Soleimani Amiri. Azerbaijan Democratic Party: Ups and Downs (1945-1946) Desde las ciencias sociales, la filosofía y la educación Azerbaijan Democratic Party: Ups and Downs (1945-1946) Partido Demócrata de Azerbaiyán: altibajos (1945-1946) PhD. Mohammad Soleimani Amiri DOI: https://doi.org/10.15517/h.v10i1.39936 University of Sapienza, Italia Redalyc: https://www.redalyc.org/articulo.oa? [email protected] id=498060395015 http://orcid.org/0000-0002-0554-6964 Received: 19 June 2019 Accepted: 23 November 2019 Abstract: Democratic Party of Azerbaijan's movement is one of the most important events in the history of Iran and the world. It was for the first time in the history of Iran that a political party seriously stressed the issue of autonomy. In addition, this movement as liberation movement prioritized several decisive and fundamental reform. -

The Idea of “Law” in the Iranian Tanzimat Period
Archive of SID Journal of Islamic Political Studies JIPS Volume 1. Issue 2. September 2019 DOI: 10.22081/JIPS.2019.68401 (pp. 151-175) The Idea of “Law” in the Iranian Tanzimat Period Dr. Mohammad Hadi Ahmadi PhD of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. [email protected] Received: 28/02/2019 Accepted: 02/09/2019 Abstract To seek the intellectual roots of the Iranian constitutionalism, one has to be back to the pre- constitutionalism epoch. Indeed, in that time, Iranian elites had recognized the "deterioration" as the main crisis of Iran, which was rooted in the problem of “despotism.” Their strategy to overcome this crisis was the “Law.”However, the key point was that the majority of intellectual elites had thoughtcodifying the law is the only job that has to be done. Nevertheless, they did not pay attention to the mechanism of how to move from traditional legal logic to the new one in Iran. In the Iranian Tanzimat period, considering the two concepts of law in the European lands (the political and the rational concepts), the idea of law seems to base on the rational concept. In that time, debates were on the explanation, justification, and interpretation of the law. All the utterances were about: which law is the right one? What is the proper criterion to pass a legal regulation? Must the law be written based on nature, the tradition, the practices, or the divine Sharia? This article is going to assess the represented hypothesis by investigating some works of intellectual elites and historical documents of Iranian pre-constitutionalism. -

"Désintérêt" Politique À Une Fascination Culturelle Mutuelle DISSERTATION
France-Iran: dans le sillage du "désintérêt" politique à une fascination culturelle mutuelle DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Jaleh Sharif, MA Graduate Program in French and Italian The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Professor Jennifer Willging, Adviser Professor Danielle Marx-Scouras Professor Richard Davis 1 Copyright by Jaleh Sharif 2015 2 Abstract This dissertation studies the history of Francophonie in Iran since the first fructuous official interactions between France and Persia in 17th century. Francophonie, i.e., the use of the French language and culture outside of France, has followed a winding path throughout several centuries in Persia (Iran). It grew from the interest of the Persian elite in a French society that neither engaged Persia militarily, nor attempted to compete with other European powers doing so. France's apparent lack of political interest in Persia became an official French diplomatic policy of "désintéressement," or "disinterest." This "hands off" policy nourished a Persian/Iranian fascination with French culture during the 19th and 20th centuries, as France was seen as a potential ally against the growing menace of Russia and Great Britain. As a result, and despite the growing political influence of other Western powers in Persia/Iran, the French language enjoyed the privileged status of first foreign Western language in Persia/Iran for almost a century, before being replaced by the English language due to the entry of the United States onto the international stage after the Second World War. -

A Review of Journalism in Iran
University of Wollongong Research Online University of Wollongong Thesis Collection University of Wollongong Thesis Collections 1996 A review of journalism in Iran: the functions of the press and traditional communication channels in the Constitutional Revolution of Iran Ali Asghar Kia University of Wollongong Recommended Citation Kia, Ali Asghar, A review of journalism in Iran: the functions of the press and traditional communication channels in the Constitutional Revolution of Iran, Doctor of Philosophy thesis, Graduate School of Journalism, University of Wollongong, 1996. http://ro.uow.edu.au/theses/1882 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] A REVIEW OF JOURNALISM IN IRAN: THE FUNCTIONS OF THE PRESS AND TRADITIONAL COMMUNICATION CHANNELS IN THE CONSTITUTIONAL REVOLUTION OF IRAN A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree DOCTOR OF PHILOSOPHY from UNIVERSITY OF WOLLONGONG by ALI ASGHAR KIA FACULTY OF CREATIVE ARTS GRADUATE SCHOOL OF JOURNALISM 1996 ii CERTIFICATION I certify that the work analysed in the functions of the press and traditional communication channels in the Constitutional revolution of 1906 in Iran is entirely my own work. References to the work of others are indicated in the text. This work has not been submitted for the award of any other degree or diploma at any other university. AH AsgharKia August 1996 iii ABSTRACT THE FUNCTIONS OF THE PRESS AND TRADITIONAL COMMUNICATION CHANNELS IN THE CONSTITUTIONAL REVOLUTION OF IRAN This thesis is essentially a study of the development of the Iranian press, principally in the latter 19th Century and early 20th Century, and its relationship with traditional Communications systems during the broad period of the Constitutional Revolution, a seminal event in contemporary Iranian history. -

Afterword: Social Justice in Iran: Further Research
AFTeRWORD: SOCIAL JUSTICe IN IRAN: FURTHeR ReSeARCH This book offers possibly the first collection dedicated to social justice studies in Iran. It is hoped that the multi- and interdisciplinary contribu- tions in this book, written by scholars and activists from wide-ranging aca- demic and nonacademic backgrounds, set the stage for the much-needed, future research on the subject. Understandably, this volume cannot possi- bly address the complexities of the multiple issues pertaining to social jus- tice, including gender justice, justice for workers, vulnerable, the socially and economically disenfranchised, ethnic, religious, and sexual minorities, as well as ecological justice. This project therefore invites further research on the topic of the Iranians’ struggles for social justice since Iran’s entry into political modernity around the turn of the nineteenth to the twen- tieth century. As such, future research can be accommodated within four tentative and nonexclusive thematic–conceptual categories. POLITICAL ECONOMY AND ECONOMIC JUSTICe Understanding the economic, policy, and legal factors that enable or deny social and economic justice is key to understanding this phenomenon. It is through the implementation of state policies that ideology and power are exercised, negotiated, or forced, causing measurable impact on the peo- ple’s lives. Iran’s reliance on oil revenue is of particular interest in that such a national resource tends to yield an unresponsive state and ties a country to the world market. The resource revenue can either be monopolized by the ruling class or be distributed in the form of social programs among the © The Author(s) 2017 307 P. Vahabzadeh (ed.), Iran’s Struggles for Social Justice, DOI 10.1007/978-3-319-44227-3 308 AFTERWORD: SOCIAL JUSTICE IN IRAN: FURTHER RESEARCH population, just as it can be utilized for either the developmental projects that benefit a capitalist class or a development that increases the human development index and collective growth of a nation. -

The Lion and Sun Art from Qajar Persia New Bond Street, London | 30 April 2019 Bonhams 1793 Limited Bonhams International Board Registered No
The Lion and Sun Art from Qajar Persia New Bond Street, London | 30 April 2019 Bonhams 1793 Limited Bonhams International Board Registered No. 4326560 Malcolm Barber Co-Chairman, Registered Office: Montpelier Galleries Colin Sheaf Deputy Chairman, Montpelier Street, London SW7 1HH Matthew Girling CEO, Asaph Hyman, Caroline Oliphant, +44 (0) 20 7393 3900 Edward Wilkinson, Geoffrey Davies, James Knight, +44 (0) 20 7393 3905 fax Jon Baddeley, Jonathan Fairhurst, Leslie Wright, Rupert Banner, Simon Cottle. The Lion and the Sun Art from Qajar Persia New Bond Street, London | Tuesday 30 April 2019, from 11:30 am VIEWING Please note: REGISTRATION ILLUSTRATIONS Thursday 25 April Telephone bidding is available only IMPORTANT NOTICE Front cover: 62 12pm to 4.30pm on lots where the lower end Please note that all customers, Back cover: 63 Friday 26 April estimate is at £1000 or above. irrespective of any previous Inside front cover: 119 Inside back cover: 60 9am to 4.30pm activity with Bonhams, are Sunday 28 April ENQUIRIES Oliver White required to complete the Bidder 11am to 3pm Registration Form in advance of Monday 29 April (Head of Department) IMPORTANT INFORMATION the sale. The form can be found 9am to 4.30pm +44 207 468 8303 In February 2014 the United at the back of every catalogue [email protected] States Government SALE NUMBER and on our website at www. announced the intention to 25434 Matthew Thomas bonhams.com and should be ban the import of any ivory +44 207 468 8270 returned by email or post to the into the USA.