Druzes De La Montagne Libanaise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Recueil De Textes
LES ATELIERS DE LA RECHERCHE EN DESIGN 3 Bordeaux, 11 & 12 décembre 2007 RECUEIL DE TEXTES Université de Nîmes 3 Ouvrage préparé sous la direction de Stéphanie Sagot Conception et réalisation graphiques: Perrine Martin & Georges Schambach Comité scientifique permanent des Ateliers de la recherche en design: Brigitte Borja de Mozota, Alain Findeli, Georges Schambach Comité scientifique des Ateliers 3 à Bordeaux : Les ateliers de la recherche en design Tatiana Bouzdine-Chameeva, Bernard Claverie, Olivier Dupoüet, Alain Jeannel, Aziza Laguecir, Sylviane Leprun, Jean-Pierre Nadeau, Jérôme Pailhes Comité d’organisation à Bordeaux : Stéphanie Cardoso, Sandrine Doux, Aziza Laguecir, Isabelle Leblan, Sylviane Leprun, Jean-Pierre Nadeau, Jérôme Pailhes © 2008 Université de Nîmes Les Ateliers de la Recherche en Design Cet ouvrage est également consultable en ligne et téléchargeable (http://www.unimes.fr/design-169.php) 2 2 TABLE DES MATIÈRES 3 Avertissement 5 Programme 6 Présentation des Ateliers de la Recherche en Design 3 à Bordeaux 7 Recueil des contributions 9 Frédéric LAGARRIGUE et Séverine ROUILLAN-DUTHEIL 11 Entre danse et design : l’empathie, vecteur d’intégration de l’usager dans le processus de création Les ateliers de la recherche en design Céline PICART 20 Le design aléatoire à terminer Agnès LEVITTE 28 Quelques pistes exploratoires sur la relation entre émotions et design Marc MONJOU 37 De l’œuvre à l’outil Georges SCHAMBACH 46 Vivre avec le design ? Réflexions sur le vieillissement des matériaux Lorraine BERGERET 49 Créer l’identité -

Les Mariages Islamo-Chrétiens Au Liban
LES MARIAGES ISLAMO-CHRÉTIENS AU LIBAN : UNE ÉTUDE EMPIRIQUE ET THÉORIQUE TANNOUS Marie-Rose Thèse soumise à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul dans le cadre des exigences du programme de Doctorat en théologie Ottawa, Canada Le 31 juillet 2014 © TANNOUS Marie-Rose, Ottawa, Canada, 2014 1 INTRODUCTION GÉNÉRALE ............................................................................................ 9 La passion comme source d’inspiration ................................................................................. 9 Énoncé du problème ............................................................................................................. 10 État de la question ................................................................................................................ 12 Hypothèse de recherche ........................................................................................................ 14 Méthodologie ........................................................................................................................ 14 A. La description des cas .................................................................................................15 B. Les étapes suivies dans notre analyse de cas ..............................................................19 PARTIE I .............................................................................................................................. 26 Chapitre I ............................................................................................................................. -

This Is Not a Revolution: the Sectarian Subject's Alternative In
This is Not a Revolution: The Sectarian Subject’s Alternative in Postwar Lebanon Diana El Richani Under the Supervision of Dr. Meg Stalcup Thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies In partial fulfillment of the requirements For the Master’s of Arts in Anthropology School of Sociological and Anthropological Studies Faculty of Social Science University of Ottawa ©Diana El Richani, Ottawa, Canada, 2017 Design by William El Khoury Photography by Diana El Richani ii Acknowledgment This work would not have been possible without the support and encouragement of the many people in my life, both in Canada and across the ocean, in Lebanon. Foremost, I thank my supervisor Meg Stalcup for her continuous support, guidance, and encouragement through the countless deadlines and panic-driven days, even weeks. I thank my committee members, Vincent Mirza and Thushara Hewage, for their advice, support, and interest in my work. I also thank my cohort for their support and encouragement throughout the storms. Without the sacrifices and support of my parents, Kamal and Maya, none of this would have been possible. I offer my thanks and love to them, whom I’ve deeply missed over the course of the last few years. And of course, I send love to my brothers, Jamil and Sammy. I thank my friends – William, Ely, Omar, and Zein - for the endless support, the painful laughs, and good company. The heavenly home cooked food definitely did help in those gloomy days. I love these people. I thank Kareem for his constant support and insight. I thank the amazing people that I have had the honor to meet because of this work. -

Université Paris Viii Vincennes-Saint-Denis L
UNIVERSITÉ PARIS VIII VINCENNES-SAINT-DENIS ÉCOLE DOCTORALE : PRATIQUES ET THÉORIES DU SENS LABORATOIRE DE RECHERCHE : LITTÉRATURE, HISTOIRES, ÉSTHÉTIQUE THÈSE Pour obtenir le garde de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS VIII Spécialité : Langue et Littérature françaises L’ORALITÉ CHEZ MARGUERITE DURAS : POÉTIQUE DE LA VOIX DU CORPS présentée et soutenue par SONG Dechao Le 28 mai 2019 Thèse en co-direction dirigée par Monsieur le professeur Gérard DESSONS Monsieur le professeur HU Sishe MEMBRES DU JURY Marie-Hélène BOBLET (rapporteur), Professeure Université de Caen Normandie Florence DE CHALONGE (rapporteur), Professeure Université de Lille Gérard DESSONS, Professeur Université Paris VIII HU Sishe, Professeur Université des Études Internationales de Xi’an Jean-Nicolas ILLOUZ, Professeur Université Paris VIII Remerciements Je tiens d’abord à remercier le plus sincèrement Monsieur Gérard DESSONS, mon directeur de thèse, pour avoir accepté de me suivre durant ces cinq années de doctorat, tout en m’accordant une grande liberté dans mes recherches. Il m’a accompagné et m’a encouragé depuis mon entrée à Paris 8. L’aide et le soutien qu’il m’a apportés durant l’élaboration de cette thèse m’ont permis de continuer dans mes recherches. Ses précieux conseils et ses remarques très détaillées sur chacune de mes pages mais aussi sur mon orientation d’ensemble m’ont permis d’accomplir ce travail. Je remercie chaleureusement Monsieur Hu Sishe, mon co-directeur de thèse, pour avoir accepté de m’orienter dans mon travail, surtout dans les premiers temps de mes recherches. Je suis très reconnaissant de sa disponibilité et de sa présence malgré la distance géographique qui nous sépare. -
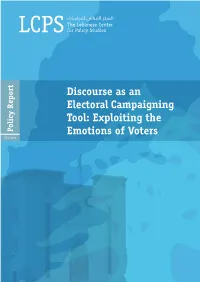
Discourse As an Electoral Campaigning Tool: Exploiting the Emotions of Voters
Discourse as an Electoral Campaigning Tool: Exploiting the Policy Report Policy Emotions of Voters DEC 2020 Founded in 1989, the Lebanese Center for Policy Studies is a Beirut-based independent, non-partisan think tank whose mission is to produce and advocate policies that improve good governance in fields such as oil and gas, economic development, public finance, and decentralization. This report is published in partnership with HIVOS through the Women Empowered for Leadership (WE4L) programme, funded by the Netherlands Foreign Ministry FLOW fund. Copyright © 2020. The Lebanese Center for Policy Studies Designed by Polypod Executed by Zéna Khairallah Sadat Tower, Tenth Flour P.O.B 55-215, Leon Street, Ras Beirut, Lebanon T+ +961 1 79 93 01 F: +961 1 79 93 02 [email protected] www.lcps-lebanon.org Discourse as an Electoral Campaigning Tool: Exploiting the Emotions of Voters Sami Atallah Sami Atallah is the director of the Lebanese Center for Policy Studies. He is currently leading several policy studies on youth social identity and political engagement, electoral behavior, political and social sectarianism, and the role of municipalities in dealing with the refugee crisis. He is the co-editor of Democracy, Decentralization, and Service Delivery in the Arab World (with Mona Harb, Beirut, LCPS 2015), co- editor of The Future of Petroleum in Lebanon: Energy, Politics, and Economic Growth (with Bassam Fattouh, I.B. Tauris, 2019), and co-editor of The Lebanese Parliament 2009-2018: From Illegal Extensions to Vacuum (with Nayla Geagea, 2018). Nadim El Kak Nadim El Kak is a researcher at the Lebanese Center for Policy Studies and research associate at Lebanon Support. -

Steht Später Die Headline
LÄNDERBERICHT Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. LIBANON DR. MALTE GAIER 10. Mai 2018 Nach den Parlamentswahlen: Balance der Macht bleibt erhalten www.kas.de/libanon LIBANONS POLITISCHER KONFESSIONALISMUS ÜBERDAUERT AUCH DIESE WAHLEN – DENNOCH MÜSSEN POLITIK, STAAT UND GESELLSCHAFT UMDENKEN Zum ersten Mal seit neun Jahren hat der Libanon am 6. Mai 2018 über ein neues Parla- ment abgestimmt. Nach dreifacher Verlängerung der Amtszeit des Kabinetts hatten rund 3,7 Mio. Wähler, davon über 21% Erstwähler, zum ersten Mal seit langem wieder die Chance, aktiv die Politik ihres Landes mitzugestalten. Doch nach monatelangem Wahlkampf und großen Hoffnungen auf Veränderungen an den politischen Verhältnis- sen im Land hat sich im Libanon auch dieses Mal am Ende wieder nur der Status Quo mit seiner fein austarierten Machtbalance zwischen den verschiedenen Lagern bestätigt. Dennoch haben die Wahlen viele Einblicke in einen langsam voranschreitenden, lang- fristigen Wandlungsprozess erlaubt. Hintergrund Nachdem die Amtszeit des libanesischen Präsidenten Michel Sleiman im Mai 2014 ausgelau- fen war, konnte sich das Parlament erst nach 45 Wahlgängen auf einen Nachfolger einigen. Bis im Oktober 2016 General Michel Aoun zum zwölften Präsidenten des Libanons ernannt wurde, blieb die Stelle vakant. Auch die politische Legitimierung des Parlaments war bereits 2013 abgelaufen, die politischen Fraktionen waren aufgrund von möglichen Änderungen im Wahlrecht jedoch gespalten. Zudem begründete auch die angespannte Sicherheitslage durch den Krieg in Syrien eine vorläufige Aussetzung der Parlamentswahlen, woraufhin das Parlament sein Mandat eigenständig zweimal bis zum Juni 2017 verlängerte. Diese Ent- scheidung wurde vom obersten Verfassungsrat zwar als verfassungswidrig, aber aufgrund der „außergewöhnlichen Umstände“ als angemessen bewertet. Nach der Ernennung General Michel Aouns zum Präsidenten wurden die Wahlen erneut um ein Jahr verschoben, um die seit 2005 angestoßenen Reformen des Wahlgesetzes abzuschließen, welches im Juni 2017 verabschiedet wurde. -

The Political Affiliation of Lebanese Parliamentarians and the Composition of the Different Parliamentary Blocs IFES Lebanon
Lebanon’s 2009 Parliamentary Elections The political affiliation of Lebanese Parliamentarians and the composition of the different parliamentary blocs International Foundation for Electoral Systems IFES Lebanon Briefing Paper September 2009 Lebanon’s 2009 Parliamentary Elections have resulted in a majority of 71 deputies and an opposition of 57 deputies. Each coalition is composed of different political parties and independent deputies. However, on the 31 st of August, and after the recent position of MP Walid Jumblatt, the Majority forces held a meeting at the residence of designate PM Saad Hariri. While 67 deputies attended the meeting and 2 deputies were outside of Lebanon, MP Najib Mikati and MP Ahmad Karami were not present and declared themselves as “centrists”. The table (1) provides the number of Parliamentarians belonging to each political party and the number of independent Parliamentarians. The table (2) gives the number of deputies in each parliamentary bloc as they stand now. The table (3) provides the political affiliation and the parliamentary bloc of each deputy, indicating that some deputies are members of more than one parliamentary bloc, but within the same coalition of the majority or the opposition. These data are subject to change based on the future political developments. Table (1) Number of Table (2) Number of Political Affiliation deputies Parliamentary Blocs deputies FM 25 Lebanon First 41 Independent/March 14 th 20 Futur Bloc 33 LF 8 Democratic Gathering 11 Kataeb 5 LF 8 PSP 5 Zahle in the Heart 7 Hanchak 2 -

Amelia Layata Jelita Perkasa Di Bisnis Para Pria
EMPOWERING ENTREPRENEUR Money&IVol. 79 SEP-OCT ’16 Notes SNAPSHOT From A Friend Bali Classic HOW Motor Show BUFFETT Menengok mobil perjuangan DOES IT dari jaman Oleh Alex P Chandra kemerdekaan Suwanto Zhang Enhance Your Beauty By Science Kelola Klinik Kecantikan Dengan Teknologi Laser Interview Amelia Layata Jelita Perkasa Di Bisnis Para Pria Kebanyakan perempuan, asyik berkecimpung dalam bisnis kecantikan, namun tidak dengan Amelia, bisnis material menjadi pilihannya. Kini, perlahan dirinya membuktikan, bahwa ia tak salah jalan Rp. 28.500 Money&I Magazine ISSN: 2087-5975 Vol. 79 | Sep - Oct 2016 1 2 Vol. 79 | Sep - Oct 2016 Vol. 79 | Sep - Oct 2016 3 FROM THE EDITOR Arif Rahman @arif_journal Womenpreneur i.huffpost.com elama 5 tahun mengejar narasumber, tidak banyak dari kami tim usaha material bangunan, yang rasanya redaksi mendapati wirausahawan perempuan yang giat di bisnis tidak banyak digemari wanita kebanyakan. para pria. Umumnya, srikandi bisnis yang banyak kami temui Dan bukan hanya itu, konsepnya pun Skerap berkecimpung dalam bidang kecantikan atau fashion. Di didesain modern, dengan layanan excellent skala nasional, rasanya tidak banyak pula wanita seperti ibu Susi Pudjiastuti, sebagai senjata utamanya. Pengagum Steve (Saat ini Menteri Perikanan dan Kelautan) yang sukses merintis bisnis di Jobs ini pun mengembangkan komunikasi bidang perikanan yang konon keras dan sengit akan persaingan, bidang layanan via elektronik untuk memudahkan bisnis yang umumnya digeluti pria. customer mendapati produk-produknya. Bahkan tidak jarang, wanita yang kerap Namun perkembangan jaman dan kemajuan teknologi mulai memupus semua di panggil Amel ini harus berburu produk itu. Secara perlahan, genre bisnis kian tak relevan dengan gender. Amelia hingga ke Negeri Cina. -

MUSIQUES DU MONDE Afrique
SIRBA OCTET MUS Tantz ! : klezmer & Gipsy music 001.2 La Dolce Volta SIR CD Passerelle musicale entre la Roumanie, la Moldavie, la Russie et la Pologne, « Tantz ! » se vit comme un voyage virevoltant et poétique, MUSIQUES DU MONDE traversant les frontières et l'imagination. AKTUALA MUS La Terra 000.2 Afrique Bla Bla Records AKT Il est dit au sujet du groupe italien Aktuala qu'il est la COMPILATION MUS réponse aux anglais du Third Africa express presents Maison 010.2 Ear Band. Pour ce deuxième A. album enregistré en 1974, le des jeunes AFR groupe est composé de six Transgressive Records musiciens, dont la présence du Africa Express, le projet lancé percussionniste Trilok Gurtu, pour un rendu par Damon Albarn de Blur acoustique complètement déphasé par rapport aux visant à faire collaborer des styles de musique qui dominent alors le marché. artistes africains et occidentaux Percussions en tout genre (tabla, bongos, djembe, sort enfin son premier disque. marimba, xylophone), instruments à vents (flûte, haut bois, saxophones) et instruments à cordes (guitares classiques, balalaika, violon) donnent le ton d'un album qui modestement ouvre une brèche vers KEL ASSOUF MUS ce que l'on qualifiera bien assez tôt de musique du Tin hinane 010.2 Igloo Mondo KEL monde. Celle de Aktuala est encore emprunte de mystère, et n'évoque pas nécessairement l'Afrique ou l'Asie, mais peut-être bien ce continent perdu qui Basé à Bruxelles le groupe Kel alimente le fantasme des hommes depuis si Assouf et son leader, le longtemps. Autrement dit, "La Terra", superbe chanteur et guitariste album de world music avant la lettre, préfigurant des Aboubacar Anana Harouna, groupes comme Codona. -

Discourse As an Electoral Campaigning Tool: Exploiting the Emotions of Voters
Discourse as an Electoral Campaigning Tool: Exploiting the Emotions of Voters DEC 2020 Report Policy Sami Atallah and Nadim El Kak Founded in 1989, the Lebanese Center for Policy Studies is a Beirut-based independent, non-partisan think tank whose mission is to produce and advocate policies that improve good governance in fields such as oil and gas, economic development, public finance, and decentralization. This report is published in partnership with HIVOS through the Women Empowered for Leadership (WE4L) programme, funded by the Netherlands Foreign Ministry FLOW fund. Copyright © 2020. The Lebanese Center for Policy Studies Designed by Polypod Executed by Zéna Khairallah Sadat Tower, Tenth Flour P.O.B 55-215, Leon Street, Ras Beirut, Lebanon T+ +961 1 79 93 01 F: +961 1 79 93 02 [email protected] www.lcps-lebanon.org Discourse as an Electoral Campaigning Tool: Exploiting the Emotions of Voters Sami Atallah Sami Atallah is the director of the Lebanese Center for Policy Studies. He is currently leading several policy studies on youth social identity and political engagement, electoral behavior, political and social sectarianism, and the role of municipalities in dealing with the refugee crisis. He is the co-editor of Democracy, Decentralization, and Service Delivery in the Arab World (with Mona Harb, Beirut, LCPS 2015), co- editor of The Future of Petroleum in Lebanon: Energy, Politics, and Economic Growth (with Bassam Fattouh, I.B. Tauris, 2019), and co-editor of The Lebanese Parliament 2009-2018: From Illegal Extensions to Vacuum (with Nayla Geagea, 2018). Nadim El Kak Nadim El Kak is a researcher at the Lebanese Center for Policy Studies and research associate at Lebanon Support. -

In Lebanon, Syria, Jordan and Palestine
Press and Cultural Freedom In Lebanon, Syria, Jordan and Palestine Annual Report 2012 SKeyes Center for Media and Cultural Freedom Samir Kassir Foundation © 2013 Samir Kassir Foundation Address: 63 Zahrani Street, Sioufi, Ashrafieh, Beirut - Lebanon Tel/Fax: (961)-1-397331 Email: [email protected] http://www.skeyesmedia.org The contents of this report are the sole responsibility of the Samir Kassir Foundation and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. The contents of this report are the sole responsibility of the Samir Kassir Foundation and do not necessarily reflect the views of the Foundation for the Future. Translation: Nada Sleiman English editing: Eric Reidy Graphic design: Jamal Awada Printing: Chemaly & Chemaly, Beirut PRESS AND CULTURAL FREEDOM IN 2012 - LEBANON, SYRIA, JORDAN AND PALESTINE Contents FOREWORD 5 SKEYES IN 2012 7 LEBANON 10 SYRIA 18 JORDAN 27 GAZA 32 WEST BANK 36 1948 TERRITORIES 42 CONCLUSION 47 FACTS & FIGURES 48 FRENCH VERSION 57 3 PRESS AND CULTURAL FREEDOM IN 2012 - LEBANON, SYRIA, JORDAN AND PALESTINE Foreword 2012: A Bloodred Year Ayman Mhanna Did the founders of the SKeyes Center for Media and Cultural Freedom expect in 2007 that a year would come when the Center would count 91 journalists, intellectuals, artists and citizen journalists killed in the Arab Levant? Unfortunately, the number of journalists, intellectuals and artists killed this year overshadows the relative improvement of most press and cultural freedom indicators, which include a decrease in cases of physical assaults, arrests and censorship decisions. However, the number of those killed is more than five times the death toll of 2011. -

Women's Participation and Representation in Lebanese Politics
Women’s Participation and Representation in Lebanese Politics: Electoral Performance, Challenges, and the Road Ahead .BS Report Policy Georgia Dagher Founded in 1989, the Lebanese Center for Policy Studies is a Beirut-based independent, non-partisan think tank whose mission is to produce and advocate policies that improve good governance in fields such as oil and gas, economic development, public finance, and decentralization. This report is published in partnership with HIVOS through the Women Empowered for Leadership (WE4L) programme, funded by the Netherlands Foreign Ministry FLOW fund. Copyright© 2021 The Lebanese Center for Policy Studies Designed by Polypod Executed by Dolly Harouny Sadat Tower, Tenth Floor P.O.B 55-215, Leon Street, Ras Beirut, Lebanon T: + 961 1 79 93 01 F: + 961 1 79 93 02 [email protected] www.lcps-lebanon.org Women’s Participation and Representation in Lebanese Politics: Electoral Performance, Challenges, and the Road Ahead Georgia Dagher Georgia Dagher is a researcher at the Lebanese Center for Policy Studies. Her research focuses on parliamentary representation, namely electoral behavior and electoral reform. She has also previously contributed to LCPS’s work on international donors conferences and reform programs. She holds a degree in Politics and Quantitative Methods from the University of Edinburgh. Executive Summary The representation of women in Lebanese politics has always been disproportionately low. Not only is the historical framework of power in Lebanon patriarchal in nature, but the country’s political families are all led by men as well. Under the majoritarian systems that have dominated parliamentary and municipal elections since the end of the civil war, electoral results have always sidelined women.