MALI) Caroline Robion-Brunner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Situation Sécuritaire Dans Le Centre Du Mali, Ofpra, 12/11/2019
MALI 12 novembre 2019 Situation sécuritaire dans le centre du Mali Avertissement Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière. Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises. Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de l’information sur le pays d’origine (avril 2008) [cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeen nes.pdf ], se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations. Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e) dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence. La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Situation sécuritaire dans le centre du Mali Table des matières 1. Le contexte général .......................................................................................... 4 1.1. Une région en proie à des « violences d’une extrême gravité » .......................... 4 1.2. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

FALAISES DE BANDIAGARA (Pays Dogon)»
MINISTERE DE LA CULTURE REPUBLIQUE DU MALI *********** Un Peuple - Un But - Une Foi DIRECTION NATIONALE DU ********** PATRIMOINE CULTUREL ********** RAPPORT SUR L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE «FALAISES DE BANDIAGARA (Pays Dogon)» Janvier 2020 RAPPORT SUR L’ETAT ACTUEL DE CONSERVATION FALAISES DE BANDIAGARA (PAYS DOGON) (MALI) (C/N 516) Introduction Le site « Falaises de Bandiagara » (Pays dogon) est inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1989 pour ses paysages exceptionnels intégrant de belles architectures, et ses nombreuses pratiques et traditions culturelles encore vivaces. Ce Bien Mixte du Pays dogon a été inscrit au double titre des critères V et VII relatif à l’inscription des biens: V pour la valeur culturelle et VII pour la valeur naturelle. La gestion du site est assurée par une structure déconcentrée de proximité créée en 1993, relevant de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) du Département de la Culture. 1. Résumé analytique du rapport Le site « Falaises de Bandiagara » (Pays dogon) est soumis à une rude épreuve occasionnée par la crise sociopolitique et sécuritaire du Mali enclenchée depuis 2012. Cette crise a pris une ampleur particulière dans la Région de Mopti et sur ledit site marqué par des tensions et des conflits armés intercommunautaires entre les Dogons et les Peuls. Un des faits marquants de la crise au Pays dogon est l’attaque du village d’Ogossagou le 23 mars 2019, un village situé à environ 15 km de Bankass, qui a causé la mort de plus de 150 personnes et endommagé, voire détruit des biens mobiliers et immobiliers. -

Inventaire Des Aménagements Hydro-Agricoles Existants Et Du Potentiel Amenageable Au Pays Dogon
INVENTAIRE DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES EXISTANTS ET DU POTENTIEL AMENAGEABLE AU PAYS DOGON Rapport de mission et capitalisation d’expérienCe Financement : Projet d’Appui de l’Irrigation de Proximité (PAIP) Réalisation : cellule SIG DNGR/PASSIP avec la DRGR et les SLGR de la région de Mopti Bamako, avril 2015 Table des matières I. Introduction .................................................................................................................................... 3 II. Méthodologie appliquée ................................................................................................................ 3 III. Inventaire des AHA existants et du potentiel aménageable dans le cercle de Bandiagara .......... 4 1. Déroulement des activités dans le cercle de Bandiagara ................................................................................... 7 2. Bilan de l’inventaire du cercle de Bandiagara .................................................................................................... 9 IV. Inventaire des AHA existants et du potentiel aménageable dans les cercles de Bankass et Koro 9 1. Déroulement des activités dans les deux cercles ............................................................................................... 9 2. Bilan de l’inventaire pour le cercle de Koro et Bankass ................................................................................... 11 Gelöscht: 10 V. Inventaire des AHA existants et du potentiel aménageable dans le cercle de Douentza ............. 12 VI. Récapitulatif de l’inventaire -

M700kv1905mlia1l-Mliadm22305
! ! ! ! ! RÉGION DE MOPTI - MALI ! Map No: MLIADM22305 ! ! 5°0'W 4°0'W ! ! 3°0'W 2°0'W 1°0'W Kondi ! 7 Kirchamba L a c F a t i Diré ! ! Tienkour M O P T I ! Lac Oro Haib Tonka ! ! Tombouctou Tindirma ! ! Saréyamou ! ! Daka T O M B O U C T O U Adiora Sonima L ! M A U R I T A N I E ! a Salakoira Kidal c Banikane N N ' T ' 0 a Kidal 0 ° g P ° 6 6 a 1 1 d j i ! Tombouctou 7 P Mony Gao Gao Niafunké ! P ! ! Gologo ! Boli ! Soumpi Koulikouro ! Bambara-Maoude Kayes ! Saraferé P Gossi ! ! ! ! Kayes Diou Ségou ! Koumaïra Bouramagan Kel Zangoye P d a Koulikoro Segou Ta n P c ! Dianka-Daga a ! Rouna ^ ! L ! Dianké Douguel ! Bamako ! ougoundo Leré ! Lac A ! Biro Sikasso Kormou ! Goue ! Sikasso P ! N'Gorkou N'Gouma ! ! ! Horewendou Bia !Sah ! Inadiatafane Koundjoum Simassi ! ! Zoumoultane-N'Gouma ! ! Baraou Kel Tadack M'Bentie ! Kora ! Tiel-Baro ! N'Daba ! ! Ambiri-Habe Bouta ! ! Djo!ndo ! Aoure Faou D O U E N T Z A ! ! ! ! Hanguirde ! Gathi-Loumo ! Oualo Kersani ! Tambeni ! Deri Yogoro ! Handane ! Modioko Dari ! Herao ! Korientzé ! Kanfa Beria G A O Fraction Sormon Youwarou ! Ourou! hama ! ! ! ! ! Guidio-Saré Tiecourare ! Tondibango Kadigui ! Bore-Maures ! Tanal ! Diona Boumbanke Y O U W A R O U ! ! ! ! Kiri Bilanto ! ! Nampala ! Banguita ! bo Sendegué Degue -Dé Hombori Seydou Daka ! o Gamni! d ! la Fraction Sanango a Kikara Na! ki ! ! Ga!na W ! ! Kelma c Go!ui a Te!ye Kadi!oure L ! Kerengo Diambara-Mouda ! Gorol-N! okara Bangou ! ! ! Dogo Gnimignama Sare Kouye ! Gafiti ! ! ! Boré Bossosso ! Ouro-Mamou ! Koby Tioguel ! Kobou Kamarama Da!llah Pringa! -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

RAPPORT D'evaluation RAPIDE DES BESOINS DES PERSONNES DEPLACÉES a SOFARA, DIABA Peulh Et DIABA Allaye Dans La Commune De Faka
Rapport de Mission Multisectorielle d’Evaluation des Besoins des PDI a Sofara (Commune de Fakala/Cercle de Djenne) RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE DES BESOINS DES PERSONNES DEPLACÉES A SOFARA, DIABA Peulh et DIABA Allaye dans la Commune de Fakala/Cercle de Djenne Le 07 Mai 2020 Page 1/10 Rapport de Mission Multisectorielle d’Evaluation des Besoins des PDI a Sofara I. CONTEXTE Le cercle de Djenné est en tampon entre la région de Mopti et la région de Ségou. Situé à 135 Km au Sud-ouest de Mopti, et dans le delta central du fleuve Niger, Le cercle de Djenné couvre une superficie de 4.561 Km². Il compte 208 413 habitants (hommes : 102 740 et femmes : 105 673) selon le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2009) avec une densité d’environ 49 habitants au km².Cette population est très inégalement répartie et près de 51 % est féminine et à majorité jeune. Les ethnies dominantes de la population sont les Bambaras, les Peulhs, les Bozo, les Somono, les Songhoï, les Rimaïbé, les Marka, les Dogons et les Bobo vivant essentiellement d’agriculture, d’élevage et de pêche. Le cercle est limité par les cercles de Mopti et Ténenkou au Nord, à l’Est par les cercles de Bandiagara et Tominian, au sud par le cercle de San et à l’ouest par les cercles de Macina et Ténenkou. En ce qui concerne la commune de Fakala, elle est héritière de l’ancien arrondissement de Sofara, son chef-lieu, elle compte 30 villages. Elle est limitée au nord par la commune de Sio (Cercle de Mopti) ; au sud par les communes de Madiama et Timissa (Cercle de Tominian) ; à l’Est par les communes de Timiniri et Bara Sara (Cercle de Bandiagara) ; à l’Ouest par les communes de Soye (Cercle de Mopti) et de Femaye (Cercle de Djenné). -

Régions De SEGOU Et MOPTI République Du Mali P! !
Régions de SEGOU et MOPTI République du Mali P! ! Tin Aicha Minkiri Essakane TOMBOUCTOUC! Madiakoye o Carte de la ville de Ségou M'Bouna Bintagoungou Bourem-Inaly Adarmalane Toya ! Aglal Razelma Kel Tachaharte Hangabera Douekiré ! Hel Check Hamed Garbakoira Gargando Dangha Kanèye Kel Mahla P! Doukouria Tinguéréguif Gari Goundam Arham Kondi Kirchamba o Bourem Sidi Amar ! Lerneb ! Tienkour Chichane Ouest ! ! DiréP Berabiché Haib ! ! Peulguelgobe Daka Ali Tonka Tindirma Saréyamou Adiora Daka Salakoira Sonima Banikane ! ! Daka Fifo Tondidarou Ouro ! ! Foulanes NiafounkoéP! Tingoura ! Soumpi Bambara-Maoude Kel Hassia Saraferé Gossi ! Koumaïra ! Kanioumé Dianké ! Leré Ikawalatenes Kormou © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA N'Gorkou N'Gouma Inadiatafane Sah ! ! Iforgas Mohamed MAURITANIE Diabata Ambiri-Habe ! Akotaf Oska Gathi-Loumo ! ! Agawelene ! ! ! ! Nourani Oullad Mellouk Guirel Boua Moussoulé ! Mame-Yadass ! Korientzé Samanko ! Fraction Lalladji P! Guidio-Saré Youwarou ! Diona ! N'Daki Tanal Gueneibé Nampala Hombori ! ! Sendegué Zoumané Banguita Kikara o ! ! Diaweli Dogo Kérengo ! P! ! Sabary Boré Nokara ! Deberé Dallah Boulel Boni Kérena Dialloubé Pétaka ! ! Rekerkaye DouentzaP! o Boumboum ! Borko Semmi Konna Togueré-Coumbé ! Dogani-Beré Dagabory ! Dianwely-Maoundé ! ! Boudjiguiré Tongo-Tongo ! Djoundjileré ! Akor ! Dioura Diamabacourou Dionki Boundou-Herou Mabrouck Kebé ! Kargue Dogofryba K12 Sokora Deh Sokolo Damada Berdosso Sampara Kendé ! Diabaly Kendié Mondoro-Habe Kobou Sougui Manaco Deguéré Guiré ! ! Kadial ! Diondori -

USAID MALI CIVIC ENGAGEMENT PROGRAM (CEP-MALI) Year 4 Report (October 01, 2019 – December 31, 2019)
USAID MALI CIVIC ENGAGEMENT PROGRAM (CEP-MALI) Year 4 Report (October 01, 2019 – December 31, 2019) Celebration of the International Day of Persons with Disabilities, December 3rd, 2019 Funding provided by the United States Agency for International Development under Cooperative Agreement No. AID-688-A-16-00006 January 2020 Prepared by: FHI 360 Submitted to: USAID Salimata Marico Robert Schmidt Agreement Officer’s Representative/AOR Agreement Officer [email protected] [email protected] Inna Bagayoko Cheick Oumar Coulibaly Alternate AOR Acquisition and Assistance Specialist [email protected] [email protected] 0 TABLE OF CONTENTS Page i LIST OF ACRONYMS ARPP Advancing Reconciliation and Promoting Peace AOR Agreement Officer Representative AAOR Alternate Agreement Officer Representative AMPPT Association Malienne des Personnes de Petite Taille AFAD Association de Formation et d’Appui du Développement AMA Association Malienne des Albinos ACCORD Appui à la Cohésion Communautaire et les Opportunités de Réconciliation et de Développement CEP Civic Engagement Program CMA Coordination des Mouvements de l’Azawad COR Contracting Officer Representative COP Chief of Party CPHDA Centre de Promotion des Droits Humains en Afrique CSO Civil Society Organization DCOP Deputy Chief of Party DPO Disabled Person’s Organization EOI Expression of Interest FHI 360 Family Health International 360 FONGIM Fédération des Organisations Internationales Non Gouvernementales au Mali FY Fiscal Year GGB Good Governance Barometer GOM Government of Mali INGOS International -
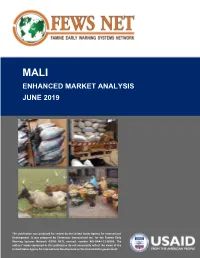
Mali Enhanced Market Analysis 2019
FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 MALI ENHANCED MARKET ANALYSIS JUNE 2019 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The authors’Famine views Early expressed Warning inSystem this publications Network do not necessarily reflect the views of the 1 United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgments FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Mali who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. Recommended Citation FEWS NET. 2019. Mali Enhanced Market Analysis. Washington, DC: FEWS NET. -

RAPPORT FINAL Evaluation Finale Du Volet 2 Du Programme : Appui À L
RAPPORT FINAL Evaluation finale du volet 2 du programme : Appui à l’autonomisation économique des femmes rurales dans le contexte de l’insécurité alimentaire et du changement climatique "LES FEMMES RURALES ONT UN ACCES ACCRU AUX OPPORTUNITES ECONOMIQUES, AUX MARCHES ET AUX INFRASTRUCTURES UTILISANT DES SERVICES ENERGETIQUES RENOUVELABLES MOINS COUTEUX PRESERVANT L’ENVIRONNEMENT ET LA VALORISATION DES FILIERES PORTEUSES" Conditionnement du lait et production de la glace commercialisable à Dougouténé I, présente évaluation Réalisée par : Badji KARAMBE, Ingénieur agroéconomiste, Consultant Septembre 2015 1 SOMMAIRE RESUME ................................................................................................................................................. 5 1. Rappel du contexte de l’évaluation finale .................................................................................. 5 2. Déroulement de la mission : ....................................................................................................... 6 3. Principaux résultats de l’évaluation : ......................................................................................... 6 3.1 Efficacité ............................................................................................................................. 6 3.2 Pertinence des actions de la composante 2 du RCE: ........................................................... 6 3.3 Genre et inclusion sociale ................................................................................................... -

Mali, Third Quarter 2018: Update on Incidents According to the Armed
MALI, THIRD QUARTER 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) - Updated 2nd edition compiled by ACCORD, 20 December 2018 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, November 2015a; administrative divisions: GADM, November 2015b; incid- ent data: ACLED, 15 December 2018; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 MALI, THIRD QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) - UPDATED 2ND EDITION COMPILED BY ACCORD, 20 DECEMBER 2018 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 63 37 208 Conflict incidents by category 2 Strategic developments 37 0 0 Development of conflict incidents from September 2016 to September Battles 36 25 159 2018 2 Remote violence 29 10 35 Methodology 3 Riots/protests 26 0 0 Total 191 72 402 Conflict incidents per province 4 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 15 December 2018). Localization of conflict incidents 4 Development of conflict incidents from September 2016 to Disclaimer 5 September 2018 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 15 December 2018). 2 MALI, THIRD QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) - UPDATED 2ND EDITION COMPILED BY ACCORD, 20 DECEMBER 2018 Methodology Geographic map data is primarily based on GADM, complemented with other sources if necessary.