Méta-Analyse Exploratoire Des Effets De Perturbations Anthropiques Sur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chytrid Fungus in Frogs from an Equatorial African Montane Forest in Western Uganda
Journal of Wildlife Diseases, 43(3), 2007, pp. 521–524 # Wildlife Disease Association 2007 Chytrid Fungus in Frogs from an Equatorial African Montane Forest in Western Uganda Tony L. Goldberg,1,2,3 Anne M. Readel,2 and Mary H. Lee11Department of Pathobiology, University of Illinois, 2001 South Lincoln Avenue, Urbana, Illinois 61802, USA; 2 Program in Ecology and Evolutionary Biology, University of Illinois, 235 NRSA, 607 East Peabody Drive, Champaign, Illinois 61820, USA; 3 Corresponding author (email: [email protected]) ABSTRACT: Batrachochytrium dendrobatidis, grassland, woodland, lakes and wetlands, the causative agent of chytridiomycosis, was colonizing forest, and plantations of exotic found in 24 of 109 (22%) frogs from Kibale trees (Chapman et al., 1997; Chapman National Park, western Uganda, in January and June 2006, representing the first account of the and Lambert, 2000). Mean daily minimum fungus in six species and in Uganda. The and maximum temperatures in Kibale presence of B. dendrobatidis in an equatorial were recorded as 14.9 C and 20.2 C, African montane forest raises conservation respectively, from 1990 to 2001, with concerns, considering the high amphibian mean annual rainfall during the same diversity and endemism characteristic of such areas and their ecological similarity to other period of 1749 mm, distributed across regions of the world experiencing anuran distinct, bimodal wet and dry seasons declines linked to chytridiomycosis. (Chapman et al., 1999, 2005). Kibale has Key words: Africa, amphibians, Anura, experienced marked climate change over Batrachochytrium dendrobatidis,Chytridio- the last approximately 30 yr, with increas- mycota, Uganda. ing annual rainfall, increasing maximum mean monthly temperatures, and decreas- Chytridiomycosis, an emerging infec- ing minimum mean monthly temperatures tious disease caused by the fungus Ba- trachochytrium dendrobatidis, is a major (Chapman et al., 2005). -

Systematics of Leptopelis (Anura: Arthroleptidae) from the Itombwe
University of Texas at El Paso DigitalCommons@UTEP Open Access Theses & Dissertations 2012-01-01 Systematics of Leptopelis (Anura: Arthroleptidae) from the Itombwe Plateau, Eastern Democratic Republic of the Congo Francisco Portillo University of Texas at El Paso, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.utep.edu/open_etd Part of the Biology Commons, Developmental Biology Commons, Evolution Commons, and the Zoology Commons Recommended Citation Portillo, Francisco, "Systematics of Leptopelis (Anura: Arthroleptidae) from the Itombwe Plateau, Eastern Democratic Republic of the Congo" (2012). Open Access Theses & Dissertations. 1906. https://digitalcommons.utep.edu/open_etd/1906 This is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UTEP. It has been accepted for inclusion in Open Access Theses & Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@UTEP. For more information, please contact [email protected]. SYSTEMATICS OF LEPTOPELIS (ANURA: ARTHROLEPTIDAE) FROM THE ITOMBWE PLATEAU, EASTERN DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO FRANK PORTILLO Department of Biological Sciences APPROVED: ______________________________ Eli Greenbaum, Ph.D., Chair ______________________________ Jerry D. Johnson, Ph.D. ______________________________ Rip Langford, Ph.D. ______________________________________ Benjamin C. Flores, Ph.D. Dean of the Graduate School Copyright © by Frank Portillo 2012 SYSTEMATICS OF LEPTOPELIS (ANURA: ARTHROLEPTIDAE) FROM THE ITOMBWE PLATEAU, EASTERN DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO by FRANK PORTILLO, B.S. THESIS Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at El Paso in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE Department of Biological Sciences THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO December 2012 ACKNOWLEDGMENTS First I would like to thank my family for their love and support throughout my life. -

Supporting Information Tables
Mapping the Global Emergence of Batrachochytrium dendrobatidis, the Amphibian Chytrid Fungus Deanna H. Olson, David M. Aanensen, Kathryn L. Ronnenberg, Christopher I. Powell, Susan F. Walker, Jon Bielby, Trenton W. J. Garner, George Weaver, the Bd Mapping Group, and Matthew C. Fisher Supplemental Information Taxonomic Notes Genera were assigned to families for summarization (Table 1 in main text) and analysis (Table 2 in main text) based on the most recent available comprehensive taxonomic references (Frost et al. 2006, Frost 2008, Frost 2009, Frost 2011). We chose recent family designations to explore patterns of Bd susceptibility and occurrence because these classifications were based on both genetic and morphological data, and hence may more likely yield meaningful inference. Some North American species were assigned to genus according to Crother (2008), and dendrobatid frogs were assigned to family and genus based on Grant et al. (2006). Eleutherodactylid frogs were assigned to family and genus based on Hedges et al. (2008); centrolenid frogs based on Cisneros-Heredia et al. (2007). For the eleutherodactylid frogs of Central and South America and the Caribbean, older sources count them among the Leptodactylidae, whereas Frost et al. (2006) put them in the family Brachycephalidae. More recent work (Heinicke et al. 2007) suggests that most of the genera that were once “Eleutherodactylus” (including those species currently assigned to the genera Eleutherodactylus, Craugastor, Euhyas, Phrynopus, and Pristimantis and assorted others), may belong in a separate, or even several different new families. Subsequent work (Hedges et al. 2008) has divided them among three families, the Craugastoridae, the Eleutherodactylidae, and the Strabomantidae, which were used in our classification. -

Vital but Vulnerable: Climate Change Vulnerability and Human Use of Wildlife in Africa’S Albertine Rift
Vital but vulnerable: Climate change vulnerability and human use of wildlife in Africa’s Albertine Rift J.A. Carr, W.E. Outhwaite, G.L. Goodman, T.E.E. Oldfield and W.B. Foden Occasional Paper for the IUCN Species Survival Commission No. 48 The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or the compilers concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN or other participating organizations. Published by: IUCN, Gland, Switzerland Copyright: © 2013 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. Citation: Carr, J.A., Outhwaite, W.E., Goodman, G.L., Oldfield, T.E.E. and Foden, W.B. 2013. Vital but vulnerable: Climate change vulnerability and human use of wildlife in Africa’s Albertine Rift. Occasional Paper of the IUCN Species Survival Commission No. 48. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xii + 224pp. ISBN: 978-2-8317-1591-9 Front cover: A Burundian fisherman makes a good catch. © R. Allgayer and A. Sapoli. Back cover: © T. Knowles Available from: IUCN (International Union for Conservation of Nature) Publications Services Rue Mauverney 28 1196 Gland Switzerland Tel +41 22 999 0000 Fax +41 22 999 0020 [email protected] www.iucn.org/publications Also available at http://www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/SSC-OP-048.pdf About IUCN IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic solutions to our most pressing environment and development challenges. -

A New Species of Arboreal <I>Leptopelis</I> (Anura
HERPETOLOGICAL JOURNAL, Vol. 16, pp. 183-189 (2006) A NEW SPECIES OF ARBOREAL LEPTOPELIS (ANURA: ARTHROLEPTIDAE) FROM THE FORESTS OF WESTERN KENYA JÖRN KÖHLER1,2, BERYL A. BWONG3, SUSANNE SCHICK4, MICHAEL VEITH4 AND STEFAN LÖTTERS4 1Department of Zoology, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Darmstadt, Germany 2Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, Germany 3Department of Herpetology, National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya 4Zoological Institute, Department of Ecology, Mainz University, Mainz, Germany A new species of arboreal Leptopelis is described from Kakamega Forest, western Kenya. It is a small, brown forest species formerly referred to L. modestus, but distinguished by differences in advertisement call and the sequence of the mitochondrial 16S rRNA gene. The specific allocation of certain related populations of Leptopelis in East and West Africa is briefly discussed. Key words: Amphibia, bioacoustics, DNA, systematics, taxonomy INTRODUCTION The confusing systematic status of East African The Kakamega Forest in western Kenya is an iso- Leptopelis modestus-like frogs led us to reinvestigate lated forest remnant of the Guineo-Congolean the status of the Kakamega Forest population. We con- rainforest belt. Its herpetofauna exhibits strong relation- cluded that it represents an unnamed species, which we ships with Central Africa (Köhler et al., 2003). describe here. Currently, 27 anuran species are known from the MATERIALS AND METHODS Kakamega Forest and its vicinity (unpubl. data). Among them are two species of the genus Leptopelis Specimens examined are deposited at the National Günther. Schiøtz (1975) tentatively referred the Museums of Kenya, Nairobi (NMK), the Zoologisches populations from Kakamega Forest to the terrestrial Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (ZFMK) Leptopelis bocagii (Günther, 1864) and the arboreal L. -

Diversity and Distribution of Amphibians in Bwindi Impenetrable National Park and the Incidence of Threats
Diversity and distribution of amphibians in Bwindi Impenetrable National Park and the incidence of threats SEKISAMBU ROBERT MUIENR/ ITFC Background • Global population decline and species loss (Gascon et al., 2005) • 1/3 of about 6500 amphibian species threatened (IUCN) • Among least studied cf. Mammals and birds • Amphibian Conservation Action Plan 2005 recommended inventories in little known and under-sampled sites Problem statement • No baseline data of the status of amphibians in biodiversity rich Bwindi INP • Baseline data urgently needed about causes and magnitude of species loss and population declines for effective biodiversity monitoring programs Objectives of the study To determine the population status of amphibians and the incidence of associated threats to conservation of amphibians in and around Bwindi INP Specific objectives i. To find out amphibian species richness of amphibians in Bwindi INP ii. To find out factors influencing the distribution of amphibians in Bwindi INP iii. To asses potential and prevailing threats to conservation of amphibians in Bwindi INP Methods • Sites selection mainly based on earlier surveys and reconnaissance (i.e Hill tops poor) • 17 sites sampled (10 inside & 7 outside park) • Jan – March 2011 • Sampling done in plots of 40X80m and trails Method cont’d • Visual encounter survey (TCC) easy monitoring (i.e Sampling 7:30pm-9:30pm using LED torches) • Capture using hand or dip net • Photographs taken (sm) and measurements (weight, body length) to aid identification • Swabbing for Chytrid fungus • Site characteristics recorded Site characteristics recorded • Location (elevation, coordinates) • Water (temp, clarity, speed, smell) • Soil (Sand, mad, rock) • Vegetation (Crown cover, dominant veg’n, moss) • Habitat disturbance (signs e.g trails, campsites) • Number of egg patches • Presence of tadpoles Equipment used Precautionary measures • A new pair of gloves when handling each individual • Equipment and gumboots disinfected between sites Preliminary results 1. -
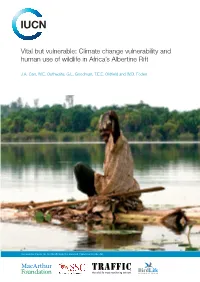
Climate Change Vulnerability and Human Use of Wildlife in Africa's
Vital but vulnerable: Climate change vulnerability and human use wildlife of in Vital but vulnerable: Climate change vulnerability and human use of wildlife in africa’s albertine rift J.a. Carr, W.e. Outhwaite, G.l. Goodman, t.e.e. Oldfield and W.B. Foden a frica’s frica’s a lbertine r ift INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE WOrld HeadqUarterS rue Mauverney 28 1196 Gland, Switzerland [email protected] tel: +41 22 999 0000 Fax: +41 22 999 0002 www.iucn.org Occasional Paper for the IUCN Species Survival Commission No. 48 The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or the compilers concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN or other participating organizations. Published by: IUCN, Gland, Switzerland Copyright: © 2013 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. Citation: Carr, J.A., Outhwaite, W.E., Goodman, G.L., Oldfield, T.E.E. and Foden, W.B. 2013. Vital but vulnerable: Climate change vulnerability and human use of wildlife in Africa’s Albertine Rift. -

Raquel Garcia.Pdf
UNCERTAINTY IN PROJECTED IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON BIODIVERSITY A FOCUS ON AFRICAN VERTEBRATES RAQUEL A. GARCIA University of Copenhagen | 2014 Uncertainty in projected impacts of climate change on biodiversity A focus on African vertebrates Raquel A. Garcia PhD thesis | January 2014 University of Copenhagen | Faculty of Science ACADEMIC ADVISORS Prof Miguel B. Araújo CMEC, University of Copenhagen, Denmark Imperial College, Silwood Park, UK National Museum of Natural History–CSIC, Spain InBio/CIBIO, Évora University, Portugal Dr Mar Cabeza Metapopulation Research Group, University of Helsinki, Finland SUBMITTED TO The PhD School of The Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark January 2014 ASSESSMENT COMMITTEE Prof Jane Hill University of York, Department of Biology, UK Dr Richard Pearson University College London, Research Department of Genetics, Evolution and Environment, UK Dr David Nogués-Bravo CMEC, University of Copenhagen, Denmark COPYRIGHT © 2014 Raquel A. Garcia (Synopsis, Design) © 2012 Blackwell Publishing Ltd (Chapter I) © 2014 The Authors Journal of Biogeography Published by John Wiley & Sons Ltd (Chapter II) © 2014 The Authors (Chapter III) © 2014 The Authors (Chapter IV) © 2014 The Authors (Chapter V) Contents | iii Contents Preface v Summary / Resumé vii Acknowledgements x Synopsis 1 The uncertain nature of assessments under climate change 5 Variation in data and model decisions 9 Robustness to ecological assumptions 11 Broadening the scope of assessments 13 Embracing uncertainty 15 References 18 Chapter -

Preliminary Data on Amphibian Diversity of the Okapi Wildlife Reserve (RFO) in Democratic Republic of the Congo
American Journal of Zoology 2019; 2(3): 38-43 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajz doi: 10.11648/j.ajz.20190203.11 Preliminary Data on Amphibian Diversity of the Okapi Wildlife Reserve (RFO) in Democratic Republic of the Congo Franck Masudi Muenye Mali 1, *, Pionus Katuala Gatate Banda 2, Zacharie Chifundera Kusamba 3, Gabriel Badjedjea Babangenge 4, Jean Robert Kambili Sebe 5, Albert Lotana Lokasola 6, Corneille Ewango 7, Guy Crispin Gembu Tungaluna 1, 2, Dudu Akaibe 2 1Department of Ecology and Biodiversity of Earth Resources, Centre de Surveillance de la Biodiversité of the University of Kisangani, Kisangani, Democratic Republic of the Congo 2Department of Ecology and Animal Management, Faculty of Science, University of Kisangani, Kisangani, Democratic Republic of the Congo 3Department of Biology, Centre de Recherche en Sciences Naturelles de Lwiro, Bukavu, Democratic Republic of the Congo 4Department of Ecology and Aquatic Biodiversity, Biodiversity Monitoring Centre, University of Kisangani, Kisangani, Democratic Republic of Congo 5Institut Supérieur de Développement Rural d’Amadi, Poko City, Democratic Republic of the Congo 6Reserve Naturelle de Kokolopori (BCI Conservation), Mbandaka City, Democratic Republic of the Congo 7Department of Ecosystem Management, Faculty of Management of Renewable Natural Resources, University of Kisangani, Kisangani City, Democratic Republic of the Congo Email address: *Corresponding author To cite this article: Franck Masudi Muenye Mali, Pionus Katuala Gatate Banda, Zacharie Chifundera Kusamba, Gabriel Badjedjea Babangenge, Jean Robert Kambili Sebe, Albert Lotana Lokasola, Corneille Ewango, Guy Crispin Gembu Tungaluna, Dudu Akaibe. Preliminary Data on Amphibian Diversity of the Okapi Wildlife Reserve (RFO) in Democratic Republic of the Congo. American Journal of Zoology. -

Natural History and Biogeography of the Amphibians and Reptiles of Kibale National Park, Uganda
Contemporary Herpetology ISSN 1094-2246 2001 Number 4 23 August 2001 NATURAL HISTORY AND BIOGEOGRAPHY OF THE AMPHIBIANS AND REPTILES OF KIBALE NATIONAL PARK, UGANDA James Vonesh Department of Zoology, University of Florida, Gainesville, FL 32611 English Abstract. This study lists the amphibian and reptile species of Kibale National Park, Uganda, and discusses the natural history and biogeography of this unique herpetofauna. This herpetofaunal inventory was compiled based upon literature records and collections made during 17 mo fieldwork between 1995 and 1997, and includes 28 anuran, 15 lizard, and 32 snake species. Faunal comparisons with seven other tropical African forests show a high degree similarity between the Kibale herpetofauna and those of central and West Africa. French Abstract. Cette étude se propose d'une part, de dresser une liste des amphibiens et des reptiles du Parc National de Kibale, en Ouganda, et d'autre part, d'éclairer l'histoire naturelle et la biogéographie de cette unique faune erpétologique. Cet inventaire des espèces reptiliennes repose sur des dossiers et collections recueillis pendant dix-sept mois de recherches dans les années 1995- 1997. Il comprend vingt-huit amphibiens anoures, quinze lézards et trente-deux espèces de serpents. Une comparaison de la faune de sept autres forêts tropicales africaines indique que l'erpétologie de Kibale s'apparente à celles de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Africa's tropical moist forests extend from Senegal, West Africa, to the montane forests of eastern Somalia (Collins, 1992) and are home to an estimated 333 amphibian species (Duellman, 1993), 105 snake species (Hughes, 1983), 95 lizard species, 16 turtle species, and three crocodilian species (Bauer, 1993). -

Development and Variation of the Anuran Webbed Feet (Amphibia, Anura)
Zoological Journal of the Linnean Society, 2008, 152, 39–58. With 7 figures Development and variation of the anuran webbed feet (Amphibia, Anura) JAVIER GOLDBERG* and MARISSA FABREZI Instituto de Bio y GeoCiencias-Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Mendoza 2, Salta 4400, Argentina Received 1 July 2006; accepted for publication 8 May 2007 Webbed feet evolved convergently in most groups of aquatic tetrapods. However, extensive webbing is not always limited to an aquatic life style. In Anurans, hind limbs display great variation, including absence, of interdigital membranes, which is explained by differential growth rates of digital and interdigital tissues during early limb development. In order to explore web diversification in anurans, this paper presents analyses of: (1) hind limb early development and its relationship to the expression of interdigital membranes; (2) intraordinal variation of interdigital membranes in adult feet; and (3) intraordinal variation of metatarsal and digit lengths, including comments on metatarsal development. Study of limb development is carried out in larval series of 12 anuran species. Analysis of intraordinal variation comprises a sample of adults of 111 species. We recognize two configurations in the autopodium bud: (1) paddle-like shape with digits differentiated within the confines of interdigital tissues, and (2) pointed autopodium with digits differentiated beyond interdigital tissues. These early differences are conserved in adult morphology, in which allometry and isometry of digit IV (and metatarsal IV) with respect to other digits (and metatarsals) result in asymmetrical and paddle-like autopodium, respectively. The paddle-like autopodium is restricted to fossil and extant pipids and the hylids Pseudis and Lysapsus, whereas the asymmetrical one is present in most anurans. -

Herpetological Study for Feronia, Lokutu Oil Palm Plantation High
Herpetological Study for Feronia, Lokutu Oil Palm Plantation High Conservation Value Assessment Project Number: CDC2950 Prepared for: Feronia PHC March 2015 _______________________________________________________________________________________ Digby Wells and Associates (South Africa) (Pty) Ltd (Subsidiary of Digby Wells & Associates (Pty) Ltd). Co. Reg. No. 2010/008577/07. Fern Isle, Section 10, 359 Pretoria Ave Randburg Private Bag X10046, Randburg, 2125, South Africa Tel: +27 11 789 9495, Fax: +27 11 789 9498, [email protected], www.digbywells.com _______________________________________________________________________________________ Directors: AR Wilke, DJ Otto, GB Beringer, LF Koeslag, AJ Reynolds (Chairman) (British)*, J Leaver*, GE Trusler (C.E.O) *Non-Executive _______________________________________________________________________________________ This document has been prepared by Digby Wells Environmental. Report Type: High Conservation Value Assessment Herpetological Study Study for Feronia, Lokutu Oil Palm Project Name: Plantation Project Code: CDC2950 Name Responsibility Signature Date Caitlin O’Connor Report Writer March 2015 Phil Patton Pr.Sci.Nat. Report Reviewer April 2015 Brett Coutts Report Reviewer May 2015 (Cand.Sci. Nat) This report is provided solely for the purposes set out in it and may not, in whole or in part, be used for any other purpose without Digby Wells Environmental prior written consent. Digby Wells Environmental i High Conservation Value Assessment Herpetological Study Study for Feronia, Lokutu Oil Palm Plantation CDC2950 EXECUTIVE SUMMARY The Democratic Republic of Congo is one of the most important countries in Africa for biodiversity conservation. It has the highest number of species for almost all groups of organisms with the exception of plants in which it is second to South Africa. There are a number of species, which are extremely important, and in critical danger, and others, which are unknown to science.