Histoire De Vendargues
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

En Rouge Les Édifices Labellisés
Liste des édifices du XXe siècle labellisés et protégés au titre des monuments historiques en Languedoc-Roussillon au 31 decembre 2015 en rouge les édifices labellisés "Patrimoine du XXe siècle" en noir les édifices labellisés et protégés MONUMENTS HISTORIQUES Date de Départe Date CRPS Ville Adresse Titre courant Auteur(s) construct Date protection ment LABEL ion Aude Carcassonne Hôtel de la Cité Vassas (architecte);Sivade Henri (peintre);Ourtal1926 JacquesIMH 1998(peintre);Pringuet (peintre) Aude Carcassonne Théâtre municipal Esparseil Raymond (architecte);Oudin Marcel1936 (architecte);GarriguesIMH 2002 J.N. (peintre);Jaulmes G.L. (peintre) Aude Coursan cave coopérative Hérans Marcel (architecte) ; Brès Paul (architecte)1936 14/02/2013 Aude Fleury cave coopérative Hérans Marcel (architecte) 1937 14/02/2013 Aude Gruissan Station balnéaire : le port (immeubles sur le bassin principalGleize avec Raymond capitainerie) (architecte); Hartané Edouard1970 (architecte) 2010 Aude Labécède-Lauragais centre de vol à voile 1933 IMH 2009 Aude Lespinassière église paroissiale Cambiès Emile (architecte) 1933 IMH 15/04/2015 Aude Leucate Station balnéaire de Port Leucate : VVF les Carats ; VVF lesCandilis Rives Georges des Corbières (architecte) ; village grec 1970 2010 Aude Leucate VVF Les Carrats Candilis Georges (architecte) 1970 IMH 2014 2014 Aude Lézignan-Corbières cave coopérative Reverdy Jules-Pierre (architecte) 1909 14/02/2013 Aude Montlaur cave coopérative Villeneuve René (architecte) 1949 14/02/2013 Aude Narbonne Monument commémoratif d'Ernest -

Georges CLEMENCEAU
Georges CLEMENCEAU Georges CLEMENCEAU La famille Clemenceau Né le 28 septembre 1841 au 19 rue de la Chapelle (rebaptisée depuis rue Georges CLEMENCEAU), dans la maison de ses grands-parents maternels à Mouilleron-en-Pareds, petite bourgade vendéenne, CLEMENCEAU affirmera plus tard « C'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Le courage, l'obstination têtue, la combativité ». Il est le deuxième des six enfants de Sophie GAUTEREAU et de Benjamin CLEMENCEAU, établi comme médecin à Nantes, mais vivant surtout de ses fermages. Sa famille paternelle, qui appartient à la bourgeoisie vendéenne, habite le manoir du Colombier, près de Mouchamps. Au début du XIXe siècle, elle hérite par mariage du domaine de "l'Aubraie" de Féole, dans la commune de La Réorthe, en Vendée, région de tradition royaliste et catholique. Son arrière-grand-père, Pierre Paul CLEMENCEAU (1749-1825), est médecin des Armées de l'Ouest pendant la guerre de Vendée, puis sous-préfet de Montaigu et député du Corps législatif en 1805, au début du Premier Empire. Son père, Benjamin (1810-1897) est médecin ; c'est un républicain engagé, progressiste, farouchement athée, qui aura une grande influence sur Georges, le second de ses six enfants, en lui transmettant les idéaux révolutionnaires et la haine de toute monarchie. Sa famille est longtemps proche d'une autre grande famille de républicains progressistes, celle de Marcellin BERTHELOT. La petite nièce de Clemenceau, Annette CLEMENCEAU, a épousé le petit-fils de Marcellin BERTHELOT, Richard BERTHELOT. Il a participé aux Trois Glorieuses de 1830 et, lors de la Révolution de 1848, il a créé une « Commission démocratique nantaise ». -
1907 Dans L'aude
Px-présentation 24/05/07 10:55 Page 1 Vignerons en révolte 1907 dans l’Aude Exposition réalisée par les Archives départementales de l'Aude 2007 / Réalisation et impression t2p numéric - 04 68 77 22 22 / Scénographie : Marc Raymond architecte D.P.L.G. - Toulouse D.P.L.G. architecte Raymond : Marc - 04 68 77 22 / Scénographie t2p numéric et impression 2007 / Réalisation Px11-100x221 21/05/07 15:07 Page 1 Au pied des remparts de Carcassonne e dimanche en dimanche, le nombre des manifestants augmente de manière démesurée. Pour les municipalités qui les accueillent, Dles enjeux sont d’importance : montrer leur solidarité avec le mouvement (certains maires, tel Jules Sauzède proche d’Albert Sarraut, sont embarrassés et préfèrent laisser le devant de la scène à leur premier adjoint), frapper l’opinion et impressionner la presse régionale et nationale par la majesté des décors et l’importance donnée au défilé des délégations, assurer le bon déroulement de la journée par une organisation irréprochable. La manifestation de Carcassonne est à cet égard exemplaire. 26 mai 1907 : manifestation à Carcas- sonne (220 000 à 250 000 personnes) Le 26 mai, le meeting doit se tenir à Carcassonne. Le préfet a prévu d’impor- tantes forces de l’ordre mais il veut que leur présence soit discrète : « Il est pré- férable de cacher, autant que possible, la vue des uniformes aux manifestants. Ils en prennent ombrage comme d’une mesure de défiance et d’hostilité et en deviennent plus irritables ». La municipalité de Carcassonne tient à témoigner sa solidarité aux manifestants. C’est Gaston Faucilhon, premier adjoint de la commune de Carcassonne, qui préside à l’organisation du meeting : Jules Sauzède, député et également maire de la ville, est absent, retenu à l’Assemblée nationale. -

Spiritism, Violence, and Social Struggle in Late Nineteenth-Century Catalonia
Spiritism, Violence, and Social Struggle in Late Nineteenth-Century Catalonia Gerard Horta University of Barcelona ABSTRACT This article discusses different situations concerning the position- ing of the nineteenth-century Catalan spiritism towards violence: on the one hand, with regard to capitalist's society's implementa- tion of the industrial process; on the other, in relation to the politi- cal use of violence – ‘terror tactics’ – employed by certain anar- chist sectors in Catalonia at the close of the century. As we shall see, an understanding of said positioning reveals the spiritist move- ment's ambiguity in this sphere. To interpret this ambiguity, one must take into account the tremendous crossroads at which its fol- lowers found themselves, midway between one society being destruc- tured and another that, in statu nascendi, was being prestructured. INTRODUCTION Catalan spiritism is first mentioned in the correspondence that José Maria Fernández Colavida established in 1858 with Léon Denizard Rivail also known as Allan Kardec (1804–1869), the Lyon-born French educator who systemized European spiritist theory and practice in 1857. Spiritism was firmly ingrained in Catalonia from the 1860s to 1939 at the end of the Spanish Civil War, the outcome of which triggered brutal repression against the movement's asso- ciations and followers. Throughout that period, broad subordinate sectors – in general, workers and artisans – devised a world's view, the organization of social relations and the development of people that embraced all spheres of existence. The presence of certain members of financial means made possible the earliest translations to Spanish, clandestine editions and the diffusion of Kardec's works, for example The Spirits' Book (Kardec 1963) (for an over- Social Evolution & History, Vol. -

Rapport D'activité
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 2 SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ DU MÉMORIAL INTRODUCTION 3 1 - FREQUENTATION 4 2 - LA LIBRAIRIE 8 3 - LE CAFÉ 10 4 - LE BATIMENT ET LA SECURITÉ 12 5 - L’ORGANIGRAMME 13 6 - LE BUDGET 14 7 - LA GESTION STATUTAIRE ET ADMINISTRATIVE 15 8 - LA COMMUNICATION 16 9 - CONSERVATION, INVENTAIRES ET TEMOIGNAGES 20 10 - LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 22 11 – LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET LES PARTENARIATS 23 12 – TERRE DE MÉMOIRES 26 13 – JEUNES ET CITOYENS 27 14 – RENCONTRES DES JEUNES EUROPÉENS 28 15 – JOURNÉES D’ÉTUDES 30 16 - LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 31 14 - PROJETS SCOLAIRES ET EN DIRECTION DE LA JEUNESSE 34 15- PROJETS EUROPÉENS 35 15 - ANNEXES 36 MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 3 INTRODUCTION Ce rapport est une présentation synthétique de l’activité du Mémorial du Camp de Rivesaltes durant l’année 2018 « Cette troisième année de fonctionnement se traduit par une stabilisation du fonctionnement : fréquentation, personnel, organisation, communication, budget et programmation. Le Mémorial du Camp de Rivesaltes prend sa place d’acteur essentiel de la politique mémorielle de la Région Occitanie. Il a étendu son activité à l’ensemble du territoire régional, notamment avec le projet « Terre de mémoires », en tissant des liens forts avec les autres partenaires : culturels (CIP, Festival Radio France Occitanie, Institut Jean Vigo, Fotolimo, CML), scolaires (57 établissements scolaires en convention) et universitaires (UPVD, Montpellier, Toulouse). Il se positionne comme un acteur structurant et dynamique au service d’une meilleure appropriation de l’histoire et la citoyenneté avec notamment le projet «Jeunes et Citoyens» conventionné par la DILCRAH, les « Rencontres des Jeunes européens », soutenues par le programme Erasmus+. -

N° 4360 Assemblée Nationale Proposition De Résolution
N° 4360 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2017. PROPOSITION DE RÉSOLUTION pour rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de Narbonne de 1871, présentée par Mme Marie-Hélène FABRE et M. Patrick BLOCHE, députés. – 2 – EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Moins connue que la Commune de Paris, la Commune de Narbonne de 1871 constitue pourtant un événement d’une portée singulière car elle a marqué l’Histoire à plusieurs points de vue. Elle est un événement révolutionnaire qui scande l’histoire de cette ville comme peuvent le faire la Révolution Française, la Révolution de 1848/1851, la Révolte des vignerons de 1907, la Libération d’août 1944. Elle rassemble la population narbonnaise animée par les sentiments républicains du club Lamourguier, du nom de l’église désaffectée où se tiennent les réunions. Parmi les participants on compte des jardiniers, des artisans, des ouvriers et des « intellectuels » comme un journaliste ou un libraire. Elle est un événement de portée nationale qui débute le 19 mars 1871, juste au lendemain du soulèvement parisien. Elle est proclamée le 24 mars « à l’exemple de l’héroïque Paris ». D’entrée, elle appelle les villes-sœurs Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot, Marseille sans pourtant en avoir la population industrielle. Elle connait, malgré sa brièveté jusqu’au 31 mars, la dureté des affrontements, l’hostilité du pouvoir central, les victimes de la reconquête militaire par les « Turcos » (les tirailleurs coloniaux) qui prennent d’assaut la mairie en faisant cinq victimes. -

CHRONOLOGIE Mvt Ouvrier
© Association des Amis du Maitron 2002 Les Editions de l'Atelier CHRONOLOGIE INDICATIVE DE L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER FRANCAIS DE LA REVOLUTION FRANCAISE A LA FIN DES ANNEES 2000 par Stéphane Sirot, complétée par Michel Cordillot, René Lemarquis et Claude Pennetier 1864 - 1870 1871 - 1913 1914 - 1939 1940 - 1968 1969 - 2000 de 1789 à 1863 1791 2 mars . Loi d'Allarde supprimant les corporations et proclamant le principe de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie. 22 mai et 14 juin . Lois Le Chapelier interdisant les coalitions de métiers et les grèves. 20 juillet . Interdiction de la concertation sur les salaires et les prix. 1792 20 juin . " Journée révolutionnaire " : les Sans-Culottes envahissent les Tuileries, le roi doit coiffer le bonnet rouge. 10 août . Les Sans-Culottes parisiens forment une commune insurrectionnelle. Le peuple investit les Tuileries et renverse le trône. 11 août . Établissement du suffrage universel. 8-9 septembre . Émeute ouvrière à Tours. Début décembre . Élections à la Commune de Paris : rôle essentiel de Jacques Roux, les " Enragés " apparaissent sur la scène politique. 1793 6 avril . Création du Comité de salut public. 24 mai . Arrestation de l' " Enragé " Jacques Hébert. 31 mai-2 juin . Insurrection parisienne contre les Girondins. 27 juillet . Maximilien Robespierre entre au Comité de salut public. 5 septembre . Jacques Roux, le chef des " Enragés ", est arrêté après une manifestation des Sans-Culottes parisiens. 1794 10 février . Suicide de Jacques Roux dans sa prison. 13 mars . Arrestation de Jacques Hébert et de ses amis. 24 mars . Fin du procès des hébertistes. Exécution des principaux militants Sans-Culottes dont Jacques Hébert et Antoine François Momoro. -

La Communauté D'auteurs
LA COMMUNAUTÉ D'AUTEURS Sous la coordination de Ryem BOUDJEMAI, académie de Créteil Baptiste FRAY, académie de Lyon Notre comité scientifique Jean-Renaud Boisserie, directeur de recherche en Claire Olive, professeure agrégée, université de Bourgogne (21) paléontologie au CNRS, Directeur de PALEVOPRIM (86) Sylvain Pichat, maître de conférences à l'ENS Lyon (69) Cédric Bordi, professeur agrégé en CPGE, Lycée Assomption- Philippe De Sousa, auteur principal des manuels de Bellevue (69) Mathématiques et professeur au Lycée Jean-Pierre Timbaud (91) Vincent Brée, professeur agrégé, Lycée Jean Jaurès (92) Delphine Viandier, professeur agrégée en CPGE, Lycée Pierre Lionel Douthe, professeur certifié, Lycée Jacques Brel (69) d'Ailly (60) Loïc Mathon, IA-IPR, académie de Nouvelle-Calédonie Henri Waisman, checheur à l'IDRI, auteur du rapport du GIEC Sophie Montuire, directrice d'études à l'EPHE, laboratoire de sur 1,5 °C de réchauffement planétaire (75) Biogéosciences (21) Marianne Wojcik, IA-IPR, académie de Nancy-Metz 22 Auteurs 16 Auteurs harmonisateurs 2 Auteures numériques 5 Professeurs documentalistes 128 Coauteurs ... ont participé à l’écriture de ce manuel d'Enseignement scientifique ! Ì Académie d’Aix-Marseille agrégée au Lycée Victor Hugo (25) agrégé au Lycée Adolphe Chévioux (94) Mathilde Calvez, professeure agrégée au Monia Verchere, professeure certifiée au Ì Académie de Bordeaux Lycée Henri Wallon (93) Collège Louis Armand (13) Romain Agier, professeur certifié au Sébastien Castillo, professeur agrégé au Ì Académie d’Amiens Lycée Jules -
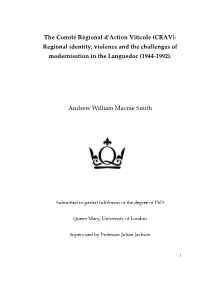
The Comité Régional D'action Viticole (CRAV): Regional Identity, Violence and the Challenges of Modernisation in the Languedoc (1944-1992)
The Comité Régional d'Action Viticole (CRAV): Regional identity, violence and the challenges of modernisation in the Languedoc (1944-1992). Andrew William Macrae Smith Submitted in partial fulfilment of the degree of PhD Queen Mary, University of London Supervised by Professor Julian Jackson 1 Abstract This thesis analyses the Comité Régional d’Action Viticole (CRAV), an active force in the French wine industry since the mid-1960s that has consistently mobilised militant winegrowers in response to economic crisis. Their role has expanded to represent not only the Midi’s viticultural heritage, but also a peculiar brand of regional nationalism. They invoked the memory of the "Grande révolte" of 1907, which saw hundreds of thousands mobilise against foreign wine imports, financial speculation and ineffective regulation. The legacy of 1907 will be considered in the context of its regionalist significance and the development of political Occitanisme, binding Oc and Vine at the beginning of the century. The prominent role of winegrowing since 1907 had seen a compact between winegrowers, local elites and the Socialist Party develop. Yet, this began to slowly disintegrate as government programmes targeted the amelioration of Languedoc wine from the early 1970s. Whilst this project embittered winegrowers, events like the shootout at Montredon in 1976 and the torching of a Leclerc store in 1984 saw the CRAV breach the frontiers of acceptability and alienate traditional supporters. Demographic change, economic development and the stain of violent protest all chipped away at the CRAV's rebellious appeal. This regional compact will be analysed both to gauge the impact of development upon regional identity and to understand changing conceptions of modernity in the agricultural South. -

Les Formations Dans L'aude
LES FORMATIONS DANS L'AUDE Plaquette réalisée par le BEFI Aude - Carcassonne Ce document est susceptible d'évolution en fonction des avancées de la réforme LES FORMATIONS CARCASSONNE CASTELNAUDARY LIMOUX - QUILLAN NARBONNE LEZIGNAN CFA du BTP CFAdu CFAI-IRFMA LycéeJules Fil Lycée Louise Michel Lycée Louise LycéeErnest Ferroul CFA Carcassonne -CCI CFACarcassonne Lycée privé BeauséjourLycée privé Lycée Privé La Rouatière LycéeLa Privé Lycée Agricole M. L. king L. M. LycéeAgricole Lycée Privé Saint François LycéeSaint Privé Les Amandiers privé LEAP CFA Agricole -SiteLimoux CFAAgricole Lycée Agricole P. P. Riquet P. P. LycéeAgricole Lycée agricole Charlemagne Lycéeagricole Lycée Privé E. de Rodat -PEZENS deRodat LycéeE. Privé CFA privé St Joseph -Limoux Joseph St CFAprivé CFA Agricole -SiteNarbonne CFAAgricole Lycée Jacques Ruffié -Limoux LycéeJacques Ruffié Lycée Privé St Joseph -limoux LycéeJoseph St Privé Lycéedes Métiers Charles Cros CFA Agricole -site Carcassonne CFAAgricole Lycée Edouard Herriot -Quillan Herriot LycéeEdouard Lycée Polyvalent Germaine LycéeTillion Polyvalent CFA Agricole - UFA de Castelnaudary de -UFA CFAAgricole Agricole Jardinier Paysagiste Métiers de l'Agriculture • orientation Arboriculture Métiers de l'Agriculture • orientation Horticulture/Pépiniériste Métiers de l'Agriculture • orientation Maraîchage Métiers de l'Agriculture • orientation Production animales CAPA Métiers de l'Agriculture • orientation Production végétales Métiers de l'Agriculture • orientation viticulture Palefrenier-Soigneur Services aux personnes -

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Pour L'affectation Post-3Ème 2020
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Pour l'affectation post-3ème 2020 1. LES RECRUTEMENTS PARTICULIERS : ( Attention nouvelles dates en rouge) 1.1. Formations Éducation Nationale : Baccalauréat Professionnel Conducteur transport routier marchandises Annexe 1 Lycée Professionnel Ernest Ferroul – LEZIGNAN-CORBIERES Lycée Professionnel Jules Raimu - NIMES Baccalauréat Professionnel Aéronautique Annexe 2 Lycée des Métiers Frédéric Mistral – NIMES ● C.A.P. Agent de sécurité Annexe 3 Lycée Polyvalent Georges Pompidou – CASTELNAU LE LEZ Lycée Professionnel Gaston Darboux – NIMES ● Baccalauréat Professionnel Métiers de la sécurité Annexe 4 Lycée Professionnel Gaston Darboux - NIMES Lycée Professionnel Jules Fil – CARCASSONNE Lycée Polyvalent Georges Pompidou – CASTELNAU LE LEZ Lycée Polyvalent Aristide Maillol - PERPIGNAN ● Seconde générale et technologique, sections internationales Annexe 5 Lycée Général et Technologique Joffre – MONTPELLIER Lycée Polyvalent Jules Guesde – MONTPELLIER ● Seconde générale et technologique, sections bi-nationales : ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC Annexe 6 Lycée Polyvalent Germaine Tillion- CASTELNAUDARY Lycée Général et Technologique Docteur Lacroix – NARBONNE Lycée Général et Technologique Alphonse Daudet – NIMES Lycée Général et Technologique Albert Camus - NIMES Lycée Polyvalent Jacques Prévert – SAINT CHRISTOL LES ALES Lycée Général et Technologique Georges Clémenceau – MONTPELLIER Lycée Polyvalent Jules Guesde – MONTPELLIER Lycée Général et technologique Chaptal - MENDE Lycée Général et Technologique Arago – PERPIGNAN -

Recueil Des Actes Administratifs
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil n°83 du 11 janvier 2021 Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS34) Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM34) Direction des sécurités – Bureau de la planifcation et des opérations (PREF34 DS BPO) Direction des sécurités – Bureau des préventions et des polices administratives (PREF34 DS BPPA) Secrétariat général commun (SGC34) DDETS34 Arrêté n°2021-0087 composition comité médical 2 DDETS34 Arrêté n°2021-0088 liste médecins agréés du comité médical et commission de réforme 4 DDETS34 Arrêté n°2021-XVIII-115 dérogation travail du dimanche 6 DDTM34 Arrêté n°30-2021-06-02-00003 classement BRL 8 DDTM34 Arrêté n°DDTM34-2021-06-11993 mise à jour des parties prenantes par SLGRI Orb Libron Herault 17 DDTM34 Arrêté n°DDTM34-2021-06-11997 creation ZAD Les Mouliers Est Clapiers 21 DDTM34 Arrêté n°DDTM34-2021-06-11998 creation ZAD Moureze 25 DDTM34 Arrêté n°DDTM34-2021-06-12012 suddélégation SAF 37 DDTM34 Arrêté n°DDTM34-2021-06-12013 avenant n°1 cahier charges concession plages Frontignan 39 DDTM34 Arrêté n°DDTM34-2021-06-12014 prescriptions spécifiqu- es réparation ouvrage permettant à l'A9 de franchir le Pallas Loupian 41 DDTM34 Arrêté n°R 21 034 0005 0 délivrance agrément SOS PERMIS M. Gautier AYME 47 PREF34 DS BPO Arrêté n°2021-01-525 modification composition CHSCT de la police nationale 50 PREF34 DS BPPA Arrêté autorisation enregistrement audiovisuel agents PM Jacou 52 PREF34 DS BPPA Arrêté autorisation enregistrement audiovisuel agents PM Portiragnes