Les Relations Franco-Belges De 1830 À 1934. Acte Du
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
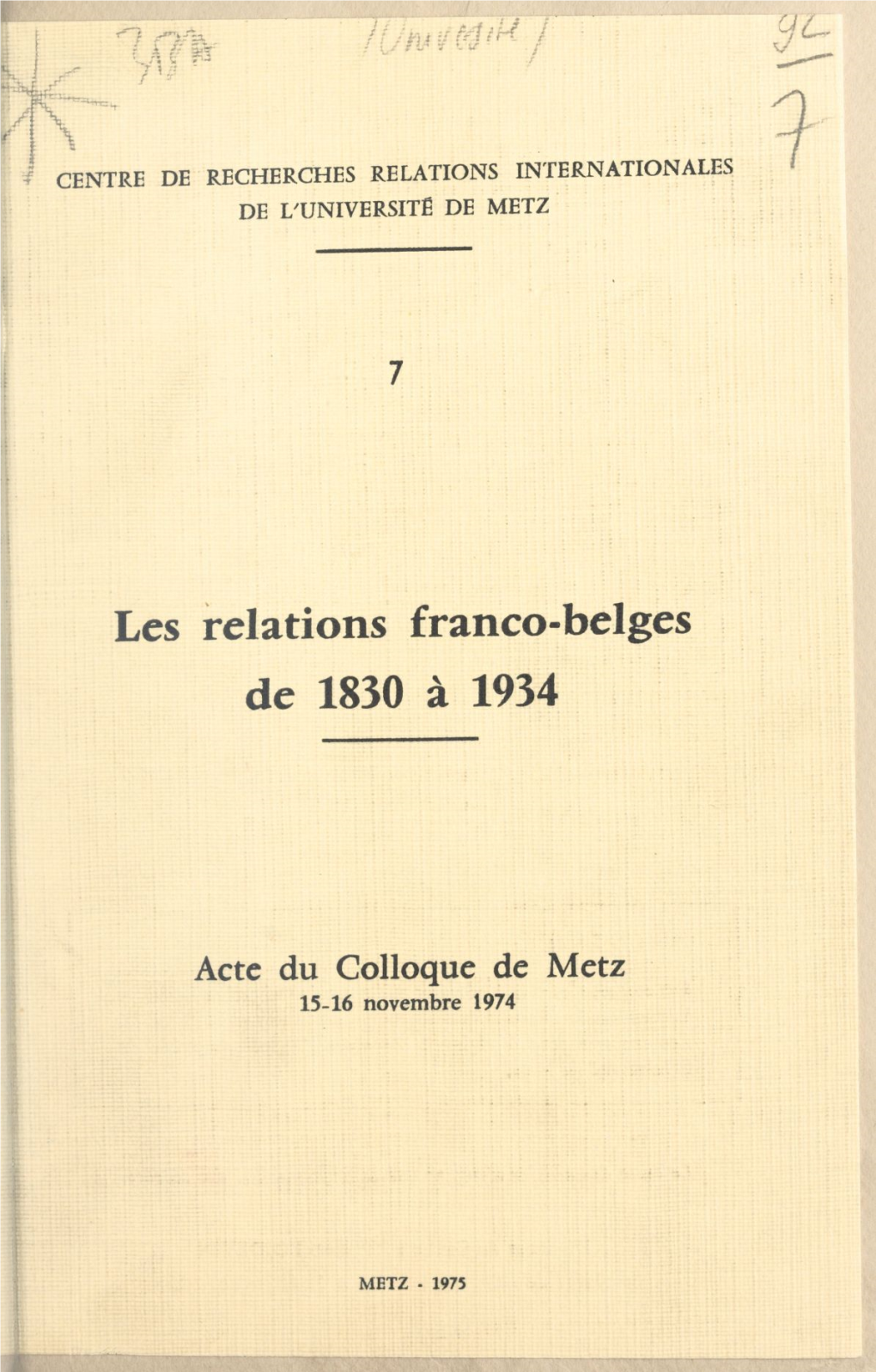
Load more
Recommended publications
-

Narrative of Don Juan Van Halen's Imprisonment in the Dungeons Of
Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. -

Le Prince Philippe De Belgique, Comte De Flandre (1837-1905)
LE PRINCE PHILIPPE DE BELGIQUE, COMTE DE FLANDRE (1837-1905) PAR Albert DUCHESNE Associé de lAcadémie Conservateur au Musée royal de lArmée et d’Histoire militaire 85 F LE PRINCE PHILIPPE DE BELGIQUE, COMTE DE FLANDRE (1837-1905) PAR Albert DUCHESNE Associé de l’Académie Conservateur au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire D/1972/0149/10 Du frère puîné du roi Léopold II, on connaît généralement la bibliophilie, l’amour de la vie de famille, le rôle plus spectaculai re aussi d’inspecteur général de la cavalerie. Tout autant que sa surdité, des dispositions naturelles propres au caractère du prince contribuèrent à l’emprisonner dans des activités à peu près uni quement représentatives. De son intérêt fort relatif pour les préoccupations expansion nistes de Léopold Ier, son père, ou pour celles combien plus concrètes de son frère, tout témoignage faisait, croyons-nous, jusqu’ici défaut. Il a paru d’autant plus urgent — dans la perspective de la prochaine sortie de presse du VIIe tome de la Biographie Belge d’Outre-Mer — de rassembler certains éléments de la correspon dance du frère de Léopold II qui sont de nature à mieux éclairer sa manière de penser et d’agir en face des projets et des réalisa tions d’autres membres de la Dynastie. Samenvatting Van de jongste broer van Léopold II, weet men over ’t alge meen enkel dat hij bibliofiel was, sterk van het familieleven hield, en de meer opvallende rol speelde van Inspecteur-gene- raal der Cavalerie. Zowel zijn hardhorigheid, als zijn natuurlijke aanleg, droegen er toe bij hem op te sluiten in bijna uitsluitend representatieve activiteiten. -

Los Van- Halen, Una Familia Flamenca En España
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE H E RALDICA Y GENE ALOGIA Los Van- Halen, una familia flamenca en España DISCURSO LEIDO EL DIA 30 DE ENERO DE 1991, EN EL ACTO DE SU RECEPCION PUBLICA, POR EL EXCMO. SR. DON JUAN VAN-HALEN Y ACEDO Y CONTES'T'ACION DEL ILMO. SR. DON CONRADO GARCIA DE LA PEDROSA YCAMPOY MADRID MCMXCI © 1991, Juan Van-Halen y Conrado García de la Pedrosa ISBN: 84 - 86568-40-4 Depósito Legal: M- 12616- 1991 Fotocomposición: Ryel. Tel. 522 18 14 Imprime: Dincolor, Discóbolo, 61 posterior. Tel. 741 97 56. 28022 Madrid Impreso en España. Printed in Spain LOS VAN - HALEN, UNA FAMILIA FLAMENCA EN ESPAÑA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERALDICA Y GENEALOGIA Los Van- Halen, una familia flamenca en España DISCURSO LEIDO EL DIA 30 DE ENERO DE 1991, EN EL ACTO DE SU RECEPCION PUBLICA, POR EL EXCMO. SR. DON JUAN VAN-HALEN Y ACEDO Y CONTESTACION DEL ILMO. SR. DON CONRADO GARCIA DE LA PEDROSA YCAMPOY MADRID MCMXCI Sesión académica presidida por S.A.R. Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria DISCURSO DEL EXCMO. SR. DON JUAN VAN-HALEN Y ACEDO 9 Señor, Señores académicos: Comparto aquella opinión clásica que conside raba la gratitud entre los placeres. Héme aquí esta tarde hablándoos desde el placer de mi gratitud, y este sentimiento comporta una acción anterior por vuestra parte: la generosidad. Cuando en 1515 se ordenó a Gonzalo de Córdoba que licenciase a su Ejército en Italia, a quien le reprendió por su cono cida generosidad con sus aliados, motivo acaso que había movido la decisión del Rey de disolver aque llos Tercios, el Gran Capitán le contestó: "No hay modo mejor de gozar de los bienes que dándolos". -

La Révolution Belge
LA RÉVOLUTION BELGE ET ■ • '*■—• r ■ :........: • -^>aï■ • ■ *"**r LA CAMPAGNE DE DIX-JOUES (1830- 1831) SOCIÉTÉ ANONYME M. WEISSENBRUCH, IMPRIMEUR DU ROI, ÉDITEUR RUE DU POINÇON, 49, BRUXELLES ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE - COMMISSION ROYALE D’HISTOIRE MÉMOIRES ET DOCUMENTS INÉDITS SUR LA RÉVOLUTION BELGE ET LA CAMPAGNE DE DIX-JOURS ( 1830- 1831) RECUEILLIS ET ANNOTÉS le Baron Camille BUFFIN AVOCAT TOME PREMIER BRUXELLES Librairie KIESSLiIN O et O1* P. 1MBREGHTS, SUCCESSEUR 42-44, RUE COUDENBERG, 42-44 1 9 1 2 INTRODUCTION Pendant de nombreuses années, la crainte de frois ser certaines susceptibilités a entravé la publication des Mémoires sur la Révolution de 1830 ; mais aujour d'hui qu'une amitié sincère unit le peuple belge et le peuple hollandais, on peut faire connaître, sans in convénient, les intéressants documents qui, depuis quatre-vingts ans, sont enfouis dans les archives pu bliques ou privées. Malheureusement, pendant cet espace de temps, les papiers du comte Frédéric de Mérode, du duc d'Ursel, des barons d'Hoogvorsf et de Stassart, du général Nypels, de M. van de Weyer, d'autres encore, ont été détruits et nous avons perdu ainsi d'importantes sources historiques. Cependant, grâce à l'amabilité de Mme la baronne de Constant Rebecque, de S. A. S. le duc d'Arenberg, du lieutenant général comte H. Du Monceau, adju dant général et chef de la maison militaire de la Reine des Pays-Bas, du baron Chazal, du général-major de Bas, directeur de la section historique au ministère de la guerre hollandais, de M. de Grellc-Rogier, du vicomte d'Hendecourt, de MM. -

2020 Juan Van Halen
Heemkring BKW – Sint-Martens-Bodegem Bodegem in vroegere tijden nr. 16 – 2020 Juan Van Halen (1788-1864), een Spaans avonturier in Bodegem. Deze bijdrage belicht een opmerkelijke militaire persoonlijkheid die een invloed- rijk en welgevuld leven heeft geleid. De bijzondere figuur wekte onze belang- stelling, omdat hij enige tijd in Bodegem zou gewoond hebben, een feit dat alleszins in de plaatselijke herinnering totaal was vervaagd. Samenzweerder en avonturier, onaf- scheidelijk verbonden aan de onrustige militair die de wereld doorkruiste op zoek naar actie, die koningen, prinsen en keizers ontmoette, die door zijn charme en bevalligheid schitterde in de mondaine salons, elegant en welbe- spraakt, intrigerend met de faam van een echte don Juan, die zowel Span- jaard, Fransman, Rus of Belg was, die in de kerker zat en verbanning kende, die meer dan eens op het punt stond te worden gefusilleerd, die na een risicovol leven waarin hij menigmaal met de dood flirtte toch een vredevolle oude dag kende aan de baai van Cadiz en Veldmaarschalk Juan Van Halen ca. 1853. zijn avonturen kon vertellen aan de zee, (schilderij in Museo Naval, Madrid). zijn eerste roeping, … Over deze avontuurlijke figuur ver- Zo beschreef (vrij vertaald) Juan Van schenen meerdere biografieën, waarvan Halen Acedo, Spaans dichter, historicus deze van de hand van Pio Baroja hier 2 en senator voor de Partido Popular, zijn bijzondere aandacht verdient. De auteur betovergrootvader don Juan Van Halen y roemt Juan Van Halen niet alleen als Sarti.1 Bevrijder van Brussel, maar verrast ook met de precisering van zijn Belgische 1 Van Halen, Juan, Memorias; Narracion – Relato del Viaje a Rusia – Cuatro Jornadas de Bruselas (Ediciones 2 Baroja, Pio, Juan Van Halen, el oficial aventurero Polifemo, Madrid 2008). -

A Narrative of a Few Weeks in Brussels in 1830. by a Resident
Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. -
Spanish Imperialism in the Fiction of Benito Pérez Galdós
Ghosts of Colonies Past and Present Spanish Imperialism in the Fiction of Benito Pérez Galdós Ghosts of Colonies Past and Present Spanish Imperialism in the Fiction of Benito Pérez Galdós Mary L. Coffey Ghosts of Colonies Past and Present Liverpool University Press First published 2020 by Liverpool University Press 4 Cambridge Street Liverpool L69 7ZU Copyright © 2020 Mary L. Coffey The right of Mary L. Coffey to be identified as the author of this book has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. British Library Cataloguing-in-Publication data A British Library CIP record is available ISBN 978-1-78962-213-3 cased ISBN 9781789623468 epdf Typeset by Carnegie Book Production, Lancaster Contents Contents Acknowledgments vii Introduction: Managing the Loss of Empire 1 The Problem of Spain’s Colonial Legacy 3 Part I: Benito Pérez Galdós and the Rewriting of Spanish History 2 Contextualizing the Trauma of Imperial Loss 54 3 End of an Empire and Birth of a Nation 93 Part II: A Tale of Two Plots 4 Historicizing Colonial Loss 126 5 A Foundational Fiction for the Metropolis 167 Part III: The Remnants of Empire 6 The New Normal in Colonial Relations 232 Conclusion: Spanish History “para uso de los niños” 287 Works Cited 295 Index 311 Acknowledgments Acknowledgments There is an undeniable audacity in attempting to write a book that addresses the broad topic of Spanish imperialism in the work of an author who enjoyed such a long, prolific career and whose fiction has attracted the attention of so many scholars. -

“Testamento De Isabel La Católica” Una Curiosa Obra Poética De Matilde Ribot Y Van Halen, Con Noticia Sobre El Origen De Su Linaje Materno
“TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA” UNA CURIOSA OBRA POÉTICA DE MATILDE RIBOT Y VAN HALEN, CON NOTICIA SOBRE EL ORIGEN DE SU LINAJE MATERNO. Por Juan Van-Halen y Acedo Académico de Número “ISABELLA THE CATHOLIC’S WILL” AN INTERESTING POETIC PIECE OF WORK BY MATILDE RIBOT Y VAN HALEN, REVEALING HER MATERNAL ROOTS. RESUMEN : Este trabajo presenta “Testamento de Isabel la Católica”, curiosa obra en verso de Matilde Ribot y Van Halen, prolífica autora teatral, poetisa y narradora infantil de la primera mitad del siglo XX, y ofrece, además, noticia sobre el linaje materno de la autora, de raíces lombardas y que llegó a Flandes en los inicios del siglo XIV, una de cuyas ramas pasó a España en el primer tercio del siglo XVIII. ABST ra CT : This paper introduces “Isabella the Catholic’s will”, an interesting poetic piece of work by Matilde Ribot y Van Halen, a prolific playwright, poet and children’s story writer from the first half of the XX century, revealing her maternal lombard roots that were present in Flan- des in the early XIV century, when certain family members happened to come to Spain during the early part of the XVIII century. ARAMHG, XVI, 2013, 253-289 254 JUAN VAN-HALEN Y ACEDO PA L A B ra S CL A VE : Isabel la Católica, Matilde Ribot y Van Halen, testamento, linaje. KEYWO R DS : Isabella the Catholic, Matilde Ribot y Van Halen, will, roots. INT R ODUCC I ÓN Matilde Ribot y Van Halen -firmó parte de sus obras como Matilde Ribot de Montenegro, uniendo el apellido de su marido- es una escritora que aparece en diversos estudios y antologías sobre la dramaturgia de la posguerra1. -

Charles Rogier / R
BE-A0510_000071_002800_FRE Inventaire des papiers de Charles Rogier / R. Boumans Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Charles Rogier DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:............................................................................5 Consultation et utilisation..............................................................................................6 Recommandations pour l'utilisation................................................................................6 Histoire du producteur et des archives..........................................................................7 Producteur d'archives.......................................................................................................7 Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille...........................................7 Archives.............................................................................................................................9 Historique......................................................................................................................9 Acquisition...................................................................................................................10 Contenu et structure....................................................................................................11 Contenu...........................................................................................................................11 -

Memoirs of Don Juan Van Halen
Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. -
Memoirs of Don Juan Van Halen Comprising the Narrative of His
M EMOI RS D O N J U AN VAN H AL E N ; COM PRISING T HE NARRATIVE OF HIS IMPRISONMENT I N T H E D UNGEONS OF T HE IN! UISIT ION AT A I M D R D , AND OF HIS E CAPE HIS J U NEY TO U IA S , O R R SS , HIS CAMPAIGN WITH THE ARMY OF THE CAUCA U S S, - - 4 0. 6 0. N AN R I T ED ITED , FROM THE ORIGINAL SPA ISH M USC P . 8 1 ru e Arrm- o “ o r ” D ON ESTEBAN AND SAND OVAL. SECO D ED ITIO N N, W I T H A L T E R A T I O N S A N D A D D I T I O N S. I N T WO VO LU M E S. VOL. II . i vy 9- 1 A p p 3 a 0 D 0 0 HENRY COLBURN AND RICHARD BENTLEY ' NE W BUR L INGT ON su inm 1830. ‘ 3 “ t v? xx Y ’ J u i l / 0 1. : 3. 0 l a n “ f 232223 l TI L L/ m g A 3 RA W LOND ON S s ’ ‘ b y to . ’ - o n isnf i u u s J on on s co unt m ar sn nnr. j , s , N AR R AT I V E D ON J UAN VAN HALE N. CHAPTE R I . — T he a uthor resolv es on entering the Russi an servi ce His i ntervi ew — wi th some g entlemen of the Russian leg ati on i n London D on — Fermi n Tenet M r. -

Einaudi, Luigi R. “Informal Remarks on Latin America and the Caribbean.” Organization of American States, May 22, 1980
The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project AMBASSADOR LUIGI R. EINAUDI Interviewed by: Charles Stuart Kennedy and Robin Matthewman Initial interview date: May 17, 2013 Copyright 2021 ADST TABLE OF CONTENTS Family Background 6 Born in Cambridge, Massachusetts 1936 The Einaudis Grandfather’s lessons The Michels Schooling 11 Phillips Exeter Academy 1950–1953 BA in Government, Harvard University 1953–1957 National Student Association Carol Peacock The Urbans and Peacocks U.S. Army Draftee 27 Fort Knox 1957 U.S. Army Europe HQ (USAREUR) in Heidelberg, Germany 1958–1959 Graduate School 33 PhD at Harvard University 1959–1961 Teaching Fellow The student movement and Cuba McGeorge Bundy Instructor in Government—Wesleyan University 1961–1962 RAND 37 Researcher—RAND Corporation in Santa Monica, California 1962–1973 Research on the third world—Africa, Asia, and Latin America Taught political science at UCLA Research on Peruvian military in Lima, Peru 1964–1965 Head of Social Science research on Latin America Worked with Pentagon, Air Force, and NSC Identifying development trends 1 “The ‘System’ does not work” Negotiated RAND’s first contract with State Department U.S.-Peruvian relations during 1968 military overthrow State Policy Planning 44 Washington, D.C.—Foreign Service Reserve Officer on the Secretary’s Policy Planning Staff 1974–1977 Winston Lord, director of S/P Henry Kissinger, Secretary of State Rise and fall of Chilean President Allende Pinochet Coup Launch of Global Outlook Program (GLOP) U.S.-Latin