Note D'analyse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
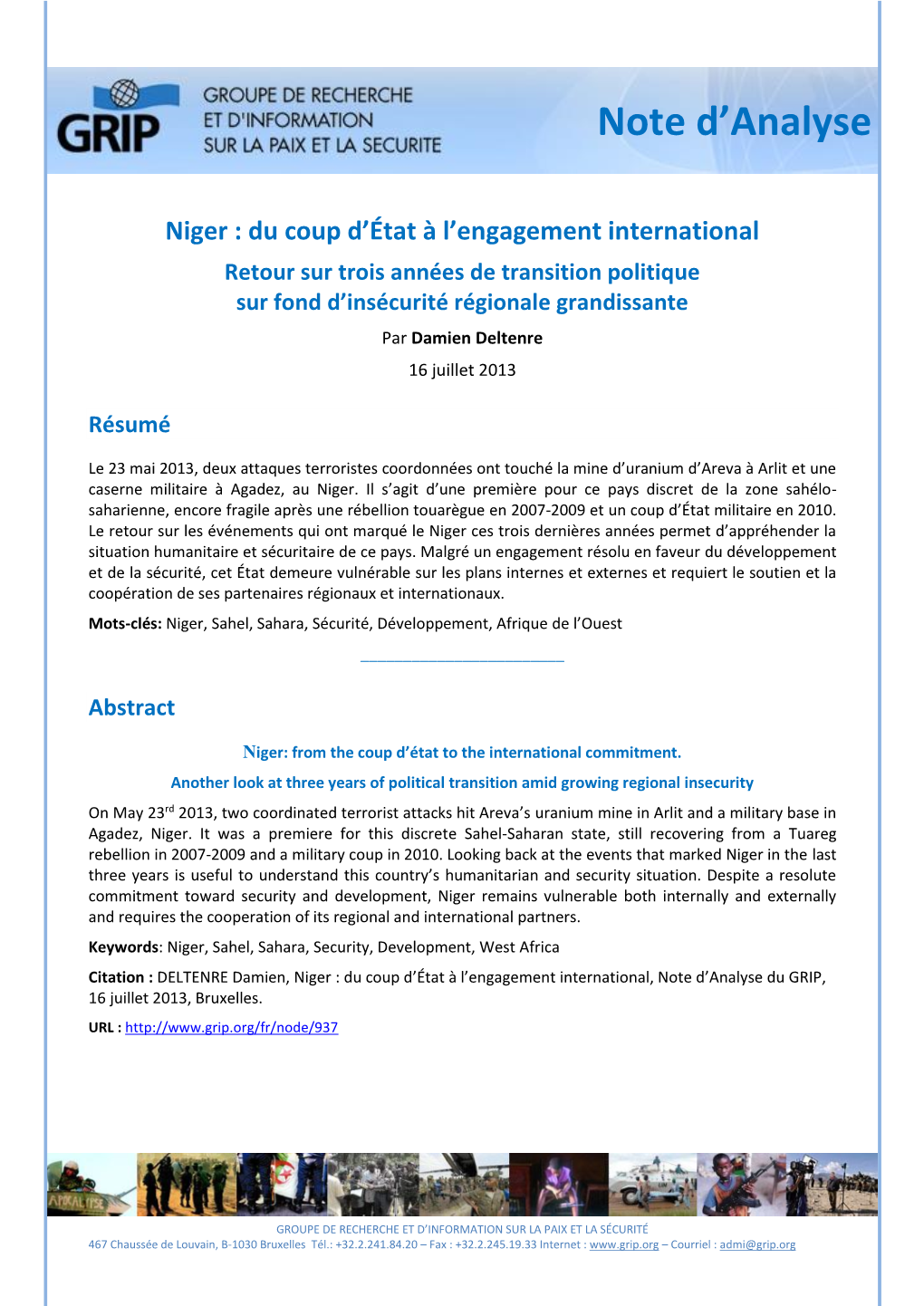
Load more
Recommended publications
-

LÄNDERBERICHT Konrad-Adenauer-Stiftung E.V
LÄNDERBERICHT Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. NIGER ELKE ERLECKE Renaissance geglückt? Eine erste Bilanz der Regierung September 2011 Issoufou www.kas.de/westafrika Der Putsch des nigrischen Militärs im ger des ehemaligen Präsidenten Tandja zu Februar 2010 hatte die Absicht des gerechnet wurde, hatte eigentlich keiner Präsidenten Tandja, sich eine dritte gerechnet. Er wurde möglich, weil sich vor Amtszeit zu ermöglichen, vereitelt. Von dem zweiten Wahlgang die Allianzen ver- Anfang hatte die Militärjunta unter Ge- schoben. Das Bündnis zwischen PNDS , Con- neral Djibo Salou das Ziel ausgegeben, vention Démocratique et Sociale (CDS) und innerhalb eines Jahres wieder eine der Partei LUMANA zerfiel. Die CDS scherte Demokratie einzurichten. Der „Conseil aus und unterstützte von da an Oumarou, suprême pour la restauration de la den Kandidaten des Mouvement Nigérien démocratie“ (CSRD) als Interimslegis- pour le Socialisme et la Démocratie lative, dem Repräsentanten aller Berei- (MNSD). Der Kandidat der LUMANA, Hama che der nigrischen Gesellschaft ange- Amadou, der im ersten Wahlgang der Präsi- hörten, bereitete die Wahlen vor. Mit dentschaftswahlen mit 20 Prozent auf dem den störungsfrei und demokratisch ver- dritten Platz gelandet war, stärkte wieder- laufenen Präsidentschafts- und Parla- um Issoufou den Rücken. ments- sowie Regional- und Kommu- nalwahlen Anfang 2011 wurde aus Der erste Präsident der VII. Republik ist von Sicht der Beobachter ein großer Schritt Haus aus Mathematiker und Bergwerksin- auf dem Weg zur Demokratisierung des genieur. Dass er den Minenbereich des Ni- Landes und der Region getan. Die Re- ger – die annähernd einzige Einnahmequelle gierung des neuen Präsident Mahama- es Landes - wie seine Westentasche kennt, dou Issoufou hat die Herausforderun- gilt als sein großes Plus. -

LET4CAP Law Enforcement Training for Capacity Building NIGER
Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union LAW ENFORCEMENT TRAINING FOR CAPACITY BUILDING LET4CAP Law Enforcement Training for Capacity Building NIGER Downloadable Country Booklet DL. 2.5 (Ve 1.2) Dissemination level: PU Let4Cap Grant Contract no.: HOME/ 2015/ISFP/AG/LETX/8753 Start date: 01/11/2016 Duration: 33 months Dissemination Level PU: Public X PP: Restricted to other programme participants (including the Commission) RE: Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission) Revision history Rev. Date Author Notes 1.0 20/03/2018 SSSA Overall structure and first draft 1.1 06/05/2018 SSSA Second version after internal feedback among SSSA staff 1.2 09/05/2018 SSSA Final version version before feedback from partners LET4CAP_WorkpackageNumber 2 Deliverable_2.5 VER1.2 WorkpackageNumber 2 Deliverable Deliverable 2.5 Downloadable country booklets VER V. 1 . 2 2 NIGER Country Information Package 3 This Country Information Package has been prepared by Eric REPETTO and Claudia KNERING, under the scientific supervision of Professor Andrea de GUTTRY and Dr. Annalisa CRETA. Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy www.santannapisa.it LET4CAP, co-funded by the Internal Security Fund of the European Union, aims to contribute to more consistent and efficient assistance in law enforcement capacity building to third countries. The Project consists in the design and provision of training interventions drawn on the experience of the partners and fine-tuned after a piloting and consolidation phase. © 2018 by LET4CAP All rights reserved. 4 Table of contents 1. Country Profile 1.1Country in Brief 1.2Modern and Contemporary History of Niger 1.3 Geography 1.4Territorial and Administrative Units 1.5 Population 1.6Ethnic Groups, Languages, Religion 1.7Health 1.8Education and Literacy 1.9Country Economy 2. -

The World Factbook
The World Factbook Africa :: Niger Introduction :: Niger Background: Niger became independent from France in 1960 and experienced single-party and military rule until 1991, when Gen. Ali SAIBOU was forced by public pressure to allow multiparty elections, which resulted in a democratic government in 1993. Political infighting brought the government to a standstill and in 1996 led to a coup by Col. Ibrahim BARE. In 1999, BARE was killed in a counter coup by military officers who restored democratic rule and held elections that brought Mamadou TANDJA to power in December of that year. TANDJA was reelected in 2004 and in 2009 spearheaded a constitutional amendment that would allow him to extend his term as president. In February 2010, a military coup deposed TANDJA, immediately suspended the constitution, and dissolved the Cabinet. ISSOUFOU Mahamadou emerged victorious from a crowded field in the election following the coup and was inaugurated in April 2011. Niger is one of the poorest countries in the world with minimal government services and insufficient funds to develop its resource base. The largely agrarian and subsistence-based economy is frequently disrupted by extended droughts common to the Sahel region of Africa. The Nigerien Movement for Justice, a predominately Tuareg ethnic group, emerged in February 2007, and attacked several military targets in Niger's northern region throughout 2007 and 2008. Successful government offensives in 2009 limited the rebels' operational capabilities. Niger is facing increased security concerns on -

ECFG-Niger-2020R.Pdf
About this Guide This guide is designed to prepare you to deploy to culturally complex environments and achieve mission objectives. The fundamental information contained within will help you understand the cultural dimension of your assigned location and gain skills necessary for success. The guide consists of 2 parts: ECFG Part 1 introduces “Culture General,” the foundational knowledge you need to operate effectively in any global environment (Photos courtesy of IRIN News 2012 © Jaspreet Kindra). Niger Part 2 presents “Culture Specific” Niger, focusing on unique cultural features of Nigerien society and is designed to complement other pre- deployment training. It applies culture-general concepts to help increase your knowledge of your assigned deployment location. For further information, visit the Air Force Culture and Language Center (AFCLC) website at www.airuniversity.af.edu/AFCLC/ or contact AFCLC’s Region Team at [email protected]. Disclaimer: All text is the property of the AFCLC and may not be modified by a change in title, content, or labeling. It may be reproduced in its current format with the expressed permission of the AFCLC. All photography is provided as a courtesy of the US government, Wikimedia, and other sources as indicated. GENERAL CULTURE CULTURE PART 1 – CULTURE GENERAL What is Culture? Fundamental to all aspects of human existence, culture shapes the way humans view life and functions as a tool we use to adapt to our social and physical environments. A culture is the sum of all of the beliefs, values, behaviors, and symbols that have meaning for a society. All human beings have culture, and individuals within a culture share a general set of beliefs and values. -

The World Factbook
The World Factbook Africa :: Niger Introduction :: Niger Background: Niger became independent from France in 1960 and experienced single-party and military rule until 1991, when Gen. Ali SAIBOU was forced by public pressure to allow multiparty elections, which resulted in a democratic government in 1993. Political infighting brought the government to a standstill and in 1996 led to a coup by Col. Ibrahim BARE. In 1999, BARE was killed in a counter coup by military officers who restored democratic rule and held elections that brought Mamadou TANDJA to power in December of that year. TANDJA was reelected in 2004 and in 2009 spearheaded a constitutional amendment that would allow him to extend his term as president. In February 2010, a military coup deposed TANDJA, immediately suspended the constitution, and dissolved the Cabinet. ISSOUFOU Mahamadou emerged victorious from a crowded field in the election following the coup and was inaugurated in April 2011. Niger is one of the poorest countries in the world with minimal government services and insufficient funds to develop its resource base. The largely agrarian and subsistence-based economy is frequently disrupted by extended droughts common to the Sahel region of Africa. The Nigerien Movement for Justice, a predominantly ethnic Tuareg rebel group, emerged in February 2007, and attacked several military targets in Niger's northern region throughout 2007 and 2008. Successful government offensives in 2009 ended the rebellion. Niger is facing increased security concerns on its borders from various external threats including insecurity in Libya, spillover from the conflict in Mali, and violent extremism in northeastern Nigeria. -

Niger: Another Weak Link in the Sahel?
Niger: Another Weak Link in the Sahel? Africa Report N°208 | 19 September 2013 Translation from French International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 [email protected] Contents Executive Summary ................................................................................................................... i I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. The Scramble for Power: Between Civilian and Military Rule (1960-2010) ................... 3 A. Old Imbalances: The Colonial State’s Weaknesses and Violence ............................. 3 B. The Failure of the First Republic (1960-1974) .......................................................... 4 C. The “Military Politicians” (1974-1990) ...................................................................... 6 D. A Fragile and Uncertain Democratisation (1990-2000) ........................................... 8 1. Short-lived regimes: The Second, Third and Fourth Republics .......................... 8 2. The armed rebellions of the 1990s ....................................................................... 9 E. The Tandja Decade (1999-2010) ............................................................................... 11 1. The “second Tuareg rebellion” ............................................................................. 11 2. The abuses of tazartché ....................................................................................... -

Niger 2017 Human Rights Report
NIGER 2017 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY Niger is a multiparty republic. President Issoufou Mahamadou won a second term in March 2016 with 92 percent of the vote. The African Union certified the election as free and fair over the criticism of some domestic observers, who noted the jailing of the entire leadership of the lead opposition party among other irregularities. The government refused to follow a Constitutional Court ruling for a parliamentary election in the district of Maradi to replace a representative who had died. Civilian authorities maintained effective control over the security forces. The most significant human rights issues included attacks by armed groups that resulted in death, disappearances, and abuse; arbitrary arrest and detention of accused terrorists or other combatants by government security forces; harsh and life-threatening prison and detention center conditions; detention of opposition politicians; restrictions on freedom of assembly; allegations of widespread official corruption; lack of accountability in cases involving violence against women and children, including rape and female genital mutilation/cutting (FGM/C); trafficking in persons, caste-based slavery, and forced labor.. The government took some steps to prosecute officials who committed abuses, but impunity remained a problem. Terrorist groups targeted and killed civilians and recruited child soldiers. Section 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from: a. Arbitrary Deprivation of Life and Other Unlawful or Politically Motivated Killings Unlike in the previous year, there were no reports that the government or its agents committed arbitrary or unlawful killings. Armed terrorist groups including Boko Haram and groups affiliated with al-Qaida and ISIS-West Africa attacked and killed civilians and security officers (see section 1.g.). -

Yahaya Ibrahim Stakesniger
Niger in the face of the Sahelo-Saharan Islamic Insurgency Precarious Stability in a Troubled Neighborhood Ibrahim Yahaya Ibrahim Working Paper No. 004 Sahel Research Group Working Paper No. 004 Paper Series: The Stakes of the Malian Crisis in the Sahel Niger in the face of the Sahelo-Saharan Islamic Insurgency Precarious Stability in a Troubled Neighborhood Ibrahim Yahaya Ibrahim August 2014 The Sahel Research Group, of the University of Florida’s Center for African Studies, is a collaborative effort to understand the political, social, economic, and cultural dynamics of the countries which comprise the West African Sahel. It focuses primarily on the six Francophone countries of the region—Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, and Chad—but also on in developments in neighboring countries, to the north and south, whose dy- namics frequently intersect with those of the Sahel. The Sahel Research Group brings together faculty and gradu- ate students from various disciplines at the University of Florida, in collaboration with colleagues from the region. More information is available here: http://sahelresearch.africa.ufl.edu/ Paper Series: The Stakes of the Malian Crisis in the Sahel In January 2012, Tuareg separatists launched a rebellion against the government of Mali in a bid to gain independence for the northern regions of the country. They were quickly joined by groups of Islamist militants seeking to establish control of the region, and dealing significant setbacks to the Malian military in a series of engagements. Following these de- feats, on 22 March 2012 frustrated junior officers in the Malian military led a coup d’état which ousted President Amadou Toumani Touré from power. -

«Turning the Page» Hopes for Media Freedom in Niger and Guinea
«TURNING THE PAGE» HOPES FOR MEDIA FREEDOM IN NIGER AND GUINEA AFP PHOTO / SIA KAMBOU © COPYRIGHT: RSF HOPES FOR MEDIA FREEDOM IN NIGER AND GUINEA ///////////////////////////////////////////////////////////// 3 Investigation by Ambroise Pierre, Africa Desk. With research coordinator Gilles Lordet in Guinea and Jean-Louis Saporito, a journalist and Reporters Without Borders board member, in Niger. n Guinea, the National Transition Council (CNT) led by Reporters Without Borders, which visited Guinea from 22 Gen. Sékouba Konaté held the first free and transpa- to 27 May and Niger from 26 to 30 June, found that the rent election in the country’s history in 2010. It was democratic transition in both countries was accompanied won by long-time opposition leader, Alpha Condé. In by a marked increase in media freedom and strong hopes INiger, a military coup on 18 February 2010 ended Presi- of an improvement in the situation of the media and jour- dent Mamadou Tandja’s attempts to stay in office beyond nalists. It was these hopes that Reporters Without Borders the end of his term and opened the way for a transition wanted to evaluate. under the Supreme Council for the Restoration of Demo- cracy (CSRD). It resulted in Mahamadou Issoufou’s election in early 2011. In Conakry, the Reporters Without Borders delegation was justice minister Marou Amadou, Gen. Salou Djibo, who hea- received by officials from the ministry of communication ded the Supreme Council for the Restoration of Democracy and ministry of territorial administration and decentraliza- (CSRD) and was president during the transition, and several tion, by justice minister Christian Sow and by government Niamey-based foreign diplomats. -

Crossing the Wilderness
REPORT — SPRING 2021 Crossing the wilderness Europe and the Sahel This report is part of Friends of Europe’s Peace, Security and Defence programme. Written by Paul Taylor, it brings together the views of scholars, policymakers and senior defence and security stakeholders. Unless otherwise indicated, this report reflects the writer’s understanding of the views expressed by the interviewees and participants of survey. The author and the participants contributed in their personal capacities, and their views do not necessarily reflect those of the institutions they represent, or of Friends of Europe and its board of trustees, members or partners. Reproduction in whole or in part is permitted, provided that full credit is given to Friends of Europe and that any such reproduction, whether in whole or in part, is not sold unless incorporated in other works. The Peace, Security and Defence programme is supported by the United States government. This report is produced in partnership with Publisher: Geert Cami Author: Paul Taylor Publication Director: Dharmendra Kanani Programme Manager: Elena Saenz-Feehan Programme Executive: Alex O’Mahony Programme Assistant: Krystal Gaillard Editors: Anna Muizniece, Angela Pauly, Teresa Carvalho & Daniel Pietikainen Design: Matjaž Krmelj © Friends of Europe - April 2021 Table of contents Foreword 6 Methodology and Acknowledgments 10 Executive summary 14 No promised land 14 Crisis of legitimacy 16 Instability and intervention 17 Containment, not victory 18 No proxy war, french lead 20 Widening coalitions, endless -

La Cour Constitutionnelle Déboute Les Députés De L'opposition
"La meilleure forteresse des tyrans est l'inertie du peuple" (Machiavel) Hebdomadaire Satirique Nigérien Site : lagriffe-niger.com - N°591 du 13 Octobre 2014 - Prix 300FCFA Polémique sur la convocation de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée nationale La Cour Constitutionnelle déboute les députés de l’opposition A travers un avis qu’elle a rendu le 9 octobre dernier, la Cour Constitutionnelle a tranché au sujet de la polémique sur la convocation de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2014. A travers son avis, l'institution dirigée par Mme Abdoulaye Kadidiatou Ly débouté les députés de l’opposition parlementaire qui accusaient leurs collègues de la majorité d’avoir violé la Constitution, en ouvrant la 2ème session ordinaire de l’Assemblée nationale, le 1er octobre 2014 sur convocation du premier vice-président de l’institution, alors même que le Président de l’Assemblée a convoqué la même session pour le 7 octobre. Assassinat de soldats nigériens de la MINUSMA au Mali Le Niger encore victime du terrorisme Mission de supervision des activités du projet PANA-CANADA Le Gouverneur de la Les bénéficiaires des région de Dosso limogé interventions du projet PANA P. 7 expriment leur satisfaction P. 2 Emigration des bras valides et impacts sur le développement local Un maire du parti CDS-RAHAMA rejoint le L’émigration massive des bras PNDS-TARAYYA dans la région de Zinder P. 3 valides de la région de Tahoua, un frein au développement local Accusations tous azimuts sur l’assassinat du Président Baré P.P. 4-5 Une occasion en or que le Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2015 Le parcours s’annonce RDP-JAMA’A doit saisir ! P. -

Niger in 2013
Niger in 2013 The government charted its way through the minefield of challeng- es posed by the war between Islamist groups and French-led forces in neighbouring Mali and Boko Haram’s revolt in Nigeria. Although Niger was seen by the outside world as a beacon of relative stability, the country’s vulnerability showed itself in attacks on a military base and uranium mine by Islamists driven out of Malian territory, as well as in a jail-break in the capital, Niamey, involving Boko Haram fight- ers. A boost in defence spending was followed by massive troop de- ployment along the Malian border, the dispatch of soldiers to assist in the French- and Chadian-led reconquest of north-east Mali, and the closure of the border with Nigeria. The attacks in Niger height- ened popular anxiety and led to new security measures. In August, the appointment of a government of national unity led to the first political crisis since President Mahamadou Issoufou had taken of- fice in 2011. Defended as a security measure, the reshuffle was part of the manoeuvring between Issoufou and his main coalition partner, National Assembly chair Hama Amadou, ahead of the 2016 presi- dential polls. Insufficient rainfall further compounded the fragile food supply. Uranium output suffered from the attack on mining installations. With its contract set to expire on 31 December, French nuclear energy group Areva got involved in tense negotiations with the government over the renewal of the agreement. Talks had not been concluded by year’s end. Fresh delays in the completion of the hydro-electric Kandadji dam, in addition to the worst power failures in years, exposed the country’s rickety infrastructure.