L'absence De Généraux Canadiens-Français Combattants
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

By Anne Millar
Wartime Training at Canadian Universities during the Second World War Anne Millar Thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in partial fulfillment of the requirements for the Doctorate of Philosophy degree in history Department of History Faculty of Arts University of Ottawa © Anne Millar, Ottawa, Canada, 2015 ii Abstract This dissertation provides an account of the contributions of Canadian universities to the Second World War. It examines the deliberations and negotiations of university, government, and military officials on how best to utilize and direct the resources of Canadian institutions of higher learning towards the prosecution of the war and postwar reconstruction. During the Second World War, university leaders worked with the Dominion Government and high-ranking military officials to establish comprehensive training programs on campuses across the country. These programs were designed to produce service personnel, provide skilled labour for essential war and civilian industries, impart specialized and technical knowledge to enlisted service members, and educate returning veterans. University administrators actively participated in the formation and expansion of these training initiatives and lobbied the government for adequate funding to ensure the success of their efforts. This study shows that university heads, deans, and prominent faculty members eagerly collaborated with both the government and the military to ensure that their institutions’ material and human resources were best directed in support of the war effort and that, in contrast to the First World War, skilled graduates would not be heedlessly wasted. At the center of these negotiations was the National Conference of Canadian Universities, a body consisting of heads of universities and colleges from across the country. -
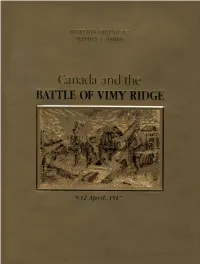
CDN Battle of Vimy Ridge.Pdf
Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 1 Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 2 Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 3 BRERETON GREENHOUS STEPHEN J. HARRIS Canada and the BATTLE OF VIMY RIDGE 9-12 April 1917 Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 4 Canadian Cataloguing in Publication Data Greenhous, Brereton, 1929- Stephen J. Harris, 1948- Canada and the Battle of Vimy Ridge, 9-12 April 1917 Issued also in French under title: Le Canada et la Bataille de Vimy 9-12 avril 1917. Includes bibliographical references. ISBN 0-660-16883-9 DSS cat. no. D2-90/1992E-1 2nd ed. 2007 1.Vimy Ridge, Battle of, 1917. 2.World War, 1914-1918 — Campaigns — France. 3. Canada. Canadian Army — History — World War, 1914-1918. 4.World War, 1914-1918 — Canada. I. Harris, Stephen John. II. Canada. Dept. of National Defence. Directorate of History. III. Title. IV.Title: Canada and the Battle of Vimy Ridge, 9-12 April 1917. D545.V5G73 1997 940.4’31 C97-980068-4 Cet ouvrage a été publié simultanément en français sous le titre de : Le Canada et la Bataille de Vimy, 9-12 avril 1917 ISBN 0-660-93654-2 Project Coordinator: Serge Bernier Reproduced by Directorate of History and Heritage, National Defence Headquarters Jacket: Drawing by Stéphane Geoffrion from a painting by Kenneth Forbes, 1892-1980 Canadian Artillery in Action Original Design and Production Art Global 384 Laurier Ave.West Montréal, Québec Canada H2V 2K7 Printed and bound in Canada All rights reserved. -

Vente Du Jeudi 13 Mars 2014
VENTE DU JEUDI 13 MARS 2014 SOUVERAINS FRANÇAIS 1. CHARLES VI, roi de France (1368-1422). Charte sur vélin signée « Charles », 20 janvier 1404 (1405 nouveau style), 1 p., in-4 oblong (31 cm x 8, cm), texte manuscrit, avec traces de cachet de cire rouge, pliures, taches et traces de montage. 300/500 € Mandement aux conseillers sur le fait des aides pour la guerre, de payer à Milet de Laigny, garde de la chambre au sel établie à Louviers, la somme de 100 francs d’or en récompense de ses services. PROVENANCE : Cabinet Henri Saffroy, expert en Autographes et documents historiques à Paris. Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 2. Non venu. 3*. JEAN II Le Bon, comte d’Angoulême (1404-1467). Pièce sur parchemin signée « Jehan » (petit-fils du roi Charles V et grand-père de François Ier) montée sur onglet, sceau manquant, 8 juillet 1452, 1 p., in-4 oblong (32, 5 cm – 12 cm), pliures. Avec une gravure ancienne représentant un portrait en médaillon du souverain. On y joint une charte manuscrite sur parchemin du XIIIe siècle, accordée par Thibaud de Cornillon, datée du 12 mars 12550. 600/800 € Ordre de paiement au receveur général de son comté d’Angoulême en faveur du lieutenant du sénéchal d’Angoulême, Denis Des Planches, « pour lui aider à entretenir son estat en nostre service ». Attaché à cette pièce par un lien de parchemin, le reçu dudit lieutenant Denis Des Planches. PROVENANCE : ancienne collection du baron de Trémont (1886-1963), Vente à Paris, 9 décembre 1852, lot 41. -

Myth Making, Juridification, and Parasitical Discourse: a Barthesian Semiotic Demystification of Canadian Political Discourse on Marijuana
MYTH MAKING, JURIDIFICATION, AND PARASITICAL DISCOURSE: A BARTHESIAN SEMIOTIC DEMYSTIFICATION OF CANADIAN POLITICAL DISCOURSE ON MARIJUANA DANIEL PIERRE-CHARLES CRÉPAULT Thesis submitted to the University of Ottawa in partial Fulfillment of the requirements for the Doctorate in Philosophy degree in Criminology Department of Criminology Faculty of Social Sciences University of Ottawa © Daniel Pierre-Charles Crépault, Ottawa, Canada, 2019 ABSTRACT The legalization of marijuana in Canada represents a significant change in the course of Canadian drug policy. Using a semiotic approach based on the work of Roland Barthes, this dissertation explores marijuana’s signification within the House of Commons and Senate debates between 1891 and 2018. When examined through this conceptual lens, the ongoing parliamentary debates about marijuana over the last 127 years are revealed to be rife with what Barthes referred to as myths, ideas that have become so familiar that they cease to be recognized as constructions and appear innocent and natural. Exploring one such myth—the necessity of asserting “paternal power” over individuals deemed incapable of rational calculation—this dissertation demonstrates that the processes of political debate and law-making are also a complex “politics of signification” in which myths are continually being invoked, (re)produced, and (re)transmitted. The evolution of this myth is traced to the contemporary era and it is shown that recent attempts to criminalize, decriminalize, and legalize marijuana are indices of a process of juridification that is entrenching legal regulation into increasingly new areas of Canadian life in order to assert greater control over the consumption of marijuana and, importantly, over the risks that this activity has been semiologically associated with. -

Canada and the BATTLE of VIMY RIDGE 9-12 April 1917 Bataille De Vimy-E.Qxp 1/2/07 11:37 AM Page 4
BRERETON GREENHOUS STEPHEN J. HARRIS JEAN MARTIN Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 2 Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 1 Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 3 BRERETON GREENHOUS STEPHEN J. HARRIS JEAN MARTIN Canada and the BATTLE OF VIMY RIDGE 9-12 April 1917 Bataille de Vimy-E.qxp 1/2/07 11:37 AM Page 4 Canadian Cataloguing in Publication Data Greenhous, Brereton, 1929- Stephen J. Harris, 1948- Canada and the Battle of Vimy Ridge, 9-12 April 1917 Issued also in French under title: Le Canada et la Bataille de Vimy 9-12 avril 1917. Includes bibliographical references. ISBN 0-660-16883-9 DSS cat. no. D2-90/1992E-1 2nd ed. 2007 1.Vimy Ridge, Battle of, 1917. 2.World War, 1914-1918 — Campaigns — France. 3. Canada. Canadian Army — History — World War, 1914-1918. 4.World War, 1914-1918 — Canada. I. Harris, Stephen John. II. Canada. Dept. of National Defence. Directorate of History. III. Title. IV.Title: Canada and the Battle of Vimy Ridge, 9-12 April 1917. D545.V5G73 1997 940.4’31 C97-980068-4 Cet ouvrage a été publié simultanément en français sous le titre de : Le Canada et la Bataille de Vimy, 9-12 avril 1917 ISBN 0-660-93654-2 Project Coordinator: Serge Bernier Reproduced by Directorate of History and Heritage, National Defence Headquarters Jacket: Drawing by Stéphane Geoffrion from a painting by Kenneth Forbes, 1892-1980 Canadian Artillery in Action Original Design and Production Art Global 384 Laurier Ave.West Montréal, Québec Canada H2V 2K7 Printed and bound in Canada All rights reserved. -

The Canadian Cadet Movement and the Boy Scouts of Canada in the Twentieth Century
“No Mere Child’s Play”: The Canadian Cadet Movement and the Boy Scouts of Canada in the Twentieth Century by Kevin Woodger A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto © Copyright by Kevin Woodger 2020 “No Mere Child’s Play”: The Canadian Cadet Movement and the Boy Scouts of Canada in the Twentieth Century Kevin Woodger Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto Abstract This dissertation examines the Canadian Cadet Movement and Boy Scouts Association of Canada, seeking to put Canada’s two largest uniformed youth movements for boys into sustained conversation. It does this in order to analyse the ways in which both movements sought to form masculine national and imperial subjects from their adolescent members. Between the end of the First World War and the late 1960s, the Cadets and Scouts shared a number of ideals that formed the basis of their similar, yet distinct, youth training programs. These ideals included loyalty and service, including military service, to the nation and Empire. The men that scouts and cadets were to grow up to become, as far as their adult leaders envisioned, would be disciplined and law-abiding citizens and workers, who would willingly and happily accept their place in Canadian society. However, these adult-led movements were not always successful in their shared mission of turning boys into their ideal-type of men. The active participation and complicity of their teenaged members, as peer leaders, disciplinary subjects, and as recipients of youth training, was central to their success. -

Canadian Official Historians and the Writing of the World Wars Tim Cook
Canadian Official Historians and the Writing of the World Wars Tim Cook BA Hons (Trent), War Studies (RMC) This thesis is submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Humanities and Social Sciences UNSW@ADFA 2005 Acknowledgements Sir Winston Churchill described the act of writing a book as to surviving a long and debilitating illness. As with all illnesses, the afflicted are forced to rely heavily on many to see them through their suffering. Thanks must go to my joint supervisors, Dr. Jeffrey Grey and Dr. Steve Harris. Dr. Grey agreed to supervise the thesis having only met me briefly at a conference. With the unenviable task of working with a student more than 10,000 kilometres away, he was harassed by far too many lengthy emails emanating from Canada. He allowed me to carve out the thesis topic and research with little constraints, but eventually reined me in and helped tighten and cut down the thesis to an acceptable length. Closer to home, Dr. Harris has offered significant support over several years, leading back to my first book, to which he provided careful editorial and historical advice. He has supported a host of other historians over the last two decades, and is the finest public historian working in Canada. His expertise at balancing the trials of writing official history and managing ongoing crises at the Directorate of History and Heritage are a model for other historians in public institutions, and he took this dissertation on as one more burden. I am a far better historian for having known him. -

THE BROWN BULLETIN to Further the Cause of Co-Operation, Progress and Friendliness
THE BROWN BULLETIN To Further the Cause of Co-operation, Progress and Friendliness ^SprnniimMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii)^ Vol. X, No. 7 Berlin, N. H., January, 1929 [frnmtrfllMllllllllllllllllllllllHlllllll^ THE FLYING COP PRINTED IN U. S. A.I MAKE IT A MASTERPIECE! The New Year is the traditional time THE BROWN BULLETIN for making a fresh start. Any other time PRINTED UPON NIBROC SUPERCALENDERED BUND should be just as good but there seems to be inspiration in something new, whether Vol. X. JANUARY 1929 No 7 it is a house, an automobile, or a suit of clothes. With the end of the old year companies BROWN BULLETIN PUBLISHING ASSOCIATION close their books, figure up their profits "The object of this organization is to publish a paper for the benefit of the employees of the Brown Company and of the Brown Corporation, in which may appear items of local and general interest; and and losses, make new plans for sales, pro- which will tend to further the cause of co-operation, progress and friendliness among and between all duction, and set new goals for accident sections of these companies."—By-Laws, Article 2. reduction. Dr. Glenn Frank, president of the Uni- versity of Wisconsin, whose syndicated EDITORIAL STAFF editorials are read by thousands of news- Editor—G. L. Cave Photographic Editor—Victor Beaudoin Associate Editors—Louville Paine, C. H. Cartoonists—J. Daw, George Prowell paper readers, finds inspiration in a blank sheet of paper. A new canvas or block Assistan^Editorslfohn'Teck1! Paul *"*"• Manager-Ja.es McGivney of marble is a challenge to the artist to Grenier, Kenneth Harvey produce a masterpiece. -

LAST POST November 2019 LAST POST Legion Magazine Publishes the Last Post Annually As Long As the Date of Death Is Within the Time During the Remembrance Day Period
LAST POST November 2019 LAST POST Legion Magazine publishes the Last Post annually As long as the date of death is within the time during the Remembrance Day period. This free period of entries on the website (1984 to present), service recognizes those who have served their the notice will be added to the database and country and allows our readers to learn of the appear in the printed edition. Notices within a passing of comrades with whom they served. year of the date of death can be submitted by Last Post is reserved for these groups: family members, but entries before that time 1) ordinary members of The Royal Canadian period must come from a Royal Canadian Legion at the time of death; 2) RCL life members Legion branch. who were previously ordinary members; and These entries are added to the searchable 3) Canadian war veterans (WW II, Korean War, Last Post database at www.legionmagazine.com. Gulf War, Afghanistan) who were not Legion members at the time of death. Legion Magazine relies on RCL branches to Copyright provide the Last Post information. Please use the Reproduction or re-creation of the Last Post Section, current Last Post form, dated January 2016, in whole or in part, in any form or media, is strictly which is available from the Dominion forbidden and is a violation of copyright, which Command Supply Department. resides with Legion Magazine and its publisher, Branches should submit notices to Legion Canvet Publications Ltd. Magazine promptly to ensure timely publication. AITKEN, Neil—May 4, 2019, age 81. -

The Canadian Militia in the Interwar Years, 1919-39
THE POLICY OF NEGLECT: THE CANADIAN MILITIA IN THE INTERWAR YEARS, 1919-39 ___________________________________________________________ A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board ___________________________________________________________ in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY __________________________________________________________ by Britton Wade MacDonald January, 2009 iii © Copyright 2008 by Britton W. MacDonald iv ABSTRACT The Policy of Neglect: The Canadian Militia in the Interwar Years, 1919-1939 Britton W. MacDonald Doctor of Philosophy Temple University, 2008 Dr. Gregory J. W. Urwin The Canadian Militia, since its beginning, has been underfunded and under-supported by the government, no matter which political party was in power. This trend continued throughout the interwar years of 1919 to 1939. During these years, the Militia’s members had to improvise a great deal of the time in their efforts to attain military effectiveness. This included much of their training, which they often funded with their own pay. They created their own training apparatuses, such as mock tanks, so that their preparations had a hint of realism. Officers designed interesting and unique exercises to challenge their personnel. All these actions helped create esprit de corps in the Militia, particularly the half composed of citizen soldiers, the Non- Permanent Active Militia. The regulars, the Permanent Active Militia (or Permanent Force), also relied on their own efforts to improve themselves as soldiers. They found intellectual nourishment in an excellent service journal, the Canadian Defence Quarterly, and British schools. The Militia learned to endure in these years because of all the trials its members faced. The interwar years are important for their impact on how the Canadian Army (as it was known after 1940) would fight the Second World War. -

Canadian Veterans and the Aftermath of the Great War
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 4-7-2016 12:00 AM And the Men Returned: Canadian Veterans and the Aftermath of the Great War Jonathan Scotland The University of Western Ontario Supervisor Dr. Robert Wardhaugh The University of Western Ontario Graduate Program in History A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Doctor of Philosophy © Jonathan Scotland 2016 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Canadian History Commons, Cultural History Commons, Military History Commons, and the Social History Commons Recommended Citation Scotland, Jonathan, "And the Men Returned: Canadian Veterans and the Aftermath of the Great War" (2016). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 3662. https://ir.lib.uwo.ca/etd/3662 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. Abstract The Great War was a formative event for men who came of age between 1914 and 1918. They believed the experience forged them into a distinct generation. This collective identification more than shaped a sense of self; it influenced understanding of the conflict’s meaning. Canadian historians, however, have overlooked the war’s generational impact, partly because they reject notions of a disillusioned Lost Generation. Unlike European or American youths, it is argued that Canadian veterans did not suffer postwar disillusionment. Rather, they embraced the war alongside a renewed Canadian nationalism. -

Rien Ne Va Plus 2 Dieser Vierte Band Über Das Leben Des Generals Lazare Hoche (1768-97) Befasst Sich Mit Den Beiden Jahren 1796 Und 1797
1 Gott schenkte Adam den Frieden, die Freiheit und das Paradies. Die Men- schen nahmen sich die Freiheit und wählten die Früchte vom Baum der Erkenntnis. Denn Wissen ist Macht. Die Macht, die sie sogleich miss- brauchten und fortwährend missbrauchen. Lazare Hoche (1768 -1797)1 Rien ne va plus 2 Dieser vierte Band über das Leben des Generals Lazare Hoche (1768-97) befasst sich mit den beiden Jahren 1796 und 1797. Gekürzte Quellenangaben bedeuten: „Rousselin 2“: A. Rousselin, „Vie de Lazare Hoche, Géné- ral des armées de la République“, tome second, 1797/8; Briefkopiensammlung der Mme Hoche „Vendéens et Chouans“: "Collection des mémoires rela- tifs à la Révolution française – Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française ou Annales des départements de l’Ouest”, Paris 1825, "par un officier supé- rieur des armées de la République". Sammlung von Akten aus dieser Zeit. „Des Elends Sohn“, 2007, Hoche 1773-1793 „Quatrevingt-quatorze“: 2008, Hoche 1794 „Politiker und Soldaten“: 2009, Hoche 1795 Wer den vielen Links nachgehen möchte, schreibt in das Adressfeld seines Explorers: http://pclavadetscher.magix.net/website/ oder http://db.peterclavadetscher.ch/ Dort findet man den Text meines Buches und kann die Links direkt anklicken. Wollen wir hoffen, die Inhalte seien zwi- schenzeitlich gleich geblieben! Anmerkungen und Glossen zum Text sind in Fussnoten, bio- graphische Notizen (und lange Anfügungen) aber in Endno- ten am Schluss des 7. Kapitels festgehalten (S.368). Alle geographischen Namen, die mit einer Tiefzahl zwischen 56 und 62 versehen sind, finden sich in einer der auf Seite 56 – 62 eingefügten Karten wieder. Auch dieses Jahr sind meine unbedarften Einwürfe kursiv geschrieben.