Rommani Province : Khémisset
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
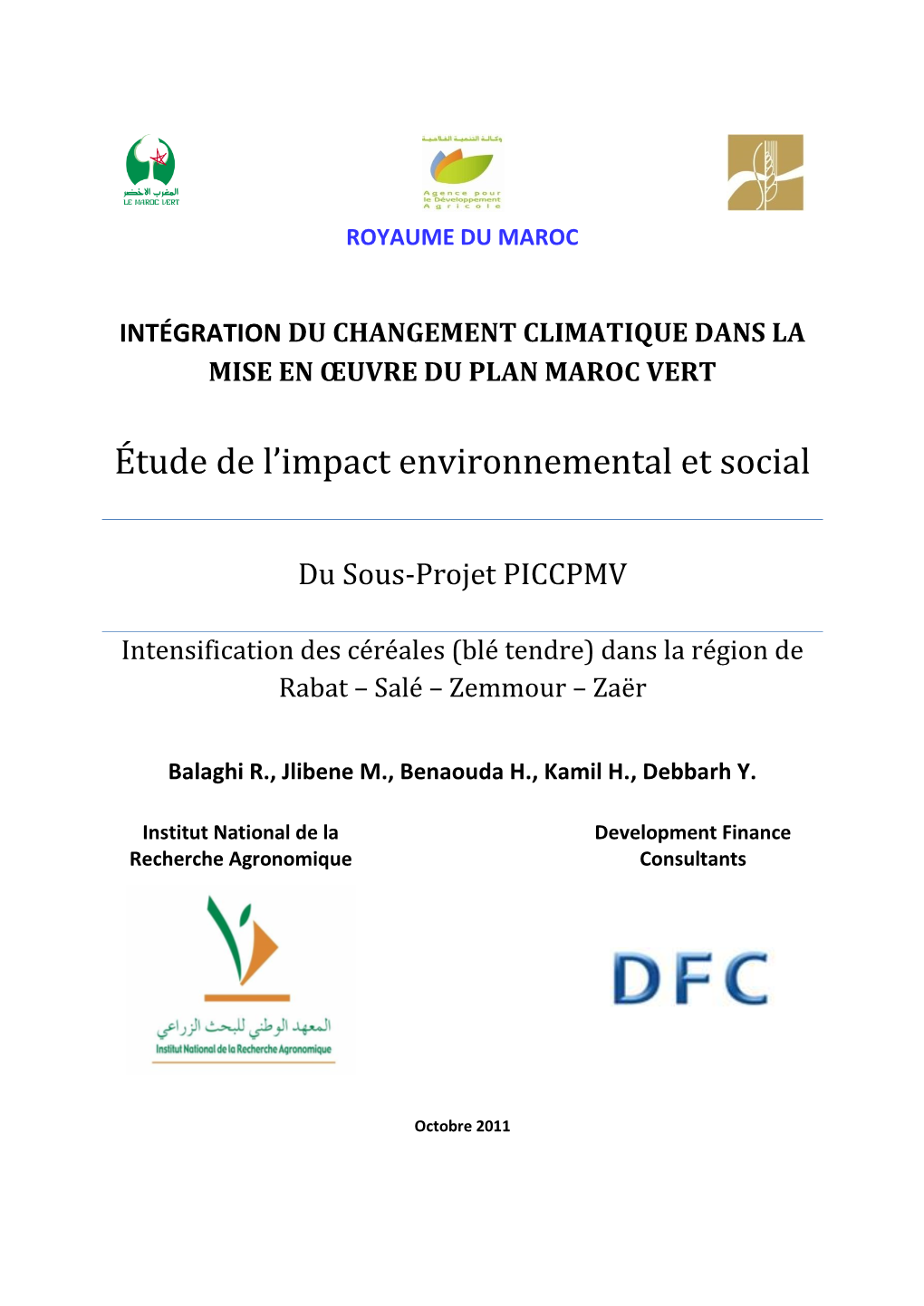
Load more
Recommended publications
-

Produits De Terroir Phares Dans La Région De Rabat-Salé-Kénitra Produits De Terroir Dans La Région De Rabat-Salé-Kénitra
Produits de Terroir phares dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra Produits de Terroir dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra A la découverte des PRODUITS DE TERROIR RÉGION de notre Arachide Coriandre Miel d'Eucalyptus Trues Camomille de la Maâmora Miel d'oranger Cactus S'houl Raisins Muscat Race bovine de Skhirat Miel d’Oulmes Zaer Citrouille Toutes eurs de Maaziz Haricots verts de Skhirat Lavandin d’Oulmès Lentille de Zaer 2 Produits de Terroir dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra A la découverte des PRODUITS DE TERROIR RÉGION de notre Arachide Coriandre Miel d'Eucalyptus Trues Camomille de la Maâmora Miel d'oranger Cactus S'houl Raisins Muscat Race bovine de Skhirat Miel d’Oulmes Zaer Citrouille Toutes eurs de Maaziz Haricots verts de Skhirat Lavandin d’Oulmès Lentille de Zaer 3 2 catalogue final SIAM 2018.- version corrigée le 16 avril 2018.pdf 1 19/04/2018 10:16 Produits de Terroir dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra ujourd’hui, plus que jamais, les consommateurs manifestent A un engouement grandissant pour les produits de terroir dits «authentiques». Parce qu’ils sont naturels et sains, ils connaissent un grand succès, localement et même à l’étranger. A travers ce livret, nous vous proposons de découvrir une large palette des produits de terroir de notre Région. Bienvenue dans la Région de Rabat Vous y découvrirez également des différents goûts et saveurs, Salé-Kénitra fruit d’un savoir faire ancestral, atypique et d’une géographie très spécifique. Ce livret, largement documenté, met à votre disposition toutes les informations nécessaires sur les produits de notre région Nous vous souhaitons une bonne découverte. -

Cadastre Des Autorisations TPV Page 1 De
Cadastre des autorisations TPV N° N° DATE DE ORIGINE BENEFICIAIRE AUTORISATIO CATEGORIE SERIE ITINERAIRE POINT DEPART POINT DESTINATION DOSSIER SEANCE CT D'AGREMENT N Casablanca - Beni Mellal et retour par Ben Ahmed - Kouribga - Oued Les Héritiers de feu FATHI Mohamed et FATHI Casablanca Beni Mellal 1 V 161 27/04/2006 Transaction 2 A Zem - Boujad Kasbah Tadla Rabia Boujad Casablanca Lundi : Boujaad - Casablanca 1- Oujda - Ahfir - Berkane - Saf Saf - Mellilia Mellilia 2- Oujda - Les Mines de Sidi Sidi Boubker 13 V Les Héritiers de feu MOUMEN Hadj Hmida 902 18/09/2003 Succession 2 A Oujda Boubker Saidia 3- Oujda La plage de Saidia Nador 4- Oujda - Nador 19 V MM. EL IDRISSI Omar et Driss 868 06/07/2005 Transaction 2 et 3 B Casablanca - Souks Casablanca 23 V M. EL HADAD Brahim Ben Mohamed 517 03/07/1974 Succession 2 et 3 A Safi - Souks Safi Mme. Khaddouj Bent Salah 2/24, SALEK Mina 26 V 8/24, et SALEK Jamal Eddine 2/24, EL 55 08/06/1983 Transaction 2 A Casablanca - Settat Casablanca Settat MOUTTAKI Bouchaib et Mustapha 12/24 29 V MM. Les Héritiers de feu EL KAICH Abdelkrim 173 16/02/1988 Succession 3 A Casablanca - Souks Casablanca Fès - Meknès Meknès - Mernissa Meknès - Ghafsai Aouicha Bent Mohamed - LAMBRABET née Fès 30 V 219 27/07/1995 Attribution 2 A Meknès - Sefrou Meknès LABBACI Fatiha et LABBACI Yamina Meknès Meknès - Taza Meknès - Tétouan Meknès - Oujda 31 V M. EL HILALI Abdelahak Ben Mohamed 136 19/09/1972 Attribution A Casablanca - Souks Casablanca 31 V M. -

Maroc) : Contribution À La Recherche D ’U Ra N Iu M Laurent Mathias
HAL archives-ouvertes La géologie de l’encaissant métamorphique du granité des Zaër (Maroc) : contribution à la recherche d ’u ra n iu m Laurent Mathias ► To cite this version: Laurent Mathias. La géologie de l’encaissant métamorphique du granité des Zaër (Maroc) : contribution a la recherche d ’uranium. Petrography. Université Scientifique et Médicale de Grenoble, 1984. French. <tel-00703249> HAL Id: tel-00703249 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00703249 Submitted on 1 Jun 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissémination of sci- destinée au depot et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may corne from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. GEOLOGIE GRENOBLE UJF MfvmiA-s (u.) E X - d . +2 Lfc THESE présentée à L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE DE GRENOBLE pour obtenir le titre de DOCTEUR DE 3e CYCLE de Géologie Appliquée \S8& par UNIVERSITE DE GRENOBLE 1 7.6 #• INSTITUT DE GEOLOGIE documentation . BUE MAURICE.G1GNOUX B BB031 GRENOBLE CEDEX ' umflT, s a r<76). BV.Xw . La u r e n t MATHIAS v LA GEOLOGIE DE L’ENCAISSANT METAMORPHIQUE __ _ • • DU GRANITE DES ZAER (MAROC) Contribution à la recherche d’uranium Thèse soutenue le 31 Octobre 1984 devant la Commission d'Examen Président R.MICHEL Professeur USM Grenoble Rapporteurs J .PERRIAUX Professeur USM Grenoble J.L.TANE Maître-assistant USM Grenoble Exami nateur H.DABROWSKI Maître-assistant USM Grenoble THÈSE présentée à L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE DE GRENOBLE pour obtenir le titre de D O C T E U R D E 3 e C Y C L E de Géologie Appliquée par ■ C dd1 S i . -

Pauvrete, Developpement Humain
ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Télécharger Le Document
CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

Amazight Identity in the Post Colonial Moroccan State
Oberlin College Amazight Identity in The Post Colonial Moroccan State: A Case Study in Ethnicity An Honors Thesis submitted to the Department of Anthropology by Morag E. Boyd Oberlin, Ohio April, 1997 Acknowledgments I would like to thank my advisers in Morocco, Abdelhay Moudden and Susan Schaefer Davis for the direction they gave me, but also for the direction that they did not. My honors adviser, Jack Glazier, was vital in the development of this thesis from the product of a short period of research to the form it is in now; I am grateful for his guidance. I would also like to thank the entire Oberlin College Department of Anthropology for guiding and supporting me during my discovery of anthropology. Finally, I must thank my family and friends for their support, especially Josh. Table of Contents Chapter one: Introduction . 1 I: Introduction . 1 II: Fieldwork and Methodology .3 Chapter two: Theoretical Foundations .7 I: Ethnicity ..... 7 II: Political Symbolism .15 Chapter three: History, Organization, and Politics . 19 I: Historical Background .. ........... .. ... 19 II: Ramifications of Segmentary Lineage and Tribal Heritage . 22 Segmentary Lineage and Tribes Tribes, Power, and Politics Political Heritage and Amazight Ethnicity III: Arabization and Colonization . .. .. .. .. .. .. 33 Contemporary ramification IV: Amazight identity and government today .... .. .. 39 Chapter four: Finding Amazight Ethnicity . 44 I: Perceptions of Amazight Identity . 44 Markers of Ethnicity Ethnic Boundaries and Maintenance of ethnic Identity Basic Value Orientation Significance of Amazight Ethnicity Common History as a Source of Group Cohesion Urban and Rural Divide II: Language.... ...... ... .... .. ...... 54 Language and Education Daily Language III: Religion ' .60 IV: Conclusions .63 Chapter Five: Conclusions . -

Pris En Application Du Dahir Portant Loi N° 1-74-338 Du 24 Joumada II 1394 (15 Juillet 1974) Relatif À L’Organisation Judiciaire (B.O
Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire Bulletin Officiel du 17 juillet 1974 Vu le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume ; Après examen par le Conseil des ministres réuni le 11 joumada II 1394 (2 juillet et 1974). Article Premier : L’organisation judiciaire comporte un certain nombre de juridictions dont le siège et le ressort sont fixés conformément au tableau annexé (1). Cours d’appel et tribunaux de première instance Tableau annexé au décret 2-74-498 tel qu’abrog. et rempl. par le n° 2-96-467 20 nov. 1996- 8 rejeb 1417 : BO 2 janv. 1997, p 3 tel que mod. par le décret 2-99-832 du 28 septembre 1999-17 joumada II 1420 ; par le Décret n° 2-00-732 du 2 novembre 2000 – 5 chaabane 1421- B.O du 16 novembre 2000 et par le décret n° 2-02-6 du 17 juillet 2002-6 joumada I 1423 (B.O du 15 août 2002, décret n° 2-03-884 du 4 mai 2004 – 14 rabii I 1425 ; B.O. -

Etude Des Qualités Chimiques Et Géochimiques Du Bassin Versant De Bouregreg Hamid Bounouira
Etude des qualités chimiques et géochimiques du bassin versant de Bouregreg Hamid Bounouira To cite this version: Hamid Bounouira. Etude des qualités chimiques et géochimiques du bassin versant de Boure- greg. Géochimie. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. Français. NNT : PARVI 5168780200702073. tel-00726475 HAL Id: tel-00726475 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00726475 Submitted on 30 Aug 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE IBN TOFAIL – FACULTE DES SCIENCES THESE DE DOCTORAT pour l’obtention du grade de DOCTEUR en Sciences Physiques UFR : Faibles Radioactivités, Physique mathématique et Environnement SPECIALITE : PHYSIQUE NUCLEAIRE ETUDE DES QUALITES CHIMIQUES ET GEOCHIMIQUES DU BASSIN VERSANT DU BOUREGREG Présentée et soutenue publiquement par Hamid BOUNOUIRA le 28 Avril 2007 devant le jury: Mme . R. CHERKAOUI EL MOURSLI Président Professeur à la Faculté des Sciences de Rabat - Maroc Mr. A. GAUDRY Rapporteur Ingénieur de recherche au Laboratoire Pierre Süe CEA de Saclay – France Mr. M. KHALIS Rapporteur Professeur à la Faculté des Sciences de Meknès - Maroc Mr. A. CHOUKRI Directeur de thèse Professeur à la Faculté des Sciences de Kénitra - Maroc Mr. M. TREUIL Examinateur Professeur à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI)- France Mr. -

PCHHAX Prevalence of Smoking Among
Available online a t www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X Der Pharma Chemica, 2016, 8(19):226-232 CODEN (USA): PCHHAX (http://derpharmachemica.com/archive.html) Prevalence of smoking among middle and high school students in Khemisset province, Morocco Lamyaa Ben El Jilali *, Bouchra Benazzouz, Aboubaker El Hessni, Ali Ouichou and Abdelhalem Mesfioui Laboratory of Genetics – Neuroendocrinology and Biotechnology, Department of Biology, University Ibn Tofail, Faculty of Sciences Kenitra, B.P 133, 14000 Kenitra, Morocco _____________________________________________________________________________________________ ABSTRACT The consumption of tobacco is a major public health problem growing rapidly around the world. The main goal of this study is to determine the prevalence of tobacco consumption, evaluate the degree of dependence to nicotine and measure the intentions of quitting smoking in a scholar environment of teenagers. In this work, a transversal investigation was made from Mars to June 2013, among a sample of 1236 middle and high school students by the mean of a survey employing two measures of tobacco dependance (test of Fagerström and test of Hooked On Nicotine Check-list : HONC). The results showed that tobacco consumption in the moment of the study was reported by 18.1% of the surveyed subjects. The test of Fagerström noted that 51.7% of smokers have a strong dependence, the prevalence of the medium and low dependence achieved 20.4% and 25.9% respectively. According to the HONC test, 64.7% of smoking students have lost control over the consumption of tobacco. This study shows the risks of tobacco consumption adopted by high and middle school students and suggests to promote preventive and therapeutic actions. -

World Bank Document
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No. 4065-MOR KINGDOM OF MOROCCO Public Disclosure Authorized STAFF APPRAISAL REPORT OF THE OULMES-ROMMANI AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT Public Disclosure Authorized November 12, 1982 Public Disclosure Authorized Europe, Middle East and North Africa Projects Department This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS Currency Unit = Dirham (DH) US$1.00 = DH 5.30 DH 1.00 = US$o.19 WEIGHTS AND MEASURES 1 hectare (ha) = 2.47 acres 1 kilometer (km) = 0.624 miles 1 kilogram (kg) = 2.205 lbs 1 ton (t) = 2205 lbs m 3 o.b. = cubic meter of wood over bark (with bark) m3 u.b. cubic meter of wood under bark (without bark) m 3 s solid cubic meter of sawn wood ABBREVIATIONS DEFCS Forestry Department (Direction des Eaux et Forets et de la Conservation des Sols) FNF National Forestry Fund (Fonds National Forestier) MARA Ministry of Agriculture (Ministere de l'Agriculture et de la Reforme Agraire MOI Ministry of Interior (Ministere de l'Interieur) GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO Fiscal Year January 1 - December 31 FOR OFFICIAL USE ONLY ABBREVIATIONS CLCA Local Agricultural Credit Bank (Caisse Locale de Credit Agricole) CNCA National Agricultural Credit Bank (Caisse Nationale de Credit Agricole) CNERV National Extension Centre (Centre Nationale d'Etudes et de Recherche sur la Vulgarisation) -

Région De Casablanca-Settat
Tableau de l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes -2019- Région de Casablanca-Settat Secteur Privé Nom Prénom Adresse Professionnelle Ville Téléphone GSM Fax Email Imm Ounasr (Chahrazade) 3éme étage, ACHGAR Lahcen Agadir 0527 21 93 46 0670 80 85 78 0528 33 72 14 Appt 6, bd Mohamed V, Inezgane Imm Azrak appt 25, Ait Melloul, 2éme amriabdelaziz AMRI Abdelaziz Agadir 0528 24 35 66 0661 28 14 11 0528 24 35 66 étage @hotmail.fr boulmers@men 131 Imm Bounnit, Place de Caidat, Ait ara.ma/cabine BOULMERS Mohamed Agadir 0528 24 05 18 0661 37 32 42 0528 24 05 18 Melloul t@cabinet- boulmers.ma Rue Omar El Khayam lot n°59 Imm chouikadalal@ CHOUIKA Dalal Lachguer 1er étage Appt 04 Agadir 0528 23 04 57 0670 14 46 44 0528 23 04 57 yahoo.fr AMSERNAT Imm Tifaouine, Place de la jeunesse, Cessation CHRISTIEN Géorges Alain Agadir 0528 84 00 39 centre urbain d'activité DU Vincent Robert rue Jorf 80000 Agadir 0528 84 00 92 0528 84 00 92 PASQUIER Mohamed agadir261@g EL AMINE 4 rue de Meknès quartier industriel Agadir 0528 82 15 61 0661 14 54 20 0528 82 15 61 Fouad mail.com elbelkasmimoh Bd Moulay Ismail, Dar Iligh, Imm A4, N° EL BELKASMI Mohamed Agadir 0528 84 82 16 0666 76 89 04 0528 82 28 46 [email protected] 307 om khalid.topo@g ESLIHI Khalid N° 128 Bloc4, Quartier Industriel Agadir 0612 12 06 79 0664 49 09 41 0528 23 16 44 mail.com hag- HAGOUNI Larbi N° 19, Imm Ifrane La Pergola Agadir 0528 27 21 95 0663 57 09 95 0528 27 21 95 [email protected] ouaddi.topogr Imm 109 Appt 5, Av Abdellah OUADDI Lahcen Agadir 0528 21 41 57 0662 19 44 43 [email protected] Guennoun, -

Mémoire- Final
Meskini Shahrazade [email protected] [email protected] Master 1 de Science politique parcours Solidarité Internationale, Action Humanitaire et Crises à l’Université Lille II. La place des ONG de développement dans la gouvernance locale dans un Maroc en transition démocratique : l’exemple d’Oulad Khlifa Sud à Rommani. Directeur de mémoire : Mr Amin Allal. !1 Remerciements : Avant toute chose je tiens à remercier Monsieur Allal, pour avoir encadré ce mémoire. En premier lieu, ce mémoire je le dédie à mes parents, et particulièrement à ma mère, Fatna Meskini, cette marocaine, cette « Zaaria » comme elle se présente, celle qui m’a transmis mon patriotisme marocain, et mon père Mbarek Meskini, celui qui a forgé ma double culture franco- marocaine et arabo-berbère. Mon cousin, qui est un frère, Abderazak, sans qui tout cela n’aurait été possible. Merci à toi, de m’avoir accompagné dans mon voyage marocain, merci d’avoir pris le taxi à 7 personnes pour m’aider à concrétiser ce projet. Ma cousine également, ma soeur, Mariam pour avoir erré dans les rues de Rabat et dans les couloirs de la Bibliothèque nationale avec moi. Je tiens à remercier toute ma famille, le clan Meskini/Manssouri, pour leur soutien, et leur aide, à Sabah et Wafa, pour avoir eu la patience de me relire et de me corriger. C’est grâce à vous que j’en suis là aujourd’hui, vous êtes tous, autant que vous êtes - et Dieu seul sait à quel point nous sommes nombreux- des exemples pour moi. J’espère vous rendre fiers à travers ce mémoire.