Vers Un Nouveau Concordat ?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
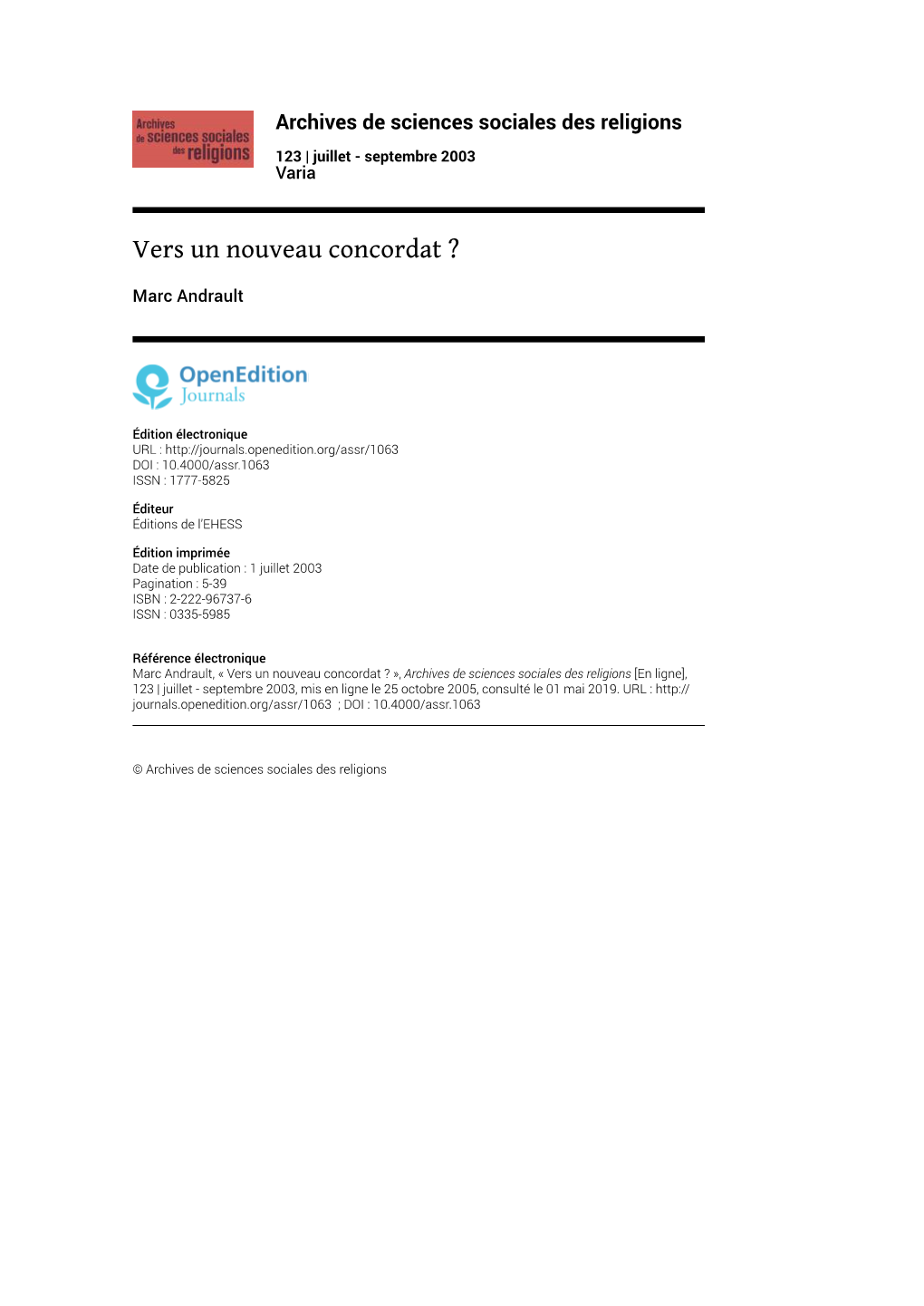
Load more
Recommended publications
-

Vers Un Nouveau Concordat ?
Arch. de Sc. soc. des Rel., 2003, 123 (juillet-septembre) 5-39 Marc ANDRAULT VERS UN NOUVEAU CONCORDAT ? En février 1976, R. Etchegaray, président de la CEF, annulait une rencontre à Matignon avec le premier ministre J. Chirac, celui-ci ayant prévenu la presse (DC, p. 240 (1)) ; en mai, il se plaignait que personne n’ose toucher aux textes incohé- rents et contraires à une « saine démocratie » régissant les libertés cultuelles (Enseignement catholique actualités, mai-juin 1976). Le 12 février 2002, soit un quart de siècle plus tard et deux siècles après le concordat conclu entre Bonaparte et Pie VII, le premier ministre L. Jospin, ayant à son côté le ministre de l’Intérieur D. Vaillant, a reçu solennellement le nonce apostolique F. Baldelli, l’archevêque de Paris J.-M. Lustiger, ainsi que les président et vice-président de la CEF J.-P. Ricard et M. Pontier. Selon Matignon, il s’agissait d’organiser « des rencontres régulières en vue de procéder à l’examen de problèmes d’ordre administratif et juridique qui se posent dans les relations entre l’Église catholique et l’État en France » (LM, 27/02/02) (2). Les deux partenaires ont précisé qu’il n’était pas question de modi- fier la loi de 1905, dite « de séparation des Églises et de l’État », afin de ne pas « rouvrir la boîte de Pandore des luttes anticléricales » (3). Ce préalable, avec le même motif exprimé dans les mêmes termes, a été réitéré en février 2003 par J. Chirac, répondant à un appel d’intellectuels (LM, 5/02/03, 20/02/03), et en avril par J.-M. -

The Latin Vulgate As an “Auxiliary Tool” of Translation
QL 97 (2016) 141-170 doi: 10.2143/QL.97.3.3197403 © 2016, all rights reserved THE LATIN VULGATE AS AN “AUXILIARY TOOL” OF TRANSLATION Historical Perspectives on Liturgiam Authenticam On March 28, 2001, the Congregation for Divine Worship and the Disci- pline of the Sacraments under the leadership of Cardinal Jorge Medina Estévez released the Fifth Instruction for the implementation of Sacrosanc- tum concilium. Entitled Liturgiam authenticam, “On the Use of Vernacular Languages in the Publication of the Books of the Roman Liturgy,” it pre- scribes the use of the Latin Vulgate as an “auxiliary tool” in the textual production of Scriptural translations for the vernacular liturgical books (no. 24). With regard to the vernacular lectionary in particular, it adds that “[i]f the biblical translation from which the Lectionary is composed exhib- its readings that differ from those set forth in the Latin liturgical text, it should be borne in mind that the Nova Vulgata Editio is the point of refer- ence as regards the delineation of the canonical text. Thus, in the transla- tion of the deuterocanonical books and wherever else there may exist var- ying manuscript traditions, the liturgical translation must be prepared in accordance with the same manuscript tradition that the Nova Vulgata has followed” (no. 37).1 This post-conciliar policy of Biblical translation soon became a matter of controversy. In a letter to the US Conference of Catholic Bishops dated August 13, 2001, the Executive Board of the Catholic Biblical Association of America aired its criticism against the curial document: Our main concerns have to do with the presentation of the Nova Vulgata as the model for Scripture translations in various ways and the provisions that translations conform to it, even to the point of requiring conformity to the Nova Vulgata in the tradition of original language manuscripts used for translation. -

Pope Kulto Elevate
X 1? Courier-Journal — Friday, April 4, 1969 Pope KuLto Elevate coming a cardinal on April 28, has customarily are not made until after (Continued from Page 1) ing elected president of the National (ContinuedT from Page 1) the, cosmos, the goodness_ojE God t£ Conference of Catholic Bishops long been recognized as one of the the consistory at which the new cardi ~ oitr fathers, how He liberated us , In his year as Archbishop of New -HNCCB) and the United States Catho most eloquent, versatile and experi nals are elevated. But unofficial priests and people to sing praise to York, Cardinal-designate Cooke, 48, 1 from slavery, of both the flesh and! lic Conference (NSCC), is best enced. Catholic churchmen in the x sounieb_Jia3reJsrw)ken„cif_two possible the Risen One:--~i , the youngest of the 10 U.S. cardi known in Detroit as a bishop deep- United States. appointments; The Secretariat for 'the spirit, bur visions of the future. nals, has already made an impres ly concerned with the prohreniria*"' Promoting Christian Unity, whose Our story mtunts as we begin four and His sombre warning of the price .- sive record in the fields of social the people of his archdiocese, He was singled out for special men first president, Augustine Cardinal lessons and four songs from Sacred\ "of our infidelity to His plan. action and ecumenical activity. tion by Archbishop Luigi Raimondi, Bea, died In November, and the Vati Scripture, telling of the origins~7sr Then we call out IhlT names of He is a tall, (6 foot 1) personable Apostolic Delegate to the U.S., in a can Secretariat of State, whose head, those present who-have-gomr before - The successor to the Me„ J&anck . -

Fathers, Pastors and Kings Prelims 24/3/04 1:32 Pm Page Ii
Prelims 24/3/04 1:32 pm Page i ACKNOWLEDGEMENTS i Fathers, pastors and kings Prelims 24/3/04 1:32 pm Page ii STUDIES IN EARLY MODERN EUROPEAN HISTORY This series aims to publish challenging and innovative research in all areas of early modern continental history. The editors are committed to encouraging work that engages with current historiographical debates, adopts an interdisciplinary approach, or makes an original contribution to our understanding of the period. SERIES EDITORS Joseph Bergin, William G. Naphy, Penny Roberts and Paolo Rossi Already published in the series The rise of Richelieu Joseph Bergin Sodomy in early modern Europe ed. Tom Betteridge The Malleus Maleficarum and the construction of witchcraft Hans Peter Broedel Fear in early modern society eds William Naphy and Penny Roberts Religion and superstitition in Reformation Europe eds Helen Parish and William G. Naphy Religious choice in the Dutch Republic: the reformation of Arnoldus Buchelus (1565–1641) Judith Pollman Witchcraft narratives in Germany: Rothenburg, 1561–1652 Alison Rowlands Prelims 24/3/04 1:32 pm Page iii ACKNOWLEDGEMENTS iii Fathers, pastors and kings Visions of episcopacy in seventeenth-century France ALISON FORRESTAL Manchester University Press Manchester and New York distributed exclusively in the USA by Palgrave Prelims 24/3/04 1:32 pm Page iv Copyright © Alison Forrestal 2004 The right of Alison Forrestal to be identified as the author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. Published by -

Le Saint-Siège
Le Saint-Siège DISCOURS DE JEAN-PAUL II AUX PÈLERINS FRANÇAIS Salle Paul VI Lundi, 5 octobre 1987 Je m'adresse maintenant aux heureux pèlerins de la Béatification de Marcel Callo. Je tiens d’abord à évoquer avec gratitude l’œuvre du cardinal Paul Gouyon, qui a résolument fait avancer la Cause du jociste rennais, avec le concours efficace du Postulateur, le Père Marcel Martin. Je salue fraternellement le successeur du cardinal, Mgr Jacques Jullien. L’événement d’hier demeurera une grâce pour son ministère épiscopal. Mes salutations vont encore aux Evêques, aux prêtres, aux religieux, aux délégués de la JOC et du Scoutisme, à tous les pèlerins de Bretagne, de France, d’Allemagne et d’Autriche, tous très attachés à la glorification du martyr de la foi de Mauthausen. Avec émotion, je me tourne vers la famille du Bienheureux. Comme je suis heureux de bénir la mémoire de ses parents, Jean-Marie Callo et Félicité Fanène, qui accueillirent neuf enfants à leur foyer profondément chrétien! Quel hymne à la vie dans cette famille marquée et sanctifiée par la croix! La perte de leur quatrième enfant, âgée de quelques mois; la mort tragique de Marie Madeleine: dans sa vingtième année sous les bombardements du 8 mars 1943; quelques jours plus tard, le départ de Marcel pour le Service du Travail Obligatoire en Allemagne. Frères et sœurs, neveux et autres parents du Bienheureux, que votre vie demeure à jamais irradiée et comme soulevée par la journée du 4 octobre 1987! J’adresse un salut particulier à l’aîné de la famille Callo, Jean, dont le ministère sacerdotal a tant bénéficié de l’invisible soutien de son frère cadet. -

Via Di Santa Chiara, 42»
Mémoire Spiritaine e Volume 20 Heurs et malheurs missionnaires début XX Article 10 s. 2004 «Via di Santa Chiara, 42». Les 150 ans du Séminaire français de Rome (1853-2003) Philippe Levillain Philippe Boutry Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/memoire-spiritaine Part of the Catholic Studies Commons Recommended Citation Levillain, P., & Boutry, P. (2004). «Via di Santa Chiara, 42». Les 150 ans du Séminaire français de Rome (1853-2003). Mémoire Spiritaine, 20 (20). Retrieved from https://dsc.duq.edu/memoire-spiritaine/vol20/iss20/10 This Chroniques et commentaires is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Mémoire Spiritaine by an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection. HEURS ET MALHEURS MISSIONNAIRES Mémoire Spiritaine, n° 20, deuxième semestre 2004, p. 117 à p. 147. Uhuître et les deux plaideurs Le conflit de deux évêques et la naissance du diocèse d'Ambanja à Madagascar (1903-1949) Bruno Hiibsch * Adin 'akoho : ny resy torotoro, ny mahery disadisaka : Combat de coqs : le vaincu est brisé, le vainqueur est broyé Au nord ouest de Madagascar, l'île de Nosy Be, avec ses plages, ses cocotiers, sa mer transparente est devenue lieu touristique apprécié et vanté. Les revues de voyage, en quête de reportages, lui consacrent de temps à autre quelques pages pour en dire les charmes, en évoquer les habitants et en conter l'histoire. Au sein de celle-ci, se dresse le personnage d'un prêtre spiritain. Clément Raimbault, qui, par ses recherches et ses cultures, a fait de cette terre l'Ile aux parfums dont les senteurs d'ylang-ylang ou de palma rosa enchantent les voyageurs. -

Downloaded from Manchesterhive.Com at 09/28/2021 09:47:34PM Via Free Access Chap 4 22/3/04 12:53 Pm Page 110
chap 4 22/3/04 12:53 pm Page 109 4 Ecclesiastical monarchy or monarchies? Why did the French episcopate prove so tenacious in opposing the regulars’ calls for independence through the seventeenth century? Like the bishops’ quarrels with the curés, these were crises of authority in which the episcopate fought to assert its disciplinary supremacy over the religious orders. Yet the struggle between the bishops and the regulars was just one manifestation of a much larger complexity: the place of the episcopate in the church’s governing hierar- chy. Not only did the bishops have to define their relationship with the lower clergy; they also had to characterise and then defend their understanding of the links between episcopacy and the supreme headship of the earthly church. As two of the major offices of the church, the episcopate and the pope had to inter- act routinely if the church was to function smoothly. But this intercourse car- ried the risks of rivalry and disagreement, and more often than not that was precisely how it evolved over the course of the century. Whenever the pope strayed into the French church, he tended to raise the hackles of its ‘perfidious’ and ‘turbulent’ bishops, and to leave his supporters feeling that the authority of ‘His Sanctity [is] ruined in this realm’.1 Contested boundaries offered fertile ground for the growth of suspicion, resentment and outright controversy. To a large extent, the disputes among the bishops, the papacy and the lower clergy represented three competing conceptions of the church, and crys- tallised opposing views of ecclesiastical government, discipline and hierarchy at local, national and international levels. -

L'épiscopat Français Depuis 1919
CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES DE L’ÉGLISE DE FRANCE 20/06/2016 Rédacteur(s) : Cécile Delaunay L’ÉPISCOPAT FRANÇAIS DEPUIS 1919 DIOCÈSE ÉVÊQUES ET DATES D’EXERCICE AGEN Charles-Paul SAGOT DU VAUROUX, 1906-1937 Jean-Marcel RODIÉ, 1938-1956 Roger JOHAN, 1956-1976 Sabin SAINT-GAUDENS, 1976-1996 Jean-Charles DESCUBES, 1997-2004 Hubert HERBRETEAU, 2005- AIRE & DAX Marie-Charles DE CORMONT, 1911-1930 Clément-Joseph MATHIEU, 1931-1963 Robert BÉZAC DES MARTINIES, 1963-1978 Robert SARRABÈRE, 1978-2002 Philippe BRETON, 2002-2012 Hervé GASCHIGNARD, 2012- AIX-EN-PROVENCE François-Joseph BONNEFOY, 1901-1920 Maurice RIVIÈRE, 1920-1930 Emmanuel COSTE, 1931-1934 Clément-Émile ROQUES, 1934-1940 Florent DU BOIS DE LA VILLERABEL, 1940-1944 Charles DE PROVENCHÈRES, 1945-1978 Bernard PANAFIEU, 1978-1994 Louis-Marie BILLÉ, 1995-1998 Claude FEIDT, 1999-2010 Christophe DUFOUR, 2010- AJACCIO Augustin SIMÉONE, 1916-1926 Jean Marie Marcel RODIÉ, 1927-1938 Jean-Baptiste LLOSA, 1938-1966 André COLLINI, 1966-1972 Jean-Charles THOMAS, 1974-1986 Sauveur CASANOVA, 1987-1995 André LACRAMPE, 1995-2003 Jean-Luc BRUNIN, 2004-2011 Olivier DE GERMAY, 2012- Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF) 35, rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Tél. : 01-55-95-96-80. Courriel : [email protected]. Page internet : cnaef.catholique.fr 1 DIOCÈSE ÉVÊQUES ET DATES D’EXERCICE ALBI Pierre-Célestin CÉZERAC, 1918-1940 Jean-Joseph MOUSSARON, 1940-1956 Jean-Emmanuel MARQUÈS, 1957-1961 Claude DUPUY, 1961-1974 Robert COFFY, 1974-1985 Joseph RABINE, 1986-1988 Roger MEINDRE, -

L'osservatore Romano
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004 Copia €1,00 Copia arretrata €2,00 L’OSSERVATORE ROMANO GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO Unicuique suum Non praevalebunt Anno CLIX n. 201 (48.229) Città del Vaticano venerdì 6 settembre 2019 . In Mozambico il Pontefice ribadisce il rifiuto della violenza che distrugge ed esprime vicinanza alle popolazioni colpite dai cicloni Testimoni di unità e di riconciliazione La preghiera per i cardinali Etchegaray e Pimiento Rodríguez «Testimoni di unità, di riconciliazio- fice nella capitale del Paese africano, ne, di speranza». Nello stadio Ma- dove l’aereo papale era giunto nella La pace di ieri xaquene di Maputo le parole di Pa- serata di mercoledì 4 settembre, do- pa Francesco infiammano le migliaia po un volo di oltre dieci ore. e la gioia di oggi: di giovani presenti e risuonano come Prima di recarsi nello stadio Ma- una consegna alta e impegnativa per xaquene, Francesco, appresa con do- speranze per il domani tutti i mozambicani. Il futuro del lore la notizia della morte del cardi- Paese è racchiuso nei «sogni» dei ra- nale Roger Etchegaray, lo ha ricor- gazzi e delle ragazze — di varie fedi dato come «uomo di dialogo e di a pace e la gioia. Questi i due temi principali e confessioni religiose — che circon- pace» nel corso della messa celebra- dei due discorsi del Santo Padre nella prima dano il Pontefice con il loro abbrac- ta nella nunziatura apostolica. E con giornata del lungo viaggio in Africa orientale L cio, riaffermando la volontà di co- lui ha fatto memoria anche del car- tra Mozambico, Madagascar e isole Mauritius. -

2 SESSIONE.Indd
Domenica 6 Ottobre 1963 Giornata splendida; celebro alle 9, dopo aver portato la S. Comunione a Villa Carpegna; è presente suor Beni- gna che saluto in partenza per Vico Equense; viene don Brescia [Parroco a Monopoli] e scendiamo in Piazza per l’Angelus; mai visto tanta gente. Nel pomeriggio ho letto qualche cosa sull’episcopato, ho scritto qualche lettera; ho fi nito di rivedere l’articolo per la Rivista Diocesana; mi sono intrattenuto a lungo con don Brescia su argomenti di interesse diocesano: ri- porta l’eco di urti e infantilismi dei parroci di Monopoli, incapacità di stabilire seri rapporti coi vice parroci, invi- diosi per i benefi ci assistenziali degli insegnanti di reli- gione, insoddisfazione per il modo con cui le ore sono di- stribuite; è penoso costatare cotesto soffuso malconten- to, causato da motivi ingiustifi cati o futili o addirittura contraddittori. 42.ª Congregazione generale – Collegiali- Lunedì 7 Ottobre 1963 tà episcopale e rapporto con il primato pon- tifi cio. Splende il sole. Nuovo posto a sinistra al n. 578. Messa del Rosario celebrata dal vescovo di Lourdes 7 ottobre - Lunedì [Mons. Théas]. R. L. Valle, Primato e collegialità. È noto come lo schema De Ecclesia accentui il va- Il segretario comunica che la Congregazione è mode- lore del collegio dei Vescovi, uniti al Papa, come rata dal Card. [Giacomo] Lercaro [Bologna]; lamenta che diretta successione del collegio degli Apostoli, alcuni entrino senza permesso; necessità di sopportare il uniti a Pietro. [...] la discussione è particolarmen- controllo; annuncia i discettanti95. te accesa su questo punto. Quale la ragione delle opinioni divergenti, quale il -[Card. -

Joseph Cardijn and the Jocist Network at Vatican II by Stefan Robert Gigacz, LL.B., LL.M
The Leaven in the Council: Joseph Cardijn and the Jocist Network at Vatican II By Stefan Robert Gigacz, LL.B., LL.M. (Legal Theory), DEA Canon Law. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Divinity 2018 Abstract This thesis investigates the role and impact of Joseph Cardijn, founder of the Jeunesse Ouvrière Chrétienne (Young Christian Workers) movement, and the jocist network of bishops and periti at the Second Vatican Council. It adopts a longue durée approach, locating Cardijn within a tradition of Catholic social thought and action that developed in the wake of Europe’s nineteenth century industrial and democratic revolutions. It highlights the influence of the Lamennais School, and Marc Sangnier’s Sillon movement as sources for his work. Secondly, it traces the influence of Cardijn, his theology and methods over the half century prior to the Council, particularly the well-known see-judge-act method, which formed part of his “Three Truths” Christian dialectic. It also documents the emergence of a global network of JOC and/or Specialised Catholic Action chaplains experienced in these methods, many of whom would become key conciliar actors. Thirdly, it examines the role at Vatican II played by Cardijn, the jocist-formed bishops and periti, as well as several lay leaders from the movement, who became lay auditors. It particularly examines Cardijn’s role in the Preparatory Commission on Lay Apostolate and its successor the conciliar Lay Apostolate Commission in the drafting of the Decree on Lay Apostolate, Apostolicam Actuositatem, and the Doctrinal Constitution Lumen Gentium, as well as the impact of his book, Laïcs en premières lignes, published in English as Laymen into Action. -

Fathers, Pastors and Kings: Visions of Episcopacy in Seventeenth-Century
Alison Forrestal - 9781526120625 Downloaded from manchesterhive.com at 09/26/2021 05:45:20AM via free access Prelims 24/3/04 1:32 pm Page i ACKNOWLEDGEMENTS i Fathers, pastors and kings Alison Forrestal - 9781526120625 Downloaded from manchesterhive.com at 09/26/2021 05:45:20AM via free access Prelims 24/3/04 1:32 pm Page ii STUDIES IN EARLY MODERN EUROPEAN HISTORY This series aims to publish challenging and innovative research in all areas of early modern continental history. The editors are committed to encouraging work that engages with current historiographical debates, adopts an interdisciplinary approach, or makes an original contribution to our understanding of the period. SERIES EDITORS Joseph Bergin, William G. Naphy, Penny Roberts and Paolo Rossi Already published in the series The rise of Richelieu Joseph Bergin Sodomy in early modern Europe ed. Tom Betteridge The Malleus Maleficarum and the construction of witchcraft Hans Peter Broedel Fear in early modern society eds William Naphy and Penny Roberts Religion and superstitition in Reformation Europe eds Helen Parish and William G. Naphy Religious choice in the Dutch Republic: the reformation of Arnoldus Buchelus (1565–1641) Judith Pollman Witchcraft narratives in Germany: Rothenburg, 1561–1652 Alison Rowlands Alison Forrestal - 9781526120625 Downloaded from manchesterhive.com at 09/26/2021 05:45:20AM via free access Prelims 24/3/04 1:32 pm Page iii ACKNOWLEDGEMENTS iii Fathers, pastors and kings Visions of episcopacy in seventeenth-century France ALISON FORRESTAL Manchester University Press Manchester and New York distributed exclusively in the USA by Palgrave Alison Forrestal - 9781526120625 Downloaded from manchesterhive.com at 09/26/2021 05:45:20AM via free access Prelims 24/3/04 1:32 pm Page iv Copyright © Alison Forrestal 2004 The right of Alison Forrestal to be identified as the author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.