III Le FN À Toulon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
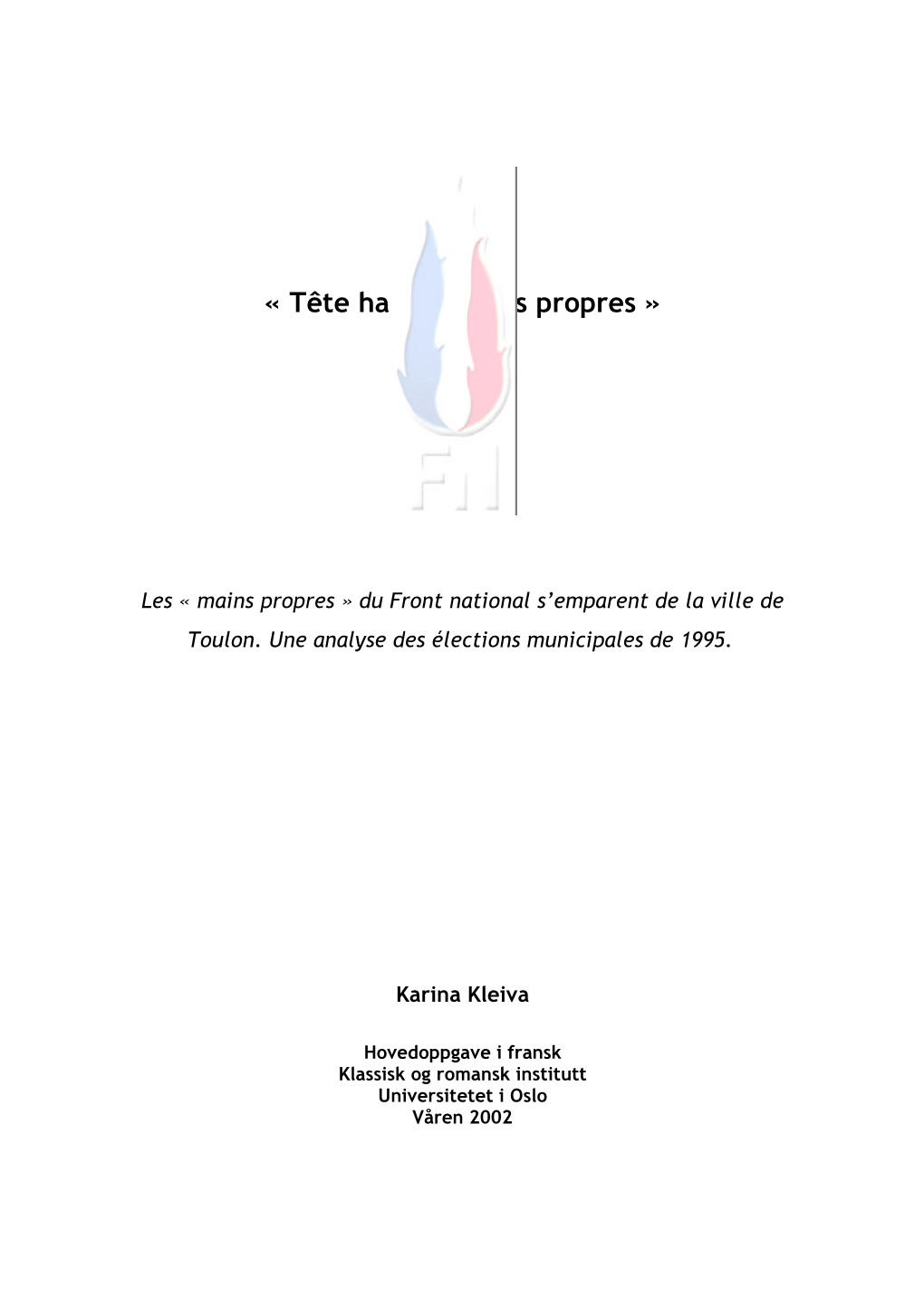
Load more
Recommended publications
-

RAPPORT D'activité 2009 D'activité IGA - RAPPORT a Rapport D’Activité IG A
IG IGA - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2009 IGA - RAPPORT A Rapport d’activité IG A Inspection Générale de l'Administration 15, rue Cambacérès 75008 PARIS Tel: 01.49.27.31.18 Site intranet http://iga.cab.mi/ 2009 Site internet: www.interieur.gouv.fr EDITORIAL En 2009, les activités de l’IGA ont été marquées par plusieurs innovations : > la mise en œuvre de la réforme de son statut, qui améliore l’ou- verture de son mode de recrutement grâce à une part plus impor- tante donnée au tour extérieur d’inspecteur général et par la créa- R [ généraux de la gendarmerie nationale (c’était déjà le cas pour des directeurs de la police nationale), symbolisant ainsi l’intégration de la gendarmerie nationale dans le périmètre ministériel ; > la lettre de mission adressée le 27 juillet 2009 par le ministre me demandant parmi d’autres priorités de préparer un programme annuel d’activité et de renforcer la coopération avec les autres ins- pections du ministère (inspection générale de la police nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale et inspection de la défense et de la sécurité civile) ; > l’adoption d’un programme d’activité élaboré de façon concer- tée au sein de l’IGA mais également avec l’ensemble des services du ministère. Approuvé par le ministre le 21 décembre 2009, ce pro- gramme comporte vingt propositions de missions répondant à six thématiques : #R # # # R collectivités territoriales, #R # > la poursuite de la démarche d’amélioration de nos méthodes de travail à partir d’une comparaison avec celles des inspections partenaires. L’IGA a atteint son double objectif d’être à la fois positionnée sur les questions les plus importantes pour le ministère et plus largement pour le gouvernement, puisque plus de la moitié de ses missions ont été interministérielles, et d’être réactive grâce notamment à une forte augmentation de son activité. -

Du Front National : Quel Devenir Après Le Départ De Jean-Marie Le Pen ?
La " vision du monde" du Front national : Quel devenir après le départ de Jean-Marie Le Pen ? Magali Balent Note de recherche n°XXV - janvier 2011 1 La « vision du monde » du Front national : Quel devenir après le départ de Jean-Marie Le Pen ? « On ne peut se passer, en politique étrangère, d’un cadre structurel de pensée. […] Il faut, pour réussir, posséder le sens de l’Histoire, la compréhension des forces multiples qui nous dépassent, et une vision très large de l’enchaînement des événements ». Henry Kissinger, A la Maison Blanche 1968-1973, 1979. Depuis que Jean-Marie Le Pen, Président fondateur du Front national, a annoncé qu’il ne se représenterait pas à la présidence du parti, la bataille fait rage entre Marine Le Pen et Bruno Gollnisch, tous deux candidats à sa succession qui aura lieu lors du prochain congrès du FN à Tours les 15 et 16 janvier 2011. Ces derniers mois, les querelles de personnes opposant les deux candidats ont davantage occupé le devant de la scène, chacun revendiquant sa plus grande légitimité à succéder au vieux chef, que le débat d’idées départageant les deux prétendants. Aussi la question du devenir des idées sur lesquelles repose la doctrine du Front national depuis près de 40 ans, a peu été évoquée. Cette situation concerne tout particulièrement la doctrine du parti en matière de relations internationales, domaine méconnu du fait que le FN a construit sa légitimité électorale sur des thèmes de politique intérieure, et que les électeurs du parti accordent généralement peu d’intérêt aux thèmes internationaux. -

CHAPITRE 4 / LE FRONT NATIONAL ET LA NOUVELLE DROITE Jean-Yves Camus
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes Paris 5 193.51.85.60 03/06/2016 19h10. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) CHAPITRE 4 / LE FRONT NATIONAL ET LA NOUVELLE DROITE Jean-Yves Camus in Sylvain Crépon et al., Les faux-semblants du Front national Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) | « Académique » 2015 | pages 97 à 120 ISBN 9782724618105 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.cairn.info/les-faux-semblants-du-front-national--9782724618105-page-97.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jean-Yves Camus, « Chapitre 4 / Le Front National et la nouvelle droite », in Sylvain Crépon et al., Les faux-semblants du Front national, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », 2015 (), p. 97-120. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.). © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.). Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes Paris 5 193.51.85.60 03/06/2016 19h10. -

Comprendre L'extrême Droite
L’Extrême droite en France et en Belgique « Ouvrage publié avec le soutien De l’Institut de sociologie Et du Laboratoire d’étude des partis politiques en Europe De l’Université libre de Bruxelles (ULB) » © Editions Complexe, 1998 ISBN : 2-87027-734-2 D/1638/1998/26 Sous la direction de Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele et Andrea Rea L’Extrême droite en France et en Belgique Textes de Mateo Alaluf, Andrée-France Baduel, Jacques Billiet, Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, Stefan Fiers, Serge Govaert, Bart Maddens, Pierre Martin Pascal Perrineau, Andrea Rea, Jean-Philippe Roy, Marc Swyngedouw, Jean Viard, Bruno Villalba Interventions Editions Complexe SOMMAIRE Pascal DELWIT , Jean-Michel DE WAELE et Andrea REA Comprendre l’extrême droite…………………………………. 13 Pascal PERRINEAU Les étapes de l’implantation du Front national…………….. 29 Pascal DELWIT , Jean-Michel DE WAELE et Andrea R EA Les étapes de l’extrême droite en Belgique ……………….. 57 Jean-Philippe ROY Le programme économique et social du Front national en France ………………………………. 85 Mateo ALALUF L’émergence du Front national en Belgique est plus redevable aux circonstances qu’à son programme…. 101 Serge GOVAERT Le programme économique du Vlaams Blok ……………….. 119 Pierre MARTIN Qui vote pour le Front national français ?.......................... 133 PASCAL DELWIT Qui vote pour le Front national en Belgique ?...................... 167 7 Jacques B ILLIET Qui vote pour le Vlaams Blok ?........................................ 181 Bruno VILLALBA L’esquive. La gauche et la droite face au Front national .. 203 Pascal DELWIT et Jean-Michel DE WAELE Les partis politiques et la montée de l’extrême droite en Communauté française de Belgique………………………. -

Overview of Extreme Right Parties in France Gilles Ivaldi
Overview of Extreme Right parties in France Gilles Ivaldi To cite this version: Gilles Ivaldi. Overview of Extreme Right parties in France. 2002. halshs-00090338 HAL Id: halshs-00090338 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00090338 Submitted on 30 Aug 2006 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Overview of Extreme Right Parties in France Gilles Ivaldi Extreme Right Parties in France An overview Updated 8 July 2002 Background The Front national (FN) was founded in 1972 but remained electorally irrelevant until the mid 80s. The impact of the party on French politics was negligible until its first success in the 1983 municipal by-election in the city of Dreux where the extreme-right list led by Jean- Pierre Stirbois gained 16.7 per cent of the vote. This performance at the local level was followed by the impressive national breakthrough of the far right in the subsequent 1984 European election, with Le Pen’s party polling over 11 per cent of the votes cast. The National Front in Elections (1983-2002). Year Election % Note 1983 Municipal by-election 16.7 Jean-Pierre Stirbois, Dreux. -

The Long and Winding Road of the Front National
The Long and Winding Road of the Front National Ismail FERHAT The Front National has been an established player in French political life for thirty years now. Nevertheless, behind the figure of its historical leader, Jean-Marie Le Pen, the development of the party itself has had its fair share of vicissitudes. Reviewed: Valérie Igounet, Le Front national de 1972 à nos jours. Le parti, les hommes, les idées, Paris, Seuil, 2014. 496 p., €24. Since the 1980s, the Front National, or FN for short, has been a continuous presence in the French political arena. How can we explain that a party that claims to reject the game of politics as a whole has survived for thirty years, and at such a high level in terms of votes? How can this stability square with the upheavals that have affected French society over the same period? These thorny issues are tackled by Valérie Igounet in her capacity as historian, in light of the undeniable fact that the FN can no longer be considered to be merely a temporary eruption in French political life. The author of this book is a specialist of Holocaust denial1. She offers us a study that is based both on in-depth interviews with (current or former) members of the FN, the party’s publications or those of “friendly” organisations, and often previously unseen archive material. The book has a chronological structure, while highlighting key dates for the movement (1972, 1983, 1999, 2010) and providing in-depth portraits of its cadres. The History of a Rise While the FN may seem inseparable from Jean-Marie Le Pen, or even from the Le Pen family, this movement was not actually instigated by him originally. -

Histoire De L'extrême Droite En France Centre Social De Montbrison, Village De Forez
Histoire de l'extrême droite en France Centre social de Montbrison, Village de Forez Histoire de l’extrême droite en France Centre social de Montbrison Collection Espace citoyen et Village de Forez 2002 Histoire de l’extrême droite en France Centre social de Montbrison, Village de Forez L’Histoire de l’extrême droite en France reprend le texte d’une conférence faite par Claude Latta au Centre social de Montbrison le 10 mars 1998 dans le cadre de la semaine nationale d’éducation contre le racisme. Ce texte a été mis à jour et complété à l'occasion de la reprise de cette conférence organisée par le Centre social de Montbrison et faite le 1 er mai 2002 à la salle des fêtes de la mairie de Montbrison entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002. Le tirage a été réalisé par le CDDP Centre Départemental de Documentation Pédagogique à Saint-Etienne (Loire). Village de Forez Centre social de Montbrison Place Pasteur, 42600 Montbrison supplément au n° 89-90 de Village de Forez Directeur de la publication : Claude Latta Dépôt légal : mai 2002 2 Histoire de l’extrême droite en France Centre social de Montbrison, Village de Forez Le Front national n'est pas apparu brusquement en 1984. En fait, l'extrême droite est, sous des noms différents, l'une des composantes de notre paysage politique depuis deux siècles. Son corps de doctrine s'est formé par accumulation de strates successives, au fur et à mesure des crises que la France a connues. L'extrême droite a ainsi donné naissance à des fidélités qui nous étonnent : fidélité au roi Louis XVI et à la Vendée, fidélité à Maurras et à l'Action française, fidélité à Vichy, fidélité aux « martyrs » de l'Algérie française. -

LES GOUVERNEMENTS ET LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE
LES GOUVERNEMENTS ET LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE - 2 - AVERTISSEMENT La liste des ministères établie par la présente brochure fait suite à celles figurant : 1° dans le tome I du Dictionnaire des parlementaires français de 1871 à 1940 ; 2° dans la publication séparée, intitulée « Ministères de la France de 1944 à 1958 ». Elle couvre la période du 8 janvier 1959 au 31 juillet 2004. Outre la liste nominative des membres des Gouvernements, on trouvera les renseignements relatifs : - à l’élection des Présidents de la République ; - aux dates des élections aux Assemblées parlementaires et à la composition politique de celles-ci, ainsi qu’aux dates des sessions du Parlement ; - aux lois d’habilitation législative prises en application de l’article 38 de la Constitution ; - à la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale ; - aux réunions du Congrès ; Dans les notes en bas de page de la liste nominative des membres des Gouvernements, les formules utilisées correspondent aux cas suivants : * Devient : changement des fonctions gouvernementales * Nommé : légère modification des fonctions gouvernementales et changement de titre * Prend le titre de : changement de titre sans changement des fonctions gouvernementales. Le texte de la présente brochure a été établi par le Secrétariat général de la Présidence et le service de la Communication. - 3 - CONNAISSANCE DE L’ASSEMBLÉE 2 LES GOUVERNEMENTS ET LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE 1958-2004 (Données au 31 juillet) ASSEMBLÉE NATIONALE - 4 - TOUS DROITS RÉSERVÉS. La présente publication ne peut être fixée, par numérisation, mise en mémoire optique ou photocopie, ni reproduite ou transmise, par moyen électronique ou mécanique ou autres, sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale. -

Justice : Le Président Devient Intouchable
LeMonde Job: WMQ2601--0001-0 WAS LMQ2601-1 Op.: XX Rev.: 25-01-99 T.: 11:05 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 59Fap:100 No:0323 Lcp: 700 CMYK LE MONDE ÉCONOMIE a Les risques de déflation a Emploi : 12 pages d’annonces classées 55e ANNÉE – No 16796 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE MARDI 26 JANVIER 1999 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI a Procès Clinton Justice : le président devient intouchable La menace Les sénateurs américains doivent déci- der, lundi, de la poursuite de la procé- dure d’impeachment et de la convoca- b de dévaluation tion éventuelle de témoins. p. 4 Selon le Conseil constitutionnel, le chef de l’Etat bénéficie d’une immunité pénale pendant la durée de son mandat b Il tranche ainsi le débat sur l’éventuelle mise en cause de Jacques Chirac du yuan chinois a CIO : sauver la face dans les affaires de la Mairie de Paris b Cette décision a été obtenue par surprise, sans discussions Le Comité olympique a exclu six de ses fait chuter PRÉSIDÉ par Roland Dumas, le dire toute mise en examen et, membres pour corruption. Trois autres Conseil constitutionnel a mis à profit même, toute audition de l’ancien sont sous le coup d’un supplément la décision qui lui était demandée maire de la capitale par un juge les marchés d’Asie d’enquête, un a reçu un blâme. par le président de la République et d’instruction. p. 25 et notre éditorial p. 18 le premier ministre, sur la compatibi- La décision du Conseil – obtenue LA PRESSE économique offi- lité de la Constitution française subrepticement, sans débat – inter- cielle chinoise a évoqué pour la avec le traité de Rome créant vient après qu’à plusieurs reprises première fois, dimanche 24 janvier, a Contrer TF 1 la Cour pénale internationale M. -

On the French Right — New and Old: an Interview with Alain De Benoist1
On the French Right — New and Old: An Interview with Alain de Benoist1 Frank Adler Adler: We should begin discussing the present state of the Right in France, because the initial project of the New Right was to renew this community, to counter the hegemony of the Left. Talking about that hegemony is difficult since the Left is in a deep crisis. What we find in France now is a united Center-Right party in power; a Left leaderless, divided, and not knowing where to turn; and a Right with no clear ideas, principles, or strategies. Mégret was a fiasco. Le Pen remains in a permanent ghetto. What do you make of the present situation? Benoist: I think the situation has completely changed in the space of thirty years. When, in May 1968, the New Right emerged, that is, what later came to be called the New Right, things were relatively simple: no one claimed openly to be part of the Right, indeed, the term was hardly used anymore. There was a Left hegemony, quite evident within university circles and, generally speaking, among intellectuals. The objective was to reconstitute ideas and concepts, developed through an encyclopedic process, to create a structured discourse in every domain of thought and knowledge. I can’t say that this oobjective has yet been achieved. Thirty years later, this work continues. It has given life to a great number of arti- cles, reviews, books, symposia, meetings and conferences. Obviously, it was not a fly-by-night phenomenon. It lasted a long while — a rare occurrence in France. -

III: France: the Front National
France: The Front National 41 III: France: The Front National Nonna Mayer, Mariette Sineau Chapitre à paraître en 2002 dans le livre dirigé par Helga Amsberger, Brigitte Halbmayr eds. Rechtsextreme Parteien Leverkusen Leske & Budrich Avec l'autorisation de l'éditeur. 1. Introduction.................................................................................................................................. 42 2. Presentation of the French Front National .............................................................................. 43 2.1. History.................................................................................................................................. 43 2.2. Ideas..................................................................................................................................... 45 2.3. Voters and supporters........................................................................................................... 46 2.4. Party structure and networks................................................................................................ 47 2.5. Political opportunities .......................................................................................................... 48 3. Women voters and women candidates......................................................................................... 49 3.1. Women voters ...................................................................................................................... 49 3.2. Women candidates and elected officials ............................................................................. -

Ana- Lyse Des Premières Percées Électorales Du Front National, Des Élections Municipales À Dreux En
Du groupuscule au grand parti politique : ana- lyse des premières percées électorales du Front national, des élections municipales à Dreux en 1983 aux élections européennes en 1984 Aline JOUBERT Histoire de la France au XXe siècle Sous la direction de : Gilles RICHARD 2013-2014 Remerciements Je tiens à remercier chaleureusement mon directeur de mémoire, Gilles Ri- chard, pour son soutien et son aide précieuse tout au long de mes recherches. Je remercie également le personnel des Champs Libres, pour m’avoir épaulé pendant les après-midi passés au sixième étage. Liste des sigles et des abréviations CDS : Centre des démocrates sociaux CLAN : Comité de liaison et d’aide aux nationalistes CNIP : Centre national des indépendants et paysans FN : Front national FNEF : Fédération nationale des étudiants de France GUD : Groupe d’union défense LO : Lutte ouvrière MSI : Movimiento sociale italiano ON : Ordre Nouveau PCF : Parti communiste français PFN : Parti des forces nouvelles PS : Parti socialiste RPR : Rassemblement pour la République SERP : Société d’édition et de relations publiques UDF : Union pour la démocratie française UNEF : Union nationale des étudiants de France Sommaire INTRODUCTION ................................................................................................................................ 5 CHAPITRE 1 - « TONNERRE DE DREUX » OU LE CHOC ELECTORAL DE 1983 ....................... 9 CHAPITRE 2 - JUIN 1984 DE L’OMBRE A LA LUMIERE ............................................................. 43 CHAPITRE 3 - LENDEMAINS