Recherches Régionales N°179
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
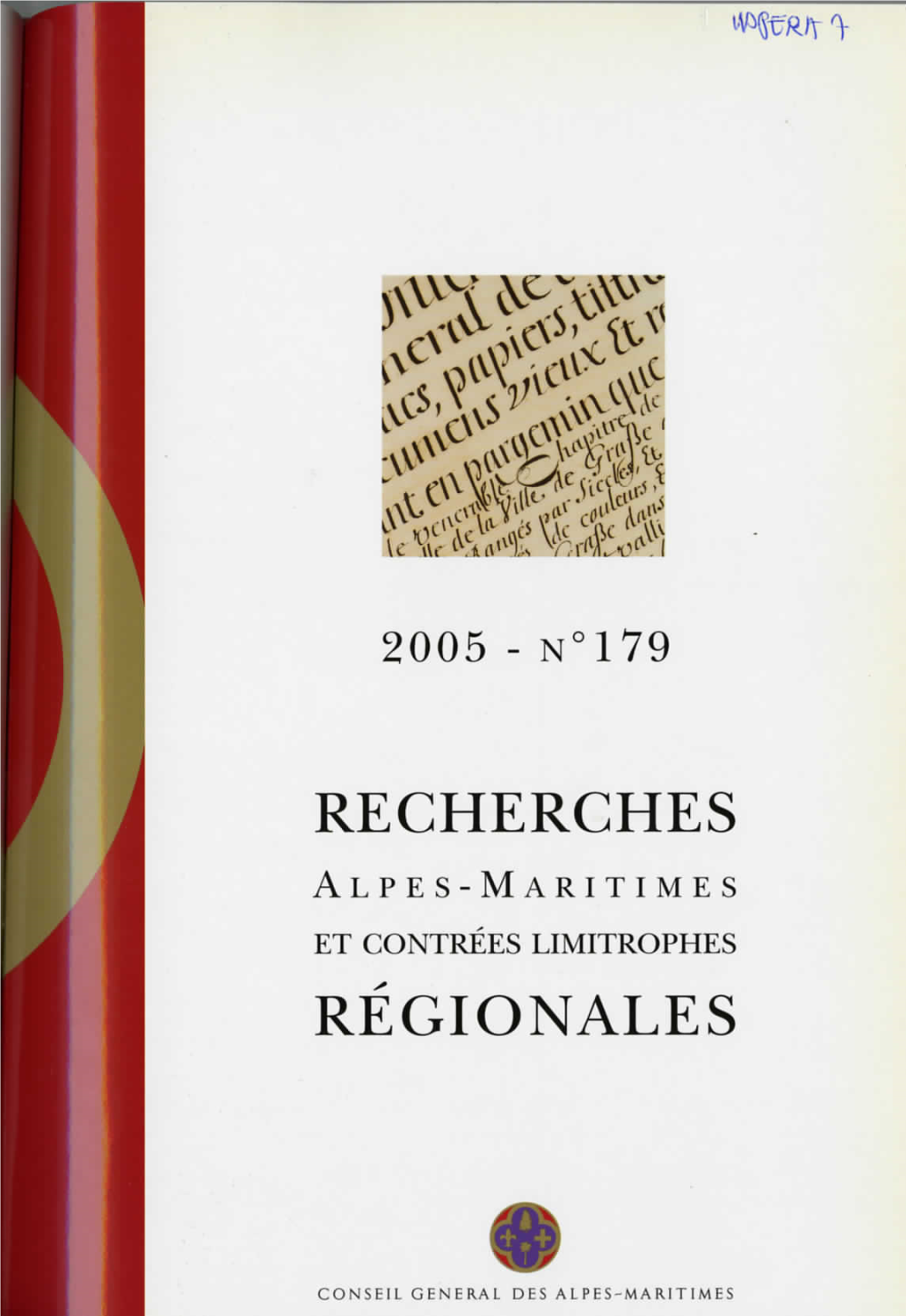
Load more
Recommended publications
-
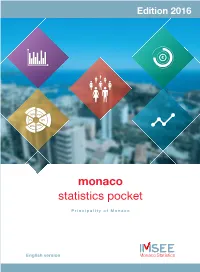
Monaco Statistics Pocket 2016 Format PDF, 5.00 MB
Visuel-Pocket.pdf 5 08/06/2016 15:11 English version English monaco Edition 2016 statistics pocket Principality of Monaco of Principality statistics pocket statistics monaco monaco statistics pocket Principauté de Monaco Edition 2016 Edition 2016 Edition Version française Visuel-Pocket.pdf 5 08/06/2016 15:11 08/06/2016 5 Visuel-Pocket.pdf www.imsee.mc www.federall.net [email protected] Printed by Imprimerie de Monaco, 1 rue du Gabian à Monaco à Gabian du rue 1 Monaco, de Imprimerie by Printed Tél. (+ 377) 98 98 98 88 98 98 98 377) (+ Tél. quarter 2015 quarter 2 deposit: Legal nd 98000 MONACO 98000 9 rue du Gabian du rue 9 ISSN-L 2311-3946 ISSN-L MINISTER OF STATE OF MINISTER MINISTÈRE D’ÉTAT ISSN-L 2311-3946 9 rue du Gabian 98000 MONACO Tél. (+ 377) 98 98 98 88 Dépot légal : 2ème trimestre 2016 [email protected] Imprimé par l’Imprimerie de Monaco, 1 rue du Gabian à Monaco www.imsee.mc www.federall.net Contents monaco statistics pocket Principality of Monaco 1. Territory and Population 1.1. Territory ..................................................................................... 02 1.2. Population ................................................................................ 05 2. Economy 2.1. Gross Domestic Product (GDP) ..................................... 09 2.2. Employment ............................................................................ 10 2.3. Turnover .................................................................................... 12 2.4. Financial Activities ............................................................. -

Immobilier La Saison Vue Par Maillot Tous Les Prix Au M2 À Monaco, R 28240 - F : 2,50 € Quartier Par Quartier 3 782824 002503 01360
JUDICIAIRE : L’AFFAIRE WADE RACONTÉE PAR UN JOURNALISTE DE L’EXPRESS 2,50 € Numéro 136 - Octobre 2014 - www.lobservateurdemonaco.mc POLITIQUE BUDGET 2014 : ENTRE APAISEMENT ET TENSIONS TRANSPORTS TRAVAUX SNCF : QUEL IMPACT POUR LES USAGERS ? SPÉCIAL CULTURE BALLETS DE MONTE-CARLO : IMMOBILIER LA SAISON VUE PAR MAILLOT TOUS LES PRIX AU M2 À MONACO, R 28240 - F : 2,50 € QUARTIER PAR QUARTIER 3 782824 002503 01360 LA PHOTO DU MOIS JUSQU’OÙ ? ’est la question que se posent pas mal d’agents immobiliers en prin- cipauté. Jusqu’où vont monter les prix ? En 2013, comme en 2012, le marché de l’immobilier a progressé. Et les six premiers mois de 2014 sont Csur la même dynamique. 2009 et 2010, deux années difficiles, semblent déjà loin. L’an dernier, le nombre de transactions a augmenté de 20 % par rapport à 2012. Résultat, le chiffre d’affaires est passé de 1 mil- liard d’euros, à 1,2 milliard d’euros. Et la plupart des experts interrogés par L’Obs’ estiment que 2014 devrait permettre d’atteindre 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec plus de 400 ventes. Pour 2015, les professionnels du secteur espèrent que les prix vont enfin se stabiliser. Car dans l’ancien, le prix moyen du m2 pour une revente est désormais de 32 000 euros/m2. Un prix qui a plus que doublé depuis 2006, avec une hausse de 115 %. Mais tout le marché n’est évidemment pas uniforme. Si les studios ont vu leurs prix augmenter de 79 % depuis 2006, les 5 pièces et plus ont enregistré un boom de 165 %. -

Inside-View-Monaco-2017-5094.Pdf
INSIDE VIEW MONACO 2017 Overview Monaco market overview There are few places in the any more”, yet that is precisely UHNWIs expect. These properties world where one would what Monaco does, with its only offer the best value in Monaco, but consider buying off-plan opportunity for expansion to extend the price must be right to take into property eight years in into the sea. account the refurbishment costs, advance, but Monaco is far effort and time required to bring The latest 2bn land reclamation from typical. € them up to scratch. programme will see six hectares This glamorous pocket of the Côte of new land created from Sicilian Time is on the side of today’s d’Azur is unwaveringly desirable, sand. On it will sit 120 new high-end buyers in Monaco, however, with thanks to the superlative location, apartments whose prices will be the average age now 35-55, lifestyle and fiscal advantages it in excess of €100,000 per sq m – compared with the 55-60 plus offers. But it also has a minuscule which ultra prime stock in Monaco demographic of a decade or supply of new property and a limited is already achieving. Of those 120 so ago. They make the most of amount of land, which means that units, 50 have already been retained the good schools, the growing Monaco is a place where you need to by the developer, leaving just 70 to number of great restaurants and plan ahead. sell with several years to go until the year-round buzz. As a result, completion. -

Spotlight-Monaco---2018.Pdf
Savills World Research Monaco Residential savills.com/research Spotlight | 2018 Monaco Market overview Property tax Values by district €2.1 billion The value of residential property transacted in 2017 €41,300 The average price (per sq m) of residential property in Monaco, making it the world’s most expensive market Savills_Monaco_p1_Cover_v1.0.indd 2 02/05/2018 11:01 Savills_Monaco_p02-03_intro_v0.2.indd 2 30/04/2018 17:51 FOREWORD High demand, low stock Summary A lack of liquidity in the market pushed up residential prices by 6% in 2017 More than €2 billion of residential property was A sovereign city-state covering just two square transacted in 2017. It was kilometres, Monaco punches well above its weight a strong year, but 23% on the world stage. With a profile in line with top-tier below the 2016 record. global cities, it’s an international centre of business, a world-class sporting and entertainment destination, and a hotspot for high-net-worth individuals. The number of new build The Principality’s economy continues to outperform transactions in 2017 was the eurozone thanks to a diversified, high-value economic a record. With little new supply in the pipeline, we expect volumes will Project Portier is under fall significantly in 2018. way, while Sporting d’Hiver Monaco’s population is nearing completion grew by 5.5% between 2008 and 2016. Home to 139 nationalities, this base. It’s a net importer of labour – around 53,300 people diverse base underpins work in Monaco each day, compared with a permanent residential demand. population of 37,550. -

La Principauté De Monaco
MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury La Principauté de Monaco Diplomová práce Brno 2018 Vedoucí práce: Vypracovala: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. Bc. Iveta Hanzlíčková Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 30.3.2018 …………………………………. Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala paní doc. Mgr. Václavě Bakešové, Ph.D. za věnovaný čas, trpělivý přístup, odborné vedení a cenné rady, které mi poskytovala po celou dobu tvorby této závěrečné práce. TABLE DES MATIÈRES Introduction .......................................................................................................................... 1 PARTIE THÉORIQUE ....................................................................................................... 4 1. Histoire et géographie ................................................................................................... 4 1.1 Préhistoire .............................................................................................................. 4 1.2 Antiquité ................................................................................................................. 4 1.3 Moyen Âge -

Chapitre 4 TRANSPORTS ET MOBILITÉ
3.13. Commerce extérieur Chapitre 4 TRANSPORTS ET MOBILITÉ Monaco en chiffres - Edition 2020 - 109 - 4 TRANSPORTS ET MOBILITÉ 4.1 Liaisons piétonnes ............................................................................................... 111 4.2 Parc automobile .................................................................................................... 111 4.3 Parc de stationnement ....................................................................................... 112 4.4 Transports routiers ............................................................................................... 115 4.5 Transports urbains ............................................................................................... 116 4.6 Réseau ferré ........................................................................................................... 119 4.7 Transport maritime ............................................................................................... 120 4.8 Transport aérien .................................................................................................... 120 - 110 - Monaco en chiffres - Edition 2020 4 | TRANSPORTS ET MOBILITÉ 4.1. Liaisons piétonnes Les données présentées concernent les appareils entretenus par la Direction de l’Aménagement Urbain. Évolution du nombre d’appareils de liaisons mécaniques Nombre de galeries et passages publics selon le type 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Nombre de galeries et passages 51 51 Ascenseurs 80 78 79 83 84 Source : Direction de l’Aménagement Urbain Escalators -

Focus Surfaces Construites 2014.Pub
Surfaces construites N° 28 — Février 2015 Données au 3 novembre 2014 Ce « Focus » porte sur les surfaces construites en Principauté. Il dresse un état par quartier de l’occupation de ces surfaces par type d’usage : résidentiel, commercial, publique, industriel… Les données proviennent du Système d'Information Géographique (SIG Batiment) mis en place par la Direction de la Pros- pective, de l’Urbanisme et de la Mobilité. 1/ Les surfaces construites par quartier Depuis l’Ordonnance Souveraine 4 481 du 13 septembre 2013, le territoire de la Principauté est découpé en sept quartiers ordonnancés, précisément délimités et basés sur le plan d’urbanisation, auxquels s'ajoutent les deux secteurs réservés de Monaco Ville et du Ravin Sainte Dévote régis par l'ordonnance loi n° 674. Ils sont ici pris comme référence et présentés ci- dessous. Surface cum ulée Sainte Dévote Les 0,1% Moneghetti 7,2% Monaco Ville 3,7% Monte-Carlo Larvotto 27,0% 8,5% Jardin Exotique 9,7% La Rousse Fontvieille 12,0% La 19,2% Condamine Le bâti total, hors œuvre et hors surface d'entreposage, avec 1 473 bâti- 12,6% ments, dépasse les 3 millions de mA. 46 % des surfaces construites se trouvent dans les quartiers de Monte- Nb de Surface Quartier Carlo et de Fontvieille, qui sont les plus vastes de la Principauté. bâtiments cumulée Monte-Carlo 318 814,1 A l'inverse, Monaco Ville, qui est le quartier le moins étendu après le Vallon Fontvieille 132 579,3 La Condamine 279 378,8 Sainte Dévote, représente moins de 4 % de la superDcie globale des bâti- La Rousse 123 363,0 ments mais regroupe plus de 15 % de ces derniers. -

DEPLIANT 100X150 IMSEE M
PRINCIPALITY OF MONACO PRINCIPALITY OF MONACO Constitutional monarchy H.S.H. Prince Albert II Currency: euro Find all our publications and the latest news Offi cial language: French from Monaco Statistics at Area: 2.03 km² www.monacostatistics.mc DIPLOMACY SOURCES 114 130 16 Businesses: Business Development Agency, Monaco Statistics State budget: Department of Budget and Treasury accredited Monegasque accredited Climate: Department of the Environment, The Exotic Garden foreign EMBASSIES CONSULATES AMBASSADORS Diplomacy: Department of Diplomatic and Consular Relations in Monaco in 79 states in 27 states Education and childcare: Department of Education, Youth and Sport, Monaco Statistics, Monaco City Hall Employment - Private sector: Monaco Social Security Funds, Monaco Statistics Housing: Monaco Statistics, 2016 census GDP: Monaco Statistics Population: Monaco Statistics, Monaco City Hall, 2016 census Workers: Monaco Social Security Funds, Human Resources and Training Department, Monaco Statistics Tourism: Tourist and Convention Authority, Monaco Statistics CLIMATE 32.3°C 16.5°C 41 2,673 Transport: Department of Forward Studies, Urban Planning and Mobility, Civil Aviation Authority MAXIMUM AVERAGE DAYS OF HOURS OF TEMPERATURE RAINFALL SUNSHINE Illustration freepik T 1.8°C ER ’V IM MINIMUM Local energy generation PR IM over 20% of national consumption SÉ LI Key fi gures BÉ LA R IMEU TRANSPORT PR IM 2017 Institut Monégasque de la Statistique • 1 et des Études Économiques CO 1 NA MO RAIL STATION HELIPORT 9, rue du Gabian - 98000 MONACO Tel. + 377 98 98 98 88 SERVICE 2 6.7 million 77,107 C [email protected] APHI PORTS PASSENGERS PASSENGERS GR ISSN-L 2617-2801 STATE BUDGET POPULATION WORKERS SURPLUS 139 +37 million 38,300 54,303 16.2 % NATIONALITIES 1,226 INHABITANTS NATIONALITIES 63.7 % French 1. -

Hautes Densités Le Problème Foncier À Monaco
URBANISME Hautes densités Le problème foncier à Monaco L’analyse des situations ix fois le musée du Louvre, trois Les besoins d’espace limites est toujours riche fois le National Mall de Wash- d’une métropole ington DC 1, le tiers d’un arron- Charmante curiosité, l’étroitesse du terri- d’enseignement : comment dissement moyen de Paris 2 ou toire monégasque est aussi un problème, car se présente la question Dencore le quart des jardins du château de la principauté a les besoins d’espace d’une foncière dans le pays Versailles. Voilà, concrètement, ce que véritable métropole. Sa population s’élève représente le territoire de la principauté à 37 550 habitants 7, faisant de Monaco le le plus densément peuplé de Monaco. Une surface d’à peine plus pays le plus densément peuplé au monde 8. du monde ? de 2 km2 (202 hectares), enclavée dans le Une population à laquelle s’ajoute, chaque département des Alpes-Maritimes et étagée jour, près de 40 000 salariés en provenance entre le cirque montagneux du Mont Agel des communes voisines 9 et 27 900 visi- et la mer Méditerranée. Un tout petit ter- teurs 10. La principauté a donc les mêmes ritoire qui classe Monaco parmi les micro- nécessités qu’une commune moyenne, États, aux côtés d’Andorre, de Saint-Marin en termes de logements et d’équipe- ou du Liechtenstein 3. Il s’agit même d’une ments publics 11, qu’un petit département, Cité-État, le périmètre de la commune se en termes de planchers d’activité écono- confondant avec celui de l’État, rappelant mique 12, et qu’une capitale internationale, le souvenir mythique de Rome, d’Athènes en termes d’infrastructures culturelles et ou de Carthage 4. -

Residential Insight New Developments Market Outlook
SPOTLIGHT 2017 Residential insight New developments Market outlook 180% Resales price growth in the Principality over 10 years 33 Margaret Street 4.3m London W1G 0JD Average resales price +44 (0)20 7499 8644 in Monaco in 2016 Savills_spotlight Monaco_Residential Market_p1_v2.indd 1 20/04/2017 14:32 Savills_spotlight Monaco_Residential Market_p1_v2.indd 2 20/04/2017 14:32 FOREWORD Global hotspot Residential property in Monaco is now the world’s most expensive – however, transaction volumes are falling as the market reaches a sticking point Monaco is home to world-class sporting and entertainment events, successful sports teams Summary and a royal family. With a population of 38,400, it is a big country in miniature. Spoken about in the same Record year breath as the premier world cities, Monaco punches A record 2.7 billion of well above its weight on the global stage. e Principality is a low-tax centre of commerce residential property was with all the characteristics of a leisure destination. transacted in 2016. is makes it very appealing to high-net-worth individuals as a place to live, do business and play. High resales price The average resales price is Prices have adjusted in the now 41,400psm, the highest prime residential markets of in prime markets globally. many cities, yet Monaco’s New build premium have continued to rise There is a signifi cant premium for new build. Sales accounted for 6% At a time when prices have adjusted in the prime of transactions by number, residential markets of many world cities, prices in Monaco have continued to rise. -

Focus : Built-Up Area
Built-up area N° 81 — March 2019 Data as at 1 January 2019 With its total area of 2 km, a third of which is already built-up, the Principality of Monaco faces an issue of land shortage. The data from Monaco’s Atlas des bâtiments as at 1 January 2019 shows how the Principality has used urban planning to tackle this issue. Chart 1. Map of Monaco’s referenced neighbourhoods Share of each neighbourhood in total floor area Monaco Ville Sainte Les 3.5% Dévote Moneghetti 0.3% 6.9% Larvotto Monte-Carlo 8.2% 26.1% Jardin Exotique 10.3% La Fontvieille Condamine 19.3% 12.3% La Rousse Source: Department of Forward Studies, Urban Planning and Mobility 13.1% Significant construction renewal Table 1. Floor area gained by rebuilding (2010-2019) There were 1 496 buildings in the Principality of Monaco at Floor area Floor area Floor area the beginning of the year 2019 adding up to a total of 3.16 demolished built gained million m of usable *oor area. Residential 15.2 167.0 151.8 Over the course of the last decade, signi-cant construction Public renewal took place: 53 buildings were demolished and re- 5.7 73.9 68.3 facilities placed by 60 new construction projects. Total *oor area in Offices 12.2 31.6 19.4 Monaco increased by 252 700 m. Hotels 18.5 25.3 6.8 Residential real estate accounted for 54 % of new construc- tion projects and 27 % of demolitions. Hotels accounted for Shops 5.4 11.7 6.4 33 % of demolitions due to the demolition and rebuilding of Industrial, arts 0.0 0.0 0.0 the Hôtel de Paris. -

Rapport Recensement 2016.Pdf
PRINCIPAUTÉ DE MONACO RECENSEMENT de la population 2016 Février 2018 Retour au sommaire Le recensement de la population permet de compter et de connaître les habitants février 2018 du territoire. À Monaco, il a été réalisé pour la première fois en 1757. Depuis la fin du XIXème siècle, l’opération de recensement est menée régulièrement afin de mesurer les évolutions démographiques et connaître la composition et les caractéristiques de la population et des logements. Un recensement de la population s’est déroulé en Principauté en 2016, du 7 juin au 29 juillet. Il a concerné l’ensemble des personnes qui résident sur le territoire de la Principauté. Au-delà du simple dénombrement des personnes et des logements, les informations recueillies facilitent et orientent la mise en œuvre des politiques publiques. Elles constituent un outil d’aide à la décision pour le Gouvernement. 1 RECENSEMENT de la population 2016 Retour au sommaire Retour au sommaire 5 Repères méthodologiques Sommaire 6 Cadre légal 6 Périmètre et dispositif de collecte 7 Méthode d’estimation de la population et des logements 9 Évolution et principales caractéristiques de la population 10 Évolution de la population résidente et répartition par quartier 13 Caractéristiques socio-démographiques 20 Mode de vie 23 Provenance et installation 25 Mobilité 27 Caractéristiques socio-économiques de la population 28 Situation principale et population active 30 Population active occupée et caractéristiques des emplois 34 Caractéristiques des chômeurs 37 Évolution et caractéristiques des