Au Pays De Québec
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
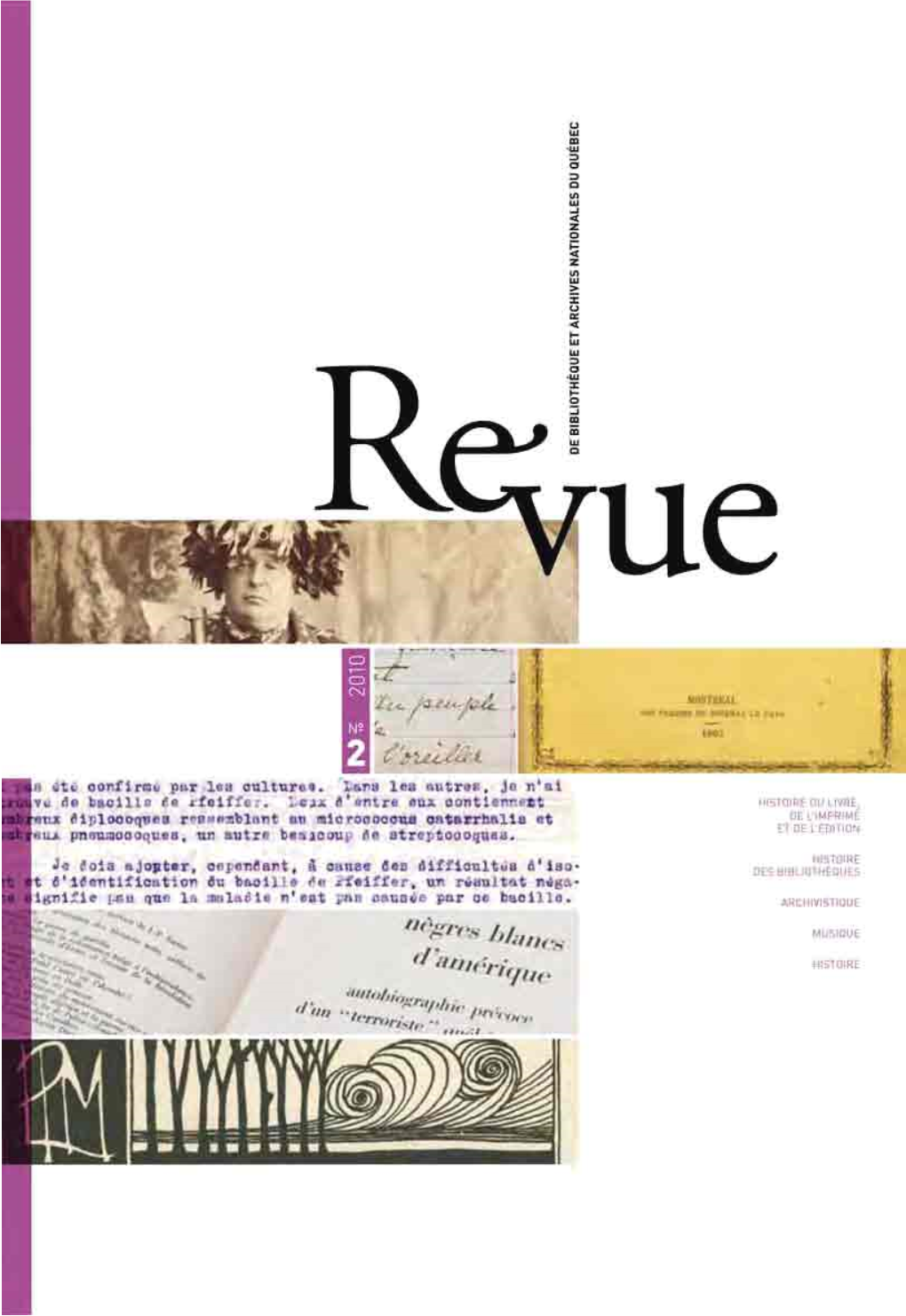
Load more
Recommended publications
-

Chano Domínguez Giuseppe Giacosa Vivaldi En Su Laboratorio Joan
REVISTA DE MÚSICA Año XXII - Nº 214 - Diciembre 2006 - 6,30 € DOSIER Martín y Soler 200 años ENCUENTROS Daniele Gatti ACTUALIDAD Joan Sutherland ESTUDIO Año XXII - Nº 214 Diciembre 2006 6,30 € Vivaldi en su laboratorio ANIVERSARIO Giuseppe Giacosa JAZZ Chano Domínguez AÑO XXII - Nº 214 - Diciembre 2006 - 6,30 € 2 OPINIÓN ¿Sólo el Petrarca de Da Ponte? Francesc Cortès 120 CON NOMBRE La ópera más popular: PROPIO Una cosa rara 8 Joan Sutherland Giuseppe De Matteis 124 Fernando Fraga ¿En tierra extraña? Alfredo Brotons Muñoz 130 12 AGENDA ENCUENTROS 18 ACTUALIDAD Daniele Gatti NACIONAL Rodrigo Carrizo Couto 132 46 ACTUALIDAD ESTUDIO INTERNACIONAL El Opus II de Vivaldi Pablo Queipo de LLano 136 60 ENTREVISTA Philippe Jarussky ANIVERSARIO Bruno Serrou Giuseppe Giacosa Blas Matamoro 142 64 Discos del mes EDUCACIÓN SCHERZO DISCOS Pedro Sarmiento 144 65 Sumario JAZZ DOSIER Pablo Sanz 146 113 Vicente Martín y Soler LA GUÍA 148 La gloria recuperada CONTRAPUNTO 114 Andrés Ruiz Tarazona Norman Lebrecht 152 Colaboran en este número: Javier Alfaya, Daniel Álvarez Vázquez, Julio Andrade Malde, Iñigo Arbiza, Emili Blasco, Alfredo Brotons Muñoz, Rafael Banús Irusta, José Antonio Cantón, Rodrigo Carrizo Couto, Francesc Cortès, Jacobo Cortines, Patrick Dillon, Pedro Elías Mamou, José Luis Fernández, Fernan- do Fraga, José Luis García del Busto, José Antonio García y García, Antonio Gascó, Mario Gerteis, José Guerrero Martín, Fernando Herrero, Bernd Hoppe, Antonio Lasierra, Norman Lebrecht, Santiago Martín Bermúdez, Joaquín Martín de Sagarmínaga, Enrique Martínez Miura, Giuseppe De Matteis, Blas Matamoro, Erna Metdepenninghen, Miguel Morate, Juan Carlos Moreno, Antonio Muñoz Molina, Miguel Ángel Nepomuceno, Rafael Ortega Basagoiti, Josep Pascual, Javier Pérez Senz, Lourdes Pérez-Sierra, Paolo Petazzi, Pablo Queipo de Llano, Fran- cisco Ramos, Arturo Reverter, Barbara Röder, Andrés Ruiz Tarazona, Stefano Russomanno, María Sánchez-Archidona, Pablo Sanz, Pedro Sarmiento, Bruno Serrou, Christian Springer, José Luis Téllez, Asier Vallejo Ugarte, Claire Vaquero Williams, Pablo J. -

Fonds Charles Koechlin
Fonds Charles KOECHLIN Médiathèque Musicale Mahler 11 bis, rue Vézelay – F-75008 Paris – (+33) (0)1.53.89.09.10 Médiathèque Musicale Mahler – Fonds Charles Koechlin Table des matières Documents personnels sur Charles Koechlin .................................................................................. 4 Biographie / Ephémérides ........................................................................................................... 4 Ecrits autobiographiques ............................................................................................................. 4 Ecrits et dossiers de voyages ...................................................................................................... 5 Œuvres de Charles Koechlin ......................................................................................................... 10 Boite 1 : Listes d’œuvres ........................................................................................................... 10 Boite 2 : Ecrits de Ch. Koechlin sur ses œuvres ........................................................................ 10 Ecrits de Charles Koechlin ............................................................................................................ 12 Conférences .............................................................................................................................. 12 Causeries radiophoniques ......................................................................................................... 14 Articles et textes ....................................................................................................................... -

Charles Tournemire Memoirs Edited by Marie- Louise Langlais
Charles TOURNEMIRE MEMOIRS Edited by Marie-Louise Langlais Charles Tournemire Memoirs Edited by Marie- Louise Langlais Memoirs translated by Susan Landale “Introduction and Epilogue” translated by Shirley Parry Footnotes and additional Letters translated by Rebecca Oualid Translations harmonized by Shirley Parry Charles Tournemire in his forties (Odile Weber collection) Acknowledgements I wish to express my gratitude to the translators of this book whose role has been indispensable. It has been a difficult and delicate task, knowing that Charles Tournemire’s language was often complex; he sometimes even invented French words which, for a translator, can be a nightmare! In 2014, I edited the French long version of Tournemire’s Memoirs, but I then had the idea that an English translation of this text, limited to material relating to music and the world of the organ and organists, would be useful and welcomed. This is that work. To translate the Memoirs, Susan Landale came immediately to mind as an authority on Tournemire and also as someone perfectly bilingual. Born in Scotland, she came to France at the end of the 1950s to study with André Marchal, the famous French blind organist. Winner of the first International Organ Competition at the St Albans Festival, England, she has firmly established a worldwide reputation as a brilliant concert organist and a renowned teacher, in frequent demand for master classes, seminars, and as a juror for leading international organ competitions. She taught for a long time at the National Conservatoire in Rueil-Malmaison (France). She is currently Visiting Professor of organ at the Royal Academy of Music in London and organist at the Cathedral Saint-Louis des Invalides, Paris. -

Composers for the Pipe Organ from the Renaissance to the 20Th Century
Principal Composers for the Pipe Organ from the Renaissance to the 20th Century Including brief biographical and technical information, with selected references and musical examples Compiled for POPs for KIDs, the Children‘s Pipe Organ Project of the Wichita Chapter of the American Guild of Organists, by Carrol Hassman, FAGO, ChM, Internal Links to Information In this Document Arnolt Schlick César Franck Andrea & Giovanni Gabrieli Johannes Brahms Girolamo Frescobaldi Josef Rheinberger Jean Titelouze Alexandre Guilmant Jan Pieterszoon Sweelinck Charles-Marie Widor Dieterich Buxtehude Louis Vierne Johann Pachelbel Max Reger François Couperin Wilhelm Middelschulte Nicolas de Grigny Marcel Dupré George Fredrick Händel Paul Hindemith Johann Sebastian Bach Jean Langlais Louis-Nicolas Clérambault Jehan Alain John Stanley Olivier Messiaen Haydn, Mozart, & Beethoven Links to information on other 20th century composers for the organ Felix Mendelssohn Young performer links Fanny Mendelssohn Hensel Pipe Organ reference sites Camille Saint-Saëns Credits for Facts and Performances Cited Almost all details in the articles below were gleaned from Wikipedia (and some of their own listed sources). All but a very few of the musical and video examples are drawn from postings on YouTube. The section of J.S. Bach also owes credit to Corliss Arnold’s Organ Literature: a Comprehensive Survey, 3rd ed.1 However, the Italicized interpolations, and many of the texts, are my own. Feedback will be appreciated. — Carrol Hassman, FAGO, ChM, Wichita Chapter AGO Earliest History of the Organ as an Instrument See the Wikipedia article on the Pipe Organ in Antiquity: http://en.wikipedia.org/wiki/Pipe_Organ#Antiquity Earliest Notated Keyboard Music, Late Medieval Period Like early music for the lute, the earliest organ music is notated in Tablature, not in the musical staff notation we know today. -

Poulenc-Chamber Music 32-Stg Layout 1 29.06.15 10:36 Seite 1
RZneu_pmr0049_BOOKLET_poulenc-chamber music_32-stg_Layout 1 29.06.15 10:36 Seite 1 poulenc chamber music wiese lessing may wienand RZneu_pmr0049_BOOKLET_poulenc-chamber music_32-stg_Layout 1 29.06.15 10:36 Seite 2 RZneu_pmr0049_BOOKLET_poulenc-chamber music_32-stg_Layout 1 29.06.15 10:36 Seite 3 francis poulenc chamber music 3 RZneu_pmr0049_BOOKLET_poulenc-chamber music_32-stg_Layout 1 29.06.15 10:36 Seite 4 Francis Poulenc (1899–1963) Sonata for violin and piano, FP 119 (1943/49) 01 Allegro con fuoco 6:45 02 Intermezzo. Très lent et calme 6:52 03 Presto tragico 5:56 Sonata for flute and piano, FP 164 (1957) 04 Allegro malinconico 4:32 05 Cantilena 4:11 06 Presto giocoso 3:35 from Improvisations (1932–59) 07 No 1 in B minor: Presto ritmico 2:08 08 No 3 in B minor: Presto très sec 1:38 09 No 5 in A minor: Modéré mais sans lenteur 2:04 10 No 7 in C major: Modéré sans lenteur 3:00 11 No 8 in A minor: Presto 1:32 12 No 10 in F major: Modéré, sans trainer 1:39 Sonata for two pianos, FP 156 (1952–53) 13 Prologue 6:54 14 Allegro molto 5:49 15 Andante lyrico 6:18 16 Epilogue 5:39 TT 68:35 4 RZneu_pmr0049_BOOKLET_poulenc-chamber music_32-stg_Layout 1 29.06.15 10:36 Seite 5 Kolja Lessing, violin (1–3) Henrik Wiese, flute (4–6) Eva-Maria May, piano (1–7, 9, 10, 13–16) Alexander Wienand, piano (8, 11–16) 5 RZneu_pmr0049_BOOKLET_poulenc-chamber music_32-stg_Layout 1 29.06.15 10:36 Seite 6 A la recherche de l’harmonie perdue – years of experimentation, it was mainly for young com- Francis Poulenc and the Magic of Remembrance posers that aspects of direct melodic and harmonic understanding, the transparency of sound and, conse- Francis Poulenc was born in Paris on 7 January 1899. -

Piano Quatuor Pražák Quatuor À Cordes Pavel Hůla* 1Er Violon • Vlastimil Holek 2Ème Violon • Josef Klusoň Alto • Michal Kaňka, Violoncelle
Marie-Catherine Girod piano Quatuor Pražák quatuor à cordes Pavel Hůla* 1er violon • Vlastimil Holek 2ème violon • Josef Klusoň alto • Michal Kaňka, violoncelle GABRIEL DUPONT (1878 - 1914) TRACKS 2 PLAGES CD Poème pour piano et quatuor à cordes 1 - Sombre et douloureux 15’28 2 - Clair et calme 5’31 3 - Joyeux et ensoleillé 12’56 Pièces pour piano solo 4 - Les Heures dolentes, "épigraphe" 2’03 5 - La Maison dans les dunes, "La maison du souvenir" 2’45 6 - Les Heures dolentes, "Du soleil au jardin" 3’15 7 - Les Heures dolentes, "Après-midi de dimanche" 3’23 8 - Les Heures dolentes, "Une amie est venue avec des fleurs" 2’53 9 - La Maison dans les dunes, "Mélancolie du bonheur" 3’49 10 - Les Heures dolentes, "Coquetteries" 5’17 11 - Les Heures dolentes, "Des enfants jouent dans le jardin" 5’57 12 - Les Heures dolentes, "Calme" 3’55 Journée de printemps, pour violon* et piano 13 - Au matin 4’52 14 - Au soir 5‘10 TRACKS 3 PLAGES CD « Et nul ne franchira le seuil de cette tombe, Pour un culte éternel encor que périssable, Et le profond remous de ces vagues de sable Où le pied du silence à chaque pas retombe. » Charles Péguy, La Tapisserie de Notre-Dame. es ombres de nos maîtres français (Fauré, morbide - est hantée par la maladie, elle chante Ravel, Debussy) furent écrasantes la mélancolie et l’angoisse des derniers jours, elle pour toute une génération de jeunes revendique les envolées lyriques d’un autre temps, Lcompositeurs. Au tournant du siècle, alors que elle cherche une voie unique entre l’exaltation et chacun cherchait sa voie, trouvait une issue la vérité de son siècle, elle questionne l’héritage et dans les brumes wagnériennes, se reposait aux ouvre une nouvelle sensibilité. -

La Scena Musicale Juin 2006
sm11-9_Cover_v4.qxp 2006-05-29 20:50 Page 1 numéro spécial 200 festivals d’été summer festivals Juin 2006 June Vol. 11.9 • 4,95$ ■ JAZZ PLEINS FEUX SUR LES FESTIVALS ■ PORTRAIT WONNY SONG ■ AUDIO iPodMANIA ■ CRITIQUES REVIEWS DISQUES, DVD, LIVRES CDS, DVDS, BOOKS ■ CALENDRIER CALENDAR MONTRÉAL, QUÉBEC, Gregory OTTAWA-GATINEAU CHARLES UNE CLASSE À PART IN A CLASS BY HIMSELF 0 9 0 6 5 3 8 5 0 4 6 1 5 9 Canada Post PMSA no. 40025257 sm11-9_publicités.qxd 5/28/06 2:32 PM Page 2 les séries Une pause sur mesure 2006•2007 SÉRIE ÉMERAUDE CONCERT SAPHIR, Salle Maisonneuve, les lundis ou mardis à 19 h 30 ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE Abonnements, 160$*, 130$*, 75$* (étudiants) Cocktail et concert 160$*; concert seulement, 60$* Les trios de l’automne 2006 Lundi, 16 avril 2007, 19 h 30, D’Italie IL GIARDINO ARMONICO ensemble baroque Du Canada, Mardi, 3 octobre, le Trio GRYPHON Jamie Parker, piano, Annalee Patipatanakoon, violon, Roman Borys, violoncelle Des États-Unis, Lundi, 23 octobre, le Trio SCHUB/KAVAFIAN/SHIFRIN piano, alto, clarinette, PIANO EN RAFALE De Roumanie, Lundi, 6 novembre, MIHAELA URSULEASA, SÉRIE TOPAZE CINQUIÈME SALLLE, Dimanches, 11h De Russie, Mardi, 21 novembre, Abonnements 60$* 25$* (étudiants) YEVGENY SUDBIN, Atelier d’éducation musicale pour enfants de 5 à 10 ans, 3$ De France mais natif des États-Unis, 2007 4 mars, PAUL STEWART, piano. Lundi, 11 décembre NICHOLAS ANGELICH 1er avril, ALEXANDRE DA COSTA ET WONNY SONG, violon et piano. Les ensembles de l’hiver 2007 13 mai, MUSICA FRANCA, bassons avec théorbe De Russie Lundi, 15 janvier, et continuo. -
François-X Avier Roth
Roch-Olivier Maistre, Président du Conseil d’administration Laurent Bayle, Directeur général Mercredi 25 février Ensemble intercontemporain | François-Xavier Roth Mercredi 25 février | Dans le cadre du cycle 1913 Du mardi 24 au samedi 28 février 2009 Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.citedelamusique.fr Ensemble intercontemporain | François-Xavier Roth | François-Xavier Ensemble intercontemporain EIC 25-02OK.indd 1 19/02/09 18:35 Cycle 1913 DU maRDI 24 AU SamEDI 28 FÉVRIER 2009 MARDI 24 FÉVRIER – 20H MERCREDI 25 FÉVRIER – 20H SAMEDI 28 FÉVRIER – 15H Un an avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la conflagration générale qui allait marquer le déclin de l’Europe, la création artistique ne cesse de se renouveler et d’explorer des voies Jacques de La Presle Alban Berg Forum Le dialogue des arts nouvelles, que ce soit en peinture, en littérature, en architecture ou en musique. En mars 1913, Mondrian Odelette Quatre Pièces pour clarinette et piano à la naissance des avant-gardes expose à Paris ses toiles abstraites d’une « cérébralité sensible » selon Apollinaire, tandis que Fernand Vœu op. 5 Léger montre sa Femme en bleu et Robert Delaunay son Équipe de Cardiff« où chaque ton appelle et laisse Dédette Anton Webern 15H : table ronde s’illuminer toutes les autres couleurs du prisme » (Apollinaire). Ce dernier publie son recueil de poèmes Nocturne Six Bagatelles pour quatuor à cordes Animée par Marcella Lista, Alcool en supprimant toute ponctuation, ce qui tisse des liens nouveaux entre le visuel et l’auditif, Darius Milhaud op. -
Lettres & Manuscrits Autographes
ALDE Lettres & Manuscrits autographes mercredi 17 décembre 2014 Expert Thierry Bodin Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art Les Autographes 45, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél. 01 45 48 25 31 - Facs 01 45 48 92 67 [email protected] 7, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 53 34 55 00 - Fax 01 42 47 10 26 [email protected] - www. rossini.fr présentera le no 56 Celui-ci est signalé par un R dans le catalogue Exposition privée chez l'expert Uniquement sur rendez-vous préalable Exposition publique à la Salle Rossini le mercredi 17 décembre de 10 heures à midi En première de couverture no 357 (détail) En quatrième de couverture no 156 ALDE Maison de ventes spécialisée Livres & Autographes Lettres & Manuscrits autographes Vente aux enchères publiques Le mercredi 17 décembre 2014 à 14 h 00 Salle Rossini 7, rue Rossini 75009 Paris Tél. : 01 53 34 55 01 Commissaire-priseur Jérôme Delcamp Expert Thierry Bodin Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art Les Autographes 45, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél. 01 45 48 25 31 - Facs 01 45 48 92 67 [email protected] EALDE Maison de ventes aux enchères 1, rue de Fleurus 75006 Paris Tél. 01 45 49 09 24 - Facs. 01 45 49 09 30 - www.alde.fr Agrément n°-2006-583 1 5 1. ACADÉMIE DE PEINTURE. Manuscrit, [Mémoires pour l’Académie de peinture, vers 1750] ; cahier in-4 de [107] ff. n. ch., dérelié. 800/1 000 Intéressant recueil composé par ou pour un membre de l’Académie royale de peinture et de sculpture, en 4 parties. -

Musical Gems at Home
“musical gems at home” “gemme musicali a casa” puntate 1 – 214 (16 Aprile 2020 – 1 mAGGIO 2021) Ogni settimana video per Pianoforte dal museo Wunderkammer “Artificialia” Playlist competa: https://www.youtube.com/playlist? list=PLIN_wpoQuw6We5Xa6fvlwDKgZa0pDMIU7 16 Aprile - Johann Sebastian Bach: Contrapunctus I – II – III BWV 1080 https://www.youtube.com/watch?v=nnp8S3uJg3E 17 Aprile - Franz Liszt: Preludio su “Weinen,Klagen, Sorgen, Zagen” https://www.youtube.com/watch?v=W91lieKhFuA 18 Aprile - Franz Schubert Lied “Der Wanderer” (Arr. Gulda) https://www.youtube.com/watch?v=tDK-P-s8i2I 19 Aprile – Carl Philipp Emanuel Bach: Solfeggio in do minore Johann Sebastian Bach: Preludio in do minore https://www.youtube.com/watch?v=UPswsvCDWuw 20 Aprile – Edvard Grieg: 4 Lyric Pieces https://www.youtube.com/watch?v=tnvZPUFKHWA 21 Aprile – Philip Selby: Lento Espressivo (from Sonatina) – Soul's Flight (from “At the tomb of Maurice Ravel) https://www.youtube.com/watch?v=eUxcZ97f2jY 22 Aprile – Franz Liszt: Ode Funebre n.1 “Les Morts” https://www.youtube.com/watch?v=pjZStH2x8KA 23 Aprile – Alexander Scriabin: “Vers la Flamme” op.72 https://www.youtube.com/watch?v=pGrTJPaTKqc 24 Aprile- Alexander Scriabin: “Funebre” op.6 n.4 https://www.youtube.com/watch?v=WMgIOZZxjBw 25 Aprile – J. S. Bach: Preludio in Sol Maggiore – Steve Hackett: Horizons https://www.youtube.com/watch?v=k7XhXrMSmPo 26 Aprile – Claude Debussy: Prelude “Suite Bergamasque” https://www.youtube.com/watch?v=aRgvUYD9Za0 27 Aprile – Nino Rota: Canzona “Ai giochi addio” (“Romeo and Juliet”) https://www.youtube.com/watch?v=kZJtnclKpEg 28 Aprile – Denes Agay: Prelude to a Fairy Tale https://www.youtube.com/watch?v=wJhd7TK6H-s 29 Aprile - György Ligeti: Musica Ricercata n.11 (Ricercare) https://www.youtube.com/watch?v=jnttlq-cKPU 30 Aprile – Samuel Barber: Ballade op. -
Le Saxo Phone Et Son Pluriel
*, Confédération Musicale de France GUNN MlliCfl revisité par Teuropean saxophone orchestra ; le saxo phone et son pluriel UNE RENTRÉE EN FRANCHE-COMTÉ et YFl 381 II (tête argent) Les références incontestées en matière de flûtes d'étude. i y Professionnel : Dès le modèle YFL 383 (tête argent massif) un mécanisme d'une qualité et d'une précision légendaire. Or ou argent variété de finitions et options, le choix de très sa W/ Yamaha dansje domaine'de la flûte a permis la mise au point d’instruments jjgjpr: exceptionnels, en alliant idéalement haute 7/ technologie et savoir-faire artisanal. L'innovation : corps en cuivre et ergonomie du clétage au service de la La qualité et la notoriété des flûtes Yamaha sont les sonorité et du confort résultats d'années d'effort et de passion mais aussi d'une rlCCUlU . 5 modèles de piccolos avec toujours équilibre, homogénéité . collaboration permanente entre artistes et techniciens. ut qualités sonores. Le besoin et le goût des musiciens pour la perfection font qu'aujourd'hui, les plus grands flûtistes internationaux ainsi que des milliers d'élèves accordent une totale confiance à Yamaha. -Paris Ven Cela ne peut pas être un hasard... Hortion I YAMAHA MUSIQUE FRANCE B.P 70. 77312 Marne-la-Vallée Cedex 2 e chant choral est en train de prendre sa place - qui est essentielle - au sein de la Confédération Musicale de France. LaL promotion du chant choral dans notre mouvement se fait sous l'impulsion de la dynamique commission des chorales, placée sous la responsabilité de Robert Combaz. Il ne s'agit plus seulement, en effet, pour cette commission, de choisir des œuvres de concours mais bien d'initier une véritable poli tique du chant choral, pour la C.M.F. -

Charles Tournemire Memoirs Edited by Marie- Louise Langlais
Charles TOURNEMIRE MEMOIRS Edited by Marie-Louise Langlais Charles Tournemire Memoirs Edited by Marie- Louise Langlais Memoirs translated by Susan Landale “Introduction and Epilogue” translated by Shirley Parry Footnotes and additional Letters translated by Rebecca Oualid Translations harmonized by Shirley Parry Charles Tournemire in his forties (Odile Weber collection) Acknowledgements I wish to express my gratitude to the translators of this book whose role has been indispensable. It has been a difficult and delicate task, knowing that Charles Tournemire’s language was often complex; he sometimes even invented French words which, for a translator, can be a nightmare! In 2014, I edited the French long version of Tournemire’s Memoirs, but I then had the idea that an English translation of this text, limited to material relating to music and the world of the organ and organists, would be useful and welcomed. This is that work. To translate the Memoirs, Susan Landale came immediately to mind as an authority on Tournemire and also as someone perfectly bilingual. Born in Scotland, she came to France at the end of the 1950s to study with André Marchal, the famous French blind organist. Winner of the first International Organ Competition at the St Albans Festival, England, she has firmly established a worldwide reputation as a brilliant concert organist and a renowned teacher, in frequent demand for master classes, seminars, and as a juror for leading international organ competitions. She taught for a long time at the National Conservatoire in Rueil-Malmaison (France). She is currently Visiting Professor of organ at the Royal Academy of Music in London and organist at the Cathedral Saint-Louis des Invalides, Paris.