Master Reference
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
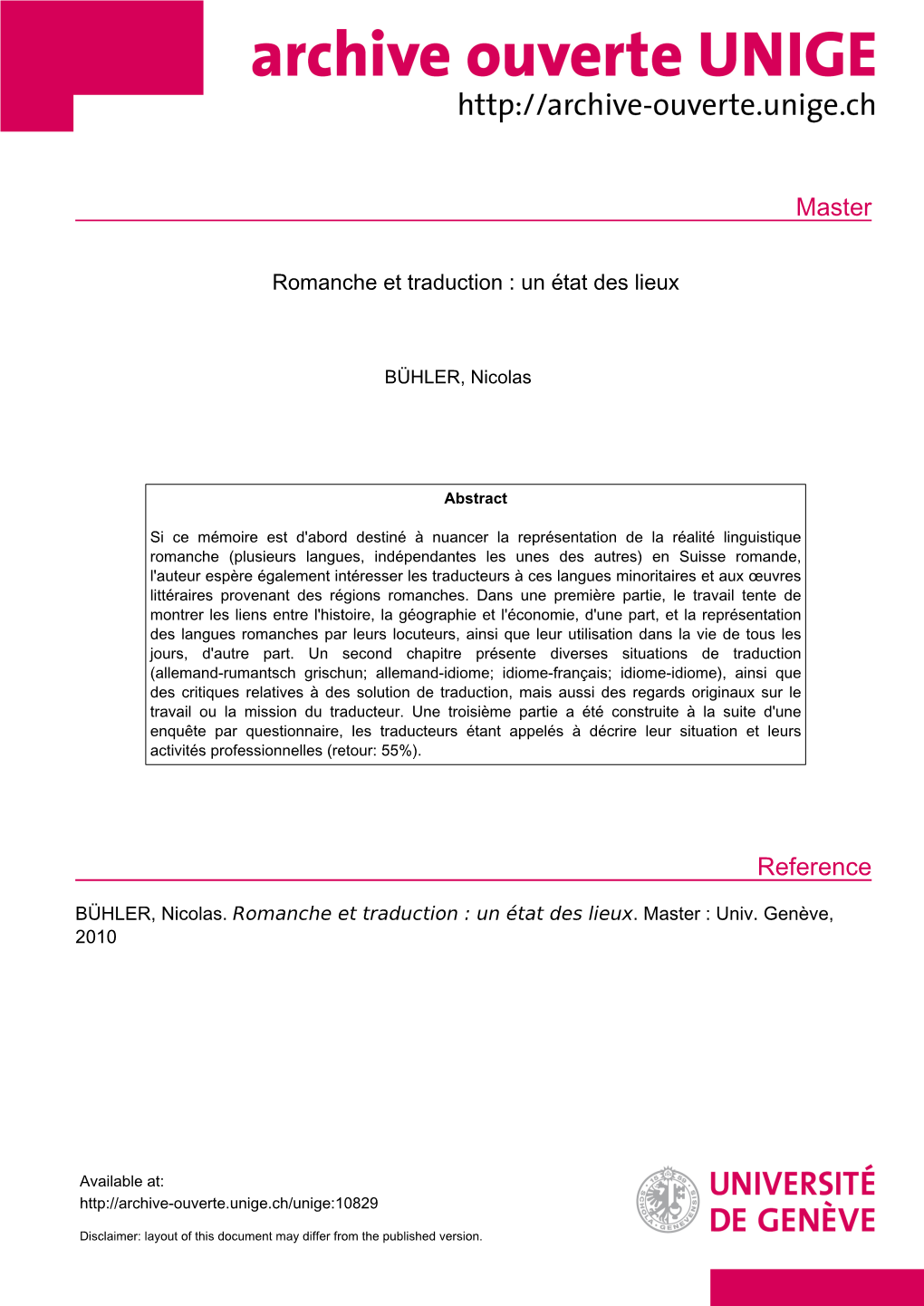
Load more
Recommended publications
-

Festschrift 100 Jahre CVP Graubünden
100 jahre cvp graubünden kdp konservativ-demokratische partei graubündens 1903 – 1938 kvp konservative volkspartei graubünden 1938 – 1951 konservative und christlichsoziale volkspartei graubünden 1951 – 1971 cvp christlichdemokratische volkspartei graubünden seit 1971 festschrift autorenverzeichnis Peder Anton Augustin Alt-Kreispräsident, Alvaschein Christian Camathias Alt-Gewerkschaftssekretär CHB, Laax Roman Cantieni lic. iur., Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Gene- ralsekretariats CVP Schweiz, Präsident Junge CVP Graubünden, Ilanz Giusep Capaul Dr. phil., Alt-Chefredaktor Gasetta Romontscha, Disentis Fidel Caviezel Dr. iur., Rechtsanwalt, Alt-Kanzleidirektor, Chur Silvia Degiacomi lic. iur., Hotelière, Präsidentin CVP-Frauen GR, St. Moritz Stefan Engler lic. iur., Rechtsanwalt, Regierungspräsident 2003, Surava Patricia Giger-Capeder Parteisekretärin CVP Graubünden, Chur René Hefti Alt-Parteisekretär CVP Graubünden, Valbella Bernardo Lardi Dr. iur., Rechtsanwalt, Alt-Regierungsrat, Chur Carmelia L. Maissen dipl. arch. ETH, Sevgein Theo Maissen Dr. ing. agr. ETH, Ständerat und Parteipräsident CVP Graubünden, Sevgein Philipp Stähelin Dr. iur., Rechtsanwalt, Ständerat und Parteipräsi- dent CVP Schweiz, Frauenfeld Ettore Tenchio Dr. iur., Rechtsanwalt, Alt-Nationalrat und Alt-Re- gierungsrat, Chur/Roveredo Herausgegeben von der CVP Graubünden © 2003 CVP Graubünden Auflage: 1500 Exemplare Redaktion: Patricia Giger-Capeder, Chur und René Hefti, Valbella Satz und Gestaltung: Carmelia L. Maissen, Sevgein Druck: Spescha & Grünenfelder, Ilanz -

Klassenkampf Und Klassenkompromiss. Arbeit, Kapital Und Staat in Den Niederlanden Und Der Schweiz, 1914-1950 Adrian Zimmermann
Unicentre CH-1015 Lausanne http://serval.unil.ch Year : 2012 Klassenkampf und Klassenkompromiss. Arbeit, Kapital und Staat in den Niederlanden und der Schweiz, 1914-1950 Adrian Zimmermann Adrian Zimmermann, 2012, Klassenkampf und Klassenkompromiss. Arbeit, Kapital und Staat in den Niederlanden und der Schweiz, 1914-1950 Originally published at : Thesis, University of Lausanne Posted at the University of Lausanne Open Archive. http://serval.unil.ch Droits d’auteur L'Université de Lausanne attire expressément l'attention des utilisateurs sur le fait que tous les documents publiés dans l'Archive SERVAL sont protégés par le droit d'auteur, conformément à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). A ce titre, il est indispensable d'obtenir le consentement préalable de l'auteur et/ou de l’éditeur avant toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre ne relevant pas d'une utilisation à des fins personnelles au sens de la LDA (art. 19, al. 1 lettre a). A défaut, tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par cette loi. Nous déclinons toute responsabilité en la matière. Copyright The University of Lausanne expressly draws the attention of users to the fact that all documents published in the SERVAL Archive are protected by copyright in accordance with federal law on cop- yright and similar rights (LDA). Accordingly it is indispensable to obtain prior consent from the au- thor and/or publisher before any use of a work or part of a work for purposes other than personal use within the meaning of LDA (art. 19, para. -
Gion Casper Collenbergs Viadi En L'isla De Fronscha
Gion Casper Collenbergs Viadi en l’Isla de Fronscha (1766) – Ausblick auf ein Dissertationsprojekt Michele Luigi Badilatti 1. Einleitung Die “Biblioteca romontscha” der Klosterbibliothek Disentis bewahrt unter der Signatur M 287 ein Manuskript auf, das bisher nicht die Aufmerksamkeit erfah- ren hat, die ihm gebührt. Es handelt sich um den größtenteils auf Surselvisch verfassten Reisebericht mit dem Titel Viadi che iau Gion Casper Collenberg vai faig il on 1765. en lisla de Fronscha La qualla ei a 4 Melli uras davent de paris. In diesem autobiografischen Text beschreibt Gion Casper COLLENBERG (1733–1792) aus Lumbrein seine in den Jahren 1765 und 1766 unternommene Reise von Paris über Lorient nach Port-Louis in der damaligen französischen Kolonie Île de France, dem heutigen Mauritius.1 COLLENBERGs Viadi umfasst knapp 200 teils illustrierte Seiten, die alle aus sei- ner Hand stammen. Der Reisebericht ist zwar hauptsächlich auf Surselvisch geschrieben, enthält aber auch einige französische Passagen. Dabei handelt es sich entweder um kurze Einschübe im surselvischen Text (u.a. in Form eines 1 Der Kammerdiener COLLENBERG begleitete seinen Dienstherrn Jacques-Armand DUPIN DE CHENONCEAUX (1727–1767), den Großonkel der Schriftstellerin George SAND (1804 –1876), auf einer Geschäftsreise (cf. HUBERT-BRIERRE 2001, 299). Ladinia XLI (2017), 39–52. ISSN 1124–1004; © Istitut Ladin Micurá de Rü, San Martin de Tor (BZ). 40 Ladinia XLI (2017) / Michele Luigi Badilatti religiösen Liedes oder eines Gedichts) oder aber um separate Inventarlisten, in denen die einzelnen Bestandteile sowie die Ausrüstung des für die Überfahrt von Lorient nach Port-Louis genutzten französischen Handelsschiffs Comte d’Artois festgehalten werden. Zudem findet man einen ganzen Abschnitt, in dem COL- LENBERG die unterschiedlichen Funktionen der jeweiligen Seeleute beschreibt, wobei er dies in bester französischer Dichtungstradition in alternierenden Ale- xandrinern tut (cf. -

Bibliographie Zur Ethnomusikologischen Literatur Der Schweiz
MAX PETER BAUMANN BIBLIOGRAPHIE ZUR ETHNOMUSIKOLOGISCHEN LITERATUR DER SCHWEIZ MIT EINEM BEITRAG ZU GESCHICHTE, GEGENSTAND UND PROBLEMEN DER VOLKSLIEDFORSCHUNG A<DA06US Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung AMADEUS VERLAG· WINTERTHURISCHWEIZ @COPYRIGHT 1981 BY AMADEUS VERLAG (BERNHARD PÄULER), WINTERTHURISCHWEIZ ALLE RECHTE VORBEHALTEN. JEGLICHE WIEDERGABE VON TEXTEN UND NOTENBEISPIELEN NUR MIT ERLAUBNIS DES VERLAGS GESTATTET SATZ UND MONTAGE: BERNHARD PÄULER, WINTERTHUR NOTENGRAFIK: YVONNE MORGAN, WINTERTHUR DRUCK: ERNST BÜHLER, HENAU-UZWIL EINBAND: HEINRICH WEBER AG, WINTERTHUR AUFLAGE: 1000 EXEMPLARE PRINTED IN SWITZERLAND BP 2465 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort ........... 7 ZU GESCHICHTE, GEGENSTAND UND PROBLEMEN DER VOLKSLIEDFORSCHUNG ............... 9 1. Zur Lage der Volksliedforschung in der Schweiz .. .. .. .. 11 1.1. überlieferungsgeschichte, Volkslied und Interesse .. .. 12 1. 2. Vom Liedverbot zur Aufklärung durchs Volkslied .. .. 13 1. 3. Vom Entdecken des Volksliedes zu dessen Idealisierung 14 1.4. Wiederbelebung und Verklärung .. .. .. .. .. .. .. 15 1. 5. Gepflegte "Unmittelbarkeit" ................ 16 1. 6. "Die Wahrheit des Volkes im Lied aufspüren ... " .. .. 17 1. 7. "Sammeln und Retten" ............ 18 1.8. Neuorientierung und Aufgabenstellung ........ 19 1. 9. Zum Gegenstand der Forschung . .. .. .. .. 25 2. Volksliedforschung und das Problem ihrer Motivation .... 28 2.1. Musikfolklore im Rücklauf von Historismus und Historizismus 30 2.2. "Das Volkslied"- oder das Problem wissenschaftlichen Definierens .. 36 2. 3. Zum Paradigma einzelner Volkslieddefinitionen .. .. 39 3. Einige Reflexionen über folkloristische Veranstaltungen ..... 44 3.1. Folklore und Folklorismus . .. .. .. .. .. .. .. 45 3.2. Folklorismus als Problem musikalischer Akkulturation .... 46 3. 3. Folklore im Dienste der Fremdenindustrie 48 3.4. Der objektivistische Schein des "Echten" .......... 49 3. 5. Folklorismus zwischen Regression und Emanzipation 50 3.6. Identifikation und die Angst von außen 51 3. -

Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV 2015 / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science XIV 2015
PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU TOM XIV Komitet Redakcyjny / The Editorial Committee Redaktor naczelny i sekretarz redakcji / Editor-in-Chief and Editorial Secretary: prof. dr hab. Michał KOKOWSKI (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa–Kraków) Zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor-in-Chief: prof. dr hab. Jerzy KREINER (em. prof., Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego; Kraków) Redaktor statystyczny / Statistical Editor: dr Alicja RAFALSKA-ŁASOCHA (Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński; Kraków) Redaktorzy pomocniczy / Advisory Editors: prof. Jan GOLINSKI, PhD (University of New Hampshire, College of Liberal Arts, Department of History; Durham, Great Britain) dr Jan SURMAN (Leibniz Graduate School „Geschichte, Wissen, Medien in Ostmittel europa”, HerderInstitut für historische Ostmitteleuropaforschung; Marburg, Germany) dr hab. Piotr DASZKIEWICZ (Musée National d’Histoire Naturelle; Paris, France) Redaktor językowy (jęz. polski) / Linguistic Editor (Polish): Edyta PODOLSKA-FREJ (Dział Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności / Publishing Department of the Polish Academy of Arts and Sciences; Kraków) Redaktor językowy (jęz. angielski) / Linguistic Editor (English): Filip KLEPACKI Od kolejnego numeru PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU będą się ukazywać pod nowym tytułem STUDIA HISTORIAE SCIENTIARUM. Zostanie zachowana ciągłość wydawnicza i tematyczna; numeracja tomów będzie zapisywana liczbami arabskimi a nie rzymskimi (jest to podyktowane kwestiami tech nicznymi). -
Wirtschaft Und Ethik Im Spannungsfeld Economie Et Éthique En Champ De Tensions
Ausgabe 1/2020-2021 – Zur Unternehmensverantwortungsinitiative – Zur Kriegsgeschäfteinitiative – Zur DV Plus in Solothurn Wirtschaft und Ethik im Spannungsfeld Economie et éthique en champ de tensions ZEITSCHRIFT FÜR GESELLSCHAFT UND POLITIK HERAUSGEBER SCHWEIZERISCHER STUDENTENVEREIN STV REVUE DE SOCIÉTÉ ET POLITIQUE ÉDITEUR SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES SES RIVISTA DI SOCIETÀ E POLITICA EDITORE SOCIETÀ DEGLI STUDENTI SVIZZERI SSS REVISTA PER SOCIETAD E POLITICA EDITUR SOCIETAD DA STUDENTS SVIZZERS SSS In dieser Ausgabe Dans cette édition Redaktioneller Teil 3 Editorial 4 «Für verantwortungsvolle Unternehmen» 9 Wirtschaft und Ethik im Widerspruch? 10 «Die Einsicht, dass etwas schiefläuft, reicht noch nicht» 15 L’église et l’IniMulti: «L’économie à besoin des droits humains» 18 Das Fastenopfer und die UVI 20 Die Kriegsgeschäfte-Initiative 22 Von «Katholischer Volkspartei» zu «Die Mitte» Vereinsteil 30 Billet de la Présidente 32 DV Plus in Solothurn 35 Mitgliedermutationen 36 Zentralkomitee 2020/2021 38 Jahresprogramm 2020/2021 39 Programme annuel 2020/2021 40 «Es gelingt nur gemeinsam» 41 Séminaire des nouveaux membres 2020 42 Neumitgliederseminar 2020 43 Dreiverbände-Gespräch 44 Rubrik: Verbindungsanlässe 46 Rubrik: Was macht eigentlich …? 47 Rubrik: Aus dem CC 48 Jobbörse 50 Chroniken 57 Nekrologe 63 Impressum 63 Vorschau nächste Ausgabe Zentralpräsidentin Vize-Zentralpräsident Zentralsekretariat Redaktion Civitas Kommunikation Elena Furrer v/o Thalia Hans Ruppanner Heinz Germann Thomas Gmür Kilian Ebert v/o Fanat, BA in Theology v/o -

Rätoromanische Märchen Aus Graubünden : Internationales Wandergut Oder Eigenproduktion?
Rätoromanische Märchen aus Graubünden : internationales Wandergut oder Eigenproduktion? Autor(en): Brunold-Bigler, Ursula Objekttyp: Article Zeitschrift: Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen Band (Jahr): 11 (2006) PDF erstellt am: 24.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-11835 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch -

L'idée Latine Du Félibrige Et La Renaissance Romanche 1854-1914
Lizenziatsarbeit der Philosophischen Fakultät Romanisches Seminar Universität Zürich L’Idée latine du Félibrige et la Renaissance romanche 1854-1914 La fonction des traductions entre l’occitan et le romanche Mémoire 20. April 2008 Autorin: Bettina Berther, Luzern/Rueras Betreuung: Prof. Martin-Dietrich Glessgen Table des matières 1 Préface .................................................................................................................................. 4 2 Introduction .......................................................................................................................... 6 2.1 Les langues .................................................................................................................... 6 2.1.1 L’occitan ................................................................................................................. 6 2.1.2 Le romanche ........................................................................................................... 7 3 L’élaboration linguistique et littéraire 1854 - 1914 ............................................................. 9 3.1 Le Félibrige ................................................................................................................. 10 3.2 La Renaissance romanche ........................................................................................... 11 3.3 L’Idée latine ................................................................................................................ 13 3.4 Les acteurs et les sources des rapports -

English Summaries
English summaries Objekttyp: Group Zeitschrift: Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen Band (Jahr): 11 (2006) PDF erstellt am: 27.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch English Summaries Marjetka Golez Kaucic, Slovenian folk song, music and dance heritage in the alpine region This article focuses on the legacy of folk songs, music and dance in the Slovenian Alps. It describes and defines the geographical boundaries within which the whole tradition was preserved and could grow. Particular attention is paid to three among the best known and most representative folk traditions of the regions surveyed, a sort of crossroads of traditions. -

Publicaziuns 1982
Publicaziuns 1982 Autor(en): Widmer, K. Objekttyp: Article Zeitschrift: Annalas da la Societad Retorumantscha Band (Jahr): 96 (1983) PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-234640 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Publicaziuns 1982 Tscherna bibliografica Cun la seguainta glista vuless l'Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun preschantar üna tscherna plü vasta da publicaziuns rumantschas cumparüdas l'on passä. Cumprais sun eir bainquants tituls chi nun han amo pudü gnir adüts aint illa Tscherna dal numer prece- daint da las Annalas. La tscherna bibliografica nu cuntegna ingünas publicaziuns periodicas rumantschas, dimperse singuls artichels landroura, schi sun cumparüts sco separats. -

Die Digitale Rätoromanische Chrestomathie
Die Digitale Rätoromanische Chrestomathie Jürgen Rolshoven unter Mitarbeit von Florentin Lutz, Claes Neuefeind und Fabian Steeg Hans Dieter Bork zum 12.7.2012 1. Einführung Der vorliegende Beitrag hat die digitale Tiefenerschließung der Rätoromanischen Chrestomathie von Caspar DECURTINS zum Gegenstand. Die Rätoromanische Chrestomathie, 1896–1919 in der Zeitschrift “Romanische Forschungen” (Er- langen) erschienen, ist die bis heute wichtigste Textsammlung für das Bündnerro- manische und eine für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften unübertrof- fene Quelle. Mit der Tiefenerschließung werden die Volltexte der Chrestomathie und darüber hinaus ein rätoromanisches Textkorpus als Grundlage korpuslin- guistischer und philologischer Forschungen der Öffentlichkeit über das Internet frei zugänglich bereitgestellt. Damit verbunden ist auch ein quelloffenes Korrek- tur-, Erschließungs- und Anreicherungsverfahren. Es werden automatische und interaktive Korrekturen und Anreicherung kombiniert. Die interaktive Korrek- tur und Anreicherung setzt Wiki-Prinzipien um und bindet in Zusammenarbeit mit den Rätoromanen in der Schweiz und deren Organisationen die Sprachge- meinschaft und die am Bündnerromanischen Interessierten ein. Die im Vorha- ben eingesetzten Techniken sollen in der Folge auf weitere Textsammlungen des Bündnerromanischen und anderer Sprachen angewandt werden. Das Projekt hat somit prototypischen Charakter für Vorhaben, die der Erschließung spezia- lisierter Textsammlungen gewidmet sind, die vorrangig die Dokumentation und Ladinia XXXVI (2012), 119–151 ISSN 1124–1004; © Istitut Ladin Micurà de Rü, San Martin de Tor (BZ). 120 Ladinia XXXVI (2012) / Jürgen Rolshoven unter Mitarbeit von Florentin Lutz, Claes Neuefeind und Fabian Steeg Bewahrung kleinerer, auch bedrohter Sprachen zum Gegenstand haben, und die die Sprecher dieser Sprachen in Textkorrektur, -anreicherung und -nutzung ein- binden. Dadurch gewinnt die Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache und Kultur eine neue quantitative und qualitative Dimension. -

ROMANCHE FACTS & FIGURES Conception Et Texte: Manfred Gross, Lia Rumantscha Rédaction Avec La Collaboration De: Ivo Berther (P
ROMANCHE FACTS & FIGURES Conception et texte: Manfred Gross, Lia Rumantscha Rédaction avec la collaboration de: Ivo Berther (p. 40 - 45); Werner Carigiet (p. 52 - 55); Bernard Cathomas; Anna-Alice Dazzi Gross; Jean- Jacques Furer (ill. p. 8; p. 11, 24 - 27, 31- 34); Hans Goebl (p. 13 - 14); Daniel Telli; Radio Rumantsch (p. 67- 70); Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun (p. 100 - 101) Relecture: Jean-Jacques Furer Traduction française: Jean-Jacques Furer Cartes: Lia Rumantscha, Coire; Hatrick SA, Domat (p. 8, 12, 14, 16, 23, 88) Illustrations: ANR (p. 66); E. Caduff, LQ (p. 7); S. Haas, Coire (p. 72, 96); Keystone (p. 94); Lia Rumantscha, Coire; J. F.Pajarola, Cazis (p. 75 gauche); Chemins de fer rhétiques, Coire (p. 81); RTR (p. 67, 68); M. Sauter (p. 90); A. E. Wieser (p. 33) Maquette de la couverture: APART CAV GMBH, Zurich Maquette, composition et mise en page: Fotosatz Graf, Coire Clichés, impression et équipement: Südostschweiz Print AG, Coire Cet ouvrage est basé sur des publications, articles et rapports mentionnés dans les bibliographies pla- cées à la fin des différents chapitres, ainsi que sur des articles de journaux. L’ouvrage peut également être consulté dans sa totalité le site de la Lia Rumantscha: www.liarumantscha.ch. La Lia Rumantscha remercie toutes les personnes mentionnées ci-dessus pour leurs observations et leurs conseils qui ont permis d’améliorer et compléter le présent ouvrage. © 2004 Lia Rumantscha, Coire, 2e édition revue et mise à jour Tous droits réservés ISBN 3-03900-036-5 ROMANCHE FACTS & FIGURES Table des matières 5 Éditorial . 7 Minorités linguistiques en Europe .