Descartes Et Corneille Ou Les Démesures De L'ego
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1629 Corneille Pierre Mélite C 1630 Corneille Pierre Clitandre Ou L
1629 Corneille Pierre Mélite C 1630 Corneille Pierre Clitandre ou l'innocence persécutée TC 1632 Corneille Pierre La Veuve C 1632 Corneille Pierre Mélanges poétiques 1633 Corneille Pierre La Galerie du Palais C 1634 Corneille Pierre La Suivante C 1634 Corneille Pierre La Place Royale ou l'Amour extravagant C 1635 Corneille Pierre Médée T 1636 Corneille Pierre L'Illusion comique C 1637 Corneille Pierre Le Cid TC 1637 Corneille et 4 autres La Grande Pastorale 1640 Corneille Pierre Horace T 1642 Corneille Pierre Cinna T 1643 Corneille Pierre Polyeucte T 1643 Corneille Pierre La Mort de Pompée T 1643 Corneille Pierre Le Menteur C 1644 Corneille Pierre La Suite du Menteur C 1645 Corneille Pierre Rodogune T 1645 Corneille Pierre sixains pour Valdor "Le Triomphe de Louis le Juste" 1646 Corneille Pierre Théodore T 1647 Corneille Pierre Héraclius T 1650 Corneille Pierre Andromède T 1650 Corneille Pierre Don Sanche d'Aragon CH 1651 Corneille Pierre Nicomède T 1651 Corneille Pierre trad. de l'"Imitation de Jésus-Christ", 20 ch. 1652 Corneille Pierre Pertharite T 1659 Corneille Pierre Oedipe T 1660 Corneille Pierre La Toison d'or (T à machines) 1662 Corneille Pierre Sertorius T 1663 Corneille Pierre Sophonisbe T 1664 Corneille Pierre Othon T 1666 Corneille Pierre Agésilas T 1667 Corneille Pierre Attila T 1669 Corneille Pierre trad. de l'"Office de la Vierge" 1670 Corneille Pierre Tite et Bérénice T 1671 Corneille + Molière/Quinault Psyché CB 1672 Corneille Pierre Pulchérie T 1674 Corneille Pierre Suréna T 1654 Molière L'Etourdi 1656 Molière Le Dépit -

The Women Characters of Corneille and Racine
MERRILLS THE WOMEN CHARACTERS DF CdRNEILLE AND RACINE FRENCH — B. A. — 19 I 9 THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY 191 ^ M 55 The person charging this material is re- sponsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University. UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN BUILDING LSE ONLY BUILDING I SE'ONCV BUILD!! L161 — O-1096 THE WOMEN CHARACTERS OF CORNEILLE AND RACINE BY VIRGINIA MERRILLS THESIS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN FRENCH COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES UNIVERSITY OF ILLINOIS 1919 M55 UNIVERSITY OF ILLINOIS *SS*...7 191.9... THIS IS TO CERTIFY THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY VIRGINIA MERRILLS ENTITLED !™...!!9™! CHARACTERS OF CORNEILLE AND RAOIHE IS APPROVED BY ME AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF B*™5P.R. 0F..AK?g.. Instructor in Charge Approved : \AdJt-&Jid<^~ a Sc 4«rrV© OF DEPARTMENT ()F/\..^^. ^ .Z~±?^^.f$Z<. * 443959 i CONTENTS Page Introduction ii Chapter I. The Women Characters of Corneille 1 II. The Y/omen Characters of Racine 7 III. Contrasts Between Corneille and Racine 12 Digitized by the Internet Archive in 2014 http://archive.org/details/womencharactersoOOmerr ii INTRODUCTION The purpose of this essay is to discuss briefly the women characters of Corneille and Racine, showing their resemblances and differences. It is beyond the scope of the subject to analyze the plots and purposes of the plays of Corneille and Racine, and hence the reader is expected to be somewhat familiar with the plays which are used as the back- ground of this essay. -

An Anthropology of Gender and Death in Corneille's Tragedies
AN ANTHROPOLOGY OF GENDER AND DEATH IN CORNEILLE’S TRAGEDIES by MICHELLE LESLIE BROWN (Under the Direction of Francis Assaf) ABSTRACT This study presents an analysis of the relationship between gender and death in Corneille’s tragedies. He uses death to show spectators gender-specific types of behavior to either imitate or reject according to the patriarchal code of ethics. A character who does not conform to his or her gender role as dictated by seventeenth-century society will ultimately be killed, be forced to commit suicide or cause the death of others. Likewise, when murderous tyrants refrain from killing, they are transformed into legitimate rulers. Corneille’s representation of the dominance of masculine values does not vary greatly from that of his contemporaries or his predecessors. However, unlike the other dramatists, he portrays women in much stronger roles than they usually do and generally places much more emphasis on the impact of politics on the decisions that his heroes and heroines must make. He is also innovative in his use of conflict between politics, love, family obligations, personal desires, and even loyalty to Christian duty. Characters must decide how they are to prioritize these values, and their choices should reflect their conformity to their gender role and, for men, their political position, and for females, their marital status. While men and women should both prioritize Christian duty above all else, since only men were in control of politics and the defense of the state, they should value civic duty before filial duty, and both of these before love. Since women have no legal right to political power, they are expected to value domestic interests above political ones. -

From the Tragic to the Comic in Corneille
Trinity University Digital Commons @ Trinity Modern Languages and Literatures Faculty Research Modern Languages and Literatures Department 2005 Over the Top: From the Tragic to the Comic in Corneille Nina Ekstein Trinity University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.trinity.edu/mll_faculty Part of the Modern Languages Commons Repository Citation Ekstein, N. (2005). Over the top: From the tragic to the comic in Corneille. In F. E. Beasley & K. Wine (Eds.), Intersections: Actes du 35e congrès annuel de la North American Society for Seventeenth-Century French Literature, Dartmouth College, 8-10 mai 2003 (pp. 73-84). Tübingen, Germany: Narr. This Contribution to Book is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures Department at Digital Commons @ Trinity. It has been accepted for inclusion in Modern Languages and Literatures Faculty Research by an authorized administrator of Digital Commons @ Trinity. For more information, please contact [email protected]. Over the Top: From the Tragic to the Comic in Corneille by NINA EKSTEIN (Trinity University) The notions of tragedy and comedy that one can intuit from the theater of Corneille are markedly different from those found in other authors of the period. This is but one aspect of a larger issue concerning Corneille's placement in the hallowed pantheon of literary history. He is one of the major canonical authors and yet he often disconcerts.1 He was one of the principal theorists of drama in the seventeenth century and yet he took a number of stands in direct and lonely opposition to his peers. -

On the Passions of Kings: Tragic Transgressors of the Sovereign's
ON THE PASSIONS OF KINGS: TRAGIC TRANSGRESSORS OF THE SOVEREIGN’S DOUBLE BODY IN SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH THEATRE by POLLY THOMPSON MANGERSON (Under the Direction of Francis B. Assaf) ABSTRACT This dissertation seeks to examine the importance of the concept of sovereignty in seventeenth-century Baroque and Classical theatre through an analysis of six representations of the “passionate king” in the tragedies of Théophile de Viau, Tristan L’Hermite, Pierre Corneille, and Jean Racine. The literary analyses are preceded by critical summaries of four theoretical texts from the sixteenth and seventeenth centuries in order to establish a politically relevant definition of sovereignty during the French absolutist monarchy. These treatises imply that a king possesses a double body: physical and political. The physical body is mortal, imperfect, and subject to passions, whereas the political body is synonymous with the law and thus cannot die. In order to reign as a true sovereign, an absolute monarch must reject the passions of his physical body and act in accordance with his political body. The theory of the sovereign’s double body provides the foundation for the subsequent literary study of tragic drama, and specifically of king-characters who fail to fulfill their responsibilities as sovereigns by submitting to their human passions. This juxtaposition of political theory with dramatic literature demonstrates how the king-character’s transgressions against his political body contribute to the tragic aspect of the plays, and thereby to the -

Corneille in the Shadow of Molière Dominique Labbé
Corneille in the shadow of Molière Dominique Labbé To cite this version: Dominique Labbé. Corneille in the shadow of Molière. French Department Research Seminar, Apr 2004, Dublin, Ireland. halshs-00291041 HAL Id: halshs-00291041 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291041 Submitted on 27 Nov 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. University of Dublin Trinity College French Department Research Seminar (6 April 2004) Corneille in the shadow of Molière Dominique Labbé [email protected] http://www.upmf-grenoble.fr/cerat/Recherche/PagesPerso/Labbe (Institut d'Etudes Politiques - BP 48 - F 38040 Grenoble Cedex) Où trouvera-t-on un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents (…) capable néanmoins de s'abaisser, quand il le veut, et de descendre jusqu'aux plus simples naïvetés du comique, où il est encore inimitable. (Racine, Eloge de Corneille) In December 2001, the Journal of Quantitative Linguistics published an article by Cyril Labbé and me (see bibliographical references at the end of this note, before appendixes). This article presented a new method for authorship attribution and gave the example of the main Molière plays which Pierre Corneille probably wrote (lists of these plays in appendix I, II and VI). -

L'illusion Comique De Pierre Corneille Et L'esthétique Du Baroque
UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIQUE FACULTÉ DES LETTRES DÉPARTEMENT DE LANGUE ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISES L'ILLUSION COMIQUE DE PIERRE CORNEILLE ET L'ESTHÉTIQUE DU BAROQUE MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR KYRIAKI DEMIRI SOUS LA DIRECTION DE MADAME LE PROFESSEUR APHRODITE SIVETIDOU THESSALONIQUE 2008 1 UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIQUE FACULTÉ DES LETTRES DÉPARTEMENT DE LANGUE ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISES L’ILLUSION COMIQUE DE PIERRE CORNEILLE ET L’ESTHÉTIQUE DU BAROQUE MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR KYRIAKI DEMIRI SOUS LA DIRECTION DE MADAME LE PROFESSEUR APHRODITE SIVETIDOU THESSALONIQUE 2008 2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION .......................................................................... p. 5 CHAPITRE I: L' «étrange monstre» de Corneille: une structure irrégulière et chaotique .......................................................................................... p. 13 CHAPITRE II : Les éléments du baroque 1. L'instabilité ......................................................................... p. 24 2. Le déguisement.................................................................... p. 35 3. L'optimisme ......................................................................... p. 47 4. La dispersion des centres d'intérêt .............................. p. 52 CHAPITRE III: L'esthétique 1. Le thème de l'illusion ........................................................ p. 59 2. La métaphore du théâtre ................................................. p. 70 CONCLUSION ............................................................................... -

The Cornelian Ethics of Flight and the Case of Horace
Trinity University Digital Commons @ Trinity Modern Languages and Literatures Faculty Research Modern Languages and Literatures Department 2016 The Cornelian Ethics of Flight and The Case of Horace Nina Ekstein Trinity University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.trinity.edu/mll_faculty Part of the Modern Languages Commons Repository Citation Ekstein, N. (2016). The Cornelian ethics of flight and the case of Horace. Romance Notes, 56(3), 485-493. doi: 10.1353/rmc.2016.0050 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures Department at Digital Commons @ Trinity. It has been accepted for inclusion in Modern Languages and Literatures Faculty Research by an authorized administrator of Digital Commons @ Trinity. For more information, please contact [email protected]. The Cornelian eThiCS of flighT and The CaSe of horaCe nina ekSTein flighT is a simple dramatic action, one that lends itself to any number of dif- ferent plots. its implied movement can be represented on stage or merely recounted. So common is it that the words fuite and fuir appear in every one of Corneille’s 32 plays, from as infrequently as twice to as many as 32 times.1 The two terms belong to a broad semantic network including retraite, éviter, dérober, échapper, partir, quitter, abandonner, but differ in their suggestion of abrupt, precipitous movement as well as the element of fear implied. furetière begins his definition of fuir with “Tascher d’éviter un péril en s’en éloignant à force de jambes.” The next sentence, however, immediately ties the term to issues of morality: “les braves aiment mieux périr que fuir d’une bataille.” Thus a common, if at times startling, action has inherent ethical ram- ifications. -

Bérénice Au Xviie Siècle : La Confrontation De Deux Maîtres
Université de Gand Faculté Lettres et Philosophie Florence Dierick Bérénice au XVIIe siècle : La confrontation de deux maîtres. Bérénice de Jean Racine versus Tite et Bérénice de Pierre Corneille : L’histoire, l’enjeu et les pièces. Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de taal- en letterkunde : Frans – Duits 2014 – 2015 Directeur de recherche : Prof. Dr. A. Roose Département de Littérature française Remerciements Je remercie sincèrement mon directeur de recherche, le Professeur A. Roose, qui m’a aidée à mener ce mémoire à bonne fin. Le Professeur A. Roose était prêt à donner son avis, à corriger quelques esquisses de travail et surtout à m’encourager à faire mieux. Cette coopération m’a donné beaucoup de confiance dans mon travail et pour mon futur, académique et professionnel. Je tiens également à remercier ma famille, et en particulier ma mère, qui m’a toujours appris à persévérer et qui a voulu relire ce mémoire de maîtrise. Mes copines du département de français, Lies, Fien, Heleen, Gaëlle, Hannah et Alix, m’ont encouragée pendant les moments difficiles. Je suis soulagée et contente de pouvoir dire que nous finirons ensemble cette aventure à la faculté de lettres. Très reconnaissante du soutien que j’ai reçu, je remercie tout le monde qui a voulu m’aider durant ces derniers mois. 1. Introduction Nous écrivons novembre 1670, Paris. Bérénice, la nouvelle tragédie de Jean Racine (1639 – 1699), se joue à l’Hôtel de Bourgogne. La Champmeslé, une nouvelle actrice de la troupe et la Bérénice de la pièce, est surnommé l’ « Enchantriche »1. -

La Place Royale Du Même Auteur Dans La Même Collection
La Place Royale Du même auteur dans la même collection Le Cid (édition avec dossier). Horace (édition avec dossier). L’Illusion comique (édition avec dossier). Théâtre I : Mélite. La Veuve. La Galerie du Palais. La Suivante. La Place Royale. L’Illusion comique. Le Menteur. La Suite du Menteur. Théâtre II : Clitandre. Médée. Le Cid. Horace. Cinna. Polyeucte. La Mort de Pompée. Théâtre III : Rodogune. Héraclius. Nicomède. Œdipe. Tite et Bérénice. Suréna. Trois Discours sur le poème dramatique (édition avec dossier). CORNEILLE La Place Royale • PRÉSENTATION NOTES DOSSIER CHRONOLOGIE BIBLIOGRAPHIE LEXIQUE par Marc Escola GF Flammarion © Flammarion, Paris, 2001. Édition corrigée et mise à jour en 2019. ISBN : 978-2-0814-7011-8 Présentation La postérité a fixé Corneille dans un face-à-face avec Racine qui nous prive d’une bonne part de son œuvre vive : sait-on bien que Corneille n’est pas venu au théâtre avec Le Cid (1637) et que cette pièce n’était pas d’abord une tragédie mais une tragi-comédie, tout comme Cli- tandre (1632), la deuxième pièce du dramaturge ? Peut-on imaginer que la notoriété gagnée au cours de la fameuse Querelle du Cid, où s’élaborèrent les grandes lois de l’esthétique classique, ne fit qu’étendre et renouveler une réputation acquise, entre 1629 et 1635, par la création coup sur coup de cinq comédies (Mélite, La Veuve, La Galerie du Palais, La Suivante, La Place Royale) et d’une Illusion comique qui s’apparente encore au genre de la comédie ? Avant de se voir consacré comme le « Sophocle français », Corneille eut une ambition qui devait aussi, plus tard, animer Molière : mériter le nom de « nouveau Térence ». -
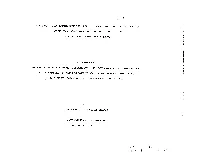
Theme and Structure in Rodogune of Corneille And
- !‘ / THEME AND STRUCTURE IN RODOGUNE OF CORNEILLE AND LA TH1~BA~DE OF RACINE: A STUDY OF THE BAROQUE A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF ATLANTA UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF MASTER OF ARTS BY RUSSELL WILLINGHAM ATLANTA, GEORGIA AUGUST 1967 PI?EFACE In this study, the writer shall examine the parallels and contrasts between Rodogune of Pierre Corneille and La Th~ba’~ide of Jean Racine, with special emphasis on the baroque aspects of the two works. The total production of these two writers has long been unjustly placed or labeled in one particular category, that of being “classical.” That type of categorizing is quite unjust if we take into consideration such works as Rodogune, Attila, Sor~na of Cornejlle and La Th~ba’ide and Alexandre Le Grand of Racine. This traditional and misleading conception in applying the label “classical” to the two dramatist by such critics as Gustave Lanson in his Esquisse d’une histoire de la trag~die français and Martin Trunell in his Classical Moment has been challenged by a group of “Revisionists.” Such modern day cdtinc as W.G. Moore, French Classi~l Literature, Imbrie Buffum , Studies in the Baroque and E. B. Borgehoff, “The Freedom of French Classicism.?? The study of these revisionists have lead to a truer and deeper appraisal of the two dramatist. In this study, the writer shall consider the baroque and classicism, not only in their artistic and literary sense but also in relation to the time and the milieu in which they developed. -

BOOK REVIEWS 175 Lyons, John D. the Tragedy of Origins: Pierre Corneille and Historical Perspec- Tive (Stanford, CA: Stanford
BOOK REVIEWS 175 Lyons, John D. The Tragedy of Origins: Pierre Corneille and Historical Perspec- tive (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996. Pp. xv + 236. Cloth. $37.50. In this cogent study of five plays by Pierre Corneille, John Ly- ons goes one step beyond traditional readings of history in Corneille’s theater by positing a fundamental conjunction between history and tragedy as complimentary ways of relating or restruc- turing human experience. Each of the dramatic works studied here – Horace, Cinna, Polyeucte, Sertorius and Attila -- stages a mo- ment of origin, a confrontation between the past and the present (of the represented world) which results in the foundation of a new political and social order. Unlike Racine’s representation of mythic, circular time, Corneille’s plays focus on the singularity of the moment; a tragedy of origins is thus “a drama that illustrates the characters’ struggle to act according to a framework of refer- ences to the past precisely at the moment when that past is ren- dered obsolete by a new structure that will itself in retrospect con- vert their present into a beginning” (76). Such tragedies naturally privilege the events which alter the course of history rather than the hero himself. Yet, most often, only the hero recognizes as the play closes the magnitude of the originary shift which has taken place before his eyes. Any such radical change is of course viewed as transgressive by those who live it; ironically, the hero, who is instrumental in any movement toward change, is, in the end, ex- cluded from the new order established by his actions.