Lac Du Bourget
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

7200 Years of Rhône River Flooding Activity in Lake Le Bourget, France
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-INSU 7200 years of Rh^oneriver flooding activity in Lake Le Bourget, France: a high-resolution sediment record of NW Alps hydrology. Fabien Arnaud, M. Revel, Emmanuel Chapron, Marc Desmet, Nicolas Tribovillard To cite this version: Fabien Arnaud, M. Revel, Emmanuel Chapron, Marc Desmet, Nicolas Tribovillard. 7200 years of Rh^oneriver flooding activity in Lake Le Bourget, France: a high-resolution sedi- ment record of NW Alps hydrology.. Holocene, SAGE Publications, 2005, 15, pp.3, 420-428. <10.1191/0959683605hl801rp>. <hal-00023343> HAL Id: hal-00023343 https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/hal-00023343 Submitted on 18 Jan 2007 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Arnaud et al., 7200 years of Rhône River floods The Holocene, in press 7200 years of Rhône river flooding activity in Lake Le Bourget: A High-resolution sediment record of NW Alps hydrology F. Arnaud1,4*, M. Revel2, E. Chapron3*, M. Desmet4, N. Tribovillard1 1 UMR 8110 Processus et Bilan en Domaine Sédimentaire, UST Lille 1 Bât. SN5 59655 Villeneuve d’Ascq, France 2 UMR 5025 Laboratoire de Géodynamique des Chaînes Alpines, Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble, Université J. -

Catalogue Des Brochures
Archives Municipales D’AixD’Aix----lesleslesles----BainsBains Catalogue des Brochures Série BR Par Joël Lagrange Edition du 28 janvier 2008 - 0 - Archives Municipales d’Aixd’Aix----lesleslesles----BainsBains Répertoire thématiques des Brochures Série BR Ed. du 28 janvier 2008 Introduction La distinction entre une brochure et un livre est floue. Sont concernés par cette rubrique les petits ouvrages qui ne constituent pas à proprement parlé des livres imprimés reliés ou brochés ou qui sont trop "étriqués" pour êtres conservés dans le fonds de bibliothèque. En grande partie issue de la « littérature grise », sans éditeur précisé, sans diffusion en librairie, ces brochures sont souvent des dépliants touristiques, des rapports, des thèses. A noter que les programmes d'une page, les invitations sont en série FI. Quant aux journaux et articles de journaux, ils se classent avec les périodiques. Nous trouverons dans cette série environ 700 brochures, de l'imprimé à la photocopie ou au document dactylographié, sur des sujets très variés. En complément de cet inventaire, une base de donnés informatique est disponible aux Archives permettant la recherche sur plusieurs champs : titres, auteurs,… Table des matières ADMINISTRATION 2 CULTURE ET ANIMATION 5 ECONOMIE 11 ENVIRONNEMENT 14 HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 16 SOCIAL 21 SPORT 22 THERMALISME 27 TOURISME 32 TRANSPORT 38 1 Archives Municipales d’Aixd’Aix----lesleslesles----BainsBains Répertoire thématiques des Brochures Série BR Ed. du 28 janvier 2008 Administration *BR 567 Grosse Léon. Brochure de présentation de la société. - Aix-les-Bains : Entreprise Léon Grosse, 2001. - 72 p. ; 30 cm *BR 479 Le petit Franclens. (Journal municipal de Franclens). N°13 1999. -

Plan Des Lignes Principales Plan Des Lignes De Proximité
auges B Route des Bauges es GRÉSY-SUR-AIX M d e o Rou t Collège de Grésy n t La Cascade é * e 2 Transport à s i d a La Guicharde e la Demande n G la a s u e b i ZONE E l g ch A ' u a l rde a Montcel, Trévignin, B Grésy Saint Offenge, Grésy Collège Centre Commercial Le Revard A s e e l l b d b e e a p d y u e R e r de la H t t e ou h e R c a u u s u r o t o B e C c e o u m e R d b N e N É te E - u Pont Pierre A L Ro e ’ e ut L B Corsuet Ro ou rg E e Saint Simond t d et T u su elt La or ev c C os U o - R Ch emin de O R Ch o La Baye e u mi n t in T e l k d Transport à Colonel n e d d a n e r S Mémard Rollet F Henri o a la Demande m i i S n Ba t ZONE D Dunant ye Office de - Pont I Lafin n n Brison, Tresserve, Tourisme Villon o Rouge R ue Ecole Plans Hen ri c Dunan Dim t e Aix les Bains Lafin n Ecole St Simond t Garibaldi 1 Ecole de du Sierroz - Lignes principales Grand Zander Che Lafin m in d Neptune es Mo ller ons Port Ave nue d Pont Rouge u B G ra o n Ecole d e Port Saint-Simond u P u or * t l Lignes de proximité e n LA CHAPELLE Roosevelt v e a r v t A r e Collège A d A n SPAR i v i v t e a s n S Garibaldi e u r . -

Circuits Vtt Bugey Vélo
BUGEY VÉLO BASE FÉDÉRALE VÉLO DE ROUTE ET VTT Undulating minor roads running through vineyards, forests and along Maison Saint-Anthelme the haulage paths beside the river Rhone and the Bugey landscapes - all ideal for road and mountain and trail biking. The Petites routes, vignes, forêts ou chemins le long du Rhône, les paysages du Bugey, www.maisonsaintanthelme.com vallonnés, sont propices à la pratique du vélo de route et du VTT. road, mountain and trail biking circuits leading off from the Bugey biker base go to “ must ” sites and hidden beauty spots. Les itinéraires routes et VTT de la base d’activité du Bugey permettent AIN À VÉLO The “ Ain by bike ” signposted circuits take you along through de découvrir sites incontournables et coins secrets. www.ain-tourisme.com unspoilt landscapes between the river Rhone and vineyards. Les circuits balisés de l’Ain à vélo vous emmènent au cœur d’un territoire naturel, www.ain-rando.com www.bugeyvelo.com entre Rhône et vignes. www.bugeysud-tourisme.fr www.bugeyvelo.com Kleine Straßen, Weinberge, Wälder oder Wege www.bugeysud-tourisme.fr entlang der Rhone: die welligen Landschaften Col de Valorse des Bugey sind ideal für den Rennrad- und 902 Col de la Mountainbike-Sport. Die vom Radstützpunkt Croix de l'Orme 1083 Bugey ausgewählten Strecken streifen Col de la Rochette D991 attraktive Orte und geheime Winkel. Die markierten Touren von “ Ain à vélo ” D8 D992 Golet Bélier führen durch eine reizvolle Natur 967 zwischen Rhone und Weinbergen. D21 D991 www.bugeyvelo.com Passage de la D991 A Pierre Taillée -
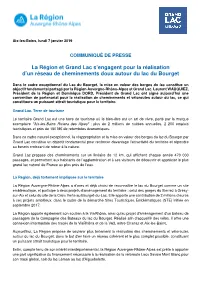
CP 01 07 Convention AURA Grand
Aix-les-Bains, lundi 7 janvier 2019 COMMUNIQUÉ DE PRESSE La Région et Grand Lac s’engagent pour la réalisation d’un réseau de cheminements doux autour du lac du Bourget Dans le cadre exceptionnel du Lac du Bourget, la mise en valeur des berges du lac constitue un objectif fondamental partagé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Lac. Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région et Dominique DORD, Président de Grand Lac ont signé aujourd’hui une convention de partenariat pour la réalisation de cheminements et véloroutes autour du lac, ce qui constituera un puissant attrait touristique pour le territoire. Grand Lac, Terre de tourisme Le territoire Grand Lac est une terre de tourisme où le bien-être est un art de vivre, porté par la marque exemplaire "Aix-les-Bains Riviera des Alpes" : plus de 2 millions de nuitées annuelles, 2 200 emplois touristiques et près de 150 M€ de retombées économiques. Dans ce cadre naturel exceptionnel, la réappropriation et la mise en valeur des berges du lac du Bourget par Grand Lac constitue un objectif fondamental pour renforcer davantage l'attractivité du territoire et répondre au besoin croissant de retour à la nature. Grand Lac propose des cheminements sur un linéaire de 12 km, qui affichent chaque année 470 000 passages, et permettent aux habitants de l’agglomération et à ses visiteurs de découvrir et apprécier le plus grand lac naturel de France au plus près de l’eau. La Région, déjà fortement impliquée sur le territoire La Région Auvergne-Rhône-Alpes a d'ores et déjà choisi de reconnaître le lac du Bourget comme un site emblématique, et participe à deux projets d'aménagement du territoire : celui des gorges du Sierroz à Grésy- sur-Aix et celui du site de la Croix Verte au Bourget-du-Lac. -

Le Contrat De Bassin Versant Du Lac Du Bourget
La lettre | numéro 1 | juin 2003 Assainissement Le contrat domestique 5,2 M€ de travaux pour 2003 de bassin versant Artisanat et industrie Des aides exceptionnelles pour l’élimination du lac du Bourget des déchets toxiques Protection contre les crues Un chenal écologique pour protéger Savoie Technolac Littoral Restauration de la roselière de la baie de Mémard Actions pédagogiques Aquarium et Maison du Lac s’équipent > Dossier Le Grand Lac relève son défi écologique Sommaire Dossier Le Grand Lac relève son défi écologique …………………………04 Eau ➤ Assainissement domestique : 5,2 M€ de travaux pour 2003 ……………06 ➤ Déchets toxiques : des aides exceptionnelles ……………………08 Protection contre les crues Un chenal écologique pour protéger Savoie Technolac …………09 Milieux aquatiques ➤ Entretien des rivières : prévenir et guérir ………………………………………10 ➤ Marais de Chautagne : la restauration partenariale……………………12 ➤ Baie de Mémard : Aix-les-Bains panse ses roseaux ………13 ➤ Pêcheurs : vers une gestion durable ………………………14 Actions pédagogiques Aquarium et Maison du Lac : une nouvelle expo pour 2004 ………………15 Directeurs de la publication Thierry LATASTE, Michel DANTIN Conception - réalisation CISALB Mise en page Esprit Public Rédaction Renaud Portrait JALINOUX Illustrations Isabelle MANDROU Crédits photo CISALB Tirage 2500 exemplaires Fernand BRUYÈRE. Impression Imprimerie VINÇOT Dépôt légal La Deysse coule dans ses veines ………16 en cours CISALB 474, rue Aristide Bergès, 73000 Chambéry - Tél. 04 79 96 87 27 Fax. 04 79 96 86 21 [email protected] Le Grand Lac | la lettre | numéro 1 | CISALB Edito | 03 L’homme, l’eau et la biodiversité Le contrat de bassin versant du lac du Bourget, signé le 28 septembre dernier, définit quelques 250 opérations qu’il nous faudra conduire ensemble d’ici 2009 pour garantir durablement la ressource en eau et la biodiversité de notre territoi- re. -

Programme Estival 2021 Le Bourget-Du
Programme estival 2021 ● ● ● Plus de 50 rendez-vous à ne pas manquer de juin à octobre ! Plage municipale du Bourget-du-Lac ■ CLB Canoë-Kayak : Location Canoës Kayaks 1 ou 2 Baignade surveillée jusqu’au 31 août 2021 de 10h à 19h places, paddles... 06 52 91 33 13 / www.clbck.fr Plage payante de 10h à 18h (tarifs réduits à partir de 16h) ■ Tarif Adulte : 3 € / Enfant (de 4 à 17 ans inclus) : 2,05 € ■ BOURGET NAUTIC : Location de bateaux avec ou Découvrez le Château de Thomas II et son marais ■ Abonnement Adulte : 27 € / Enfant : 17,60 € sans permis et pédalos 07 81 09 97 66 Château de Thomas II : Ouverture du 06 juillet au 29 août 2021 ■ Carte 10 entrées Adulte : 20€ / Enfant : 9,80 € ■ NAUTIC PULSION : Location de bateaux avec ou ■ Accès au site du mardi au dimanche de 14h à 18h / cour intérieure du château en accès libre Jeux d’eau pour enfants, solarium, terrain de beach sans permis, ski nautique, Wake-board Visite simple : Adulte : 2€ - Enfant : 1€ / Visite guidée tous les jeudis à partir du 08 juillet à 11h : volley, sanitaires, douches et vestiaires sur place. 06 80 41 54 89 / www.nauticpulsion.com Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans / 04 79 25 01 99 04 79 35 00 51 ■ TOP DÉLIRE NAUTIC : Magasin de surf - sports de ■ Visite guidée Prieuré + Château Thomas II : tous les jeudis du 08 juillet au 19 août à 09h30. glisse (paddle, wakesurf, kitesurf...) 04 79 25 00 09 Adulte : 8€ - Tarif réduit : 6€ - Gratuit pour les moins de 12 ans / 04 79 25 01 99 Activités nautiques www.topdelireshop.com ■ Visite combinée Aqualis + Château Thomas II : 3€ ■ CNCB AVIRON : Stages, initiations.. -

EXPERIENCE RHÔNE-ALPES.Pdf
Paris Strasbourg FRANCHE-COMTÉ eneva Paris ke G La BOURGOGNE Col de la Faucille Évian-les-Bains 1 323 m Gex Loire Thonon- is SWITZERLAND Saône se Aéroport la Bres les-Bains hab Mâcon A39 Parc Naturel international C de Genève HAUTE-SAVOIE A40 Régional A404 Genève Morzine du Haut-Jura Annemasse Bourg- Nantua Bellegarde Les Gets s en-Bresse Bonneville i la A40 is o A41 Samoëns j c a u s A410 A40 Milan e n n ea A6 b Aéroport d'Annecy n B a a Roanne m s Chamonix l o o B i B R D AIN v Mont-Blanc u t Villefranche- a n g Annecy La Clusaz r o en-Beaujolais Ain e A M y Lac Megève St-Gervais u L f d Clermont-Ferrand RHÔNE oir A42 d’Annecy ssi y a Mont Blanc e l M M A89 Lac du Bourget r 4 810 m A89 A o ' n d A41 l Col du Petit t A432 Parc Naturel a s Belley St-Bernard Aéroport V d international Aix-les- Régional Albertville 2 188 m A72 u F LYON de Lyon - Bains L o M LOIRE y Saint Exupéry Chambéry- des Bauges n r Beaufortai e o Savoie A430 e o z n A43 s Les Arcs n n La Tour- Chambéry i t Montbrison a ta s is du-Pin A43 n re d St-Étienne- Lac A43 Ta La Plagne u Bouthéon Val d’Isère A47 d’Aiguebelette Moûtiers Tignes F Vienne o Parc Col de l’Iseran r Méribel Courchevel e 2 770 m z Parc La Côte- Parc Naturel SAVOIE National St-Étienne A48 A43 c St-André Régional Ar Lac de Grangent Naturel Les Ménuires de la Vanoise Grenoble-Isère e Régional de Chartreuse n Val-Thorens n St-Jean- A7 ISÈRE o du Pilat A41 d de-Maurienne e M Modane ll a re e u Col du Annonay B rie A49 Isè nne Mont-Cenis AUVERGNE Valloire 2 081 m Grenoble Col du Villard- L’Alpe-d’Huez Galibier -

Du Bourget En Savoie
La pêche au lac du Bourget en Savoie www.savoiepeche.com Un lac remarquable Le Lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France (en volume) avec 3.6 milliards de m3 d’eau douce, soit l’équivalent de l’ensemble de la consommation annuelle domestique de France, grâce à des dimensions hors normes : 4 450 ha, longueur 18 km, largeur entre 1,6 et 3,5 km, profondeur moyenne de 85 m et 145 m au plus profond. La température de l’eau est d’environ 7 °C en janvier et de 23 °C en juillet. Ancré à 232 m d’altitude dans un cadre magnifique, il s’étire sur un axe Nord/Sud de la Chautagne avec le Rhône et ses marais jusqu’au Bassin Chambérien. Côté Ouest, la chaine de l’Epine et sa Dent du Chat (1 390 m), dernier contrefort du Jura, plonge directement dans le lac et forme une longue côte sauvage. Le rivage Est prend des allures de station balnéaire autour d’Aix-les-Bains. Pour autant, les Massifs de la Chambotte et des Bauges avec le Revard (1 562 m), qui surplombent cette cité thermale, sont là pour rappeler le contexte naturel et préservé du lac. Ce site abrite une faune sauvage très riche et variée. Plus de 20 000 oiseaux sont recensés chaque hiver sur l’eau, dans les grandes roselières et marécages des extrémités du lac. Ces zones sont aussi des lieux privilégiés pour la tortue cistude, réintroduite depuis 2000, mais également pour la reproduction de nombreuses espèces piscicoles. -

CARTE VÉLO CARTE E Du Chéran De-Chevelu 2 181M 2 198M Yenne 9 T 5
Marcellaz- D D en-Chautagne 5 Sales Albanais D 1 2 LÉGENDE • LEGEND 9 9 Montagny- Forêt 9 Les Clefs Départ 9 Départ D Menthon- D Rumilly les-Lanches Sévrier NANTUA ViaRhôna / Eurovelo 17 ARRIVÉe St-Bernard ANNECY Véloroutes 62 et 63 - Cycling routes 62 & 63 L Boussy a Véloroute 62 tracé provisoire - Temporary cycle route 62 c Domaniale 41 Étapes du Tour de France - Tour de France stages D D 904 5 Chapeiry 5 16 D Parcours athlétique - ChallengingD cycling routes D C Talloires 90 Culoz Le hé 4 r Ruffieux D a n D Parcours sportif - Sporty cycling routes 3 Quintal 9 ViaRhôna D 9 1 1 Parcours familial, plat et court - Family-friendly cycling routes D 150 909a La Tournette Col du Marais St-Sylvestre 8 Duingt 840m de Chautagne Véloroutes entre lacs et montagnes St-Jorioz 712 2 351m Réserve D Cycling routes between lakes and mountains E d 9 Marigny- 2 Naturelle 1 Vélo & Nature - Cycling and nature 912 ' Massingy St-Marcel 41 D A du Marais Col du Sapenay A 897 m Vélo & Gastronomie - Cycling and gastronomy n de Lavours D 57 Bloye n Cycling and heritage Vélo & Patrimoine - D TourVions de la Charvaz e Col de 9 c 1 01 la Forclaz 0 2 Alby- La Charvaz cycle circuit Les étapes mythiques du Tour de France D 1 y The mythical stages of the Tour de France sur-Chéran 1 150m Chindrieux 15 D 42 Serraval Parcours adaptés aux vélos à assistance électrique Montmin Cycling routes adapted to electric bikes 5 Viuz- Mûres D z 1 la-Chiésaz o D D 9 Plage - Baignades - Beach - Bathing n Crêt des Mouches 83 14 Taillefer 12 m Crêt de Entrevernes D e Lavours Chanaz Gare -

Le Lac Du Bourget
GITES-BAUGES.COM Gites au Châtelard (73 630), au cœur des Bauges. De 1 à 20 personnes. Nos tarifs de location Tel : 06 75 13 35 44 Le Lac du Bourget . Sentier sauvage en bordure du lac du Bourget. Un très beau lac, entre la Chaîne de l'Épine à l'ouest Le lac peut aussi s'admirer de plus haut. Depuis le et le Mont Revard à l'est. belvédère de la Chambotte, le relais du Mont du Chat Idéal avec de jeunes enfants ou une poussette. (vue à 360 ° du Mollard noir), ou du belvédère du Depuis la promenade en bordure du lac. PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos Revard. + roulette de la souris (ou flèches) pour le Le bord du lac entre Aix-les-Bains et le Viviers est Sur le tour du lac, pas moins de 10 plages sont défilement. aménagé au raz de l'eau. la promenade piétonne est aménagées pour la baignade. très agréable. Elle a été créée il y a quelques années lors du réaménagement routier du bord du lac. Plus loin, côté nord, vous pouvez continuer vers le petit port puis l'esplanade, le grand port, la baie de mémard et, depuis le printemps 2013, marcher jusqu'à la plage de Brison par un sentier qui passe sur 2 longues passerelles sur pilotis. Panorama sur le lac du Bourget. En hiver, les roselières. Depuis la piste piétonne. De nos gites, descendre sur Aix les Bains via La dent du Chat (1390m). Lescheraines, Cusy... puis prendre la direction Au sud, une vaste roselière appartenant au Chambéry jusqu'au Viviers du lac (pour la base des Conservatoire du littoral a été réaménagée, la zone Mottets) ou la direction Brison St Innocent (pour située à la pointe sud du lac (domaine de Buttet et rejoindre la plage de Brison, à la pointe de l'ardre). -

Le Lac Du Bourget, Un Lac Relique
Le lac du Bourget, un lac relique Le lac du Bourget, avec ses 18 km de longueur, ses 2,8 km de largeur maxi- male, ses 146 m d’eau dans sa plus grande profondeur et sa cote réglée à 231,5 m, n’est que le reliquat d’un vaste lac primitif, consécutif à la dernière gla- ciation. En effet, le plan d’eau du Bourget doit son existence au passage des glaciers alpins, à leur énorme pouvoir d’érosion capable de creuser un bassin (ombilic) bien au-dessous du verrou rocheux de Pierre-Châtel (La Balme), établi aujour- d’hui vers 223 m. Guidés par les struc- tures géologiques, les derniers glaciers de l’Isère au Sud et du Rhône au Nord, se sont affrontés vers Aix-les-Bains/Châ- tillon. Entre Bauges et Chartreuse puis dans les vallées synclinales molassiques du domaine jurassien, entre montagnes de Chambotte-Gros Foug et du Chat- Colombier puis montagnes de Parves et du Chat, le puissant surcreusement a été occupé par un lac de près de 47 km de long et de superficie voisine de 200 km 2, entre Challes-les-Eaux au Sud, Seyssel au Nord et Yenne à l’Ouest (fig. 1). – 70 000 à – 15 000. Les glaciers, d’âge würmien, ont creusé près de 450 m au- dessous de la plaine alluviale ancienne de la vallée d’alors si l’on se réfère aux banquettes préservées du Tremblay à La Motte-Servolex, de Chambéry-le-Vieux -Voglans, de Groisin à Chindrieux ou de la vierge d’Anglefort près de Seyssel.