GMJO 25 Juillet Ok
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mahler, Petra Lang, Royal Concertgebouw
Mahler Symphony No. 3 / Bach Suite mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Classical Album: Symphony No. 3 / Bach Suite Country: Europe Released: 2004 Style: Romantic, Modern MP3 version RAR size: 1829 mb FLAC version RAR size: 1389 mb WMA version RAR size: 1509 mb Rating: 4.4 Votes: 858 Other Formats: RA XM ADX MMF ASF APE VOC Tracklist Symphony No. 3 In D Minor 1-1 1. Kräftig - Entschieden 35:00 1-2 2. Tempo Di Menuetto. Sehr Mäßig 9:44 1-3 3. Comodo. Scherzando. Ohne Hast 17:25 2-1 4. Sehr Langsam. Misterioso - 'o Mensch! Gib Acht!' 10:11 5. Lustig Im Tempo Und Keck Im Ausdruck - 'bimm Bamm. .Es 2-2 10:18 Sungen Drei Engel' 2-3 6. Langsam. Ruhevoll. Empfunden 23:10 Bach Suite (Arr. Mahler) 2-4 1. Overture 6:32 2-5 2. Rondeau - Badinerie 3:45 2-6 3 Air 5:06 2-7 4. Gavottes 1. And 2. 3:37 Companies, etc. Phonographic Copyright (p) – Decca Music Group Limited Copyright (c) – Decca Music Group Limited Recorded At – Grote Zaal, Concertgebouw, Amsterdam Credits Arranged By – Gustav Mahler (tracks: 2-4 to 2-7) Choir – Netherlands Children's Choir (tracks: 1 to 2-3), Prague Philharmonic Choir* (tracks: 1 to 2-3) Composed By – Gustav Mahler (tracks: 1 to 2-3), Johann Sebastian Bach (tracks: 2-4 to 2-7) Conductor – Riccardo Chailly Edited By – Ian Watson , Jenni Whiteside Engineer – Andrew Hallifax (tracks: 1-1 to 2-3), Graham Meek (tracks: 2-4 to 2-7) Executive Producer – Andrew Cornall Liner Notes – Donald Mitchell Mezzo-soprano Vocals – Petra Lang (tracks: 1 to 2-3) Mixed By – Jonathan Stokes Orchestra – Royal Concertgebouw Orchestra* Notes - Recording dates: 5-9 May 2003 (Symphony No. -

Kurt Hübner- Der Intendant
Kurt Hübner- Der Intendant Seine Stationen: Ulm- 1959-1962 Bremen- 1962-1973 Berlin- 1973-1986 1 ANHANG 1959-1986: DIE AUFFÜHRUNGEN DER INTENDANTENZEIT KURT HUBNERS I. ULM 1959-1962 Das Ensemble Schauspiel (Herren) Schauspiel (Damen) Oper I Operette Oper I Operette Peter Böhlke Elisabeth Botz (Herren) (Damen) Kar! Heinz Bürkel Käthe Druba Lambertus Bijnen Lisa Anders Will Court Angela Gotthardt Kari-Heinz von Eicken Helen Borbjerg Josef Gessler Friede! Heizmann Helmuth Erfurth Anita Butler Joachim Giese Hannelore Hoger George Fortune RuthConway Günter Hanke Alke Hoßfeld Jan Gabrielis Irmgard Dressler Hans-H. Hassenstein Elisabeth Karg Josef Gessler Josette Genet-Bollinger Valentin Jeker Maria-Christina Müller Peter Haage Marjorie Hall Rolf Johanning Elisabeth Orth Kar! Hauer Rita Hermann Norbert Kappen Helga Riede! J osef Kayrooz Marian Krajewska Jon Laxdall Ursula Siebert Bernd Küpper Liane Lehrer Georg von Manikowski Katharina Tüschen Bill Lucas Christine Mainka Dieter Möbius Erika Wackernagel Fritz Neugebauer Gertrud Probst Siegfried Munz Sabine Werner Richard Owens Gertrud Romvary Walther Fr. Peters Fritz Peter Ursula Schade Rudolf Peschke Heinrich Reckler Ingeborg Steiner Hans Jakob Poiesz Herbert Reiter Patricia Hyde Thomas Friedhelm Ftok Heinz Röthig Eva-Maria Wolff Willi Ress Hermann Runge Hermann Schlögl Fred Straub Hermann Schober Walter Voges Alois Strempel Heinz Weigand Peter Striebeck Kar! Schurr Rainald Walter RolfWiest 2 SPIELZEIT 1959/60 das zu überwinden, was gegen die Figur des Posa, die naive Leichtgläubigkeit des Carlos Carl Maria von Weber: und gegen andere alogische Entwicklungen Der Freischütz (29. 8. 59) gesagt werden kann. Schillers Feuerodem, ML: Harald von Goertz; 1: JosefWitt; hier zum erstenmal in reine, gehämmerte B: Hansheinrich Palitzsch Verse gebändigt, überall diese Bedenklich keiten siegen zu Jassen, fast möchte man Friedrich Schiller: Don Carlos (3. -

Sir Colin Davis Anthology Volume 1
London Symphony Orchestra LSO Live Sir Colin Davis Anthology Volume 1 Sir Colin Davis conductor Colin Lee tenor London Symphony Chorus London Symphony Orchestra Hector Berlioz (1803–1869) – Symphonie fantastique, Op 14 (1830–32) Recorded live 27 & 28 September 2000, at the Barbican, London. 1 Rêveries – Passions (Daydreams – Passions) 15’51’’ Largo – Allegro agitato e appassionato assai – Religiosamente 2 Un bal (A ball) 6’36’’ Valse. Allegro non troppo 3 Scène aux champs (Scene in the fields) 17’16’’ Adagio 4 Marche au supplice (March to the Scaffold) 7’02’’ Allegretto non troppo 5 Songe d’une nuit de sabbat (Dream of the Witches’ Sabbath) 10’31’’ Larghetto – Allegro 6 Hector Berlioz (1803–1869) – Overture: Béatrice et Bénédict, Op 27 (1862) 8’14’’ Recorded live 6 & 8 June 2000, at the Barbican, London. 7 Hector Berlioz (1803–1869) – Overture: Les francs-juges, Op 3 (1826) 12’41’’ Recorded live 27 & 28 September 2006, at the Barbican, London. Hector Berlioz (1803–1869) – Te Deum, Op 22 (1849) Recorded live 22 & 23 February 2009, at the Barbican, London. 8 i. Te Deum (Hymne) 7’23’’ 9 ii. Tibi omnes (Hymne) 9’57’’ 10 iii. Dignare (Prière) 8’04’’ 11 iv. Christe, Rex gloriae (Hymne) 5’34’’ 12 v. Te ergo quaesumus (Prière) 7’15’’ 13 vi. Judex crederis (Hymne et prière) 10’20’’ 2 Antonín Dvořák (1841–1904) – Symphony No 9 in E minor, Op 95, ‘From the New World’ (1893) Recorded live 29 & 30 September 1999, at the Barbican, London. 14 i. Adagio – Allegro molto 12’08’’ 15 ii. Largo 12’55’’ 16 iii. -

Summer 2009 —Dir Werf’ Ich’S Zu— Volume 6, Number 3 Weisst Du Wie Das Wird? –Götterdämmerung
Wagneriana Singe, Schwester, Summer 2009 —dir werf’ ich’s zu— Volume 6, Number 3 weisst du wie das wird? –Götterdämmerung From the Editor he May 23 Wagner and Strauss concert went spectacularly well. On the program were Strauss’s enchanting Vier letzte Lieder (Four Last Songs), as T well as his “Ruhe, meine Seele” (Rest, My Soul), “Wiegenlied” (Cradle Song), and “Zueignung” (Dedication). Excerpts from Wagner’s Tannhäuser and Die Walküre in the second half provided much enjoyment. In addition to his ex- pert accompaniment of soprano Julia Rolwing, pianist Lloyd Arriola performed Liszt’s powerful transcriptions of Tannhäuser. This concert offered a sophisti- cated sampling of some the best vocal German music. Rolwing, who sang the Strauss songs for only the second time in her career, demonstrated great agility, flexibility, and tonal accuracy as she swooped up and down the scales of these exquisite lieder. And in Wagner’s excerpts, she evinced a wonderful combina- tion of great sweetness and heroic flair, charming her audience with her sensitiv- Julia Rolwing beams ity, dramatization, and expressivity. Hers is a multicolored timbre that is very at the applause (Concert photos by pleasant to hear. Thomas Kwei) Arriola’s performance of the Tannhäuser piano transcriptions by Liszt elicited a standing ovation from the audience. And his accom- paniment was delicate and attentive, providing solid, artful support for Rolwing. Despite the holiday weekend (Memorial Day), attendance was good. The concert was featured in the Boston Globe three times in the days leading up to the event and was advertised on WGBH and WHRB. -

660374-75 Bk Rheingold EU
WAGNER DIE WALKÜRE Matthias Goerne Michelle DeYoung Stuart Skelton Heidi Melton Petra Lang Hong Kong Philharmonic Orchestra Jaap van Zweden CD 1 67:15 # War Wälse dein Vater, und bist du ein Wälsung? 2:02 Die Walküre (Sieglinde, Siegmund) (The Valkyrie) Act I $ Siegmund den Wälsung siehst du, Weib! 2:24 (Siegmund, Sieglinde) The First Day 1 Vorspiel (Prelude) 3:50 of Der Ring des Nibelungen Scene 1 CD 2 51:50 (The Ring of the Nibelung) 2 Wes Herd dies auch sei 8:53 by (Siegmund, Sieglinde) Act II 1 Vorspiel (Prelude). Scene 1 Richard Wagner 3 Einen Unseligen labtest du 3:20 (1813-1883) (Siegmund, Sieglinde) Nun zäume dein Roß 2:44 (Wotan) Scene 2 Siegmund . Stuart Skelton, Tenor 2 Hojotoho! Hojotoho! 2:15 (Brünnhilde) Sieglinde . Heidi Melton, Soprano 4 Müd am Herd fand ich den Mann 5:10 (Sieglinde, Hunding, Siegmund) Hunding . Falk Struckmann, Bass-baritone 3 Der alte Sturm, die alte Müh’! 5:07 Wotan . Matthias Goerne, Baritone (Wotan, Fricka) 5 Friedmund darf ich nicht heißen 6:29 Brünnhilde . Petra Lang, Soprano (Siegmund, Hunding) Fricka . Michelle DeYoung, Mezzo-soprano 4 So ist es denn aus mit den ewigen Göttern 9:30 (Fricka, Wotan) Waltraute . Sarah Castle, Mezzo-soprano 6 Die so leidig Los dir beschied 4:39 Gerhilde . Karen Foster, Soprano (Hunding, Sieglinde, Siegmund) 5 Was verlangst du? 2:42 Helmwige . Katherine Broderick, Soprano (Wotan, Fricka, Brünnhilde) Schwertleite . Anna Burford, Mezzo-soprano 7 Ich weiß ein wildes Geschlecht 5:17 (Hunding) Ortlinde . Elaine McKrill, Soprano 6 Deiner ew’gen Gattin heilige Ehre 3:27 Siegrune . Aurhelia Varak, Mezzo-soprano Scene 3 (Fricka, Wotan) Grimgerde . -

WAGNER NEWS Wagner News Is Published by the TORONTOWAGNER SOCIETY
DECEMBER 2015 - APRIL 2016 WAGNER NEWS Wagner News is published by the TORONTOWAGNER SOCIETY TWS web site: www.torontowagner.org TWS CALENDAR E-mail: [email protected] Our Winter season begins with a very special event: Monday François Girard, (the director of Siegfried), and Sue January 18 Elliott, (educator and pre-performance speaker, 8.00 p.m. Royal Conservatory of Music), “In Conversation - Directing Wagner Operas”. Friday Siegfried Singers’ Roundtable, with Stefan Vinke, February 12 8.00 p.m. Christine Goerke, Alan Held, Wolfgang Ablinger- Sperrhacke and other members of the Siegfried cast. Brett Polegato in Conversation; Canadian lyric Monday March 7 baritone, well known for many roles, including 8.00 p.m. Kurwenal. Monday Barry Millman, a TWS member will present April 18 8.00 p.m. Wagner’s Ring by way of the Postcard, featuring his postcard collection that goes back to the 1800’s. Meetings at Arts and Letters Club, 14 Elm Street Stephan Bonfield From Gods to Mortals; Exploring Human Identity and Memory in Siegfried; INSIDE Frances Henry, Richard Rosenman, Pierre Couture News and Comments; Wagner on Stage; 2 Stephan Bonfield From Gods to Mortals; Exploring Human Identity and Memory in Siegfried When we first meet the hero Siegfried, it is difficult at first to recognize in him a character we could hardly believe we will come to know all too well: a man-child- demigod who seeks knowledge of his own past and identity from a dwarf who can tell him very little about either. What little Mime does know he buttresses with untruths, such as claiming to be both Siegfried's father and mother, in a petulant and often fitful manner to control the young man so as to use him for his own sinister purposes to acquire the Ring. -

Building a Library
BUILDING A LIBRARY All selections were made from recordings available in the UK at the time of the broadcast and are full price unless otherwise stated. CD Review cannot guarantee that they have not subsequently been deleted. KEY: CD = compact disc c/w = coupled with SIS = a recording which is only available through EMI’s Special Import Service IMS = a recording which is only available through Universal Classics' Import Music Service CONTENTS September 1999 – July 2000 .................................................................................................................................................................................. 2 September 2000 – July 2001 ................................................................................................................................................................................ 23 September 2001 – July 2002 ................................................................................................................................................................................ 45 September 2002 – July 2003 ................................................................................................................................................................................ 73 September 2003 – July 2004 ................................................................................................................................................................................ 97 September 2004 – July 2005 ............................................................................................................................................................................. -
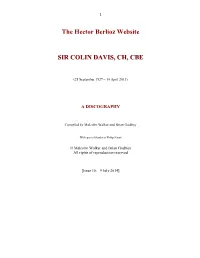
Sir Colin Davis Discography
1 The Hector Berlioz Website SIR COLIN DAVIS, CH, CBE (25 September 1927 – 14 April 2013) A DISCOGRAPHY Compiled by Malcolm Walker and Brian Godfrey With special thanks to Philip Stuart © Malcolm Walker and Brian Godfrey All rights of reproduction reserved [Issue 10, 9 July 2014] 2 DDDISCOGRAPHY FORMAT Year, month and day / Recording location / Recording company (label) Soloist(s), chorus and orchestra RP: = recording producer; BE: = balance engineer Composer / Work LP: vinyl long-playing 33 rpm disc 45: vinyl 7-inch 45 rpm disc [T] = pre-recorded 7½ ips tape MC = pre-recorded stereo music cassette CD= compact disc SACD = Super Audio Compact Disc VHS = Video Cassette LD = Laser Disc DVD = Digital Versatile Disc IIINTRODUCTION This discography began as a draft for the Classical Division, Philips Records in 1980. At that time the late James Burnett was especially helpful in providing dates for the L’Oiseau-Lyre recordings that he produced. More information was obtained from additional paperwork in association with Richard Alston for his book published to celebrate the conductor’s 70 th birthday in 1997. John Hunt’s most valuable discography devoted to the Staatskapelle Dresden was again helpful. Further updating has been undertaken in addition to the generous assistance of Philip Stuart via his LSO discography which he compiled for the Orchestra’s centenary in 2004 and has kept updated. Inevitably there are a number of missing credits for producers and engineers in the earliest years as these facts no longer survive. Additionally some exact dates have not been tracked down. Contents CHRONOLOGICAL LIST OF RECORDING ACTIVITY Page 3 INDEX OF COMPOSERS / WORKS Page 125 INDEX OF SOLOISTS Page 137 Notes 1. -

Ivan Fischer Started As Music Director of the Konzerthaus Berlin and Principal Conductor of the Konzerthausorchester Berlin
CHANNEL CLASSICS Wagner CCS SA 32713 Götterdämmerung Die Meistersinger von Nürnberg (excerpts) Siegfried – Idyll BUDAPEST FESTIvanI VAL ORCHESTRA Fischer Petra Lang, soprano Recording session (photo Channel Classics) Iván Fischer & Budapest Festival Orchestra ván Fischer is founder and Music Director of the Budapest Festival Orchestra. This partnership Ihas become one of the greatest success stories in the past 25 years of classical music. Intense international touring and a series of acclaimed recordings for Philips Classics, later for Channel Classics have contributed to Iván Fischer’s reputation as one of the world’s most visionary and successful orchestra leaders. He has developed and introduced new types of concerts, ‘cocoa-concerts’ for young children, ‘surprise’ concerts where the programme is not announced, ‘one forint concerts’ where he talks to the audience, open-air concerts in Budapest attracting tens of thousands of people, and he staged successful opera performances. He has founded several festivals, including a summer festival in Budapest on baroque music and the Budapest Mahlerfest which is also a forum for commissioning and presenting new compositions. As a guest conductor Fischer works with the finest symphony orchestras of the world. He has been invited to the Berlin Philharmonic more than ten times, he leads every year two weeks of programs with the Royal Concertgebouw Orchestra, and appears with leading us symphony orchestras, including the New York Philharmonic and the Cleveland Orchestra. Earlier music director of Kent Opera and Lyon Opera, Principal Conductor of National Symphony Orchestra in Washington dc, his numerous recordings have won several prestigious international prizes. Iván Fischer studied piano, violin, cello and composition in Budapest, continuing his education in Vienna in Professor Hans Swarowsky’s conducting class. -

Orchestre Français Des Jeunes Petra Lang Fabien Gabel Jeudi 13 Décembre 2018 – 20H30
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE Orchestre français des jeunes Petra Lang Fabien Gabel Jeudi 13 décembre 2018 – 20h30 NPGS_13-12_20h30_Petra Lang_19154.indd 1 10/12/18 10:36 Ce concert est enregistré par France Musique. NPGS_13-12_20h30_Petra Lang_19154.indd 2 10/12/18 10:36 PROGRAMME Richard Wagner Ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg Clemens Krauss Huit Lieder sur des poèmes de Rainer Maria Rilke – extraits (orchestration de Michael B. Weiss) Richard Strauss Die heil’gen drei Kön’ge aus Morgenland Morgen! Wiegenlied Cäcilie ENTRACTE Igor Stravinski Le Chant du rossignol Claude Debussy La Mer Orchestre français des jeunes Fabien Gabel, direction Petra Lang, soprano Coproduction Orchestre français des jeunes, Philharmonie de Paris. FIN DU CONCERT VERS 22H30. Livret en page 24. NPGS_13-12_20h30_Petra Lang_19154.indd 3 10/12/18 10:36 LES œUVres Richard Wagner (1813-1883) Ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg Composition : 1861-1867, mais projeté dès 1845. Création : le 21 juin 1868 au Hoftheater de Munich, sous la direction de Hans von Bülow. Effectif : 3 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons – 4 cors, 5 trompettes, 2 trombones, tuba basse – timbales, triangle, tambour, cymbales – harpe, luth – cordes. Durée : environ 15 minutes. La découverte, en 1845, du personnage historique de Hans Sachs, « der- nière incarnation de l’esprit populaire artistiquement créateur en art » (Une communication à mes amis, 1851), pousse Wagner à esquisser les grandes lignes des Maîtres chanteurs de Nuremberg ; s’il faut attendre les années 1860 et la composition de Lohengrin, de Tristan et Isolde et d’une grande partie de la Tétralogie pour que le compositeur s’y attelle véritablement, la thématique principale, elle, est déjà présente : réflexion sur l’art, l’opéra prône la réconciliation entre tradition (représentée par la confrérie des maîtres chanteurs) et nouveauté (incarnée par le jeune Walther). -

Berlioz's Les Troyens
Berlioz’s Les Troyens - A Survey of the Discography by Ralph Moore In over a hundred years of recording history, there have been no more than forty recordings of Berlioz’ epic masterpiece in any form – excerpts, complete, in French, English and several other languages – and there are reasons for that comparative paucity of output. Of those, only two are complete studio recordings in French, as Scherchen’s 1952 set is just Part 2, Les Troyens à Carthage. There are, however, also a couple of complete, live, modern recordings in French, whose digital sound is virtually as good as the studio versions; otherwise, despite individual gems, the catalogue offers a limited choice if you apply the reasonable criteria of wanting a complete performance in good sound performed in French by first-rate singers. Fortunately, we are not bereft of worthy accounts: those remaining options are generally attractive and there is also a range of excellent supplementary recordings. Les Troyens is challenging to stage as well as sing; it essentially combines two operas running for a total of four hours and as such a stage production is at least the equivalent of mounting Götterdämmerung - and you need two prima donnas, not just one. I am of the not especially controversial opinion that the best music is in the second half of an opera, which is why that was first performed. The Trojan first part is necessarily more jagged and violent apart from interludes such as the lovely duet between Cassandre and Chorèbe, whereas the Carthage action contains more which is lyrical or reflective. -

Sinfónico 2 Programa De Mano
2 CICLO SINFÓNICO / 17 Y 20 OCT ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA DAVID AFKHAM DIRECTOR PETRA LANG SOPRANOVIOLETA URMANA MEZZOSOPRANO FRANK VAN AKEN TENOR ROMAN SADNIK TENOR ROGER PADULLÉS TENOR BOAZ DANIEL BARÍTONO ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES BARÍTONO BRINDLEY SHERRATT BAJO PEDRO CHAMIZO PUESTA EN ESCENA TEMPORADA 19/20 PARADIGMAS S. M. LA REINA ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA DE ESPA ÑA TEMPORADA 19/20 PARADIGMAS PRESIDENCIA DE HONOR 2 CICLO SINFÓNICO 17 Y 20 OCT AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA SALA SINFÓNICA Las imágenes que ilustran la temporada 2019/2020 «Paradigmas» proceden de la colección de Getty Images y son en sí mismas un abrazo al mundo de la naturaleza y la ciencia, un nexo de unión entre ambos. Imágenes de medusas cuyos tentáculos parecen diluirse en los fondos marinos, insectos de estructuras complejas y exactas formadas por millones de tonalidades o microorganismos cuyas arquitecturas inspiranel desarrollo de nuevos sistemas y metodologías. El espectador es invitado a un viaje en el que las disciplinas se fusionan para recorrer un camino hacia el conocimiento de la música, sublime e hipnótica forma de expresión. El propósito es reflexionar sobre el ser humano, la ciencia, el arte y la eternidad. Sobre los modelos que nos llevan a alcanzar la genialidad,vertebrarla y traspasarla. 2 — TEMPORADA 19/20 PARADIGMAS 3 — NOTAS AL PROGRAMA DAVID AFKHAM CICLO SINFÓNICO ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO DAVID AFKHAM DIRECTOR JOSEP PONS DIRECTOR HONORARIO JUANJO MENA Petra Lang (Isolda) SOPRANO RICHARD