Femmes Parlementaires Dans La Belgique De La Question Royale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'homme Politique Belge Belgian Man of Politics De Belgische Politieke
L’homme © Belga FR politique belge Paul-Henri Spaak (Schaerbeek, 1899 – Bruxelles, 1972) voit le jour dans une famille très présente dans la vie politique et culturelle du pays. Son père, Paul Spaak (1870-1936), avocat de formation, brille dans le monde de la dramaturgie. Sa mère, Marie Janson, est la fille de Paul Janson, le puissant tribun libéral progressiste, à la pointe du combat pour le suffrage universel, et la sœur du ministre Paul-Emile Janson. Elue au Sénat dès 1921, Marie Spaak-Janson sera la première femme parlementaire de Belgique. Docteur en droit de l’Université de Bruxelles (1921), Paul-Henri Spaak acquiert une notoriété précoce en plaidant brillamment des causes retentissantes comme celle de l’anarchiste De Rosa, auteur d’un attentat manqué contre le prince Umberto d’Italie, fiancé de la princesse Marie-José, en 1929. Engagé en politique au sein du Parti ouvrier belge (P.O.B.) où il fait ses armes en tant que chef de cabinet adjoint du ministre Joseph Wauters, chargé du travail et de la prévoyance sociale (1925-1927), il s’y montre un pacifiste résolu, prend des positions perçues comme révolutionnaires par nombre de ses pairs, au point de frôler l’exclusion de son parti. Cela ne l’empêche pas d’entamer une carrière politique nationale qui s’avère prometteuse. Elu représentant de l’arrondissement de Bruxelles dès 1932, il entre trois ans plus tard dans le premier gouvernement Van Zeeland, assumant durant quinze mois les fonctions de ministre des transports et des P.T.T. En 1936, il accède pour la première fois au ministère des affaires étrangères dans Paul-Henri Spaak, Ministre des un contexte politique européen difficile marqué par la montée des extrémismes de droite comme de gauche. -

Belgian Polities in 1988 Content 1. the Painstaking Forming of The
Belgian Polities in 1988 Content 1. The painstaking forming of the Martens VIII Cabinet 303 A. The forming of regional governments complicates the making of a national cabinet . 303 B. The information mission of Dehaene 305 C. Dehaene's formation mission . 305 D. Martens VIII wins vote of confidence in Parliament 308 ll. Phase one of the constitutional reform 309 A. The amendment of seven constitutional articles 309 B. The special August 8, 1988 Act. 310 C. The bill on the language privileges . 312 111. The second phase of the constitutional reform 314 A. The new politica! status of the Brussels Region 314 B. The Arbitration Court . 315 C. The regional financing law. 315 D. Consultation and meditation 316 IV. The municipal elections, the government reshuffle and the debt of the larger cities 317 A. The municipal elections, Fourons and municipalities with special language status 317 B. The government reshuffle . 318 C. The debt of the larger cities 318 V. The social and economie policy of the Martens VIII cabinet 319 A. The 1988 and 1989 budgets 319 B. Tax reform 320 C. Labor Relations-Public Service Strikes-Health lnsurance 321 Vl. Foreign Affairs and Defense. 323 A. Foreign Affairs 323 B. Defense . 325 VII. lnternal politica! party developments. 325 Belgian polities in 1988 by Ivan COUTTENIER, Licentiate in Politica) Science During the first four months of 1988, Belgium witnessed the painstaking for mation of the Martens VIII center-left Cabinet. In October 1987, the Christian Democratic-Liberal Martens VI Cabinet had been forced to resign over the pe rennial Fourons affairs. -

L[Ffiffi&Ffiy
Wenof Eurore Brusselr, 15 Xoverbcr f983/15 Jaurryr 1984, n'33 (bi-nonthly) L[ffiffi&ffiY EUROP$AN CO|!;I}1UiiIil E,mP-{ LEffiffiffiE IJ|FORMATI0N SIRYiCI i trYA$HINGTON, D. O. This bulle tin is published by the OOiIMISSION OF THE EUROPEAN @MMUIITTIES Directorate-General I ntormation € Informalion for Women's organisations and press Rue de la Loi 200 8-1049 - Erussels - Te|,23511 11 Vomen of Europe tlr,. 3? - 15 t{ovember l9t3l15 January l9t4 - p. 2 IN THXS XSSUE The changing European CommunitY 3 Parental leave 4 Eurobarometer 6 Womenfs unemPloYment 8 The Equal Opportunities Committee l0 Women of Spain ll Local and regional elected representatives 14 European Parliament October 1983 session T7 November 1983 session t9 December 1983 session 2T Parliamentary Committee of Inquiry 24 European Court of Justice 25 Facts, Institutions and Laws 26 June r84: European Elections 43 Militant activities 44 Reseach, Meetings and Books 62 Our correspondents in the Community Belgium Nanette Nannan, 33 Rue E. Bouillot, Boite 9, 1060 Brussels Denmark Danske Kvinders Nationalraad, N. Hemmingsensgade 8, ll53' CoPenhagen France Jeanne Chaton, 43 Avenue Ernest Reyer, 75014 Paris Greece Effi Kalliga-Kanonidou, l0 Neofytou Douka St, 106 74 Athens Germany Christa Randzio-Plath, Hadermanns Yleg 2), 2 Hamburg 6l Ireland Janet Martin, 2 Clarement Close, Glasvenin, Dublin ll Italy Beatrice Rangoni Macchiavelli, Piazza di Spagna 51' 00187 Rome Luxembourg Alix Wagnerr T rue Henri Frommes, 1545 Luxembourg Netherlands Marjolijn Uitzinger, Fivelingo 207, Tnetermeer United Kingdom Pegty Crane, 12 Grove Park Road, Chiswick, London V4 European Lidya Gazzor lT Avenue de Tourville, 75007 Paris Parliament Editor: Fausta Deslpnmes krlormation for womenrs associations and press 200 Rue de la Loi' 1049 Brussels Editorial work on this issue of "Women of Europe" was Completed on 19 December 1983. -

Wilfried Martens
Wilfried Martens „WITHOUT THE CDU THE EPP WOULD NOT BE WHAT THE PARTY IS TODAy” Wilfried Martens, geboren am 19. April 1936 im belgischen Sleidinge, Studium der Rechtswissenschaften an der Katholischen Universität Leuven, 1960 Promotion zum Dr. jur., Mitglied und später Präsident der Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond, 1960–1965 praktizierender Rechtsanwalt, 1965 Berater des belgischen Premierministers Pierre Harmel,552 1966 Berater von Premierminister Paul Vanden Boeynants,553 1968 Sonderbeauftragter für Gemeinschaftsangelegenheiten unter Premierminister Leo Tindemans, 1974–1991 Mitglied der belgischen Abgeordnetenkammer, 1979–1981 und 1981–1992 Premierminister Belgiens, seit 1990 Präsident der EVP, 1991–1994 Senator, 1993–1996 Präsident der EUCD, 1994–1999 Mitglied des EP, Faktionsvorsitzender der EVP. Das Interview fand am 31. Mai 2012 in Brüssel statt und wurde geführt von Marcus Gonschor und Hinnerk Meyer. Mr President, you were born in Sleidinge in 1936. Could you please tell us something about your origins, your parental home and your time in school? I was born on a very small farm in the outskirts of the local community or local commune in Sleidinge. I was born in 1936. I remember the beginning of the war in 1940. I was on a bicycle with a young girl trans- 552 | Pierre Harmel (1911–2009), belgischer Politiker der PSC, 1965/66 Premierminister, 1966–1972 Außenminister seines Landes. 553 | Paul Vanden Boeynants (1919–2001), belgischer Politiker der PSC, 1966–1968 und 1978/79 Premierminister seines Landes. 622 porting me to the kindergarten. She said to me: ”Look in the sky! There are planes.” That was the beginning of the war. I have this memory still vivid. -

Ed.) the Civilising Offensive New Perspectives on the History of Liberalism and Freethought
Christoph De Spiegeleer (Ed.) The Civilising Offensive New Perspectives on the History of Liberalism and Freethought Edited by Liberas/Liberaal Archief Guaranteed Peer Review Series Volume 1 The Civilising Offensive Social and Educational Reform in 19th-century Belgium Edited by Christoph De Spiegeleer ISBN: 978-3-11-057842-3 e-ISBN (PDF): 978-3-11-058154-6 e-ISBN (EPUP): 978-3-11-057917-8 This publication is graciously funded by Liberas/Liberaal Archief. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Interational License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 2018958370 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Dining hall open-air school Diesterweg in Heide-Kalmthout (1904–1930), Liberas/Liberaal Archief Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com TableofContents Christoph De Spiegeleer 1New Perspectives on Social and EducationalReform during the Long Nineteenth Century.AnIntroduction 1 Part I Social-Pedagogical PerspectivesonSocial and Educational Reform Lieselot De Wilde, Bruno Vanobbergen &Michel Vandenbroeck 2 “On voit bien que c′est un petitmalheureux des Hospices”.The Child, the Body and the Bath in Nineteenth-Century Belgium: aCurefor -

Branding Brussels Musically: Cosmopolitanism and Nationalism in the Interwar Years
BRANDING BRUSSELS MUSICALLY: COSMOPOLITANISM AND NATIONALISM IN THE INTERWAR YEARS Catherine A. Hughes A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music. Chapel Hill 2015 Approved by: Annegret Fauser Mark Evan Bonds Valérie Dufour John L. Nádas Chérie Rivers Ndaliko © 2015 Catherine A. Hughes ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Catherine A. Hughes: Branding Brussels Musically: Cosmopolitanism and Nationalism in the Interwar Years (Under the direction of Annegret Fauser) In Belgium, constructions of musical life in Brussels between the World Wars varied widely: some viewed the city as a major musical center, and others framed the city as a peripheral space to its larger neighbors. Both views, however, based the city’s identity on an intense interest in new foreign music, with works by Belgian composers taking a secondary importance. This modern and cosmopolitan concept of cultural achievement offered an alternative to the more traditional model of national identity as being built solely on creations by native artists sharing local traditions. Such a model eluded a country with competing ethnic groups: the Francophone Walloons in the south and the Flemish in the north. Openness to a wide variety of music became a hallmark of the capital’s cultural identity. As a result, the forces of Belgian cultural identity, patriotism, internationalism, interest in foreign culture, and conflicting views of modern music complicated the construction of Belgian cultural identity through music. By focusing on the work of the four central people in the network of organizers, patrons, and performers that sustained the art music culture in the Belgian capital, this dissertation challenges assumptions about construction of musical culture. -
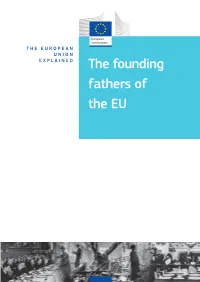
The Founding Fathers of the EU the European Union Explained
THE EUROPEAN UNION EXPLAINED The founding fathers of the EU THE EUROPEAN UNION EXPLAINED This publication is a part of a series that explains what the EU does in different policy areas, why the EU is involved and what the results are. You can see online which ones are available and download them at: http://europa.eu/pol/index_en.htm How the EU works Europe 2020: Europe’s growth strategy The founding fathers of the EU Agriculture Borders and security Budget Climate action Competition Consumers Culture and audiovisual The European Union explained: Customs The founding fathers of the EU Development and cooperation Digital agenda European Commission Economic and monetary union and the euro Directorate-General for Communication Education, training, youth and sport Publications Employment and social affairs 1049 Brussels Energy BELGIUM Enlargement Enterprise Manuscript completed in May 2012 Environment Fight against fraud Photos on cover and page 2: © EU 2013- Corbis Fisheries and maritime affairs Food safety 2013 — pp. 28 — 21 x 29.7 cm Foreign affairs and and security policy ISBN 978-92-79-28695-7 Humanitarian aid doi:10.2775/98747 Internal market Justice, citizenship, fundamental rights Luxembourg: Publications Office of the European Union, Migration and asylum 2013 Public health Regional policy © European Union, 2013 Research and innovation Reproduction is authorised. For any use or reproduction Taxation of individual photos, permission must be sought directly Trade from the copyright holders. Transport THE founding fathers OF THE EU The founding fathers of the EU Over half a century ago a number of visionary fathers were a diverse group of people who held leaders inspired the creation of the European the same ideals: a peaceful, united and Union we live in today. -

People's News
PEOPLE’S NEWS pm News Digest of the People’s Movement www.people.ie | [email protected] No. 126 31 May 2015 EU development ministers put profits projects. This shift towards private-sector and privatisation first finance risks putting public services out of reach for the poorest people, who are unable EU development ministers have adopted a joint to pay the user fees associated with it. The position on how to finance the planned private sector cannot, and should not, replace sustainable development goals before the governments’ duty of providing essential conference on Financing for Development in services, such as health services and education, July in Addis Ababa. The stated aim is not only especially when there are no safeguards to to end poverty in all forms everywhere by 2030 ensure that this is done responsibly. but also to introduce specific environmental and social goals, such as reducing economic Joe Costello (Labour Party), minister for inequality. state at the Department of Foreign Affairs and Trade with responsibility for trade and develop- The content of the sustainable develop- ment, was part of the decision-making process. ment goals will be decided at a UN summit meeting in New York in September, which is The EU is also trying to sell its ailing carbon- intended to set the international development trading system to developing countries as a way agenda for the next fifteen years. Decisions on to curb emissions. It would be more convincing how to finance the goals will be made at the if it spent the revenue wisely, spending some of summit meeting in Ethiopia. -

Paul–Henri Spaak: a European Visionary and Talented Persuader
Paul–Henri Spaak: a European visionary and talented persuader ‘A European statesman’ – Belgian Paul-Henri Spaak’s long political career fully merits this title. Lying about his age, he was accepted into the Belgian Army during the First World War, and consequently spent two years as a German prisoner of war. During the Second World War, now as foreign minister, he attempted in vain to preserve Belgium’s neutrality. Together with the government he went into exile, first to aris, and later to London. After the liberation of Belgium, Spaak ser ed both as Foreign Minister and as Prime Minister. Even during the Second World War, he had formulated plans for a © Nationaal Archief/Spaarnestad Photo Archief/Spaarnestad © Nationaal merger of the Benelux countries, and directly after the war he campaigned or the Paul-Henri Spaak 1899 - 1972 unification of Europe, supporting the European Coal and Steel Community and European defence community. For Spaak, uniting countries through binding treaty obligations was the most effective means of guaranteeing peace and stability. He was able to help achieve these aims as president of the first full meeting of th United Nations (1946) and as Secretary General of NATO (1957-61). Spaak was a leading figure in ormulating the content of the Treaty of Rome. At the ‘Messina Conference’ in 1955, the six participating governments appointed him president of the working committee that prepared the Treaty. Rise through Belgian politics Born on 25 January 1899 in Schaerbeek, Belgium, Paul-Henri Spaak Germans and spent the next two years imprisoned in a war camp. -

Europe 1918 – 2018 – 2118
14th Conference of European Regions and Cities Europe 1918 – 2018 – 2118 from Sunday, 30th September 2018 until Tuesday, 2nd October2018 Salzburg Congress, Austria Under the Honorary Patronage of Alexander van der Bellen President of the Republic of Austria Honorary Committee Sebastian Kurz, Chancellor of the Republic of Austria Johannes Hahn, EU Commissioner for European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations Gernot Blümel, Federal Minister for EU, Arts, Culture and Media, Vienna, Austria Wilfried Haslauer, Governor of Salzburg Karl-Heinz Lambertz, President of the European Committee of the Regions Harald Preuner, Mayor of the City of Salzburg Shortly after the informal meeting of the Heads of State and Government of the EU Member States on 20th of September 2018 in Salzburg, from 30th September to 2nd October 2018 – also in Salzburg – within the framework of and in cooperation with the Austrian EU Presidency, the 14th Conference of European Regions and Cities of the Institute of the Regions of Europe (IRE). This conference is dedicated to the main topics of the Austrian Presidency and – as in previous conferences - important special topics, which are significant especially for the regions and municipalities of Europe, companies, institutions of administration, science and research. The main topics are ”Subsidiarity and Europe“,”What became of the Europe of its founding fathers?“ and ”What will become of Europe“. For the discussions and lectures, we were able to win outstanding and prominent speakers, whom I sincerely thank for coming to Salzburg. The special discussions address the question of how Europe is preparing for its digital future, the future of energy in Europe and the existential issue of rural depopulation in Europe and how to counteract it. -

Paul–Henri Spaak:Aeuropean
Paul–Henri Spaak: a European visionary and talented persuader ‘A European statesman’ – Belgian Paul-Henri Spaak’s long political career fully merits this title. Lying about his age, he was accepted into the Belgian Army during the First World War, and consequently spent two years as a German prisoner of war. During the Second World War, now as foreign minister, he attempted in vain to preserve Belgium’s neutrality. Together with the government he went into exile, first to Paris, and later to London. After the liberation of Belgium, Spaak served both as Foreign Minister and as Prime Minister. Even during the Second World War, he had formulated plans for a © Nationaal Archief/Spaarnestad Photo Archief/Spaarnestad © Nationaal merger of the Benelux countries, and directly after the war he campaigned for the Paul-Henri Spaak 1899 - 1972 unification of Europe, supporting the European Coal and Steel Community and a European defence community. For Spaak, uniting countries through binding treaty obligations was the most effective means of guaranteeing peace and stability. He was able to help achieve these aims as president of the first full meeting of the United Nations (1946) and as Secretary General of NATO (1957-61). Spaak was a leading figure in formulating the content of the Treaty of Rome. At the ‘Messina Conference’ in 1955, the six participating governments appointed him president of the working committee that prepared the Treaty. Rise through Belgian politics Born on 25 January 1899 in Schaerbeek, Belgium, Paul-Henri Spaak Germans and spent the next two years imprisoned in a war camp. -

Shaping European Union: the European Parliament and Institutional Reform, 1979-1989
Shaping European Union: The European Parliament and Institutional Reform, 1979-1989 European Parliament History Series STUDY EPRS | European Parliamentary Research Service Wolfram Kaiser PE 630.271 – November 2018 EN Shaping European Union: The European Parliament and Institutional Reform, 1979-1989 Wolfram Kaiser Based on a large range of newly accessible archival sources, this study explores the European Parliament’s policies on the institutional reform of the European Communities between 1979 and 1989. It demonstrates how the Parliament fulfilled key functions in the process of constitutionalization of the present-day European Union. These functions included defining a set of criteria for effective and democratic governance, developing legal concepts such as subsidiarity, and pressurising the Member States into accepting greater institutional deepening and more powers for the Parliament in the Single European Act and the Maastricht Treaty. EPRS | European Parliamentary Research Service AUTHOR This study has been written by Professor Dr Wolfram Kaiser of the University of Portsmouth, United Kingdom, at the request of the Historical Archives Unit of the DIrectorate for the Library within the Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS) of the Secretariat of the European Parliament. ACKNOWLEDGMENTS The author would like to thank Christian Salm for his helpful comments on earlier drafts of this study and Etienne Deschamps for his support in finding suitable illustrations for the text. ADMINISTRATOR RESPONSIBLE Christian Salm, Historical Archives Unit To contact the publisher, please e-mail [email protected] LINGUISTIC VERSIONS Original: EN Manuscript completed in September 2018. DISCLAIMER AND COPYRIGHT This document is prepared for, and addressed to, the Members and staff of the European Parliament as background material to assist them in their parliamentary work.