170 Ans De Libéralisme Politique En Belgique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
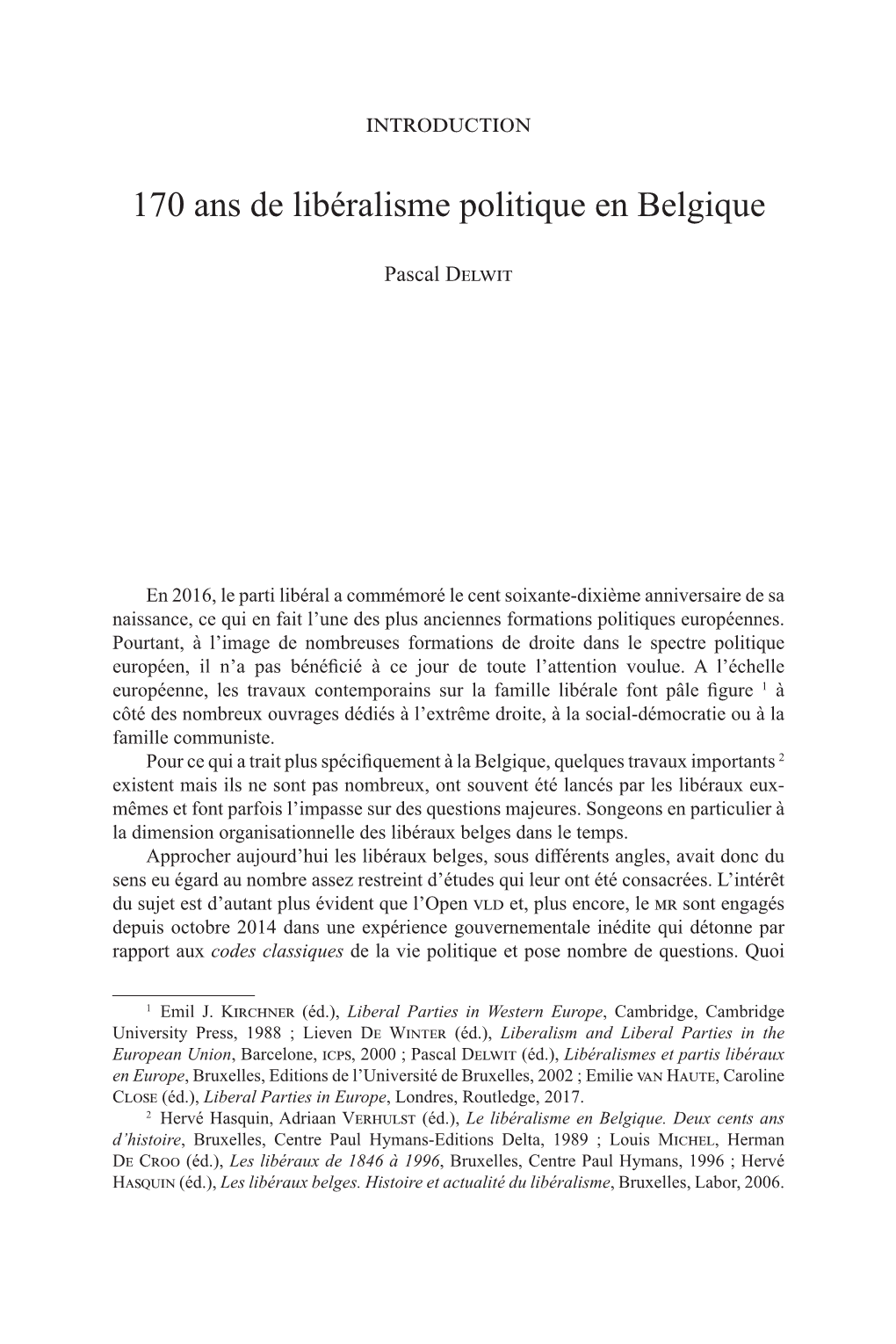
Load more
Recommended publications
-
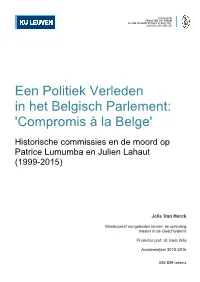
Compromis À La Belge'
KU LEUVEN FACULTEIT LETTEREN BLIJDE INKOMSTSTRAAT 21 BUS 3301 3000 LEUVEN, BELGIË Een Politiek Verleden in het Belgisch Parlement: 'Compromis à la Belge' Historische commissies en de moord op Patrice Lumumba en Julien Lahaut (1999-2015) Jelle Van Herck Masterproef aangeboden binnen de opleiding master in de Geschiedenis Promotor prof. dr. Kaat Wils Academiejaar 2015-2016 335.839 tekens Inhoudstafel: INLEIDING 4 1. Geschiedenis in de Hedendaagse Maatschappij 4 2. Geschiedenis en Politiek: Parlementaire Onderzoekscommissies 6 2.a. Historici en historische commissies 9 HOOFDSTUK I: ONDERZOEKSKADER 12 1. Historiografie van Historische Commissies 12 2. Onderzoek in Overheidsopdracht: Twee Modellen 16 2.1. Zwitserland: de commissie-Bergier 17 2.2. Nederland: de Srebrenica-commissie 19 3. Oproep aan de Overheid: Twee Voorbeelden 21 3.1. Spanje: de herinnering aan Franco 22 3.2. Verenigde Staten: Johnson Whittaker 24 HOOFDSTUK II: CASUS LUMUMBA EN LAHAUT 26 1. De Moord op Patrice Lumumba 26 2. De Moord op Julien Lahaut 31 3. Instelling van de Onderzoekscommissies 34 3.1. De aanleiding 35 3.2. Politieke besluitvorming 39 HOOFDSTUK III: HET EINDRAPPORT 42 1. Conclusies van het Onderzoek 42 1.1. Een morele verantwoordelijkheid 42 1.2. Een geheime oorlog 48 2. Debat rond de Conclusies 51 2.1. commissie-Lumumba 52 2.2. commissie-Lahaut 56 HOOFDSTUK IV: ANALYSE EN VERGELIJKING VAN DE COMMISSIES 58 1. Interne Verschillen: Lumumba vs. Lahaut 58 1.1. Mate van politieke steun 58 1.2. Mate van financiële steun 66 1.3. Toegang tot archieven 69 2. Externe Verschillen: Commissiewerk vs. 'Klassiek' Onderzoek 72 2.1. Geldigheid van het onderzoek 73 2.2. -

L'homme Politique Belge Belgian Man of Politics De Belgische Politieke
L’homme © Belga FR politique belge Paul-Henri Spaak (Schaerbeek, 1899 – Bruxelles, 1972) voit le jour dans une famille très présente dans la vie politique et culturelle du pays. Son père, Paul Spaak (1870-1936), avocat de formation, brille dans le monde de la dramaturgie. Sa mère, Marie Janson, est la fille de Paul Janson, le puissant tribun libéral progressiste, à la pointe du combat pour le suffrage universel, et la sœur du ministre Paul-Emile Janson. Elue au Sénat dès 1921, Marie Spaak-Janson sera la première femme parlementaire de Belgique. Docteur en droit de l’Université de Bruxelles (1921), Paul-Henri Spaak acquiert une notoriété précoce en plaidant brillamment des causes retentissantes comme celle de l’anarchiste De Rosa, auteur d’un attentat manqué contre le prince Umberto d’Italie, fiancé de la princesse Marie-José, en 1929. Engagé en politique au sein du Parti ouvrier belge (P.O.B.) où il fait ses armes en tant que chef de cabinet adjoint du ministre Joseph Wauters, chargé du travail et de la prévoyance sociale (1925-1927), il s’y montre un pacifiste résolu, prend des positions perçues comme révolutionnaires par nombre de ses pairs, au point de frôler l’exclusion de son parti. Cela ne l’empêche pas d’entamer une carrière politique nationale qui s’avère prometteuse. Elu représentant de l’arrondissement de Bruxelles dès 1932, il entre trois ans plus tard dans le premier gouvernement Van Zeeland, assumant durant quinze mois les fonctions de ministre des transports et des P.T.T. En 1936, il accède pour la première fois au ministère des affaires étrangères dans Paul-Henri Spaak, Ministre des un contexte politique européen difficile marqué par la montée des extrémismes de droite comme de gauche. -
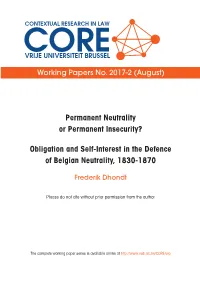
Obligation and Self-Interest in the Defence of Belgian Neutrality, 1830-1870
CONTEXTUAL RESEARCH IN LAW CORE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Working Papers No. 2017-2 (August) Permanent Neutrality or Permanent Insecurity? Obligation and Self-Interest in the Defence of Belgian Neutrality, 1830-1870 Frederik Dhondt Please do not cite without prior permission from the author The complete working paper series is available online at http://www.vub.ac.be/CORE/wp Permanent Neutrality or Permanent Insecurity? Obligation and Self-Interest in the Defence of Belgian Neutrality, 1830-1870 Frederik Dhondt1 Introduction ‘we are less complacent than the Swiss, and would not take treaty violations so lightly.’ Baron de Vrière to Sylvain Van de Weyer, Brussels, 28 June 18592 Neutrality is one of the most controversial issues in public international law3 and international relations history.4 Its remoteness from the United Nations system of collective security has rendered its discussion less topical.5 The significance of contemporary self-proclaimed ‘permanent neutrality’ is limited. 6 Recent scholarship has taken up the theme as a general narrative of nineteenth century international relations: between the Congress of Vienna and the Great War, neutrality was the rule, rather than the exception.7 In intellectual history, Belgium’s neutral status is seen as linked to the rise of the ‘Gentle Civilizer of Nations’ at the end of the nineteenth century.8 International lawyers’ and politicians’ activism brought three Noble Peace Prizes (August Beernaert, International Law Institute, Henri La Fontaine). The present contribution focuses on the permanent or compulsory nature of Belgian neutrality in nineteenth century diplomacy, from the country’s inception (1830-1839)9 to the Franco- 1 Vrije Universiteit Brussel (VUB), University of Antwerp, Ghent University/Research Foundation Flanders. -

Femmes Parlementaires Dans La Belgique De La Question Royale
Université catholique de Louvain Faculté de philosophie et lettres Département d’histoire Femmes parlementaires dans la Belgique de la question royale Leurs itinéraires et leur rôle dans la vie politique de juin 1949 à novembre 1950 Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Licenciée en histoire par Natacha WITTORSKI Promoteur : M. DUMOULIN Louvain-la-Neuve 2003 2 Parmi les personnes qui nous ont aidée à la réalisation de ce mémoire, nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur le Professeur M. Dumoulin, qui en a accepté la direction, et Monsieur J.-R. Kupper, pour le soin qu’il a mis à la relecture de ces pages. 3 UCL Université catholique de Louvain Faculté de philosophie et lettres Département d’histoire ANNÉE ACADÉMIQUE : 2002-2003 SESSION : JUIN 2003 NOM : WITTORSKI PRÉNOM : Natacha TITRE DU MÉMOIRE : Femmes parlementaires dans la Belgique de la question royale. Leurs itinéraires et leur rôle dans la vie politique de juin 1949 à novembre 1950 PROMOTEUR : M. DUMOULIN Résumé : Il s’agit de porter un éclairage sur le rôle des femmes parlementaires belges, autour d’une tranche de notre histoire politique, entre les premières élections au suffrage masculin et féminin et la fin de la question royale. Outre des aspects biographiques, ce travail contient un parcours de l’actualité (élections de 1949 et 1950, et consultation populaire) et un examen de l’activité de ces seize parlementaires au sein même du Parlement. Les quelques fonds d’archives existants ont été complétés par une consultation de la presse, quotidienne ainsi que féminine, en plus de la lecture des Annales parlementaires. -

Souvenirs D'un Militant Liberal
1 SOUVENIRS D'UN MILITANT LIBERAL. 2 Coordonnées Nom: VAN UFFELEN Jacques Lieu et date de naissance: Tirlemont, 5 janvier 1929 Adresse: Avenue Christophe Plantin, 2 1340 Ottignies Profession: Traducteur - directeur retraité au Secrétariat général de l'Union économique Benelux et à la Cour de Justice Benelux. 3 Préface de Louis Michel. C'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je me suis plongé dans la lecture de l'ouvrage de Jacques Van Uffelen. Homme de plume, militant convaincu, libéral non conformiste, Jacques Van Uffelen a mis au service du libéralisme tout son talent, toute son intelligence, toute sa créativité pour défendre avec ardeur et chaleur dans les feuilles libérales les vertus du libéralisme. Il a mis son art au service du libéralisme pour convaincre l'opinion publique que le "parti libéral est foncièrement social, qu'il prône non pas la lutte des classes comme le socialisme, mais la solidarité des classes". Jacques Van Uffelen a retracé avec une rare précision l'évolution du libéralisme. Il rappelle que, même avant la création du parti libéral, les idées libérales étaient déjà largement diffusées car tous les Belges sont attachés aux libertés constitutionnelles. Jacques Van Uffelen nous fait revivre les grands courants de la pensée libérale, la rénovation du parti, les combats d'idées, les réflexions de grandes personnalités comme Maurice Allais, Salvador de Madariaga, Albert Devèze, Roger Motz, Paul Hymans, Omer Vanoudenhove, Jean Rey. Ces derniers et bien d'autres ont fait évoluer le libéralisme, du libéralisme manchestérien ou laissez-fairisme au néo- libéralisme ou libéralisme humaniste. Ces hommes ont eu le mérite de clarifier la position des libéraux par rapport à la notion d'Etat qui garantit les bienfaits de la liberté. -

2009 Annual Report
2009 Annual Report European Liberal Forum 2009 Annual Report © Copyright 2010 European Liberal Forum asbl. AAllll rrightsights rreserved.eserved. ContentContent iiss ssubjectubject toto copyright.copyright. AnyAny useuse andand re-usere-use requiresrequires approval.approval. TThishis ppublicationublication wwasas fundedfunded byby tthehe EEuropeanuropean PParliament.arliament. TheThe EuropeanEuropean ParliamentParliament isis notnot responsibleresponsible fforor tthehe ccontent.ontent. TheThe vviewsiews eexpressedxpressed iinn tthishis ppublicationublication areare thosethose ofof thethe authorsauthors alone.alone. TheyThey dodo notnot nnecessarilyecessarily rreflefl eectct thethe vviewsiews ooff tthehe EuropeanEuropean LiberalLiberal Forum.Forum. 22009009 AAnnualnnual RReporteport Welcome 05 Contents Welcome 0077 LLetteretter fromfrom tthehe PresidentPresident 0088 FForewordoreword bbyy tthehe EExecutivexecutive DDirectorirector About us 1111 IIntrontro 1133 MMemberember organisationsorganisations 1144 BBoardoard ooff DDirectorsirectors 1155 TThehe EEuropeanuropean LLiberaliberal ForumForum (ELF)(ELF) secretariatsecretariat Selection of events 1177 IIntrontro 1199 GGlobalisationlobalisation afterafter thethe CreditCredit CrunchCrunch 2222 SSpringpring AAcademiescademies 2009:2009: EEuropeurope inin PracticePractice 2244 TThehe IInflnfl uuenceence ooff EEuropeanuropean PPolicyolicy oonn tthehe LLocalocal LevelLevel 2266 MMigrationigration – EEurope’surope’s ChallengeChallenge 2288 TThehe EEurouro aass aann IInstrumentnstrument ofof StabilityStability -

Belgian Polities in 1988 Content 1. the Painstaking Forming of The
Belgian Polities in 1988 Content 1. The painstaking forming of the Martens VIII Cabinet 303 A. The forming of regional governments complicates the making of a national cabinet . 303 B. The information mission of Dehaene 305 C. Dehaene's formation mission . 305 D. Martens VIII wins vote of confidence in Parliament 308 ll. Phase one of the constitutional reform 309 A. The amendment of seven constitutional articles 309 B. The special August 8, 1988 Act. 310 C. The bill on the language privileges . 312 111. The second phase of the constitutional reform 314 A. The new politica! status of the Brussels Region 314 B. The Arbitration Court . 315 C. The regional financing law. 315 D. Consultation and meditation 316 IV. The municipal elections, the government reshuffle and the debt of the larger cities 317 A. The municipal elections, Fourons and municipalities with special language status 317 B. The government reshuffle . 318 C. The debt of the larger cities 318 V. The social and economie policy of the Martens VIII cabinet 319 A. The 1988 and 1989 budgets 319 B. Tax reform 320 C. Labor Relations-Public Service Strikes-Health lnsurance 321 Vl. Foreign Affairs and Defense. 323 A. Foreign Affairs 323 B. Defense . 325 VII. lnternal politica! party developments. 325 Belgian polities in 1988 by Ivan COUTTENIER, Licentiate in Politica) Science During the first four months of 1988, Belgium witnessed the painstaking for mation of the Martens VIII center-left Cabinet. In October 1987, the Christian Democratic-Liberal Martens VI Cabinet had been forced to resign over the pe rennial Fourons affairs. -

Des Libéraux De Pierre Et De Bronze
Des libéraux Focus sur le VOTRE RÉGION de pierre et de bronze Hainaut Joseph Tordoir, historien au Centre Jean Gol, vous présente aujourd’hui 60 monuments érigés, en Wallonie et en région bruxelloise, en hommage à des personnalités libérales des XIXe et XXe siècles. Ils ornent places et squares, décorent parcs et espaces publics réservés à la détente, tant à Bruxelles, qu’à Liège, Ixelles, Mons, Huy, Verviers, Tournai, Soignies, Morlanwelz, La Louvière, Péruwelz, Court- Saint-Etienne, Nivelles, Ohain, Esneux, Warsage, Pommeroeul, etc. Nous vous proposons de faire revivre ces témoins silencieux de notre histoire nationale et du libéralisme belge, le temps d’un livre, de Pierre-Théodore Verhaegen à Jean Gol, en passant par Joseph Lebeau, Alexandre Gendebien, Charles Rogier, Walthère Frère- Orban, Jules Bara, Paul Janson, Ernest Solvay, Adolphe Max, Albert Devèze, Maurice Chers amies et amis du Mouvement Réformateur, Destenay, Jean Rey et bien d’autres. Pour ces pages « Hainaut » du MRMag’, j’ai souhaité mettre en avant l’actualité récente de nos parlementaires qui chaque jour défendent les priorités du Mouvement Réformateur. Souscription 2014 sera une année cruciale : les scrutins régionaux, fédéraux et européens coïncident. Autant dire que les enjeux seront importants et que la campagne qui Cet ouvrage de 216 pages, richement illustré, bénéficie s’annonce sera menée sur tous les fronts ! d’une édition de luxe. Il mérite de prendre place dans votre bibliothèque et ravira tous les passionnés de l’histoire du Parmi les thématiques capitales pour la Wallonie et en particulier le Hainaut, on notera libéralisme. Il paraîtra officiellement le 20 février 2014 à l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles. -

L[Ffiffi&Ffiy
Wenof Eurore Brusselr, 15 Xoverbcr f983/15 Jaurryr 1984, n'33 (bi-nonthly) L[ffiffi&ffiY EUROP$AN CO|!;I}1UiiIil E,mP-{ LEffiffiffiE IJ|FORMATI0N SIRYiCI i trYA$HINGTON, D. O. This bulle tin is published by the OOiIMISSION OF THE EUROPEAN @MMUIITTIES Directorate-General I ntormation € Informalion for Women's organisations and press Rue de la Loi 200 8-1049 - Erussels - Te|,23511 11 Vomen of Europe tlr,. 3? - 15 t{ovember l9t3l15 January l9t4 - p. 2 IN THXS XSSUE The changing European CommunitY 3 Parental leave 4 Eurobarometer 6 Womenfs unemPloYment 8 The Equal Opportunities Committee l0 Women of Spain ll Local and regional elected representatives 14 European Parliament October 1983 session T7 November 1983 session t9 December 1983 session 2T Parliamentary Committee of Inquiry 24 European Court of Justice 25 Facts, Institutions and Laws 26 June r84: European Elections 43 Militant activities 44 Reseach, Meetings and Books 62 Our correspondents in the Community Belgium Nanette Nannan, 33 Rue E. Bouillot, Boite 9, 1060 Brussels Denmark Danske Kvinders Nationalraad, N. Hemmingsensgade 8, ll53' CoPenhagen France Jeanne Chaton, 43 Avenue Ernest Reyer, 75014 Paris Greece Effi Kalliga-Kanonidou, l0 Neofytou Douka St, 106 74 Athens Germany Christa Randzio-Plath, Hadermanns Yleg 2), 2 Hamburg 6l Ireland Janet Martin, 2 Clarement Close, Glasvenin, Dublin ll Italy Beatrice Rangoni Macchiavelli, Piazza di Spagna 51' 00187 Rome Luxembourg Alix Wagnerr T rue Henri Frommes, 1545 Luxembourg Netherlands Marjolijn Uitzinger, Fivelingo 207, Tnetermeer United Kingdom Pegty Crane, 12 Grove Park Road, Chiswick, London V4 European Lidya Gazzor lT Avenue de Tourville, 75007 Paris Parliament Editor: Fausta Deslpnmes krlormation for womenrs associations and press 200 Rue de la Loi' 1049 Brussels Editorial work on this issue of "Women of Europe" was Completed on 19 December 1983. -

Wilfried Martens
Wilfried Martens „WITHOUT THE CDU THE EPP WOULD NOT BE WHAT THE PARTY IS TODAy” Wilfried Martens, geboren am 19. April 1936 im belgischen Sleidinge, Studium der Rechtswissenschaften an der Katholischen Universität Leuven, 1960 Promotion zum Dr. jur., Mitglied und später Präsident der Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond, 1960–1965 praktizierender Rechtsanwalt, 1965 Berater des belgischen Premierministers Pierre Harmel,552 1966 Berater von Premierminister Paul Vanden Boeynants,553 1968 Sonderbeauftragter für Gemeinschaftsangelegenheiten unter Premierminister Leo Tindemans, 1974–1991 Mitglied der belgischen Abgeordnetenkammer, 1979–1981 und 1981–1992 Premierminister Belgiens, seit 1990 Präsident der EVP, 1991–1994 Senator, 1993–1996 Präsident der EUCD, 1994–1999 Mitglied des EP, Faktionsvorsitzender der EVP. Das Interview fand am 31. Mai 2012 in Brüssel statt und wurde geführt von Marcus Gonschor und Hinnerk Meyer. Mr President, you were born in Sleidinge in 1936. Could you please tell us something about your origins, your parental home and your time in school? I was born on a very small farm in the outskirts of the local community or local commune in Sleidinge. I was born in 1936. I remember the beginning of the war in 1940. I was on a bicycle with a young girl trans- 552 | Pierre Harmel (1911–2009), belgischer Politiker der PSC, 1965/66 Premierminister, 1966–1972 Außenminister seines Landes. 553 | Paul Vanden Boeynants (1919–2001), belgischer Politiker der PSC, 1966–1968 und 1978/79 Premierminister seines Landes. 622 porting me to the kindergarten. She said to me: ”Look in the sky! There are planes.” That was the beginning of the war. I have this memory still vivid. -

Wilfried Martens. Deel 2
BE-A0510_000966_002273_DUT Inventaris van het archief van Wilfried Martens. Deel 2. Van Belgisch premier tot EVP-voorzitter, 1978-2009 (1919) Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Wilfried Martens. Deel 2 BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:...................................................................33 Raadpleging en gebruik.................................................................................34 Voorwaarden voor de raadpleging.............................................................34 Voorwaarden voor de reproductie..............................................................35 Fysieke kenmerken en technische vereisten..............................................35 Toegangen..................................................................................................35 Aanwijzingen voor het gebruik...................................................................36 Geschiedenis van archiefvormer en archief...................................................37 Archiefvormer............................................................................................37 Naam......................................................................................................37 Archief........................................................................................................37 Geschiedenis..........................................................................................37 Verwerving.............................................................................................39 -

1 the Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs
The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project ARNOLD DENYS Interviewed by: Self Copyright 1998 ADST TABLE OF CONTENTS Acknowledgements A out the Author Note to the Reader Preface A Crisis in the Life of a Foreign Service Officer My Beginnings (S Citi)enship Return to Civilian Life Panama Assignment Crisis in Panama London Egypt Athens Mexico Canada ,ashington, DC Antwerp ,ashington to Tijuana Tijuana Tijuana to Retirement Conclusion DIARY Son of Flanders The Making of a Consul. Diary of an American Foreign Service Officer In Memory of Emiel Denys 01103411767 8odelieve Maria Denys 01101411117 AC9NO,LED8MENTS 1 I feel deep gratitude to my late parents for their encouragement to write this memoir. The late Mrs. 9atherine McCook 9nox, an art historian from ,ashington, DC, was in great part responsi le for my efforts in compiling letters and notes on the American Foreign Service. My thanks also go to Rhoda Riddell, Ph.D., a writer and teacher, who transcri ed and edited my handwritten account, which was taken from my diary. I also wish to thank Art Drexler, who completed the editing and prepared the book for printing. I wish also to thank the following persons, whom I have known in the long course of my foreign service career, and who have meant so much to me both personally and professionally, and deserve special acknowledgment. Consul 8eneral John D. Barfield Vice Consul 0Ret.7 Frank J. Barrett Miguel Angel 8arcia Charles Stuart 9ennedy, Director of the Association for Diplomatic Studies, who inspired me with his work on the Foreign Affairs Oral History Program.