Du 21 Au 22 Novembre 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report the 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
ALGERIA United Nations 2020 Algeria Annual Report THE 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Copyright: United Nations Annual Report – Algeria 2020 Published by the United Nations System Algeria 41 Rue Mohamed Khoudi, El Biar, Algiers, Algeria Copyright © 2021 SNU Algeria All rights reserved Website: https://algeria.un.org/fr Tweet: https://twitter.com/UNALGERIA Facebook: https://web.facebook.com/UNALGERIA United Nations 2020 Algeria Annual Report Table of Contents TABLE OF CONTENTS ...................................................... 6 I. Context : Algeria in the making ................................. 8 II. COVID-19 emergency response ............................. 10 Support for the health emergency ........................... 11 Response to the socio-economic impact ............................................ 19 III. Results of the implementation of the Strategic Cooperation Framework .................... 20 Economic Diversification ......................................... 22 Social Development ................................................ 24 Environment ............................................................. 25 Good Governance ..................................................... 27 IV. Results of the humanitarian support ...................... 30 Unwavering support to Sahrawi refugees ............... 30 Support to refugees and migrants in the urban context .................................................. 32 V. Support for Partnerships and Financing of the 2030 Agenda ................................ 34 VI.Joint work results: -

Étude Originale
Étude originale Les jeunes agriculteurs itinérants et le développement de la culture de la pomme de terre en Algérie L'émergence d'une économie réticulaire Alaeddine Derderi1 1,2 Résumé Ali Daoudi ´ ´ 1,3 L’article analyse le fonctionnement en reseau des jeunes agriculteurs itinerants, figure Jean-Philippe Colin e´mergente des filie`res maraıˆche`res en Alge´rie, ne´anmoins tre`s peu connue et encore moins 1 École nationale superieure agronomique reconnue par les de´cideurs politiques. Cette analyse repose sur les donne´es d’une enqueˆte (ENSA) re´alise´e aupre`s de 108 producteurs de pomme de terre dans la re´gion d’Aflou, wilaya de Rue hassen badi Laghouat. Par leur fonctionnement re´ticulaire, ces producteurs interviennent comme Belfort El Harrach « connecteurs » d’individus et de territoires en combinant la maıˆtrise des techniques 1600 Alger culturales et la maıˆtrise des marche´s des facteurs de production et des produits agricoles Algerie <[email protected]> (souvent imparfaits, voire absents localement), mettant ainsi en rapport des marche´s et des <[email protected]> sites de production e´clate´s dans l’espace. Ils e´tablissent ces connexions pour mener a` bien <[email protected]> leur propre production, mais aussi en tant qu’interme´diaires, avec donc un effet 2 d’entraıˆnement sur l’e´conomie agricole locale. CRSTRA El Alia Mots cle´s:Aflou ; Alge´rie ; agriculteurs itine´rants ; capital social ; pomme de terre ; re´seau. Biskra Algerie The`mes : e´conomie et de´veloppement rural ; productions ve´ge´tales. 3 IRD 4911, avenue Agropolis 34394 Montpellier Abstract France Young itinerant farmers and the development of potato farming in Algeria. -

The Transhumance of Sheep Herders in Steppe: Cost Reduction Or Inevitable Adaptation?
IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN: 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 11, Issue 3 Ver. I (March 2018), PP 23-27 www.iosrjournals.org The Transhumance of Sheep Herders in Steppe: Cost Reduction or Inevitable Adaptation? Belhouadjeb Fathi Abdellatif 1, Djekal Ameur 2, Charrak Sabah 3, Chettouh Brahim 4, Beaira Mostefa 5 1. Dr. Maître de recherche, Agroéconomiste, Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie, INRA Algérie 2. Direction des Services Agricoles de la Wilaya de Djelfa, Ain El Bel, Djelfa, Algérie 3. Institut de Technologie Moyen Agricole Spécialisé (ITAMS), Djelfa, Algérie 4. Haut Commissariat au développement de la steppe (HCDS), Djelfa, Algérie 5. Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie, INRA Djelfa, Algérie Corresponding author: Belhouadjeb Fathi Abdellatif Abstract: According to the national official data in Algeria, Djelfa province is the top red meat producer in the country, 44554 tons in 2014, representing 9.16% of the national production. It is produce the majority of sheep meat with about 14% of the relevant national production. 3242760 sheep heads are located in Djelfa representing 11.66% of the national sheep flock and more than 74% of sheep herders (finishers and breeders) This study focuses on the grazing areas in Algeria and aims to this study aims to investigate the reasons behind the herders’ transhumance (transhumant pastoralist) between autumn 2014 and summer 2015. Based on survey data of 52 sheep herders, this study illustrated that the majority of the herders are transhumant and the transhumance production system is the prevailing system for sheep farming in the investigated region. -
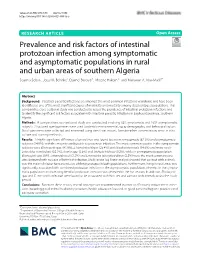
Prevalence and Risk Factors of Intestinal Protozoan Infection
Sebaa et al. BMC Infect Dis (2021) 21:888 https://doi.org/10.1186/s12879-021-06615-5 RESEARCH ARTICLE Open Access Prevalence and risk factors of intestinal protozoan infection among symptomatic and asymptomatic populations in rural and urban areas of southern Algeria Soumia Sebaa1, Jerzy M. Behnke2, Djamel Baroudi3, Ahcene Hakem1,4 and Marawan A. Abu‑Madi5* Abstract Background: Intestinal parasitic infections are amongst the most common infections worldwide and have been identifed as one of the most signifcant causes of morbidity and mortality among disadvantaged populations. This comparative cross‑sectional study was conducted to assess the prevalence of intestinal protozoan infections and to identify the signifcant risk factors associated with intestinal parasitic infections in Laghouat province, Southern Algeria. Methods: A comparative cross‑sectional study was conducted, involving 623 symptomatic and 1654 asymptomatic subjects. Structured questionnaires were used to identify environmental, socio demographic and behavioral factors. Stool specimens were collected and examined using direct wet mount, formalin‑ether concentration, xenic in vitro culture and staining methods. Results: A highly signifcant diference of prevalence was found between symptomatic (82.3%) and asymptomatic subjects (14.9%), with the majority attributable to protozoan infection. The most common species in the symptomatic subjects were Blastocystis spp. (43.8%), E. histolytica/dispar (25.4%) and Giardia intestinalis (14.6%) and more rarely Enterobius vermicularis (02.1%), Teania spp. (0.6%) and Trichuris trichiura (0.2%), while in asymptomatic population Blastocystis spp. (8%), Entamoeba coli (3.3%) and Entamoeba histolytica/dispar (2.5%) were the most common para‑ sites detected with no case of helminth infection. -

A Techno-Economic Feasibility Study of a Hybrid Renewable Plant for Hydrogen Production and Transportation in the Existing Gas Pipelines: a Case Study in Algeria
POLITECNICO DI TORINO Collegio di Ingegneria Energetica e Nucleare Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare Tesi di Laurea Magistrale A TECHNO-ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF A HYBRID RENEWABLE PLANT FOR HYDROGEN PRODUCTION AND TRANSPORTATION IN THE EXISTING GAS PIPELINES: A CASE STUDY IN ALGERIA Relatore Candidata Prof. Pierluigi Leone Giulia Carrara Co-relatore Enrico Vaccariello Ottobre 2019 2 ABSTRACT Hydrogen is considered one of the most interesting energy carriers of the future: its clean production from Renewable Energy Sources (RES hydrogen) and its transportation options are two of the main topics of the “Hydrogen Economy”. The electrical energy provided from renewable sources can be transported either as electricity or can be transformed into a secondary energy carrier, as the hydrogen: in both cases, it is required a specific infrastructure in order to transfer the “energy product” from the generation site to the demand site. As the energy demand of the Central Europe is high, but its renewable energy potential is moderate if compared to other regions such as North Africa, an interesting compromise to analyse is generating energy in these regions with a higher renewable potential and importing it to areas with a higher energy demand. In this thesis work, a techno-economic feasibility study of a hybrid renewable plant, located in Hassi R’Mel (Algeria), is performed. The analysed hybrid plant is composed by a large-scale PV-WIND-STORAGE system: the energy generated from the plant is used to work an electrolysers-system for producing renewable hydrogen. The produced hydrogen (H2) is sent as a blend, in a specific percentage, with the natural gas (NG) through the existing pipelines towards Southern Europe. -

Stratégie D'adaptation Des Éleveurs Et Modalités D'utilisation Des Parcours En Tunisie Centrale
ECOLE DOCTORALE GAIA Biodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, Terre, Eau Thèse pour obtenir le grade de docteur délivré par Montpellier SupAgro Spécialité : Zootechnie-Système présentée par Tasnim JEMAA Stratégie d’adaptation des éleveurs et modalités d’utilisation des parcours en Tunisie Centrale Directeur de thèse : Charles-Henri MOULIN, UMR Selmet Co-encadrant : Johann HUGUENIN UMR Selmet Co-encadrant : Taha NAJAR, INAT Soutenue publiquement le 14 décembre 2016 devant le jury composé de : Gilles Brunschwig, Professeur, VétAgro Sup, Clermont Ferrand Rapporteur Jean-François Tourrand, CIRAD, Montpellier Rapporteur François Bocquier, Professeur, Montpellier SupAgro Examinateur Charles-Henri Moulin, Professeur associé, Montpellier SupAgro Examinateur Taha Najar, Professeur, INAT, Tunisie Invité Johann Huguenin, CIRAD Invité À Lina À mes parents REMERCIEMENTS L’aboutissement de cette thèse n’aurait certainement pas été le même sans le soutien sans failles de M. Charles-Henri Moulin, professeur associé à Montpellier SupAgro et à l’UMR SELMET, mon directeur de thèse. Je lui suis très sincèrement reconnaissante pour sa disponibilité, ses conseils, ses encouragements, sa sincérité, sa bienveillance et son œil critique qui m’ont été très précieux. Je tiens également à le remercier pour la confiance et la sympathie qu’il m’a témoignée au cours de ces années de recherche. J’exprime mes profonds remerciements au M. Johann HUGUENIN, chercheur chez CIRAD co-encadrant de la thèse au CIRAD, pour la confiance qu’il m’a accordée en acceptant de diriger ce travail, pour l’aide compétente qu’il m’a apportée sur le plan scientifique. Tout au long de cette recherche, il m’a guidé, conseillé et encouragé par ses orientations et ses conseils sans cesser d’être une grande source de motivation. -

Les Jeunes Agriculteurs Itinérants Et Le Développement De La Culture De La Pomme De Terre En Algérie L'émergence D'une Économie Réticulaire
Étude originale Les jeunes agriculteurs itinérants et le développement de la culture de la pomme de terre en Algérie L'émergence d'une économie réticulaire Alaeddine Derderi1 1,2 Résumé Ali Daoudi ´ ´ 1,3 L’article analyse le fonctionnement en reseau des jeunes agriculteurs itinerants, figure Jean-Philippe Colin e´mergente des filie`res maraıˆche`res en Alge´rie, ne´anmoins tre`s peu connue et encore moins 1 École nationale superieure agronomique reconnue par les de´cideurs politiques. Cette analyse repose sur les donne´es d’une enqueˆte (ENSA) re´alise´e aupre`s de 108 producteurs de pomme de terre dans la re´gion d’Aflou, wilaya de Rue hassen badi Laghouat. Par leur fonctionnement re´ticulaire, ces producteurs interviennent comme Belfort El Harrach « connecteurs » d’individus et de territoires en combinant la maıˆtrise des techniques 1600 Alger culturales et la maıˆtrise des marche´s des facteurs de production et des produits agricoles Algerie <[email protected]> (souvent imparfaits, voire absents localement), mettant ainsi en rapport des marche´s et des <[email protected]> sites de production e´clate´s dans l’espace. Ils e´tablissent ces connexions pour mener a` bien <[email protected]> leur propre production, mais aussi en tant qu’interme´diaires, avec donc un effet 2 d’entraıˆnement sur l’e´conomie agricole locale. CRSTRA El Alia Mots cle´s:Aflou ; Alge´rie ; agriculteurs itine´rants ; capital social ; pomme de terre ; re´seau. Biskra Algerie The`mes : e´conomie et de´veloppement rural ; productions ve´ge´tales. 3 IRD 4911, avenue Agropolis 34394 Montpellier Abstract France Young itinerant farmers and the development of potato farming in Algeria. -

AP92-Like Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus In
LETTERS References detected in sub-Saharan Africa, southeastern Europe, the 1. Hause BM, Ducatez M, Collin EA, Ran Z, Liu R, Sheng Z, Middle East, and central Asia. The virus has been detected et al. Isolation of a novel swine influenza virus from Oklahoma in 2011 which is distantly related to human influenza C viruses. in >31 species of ticks and is transmitted to humans by bite PLoS Pathog. 2013;9:e1003176. http://dx.doi.org/10.1371/ of infected ticks (mainly of the genus Hyalomma) or by journal.ppat.1003176 contact with body fluids or tissue of viremic patients or 2. Ducatez MF, Pelletier C, Meyer G. Influenza D virus in cattle, livestock. The disease is characterized by fever, myalgia, France, 2011–2014. Emerg Infect Dis. 2015;21:368–71. 3. Hause BM, Collin EA, Liu R, Huang B, Sheng Z, Lu W, et al. headache, vomiting, and sometimes hemorrhage; reported Characterization of a novel influenza virus in cattle and swine: mortality rate is 10%–50% (1). proposal for a new genus in the Orthomyxoviridae family. MBio. CCHFV strains currently constitute 7 evolutionary lin- 2014;5:e00031–14. http://dx.doi.org/10.1128/mBio.00031-14 eages, 1 of which (Europe 2) contains the prototype strain 4. Jiang WM, Wang SC, Peng C, Yu JM, Zhuang QY, Hou GY, et al. Identification of a potential novel type of influenza virus in Bovine AP92, which was isolated in 1975 from Rhipicephalus in China. Virus Genes. 2014;49:493–6. http://dx.doi.org/10.1007/ bursa ticks collected from goats in Greece (2). -

Analysis of the Change in Position of the Countries' Sets of Leading
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at Belgorod State University International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 9, Number 22 (2014) pp. 16017-16027 © Research India Publications http://www.ripublication.com Analysis of the Change in Position of the Countries' Sets of Leading Universities and Research Centers in the World Webometrics Ranking (with the Mediterranean and the Black Sea Region Taken as an Example) Vladimir M. Moskovkin, Elena V. Pupynina, Elena N. Kamyshanchenko Belgorod State University Russia, 308015, Belgorod, Pobeda Street, 85 E-mail: moskovkin@,bsu.edu.ru Abstract The article describes the study into the change in position of the countries' sets comprising equal quantity of leading universities and research centers in the world Webometrics Ranking, representation of the countries' sets in the lists of wider scope in these rankings as well as distribution of the universities and research centers by countries and cities, with the Mediterranean and the Black Sea region taken as an example. Keywords: Webometrics Ranking, universities, research centers Mediterranean and Black Sea region. Introduction Out of all the university rankings, Webometrics Ranking has become the most popular because, in comparison to the others, it ranks not only elite universities but all the universities in the world with autonomous web domains. This statement is proved by our Google Scholar search for the names of all the world university rankings. The largest quantity of search results was received for the search query “Webometrics Ranking” [1]. That quantity will be even larger if we add results for the search queries “Webometric Ranking”, “Webometric Rankings”, “Webometrics Rankings”. -

Metlili, Atlas Saharien Central (Laghouat – Algerie)
N° d’ordre: Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université d’Oran Faculté des sciences de la Terre, de Géographie et d’Aménagement du territoire Mémoire Présenté pour l’obtention du grade de Magister en Science de la terre Option : Hydrogéologie CARTOGRAP HIE ET PROTECTION QUALITATIVE DES EAUX SOUTERRAI NES EN ZONE ARIDE, CAS DE MILOK - METLILI, ATLAS SAHARIEN CENTRAL (LAGHOUAT – ALGERIE) Par Atallah CHENAFI Soutenu le 03 juillet 2013 devant la commission d’examen STAMBOUL M. Maître de conférences Université de Laghouat Président MANSOUR. H Professeur Université d’Oran Rapporteur HASSANI. M.I Professeur Université d’Oran Examinateur SAFA. A Maître de conférences Université d’Oran Examinateur FOUKRACHE. M Maître assistant Université d’Oran Invité Année universitaire 2012 - 2013 RESUME Le travail de recherche en question consiste à l’étude hydrogéologique de la région du Milok mekhareg, sur laquelle les différentes unités seront individualisées par leurs paramètres hydrodynamiques, d’établir une cartographie piézométrique récente et la comparer avec les campagnes antérieures à des fins d’analyse spatio-temporelle du système hydrogéologique Metlili-Milok. Le dernier volet est consacré à l'évolution de la chimie des eaux en tenant compte du contexte environnemental propre à la région, dont on citera particulièrement l'existence d'un périmètre agricole de plus de 500 ha où l’utilisation abusive d’engrais est mise en évidence ainsi que l’importance de la station de service NAFTAL située au niveau du carrefour RN23-RN01, de la station de compression de gaz de Milok, de la station de pompage SONATRACH, de l'usine de mise en bouteille de l'eau minérale MILOK et du champ captant du synclinal de la dakhla. -
Combined Effect of Temperature, Ph and Salinity Variation on the Growth Rate of Gloeocapsa Sp
EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 14, 7101-7109 (2020) Combined effect of temperature, pH and salinity variation on the growth rate of Gloeocapsa sp. in batch culture method using Aiba and Ogawa medium Houria Bouazzara 1,2*, Farouk Benaceur 1,2, Rachid Chaibi 1,2, Ibtihel Boussebci 2, Laura Bruno 3 1 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Amar Telidji, 03000 Laghouat, ALGERIA 2 Laboratory of Biological and Agricultural Sciences (LSBA), Amar Thelidji university, Laghouat (UATL), 03000, ALGERIA 3 LBA-Laboratory of Biology of Algae, Dept. of Biology, University of Rome “Tor Vergata”, via Cracovia 1, 00133 Rome, ITALY *Corresponding author: [email protected] Abstract The development of cyanobacterial cultures is influenced by many environmental factors. In this analysis, the effect of pH, salinity and temperature on the growth of Gloeocapsa sp. isolated from Tadjmout dam, Laghouat province (Algeria) was investigated. The axenic cultures were maintained in sterilized culture media (Aiba and Ogawa). pH of the media was adjusted to 6, 7 and 10 using NaOH and HCl, while salinity was adjusted to 0.1%, 0.3%, 0.6% and 0.9% by varying the amount of NaCl in the media. The effect of temperature was studied by incubating the cultures at 25˚C, and 50˚C. The growth of Gloeocapsa sp. were determined by measuring its optical density and its chlorophyll-a content. Gloeocapsa sp. preferred alkaline pH. Low pH levels adversely affect the growth of Gloeocapsa sp. and substantially decreased at pH 6 despite sustained low biomass growth at pH 6 and 7. -

Enzootic Plague Foci, Algeria
ORIGINAL ARTICLE Enzootic plague foci, Algeria M. A. Malek1,2, A. Hammani3, A. Beneldjouzi4 and I. Bitam2 1) Aix Marseille Université, URMITE, UM 63, UMR_S 1095 UMR 7278, 13385 Marseille, France, 2) Laboratoire VALCORE, Faculté des Sciences, Université M’Hamed Bougara Boumerdès (UMBB), Boumerdès, 3) Faculté des Sciences Biologiques et Agronomiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou and 4) Institut Pasteur d’Alger, Dély Ibrahim, Algeria Abstract In Algeria, PCR sequencing of pla, glpD and rpoB genes found Yersinia pestis in 18/237 (8%) rodents of five species, including Apodemus sylvaticus, previously undescribed as pestiferous; and disclosed three new plague foci. Multiple spacer typing confirmed a new Orientalis variant. Rodent survey should be reinforced in this country hosting reemerging plague. New Microbes and New Infections © 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd on behalf of European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Keywords: Algeria, Molecular typing, North Africa, Plague, Yersinia pestis Original Submission: 28 March 2014; Revised Submission: 1 November 2014; Accepted: 8 November 2014 Article published online: 4 December 2014 Methods Corresponding author. I. Bitam, Laboratoire VALCORE, Faculté des Sciences, Université M’Hamed Bougara, 9 Boumerdès (UMBB), 35000 Boumerdès, Algeria fi E-mail: [email protected] Yearly eld missions were conducted in 2009 to 2012, primarily in northern Algeria (Fig. 1). These missions aimed to better understand the diversity of small mammals, including rodents maintaining Y. pestis in zoonotic foci throughout the country. All Introduction catches were made on private farms from November 2009 to February 2012 by using BTS (Besançon Technique Service; Plague, a deadly infection caused by the bacterium Yersinia INRA, Montpellier, France) and Sherman Trap (H.