Rabindranath Tagore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
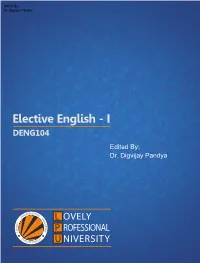
Elective English - I DENG104 Edited By: Dr
Edited By: Dr. Digvijay Pandya Elective English - I DENG104 Edited By: Dr. Digvijay Pandya ELECTIVE ENGLISH - I Edited By: Dr. Digvijay Pandya Printed by LAXMI PUBLICATIONS (P) LTD. 113, Golden House, Daryaganj, New Delhi-110002 for Lovely Professional University Phagwara SYLLABUS Elective English -I Objectives: To improve understanding of literature among students. To enhance writing skills of students. To develop skills of critical analysis in students. Sr. No. Content 1 The Post Office by R N Tagore 2 A Free Man's Worship by Bertrand Russell 3 Dream Children by Charles Lamb 4 The Spark Neglected Burns the House by Leo Tolstoy 5 Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel. The World Is Too Much With Us By William Wordsworth 6 After Twenty Years by O. Henry 7 If by Rudyard Kipling, Where the Mind is Without Fear By Rabindranath Tagore 8 Eveline by James Joyce 9 The Monkey’s Paw by W.W.Jacobs 10 Luck by Mark Twain CONTENT Unit 1: The Post Office by Rabindranath Tagore 1 Digvijay Pandya, Lovely Professional University Unit 2: A Free Man’s Worship by Bertrand Russell 12 Gowher Ahmad Naik, Lovely Professional University Unit 3: Charles Lamb-Dream Children: A Reverie—A Detailed Study 28 Gowher Ahmad Naik, Lovely Professional University Unit 4: Charles Lamb-Dream Children: A Reverie—A Critical Analysis 37 Digvijay Pandya, Lovely Professional University Unit 5: The Spark Neglected Burns the House by Leo Tolstoy 46 Digvijay Pandya, Lovely Professional University Unit 6: After Twenty Years by O. Henry 69 Gowher Ahmad Naik, Lovely Professional University -

Tagore's Song Offerings: a Study on Beauty and Eternity
Everant.in/index.php/sshj Survey Report Social Science and Humanities Journal Tagore’s Song Offerings: A Study on Beauty and Eternity Dr. Tinni Dutta Lecturer, Department of Psychology , Asutosh College Kolkata , India. ABSTRACT Gitanjali written by Rabindranath Tagore (and the English translation of the Corresponding Author: Bengali poems in it, written in 1921) was awarded the Novel Prize in 1913. He Dr. Tinni Dutta called it Song Offerings. Some of the songs were taken from „Naivedya‟, „Kheya‟, „Gitimalya‟ and other selections of his poem. That is, the Supreme Being is complete only together with the soul of the devetee. He makes the mere mortal infinite and chooses to do so for His own sake, this could be just could be a faint echo of the AdvaitaPhilosophy.Tagore‟s songs in Gitanjali express the distinctive method of philosophy…The poet is nothing more than a flute (merely a reed) which plays His timeless melodies . His heart overflows with happiness at His touch that is intangible Tagore‟s song in Gitanjali are analyzed in this ways - content analysis and dynamic analysis. Methodology of his present study were corroborated with earlier findings: Halder (1918), Basu (1988), Sanyal (1992) Dutta (2002).In conclusion it could be stated that Tagore‟s songs in Gitanjali are intermingled with beauty and eternity.A frequently used theme in Tagore‟s poetry, is repeated in the song,„Tumiaamaydekechhilechhutir‟„When the day of fulfillment came I knew nothing for I was absent –minded‟, He mourns the loss. This strain of thinking is found also in an exquisite poem written in old age. -

Dus Mahavidyas
Newsletter Archives www.dollsofindia.com Rabindranath Tagore – A Beacon of Light Copyright © 2011, DollsofIndia Jeebono Jokhon Shukaey Jaey When the heart is hard and parched up Korunadharaey Esho come upon me with a shower of mercy. Shokolo Madhuri Lukaey Jaey When grace is lost from life Geetoshudharoshe Esho come with a burst of song. Kormo Jokhon Probolo Aakar When tumultuous work raises its din Goroji Uthiya Dhake Chari Dhar on all sides shutting me out from beyond, Hridoyprante, Hey Jibononath come to me, my lord of silence Shanto Chorone Esho with thy peace and rest. Aaponare Jobe Koriya Kripon When my beggarly heart sits crouched Kone Pore Thake Deenohino Mon shut up in a corner, Duraar Khuliya, Hey Udaaro Nath break open the door, my king Raajoshomarohe Esho and come with the ceremony of a king Bashona Jokhon Bipulo Dhulaey When desire blinds the mind Ondho Koriya Obodhe Bhulaey with delusion and dust Ohe Pobitro, Ohey Onidro O thou holy one, thou wakeful Rudro Aaloke Esho come with thy light and thy thunder - a poem from the collection - Transalated by Rabindranath Tagore "Gitanjali" Original writing of Rabindranath Tagore Courtesy Gitabitan.net This song was sung by Rabindranath Tagore for Mahatma Gandhi, on September 26, 1932, right after Gandhi broke his fast unto death, undertaken to force the colonial British Government to abjure its decision of separation of the lower castes as an electorate in India. Tagore was and will remain one of the greatest poets and philosophers the world has ever seen. His contribution to Indian literature, music, arts and drama endeared him not only to Bengalis but to Indians and the world at large. -

In the World of Men: Tagore's Arrival in the Spiritual Domain of Nationalism
In the World of Men: Tagore’s Arrival in the Spiritual Domain of Nationalism Banibrata Goswami Panchakot Mahavidyalaya, India Abstract Rabindranath Tagore was born in a family which, on one hand, inherited a legacy of rich Indian culture, and on the other, did not hesitate to welcome the modernism, freshly arrived from Europe through waves of Enlightenment. He was sent early to England to imbibe the gifts of modern science and rationalism that could lead him to a standard and secured career. But even though the discipline of work, love for liberalism and quest after scientific truth and technological perfection there impressed him much, in its over all effect the West’s efforts of de-humanization disappointed Tagore and disillusioned him as well. This led him finally to the realization and reconstruction of the motherland that is India. He came to meet the common man and his everyday sorrows and tears in rural Bengal, in Silaidaha, Patisar and Sazadpur where he was given the duty to look after the family estate. The raw and rough smell of the soil, the whirl of the waves in river Padma, the play of seasons on the strings of nature lent him a unique insight. He learnt to weave his words offering a perfect slide show of mutual reciprocation of man and nature, accompanied by a hitherto unheard melody of folk tune that glorifies the struggles of that life and thereby consolidating it gradually to a consciousness out of which a nation is born. The present essay intends to seek and understand the secrets of that story, which, though lacking miserably in sound and fury, strives towards a steady self emergence and emancipation paving the way for political freedom. -

Indian Film Week Tydzień Kina Indyjskiego
TYDZIEń KINA INDYJSKIEGO 100-lecie kina w indiach kino kultura, warszawa 5–10 listopada 2012 INDIAN FILM WEEK 100 years of indian cinema kino kultura, warsaw 5–10 november 2012 W tym roku obchodzimy 100-lecie Kina Indyjskiego. This year we celebrate 100 years of Indian Cinema. Wraz z powstaniem pierwszego niemego filmu With the making of the first silent film ‘Raja Harish- „Raja Harishchandra” w 1913 roku, Indyjskie Kino chandra’ in 1913 , Indian Cinema embarked on an ex- wyruszyło w pasjonującą i malowniczą podróż, ilu- citing and colourful journey, reflecting a civilization strując przemianę narodu z kolonii w wolne, demokra- in transition from a colony to a free democratic re- tyczne państwo o bogatym dziedzictwie kulturowym public with a composite cultural heritage and plural- oraz wielorakich wartościach i wzorcach. istic ethos. Indyjska Kinematografia prezentuje szeroki Indian Cinema showcases a rich bouquet of lov- wachlarz postaci sympatycznych włóczęgów, ponad- able vagabonds, evergreen romantics, angry young czasowych romantyków, młodych buntowników, men, dancing queens and passionate social activists. roztańczonych królowych i żarliwych działaczy spo- Broadly defined by some as ‘cinema of interruption’, łecznych. Typowe Kino Indyjskie, zwane bollywoodz- complete with its song and dance ritual, thrills and ac- kim, przez niektórych określane szerokim mianem tion, melodrama, popular Indian cinema, ‘Bollywood’, „cinema of interruption” – kina przeplatanego pio- has endeared itself to global audiences for its enter- senką, tańcem, emocjami i akcją, teatralnością, dzięki tainment value. Aside from all the glitz and glamour walorowi rozrywkowemu, zjednało sobie widzów na of Bollywood, independent art house cinema has been całym świecie. Oprócz pełnego blichtru i przepy- a niche and has made a seminal contribution in en- chu Bollywood, niszowe niezależne kino artystyczne hancing the understanding of Indian society. -

Tagore's School and Methodology: Classrooms Without Walls
2016 | GITANJALI & BEYOND 1: 83-101 Tagore's School and Methodology: Classrooms Without Walls Thomas B. KANE, Edinburgh Napier University Abstract: This paper argues that Rabindranath Tagore, a very practical man, devel- oped a distinctive and successful educational methodology over the course of his work in educational systems. The paper seeks to show that Tagore drew inspiration and direction from extraordinary times, and ex- traordinary people of those times. The paper establishes the Tagore fami- ly’s place within the ongoing Bengali Renaissance; and to Tagore’s place among remarkable individuals, particularly Jagadish Chandra Bose and Patrick Geddes. The paper looks to the emergence of the poet’s education- al institutions from spiritual and technological viewpoints. An attempt is made to show that Tagore’s educational establishments were methodolog- ically developed, can claim to be part of his poetic legacy; and that telepresence technologies of the twenty-first century might offer good service to those establishments as they continue to evolve. Keywords: Tagore, Visva-Bharati, Bengal Renaissance, Bose, Geddes, telepresence, education This work is licensed under the Creative Commons | © Thomas B. Kane http://dx.doi.org/10.14297/gnb.1.1.83-101 | http://gitanjaliandbeyond.napier.ac.uk/ 84 | THOMAS B. KANE Tagore’s educational achievements gain perspective when viewed as a consequence of the Bengali Renaissance, which the Tagore family contrib- uted to for three generations. A major aspect of the Bengali renaissance was spiritual: specifically, reconnection with the ancient Vedic and Upani- shadic scriptures. The 32 years, spanning Tagore's life from 30 to 62, saw Tagore integrate his poetic and spiritual sensibilities with an evolving edu- cational methodology. -

Festa Del Cinema Di Roma
Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in una foto FESTA che celebra, oltre al glamour del grande cinema, il senso di comunione e amore interrazziale. Lo scatto, in occasione delle riprese di Paris Blues di Martin Ritt (1961), film candidato all’Oscar® per la miglior colonna sonora firmata da Duke DEL CINEMA Ellington, rappresenta un omaggio a due icone della storia del cinema. Il senso di complicità, la gioia di stare insieme, la condivisione delle esperienze, il valore della collaborazione umana e artistica sono il beat DI ROMA della Festa del Cinema 2020. Sidney Poitier and Paul Newman are the protagonists of the official poster of the 15th Rome Film Fest. This is an image that celebrates the glamour of great cinema but also a sense of communion and interracial love.The photo, taken during the shooting of Paris Blues by Martin Ritt (1961), the film est ® F nominated for the Oscar for Best Soundtrack, composed by Duke Ellington, is a tribute to two icons in the history of film. That sense of complicity, the joy of being together, the sharing of experiences, the value of human and artistic collaboration are the beat of Rome Film Fest 2020. ome Film R oma | R 15 25 10 2020 esta del Cinema di F 20 Edizione 0 2 Edition © Everett Collection Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in una foto FESTA che celebra, oltre al glamour del grande cinema, il senso di comunione e amore interrazziale. -
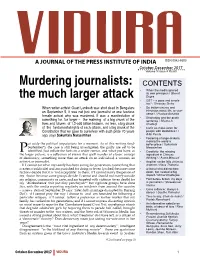
Murdering Journalists
A JOURNAL OF THE PRESS INSTITUTE OF INDIA ISSN 0042-5303 October-December 2017 Volume 9 Issue 4 Rs 60 Murdering journalists: CONTENTS • When the media ignored its own principles / Bharat the much larger attack Dogra • GST – a good and simple tax? / Shreejay Sinha When writer-activist Gauri Lankesh was shot dead in Bengaluru • Do Indian cinema and on September 5, it was not just one journalist or one fearless television mimic life, or vice- female activist who was murdered. It was a manifestation of versa? / Pushpa Achanta • Dhananjoy and the death something far, far larger – the maiming of a big chunk of the sentence / Shoma A. lives and futures of 1.2-odd billion Indians, no less, a big chunk Chatterji of the fundamental rights of each citizen, and a big chunk of the • Can’t we make room for Constitution that we gave to ourselves with such pride 70 years people with disabilities? / ago, says Sakuntala Narasimhan Aditi Panda • Fostering change-makers, making the world a ut aside the political imputations for a moment. As of this writing (end- better place / Sakuntala September*), the case is still being investigated, the guilty are yet to be Narasimhan Pidentified. Just collate the facts on a wider canvas, and what you have, as • Creativity: the missing the larger picture, is a collection of events that spell murder of a basic concept ingredient in Chinese of democracy, something more than an attack on an individual, a woman, an thinking? / Asma Masood activist, or journalist. • Another scribe falls victim to If I cannot eat what my family -

NEET-2016-Honorable-Supreme
All India ROLL APPNO CNAME FNAME Rank 1 61006480 7300516 HET SHAH SANJAYKUMAR SHAH 2 60814976 7101292 EKANSH GOYAL SANJAY GOYAL 3 64008387 7107264 NIKHIL BAJIYA BHANWAR SINGH BAJIYA 4 61105682 7029377 ASHANK KHAITAN ANURAG KHAITAN 5 60504189 7113232 ARUSHI JASPAL RAM 6 61104349 7136495 DYUTI SHAH DURLABH SHAH BISHNOI 7 60510525 7025885 JAPNOOR KAUR MANMEET SINGH 8 65007312 7000142 DHRITIMAN CHATTERJEE SUPRIYO CHATTERJEE 9 61102675 7273463 AMIT KUMAR RATTAN LAL 10 64005180 7103882 UTKARSH ANAND MANOJ KUMAR SINHA 11 60828184 7056545 BALAJI DATTATRAYA SHUKLA SHATRUGHNA SHUKLA 12 60835453 7145776 PRAKHAR BANSAL AJAY BANSAL 13 64202454 7040682 PATEL LAJJA BEN JAYESH KUMAR PATEL JAYESH KUMARLAXMAN BHAI 14 60505421 7041203 TOSHALI PANDEY AWADHESH KUMAR PANDEY 15 60505074 7014382 GURASIS SINGH BOPARAI JAGWANT SINGH 16 60516344 7011909 TANISH MODI MANISH MODI 17 64903025 7197955 PRIYAZ MISHRA RAM RAJIV MISHRA 18 60416707 7193284 SWETANK ANAND BIRENDRA KUMAR 19 64104501 7107997 MAHAK KUMAR SURANA MAHENDRA KUMAR SURANA 20 64207759 7215659 PRACHI SINGH VINOY KUMAR SINGH 21 64714228 7147645 SHREYA MITTAL PAVAN KUMAR MITTAL 22 61103254 7081544 VISHAL SAINI SURENDER SINGH 23 64000996 7264260 AYUSH JAIN RAKESH KUMAR JAIN 24 60821877 7135524 AKHIL GUPTA MANOJ GUPTA 25 60835360 7046576 NIPUN SINGHAL NEERAJ SINGHAL 26 61905278 7179612 SIDDARTH V RAJ VARADARAJ V 27 64000872 7104550 SHUBHAM LEKHWANI OM PRAKASH LEKHWANI 28 60500574 7166230 SUKRITI CHAUDHRI SANDEEP CHAUDHRI 29 60511876 7031466 LOVISH GUPTA ARVIND KUMAR 30 60826866 7147125 AISHVARY GUPTA BRIJESH -

Annual Report 2015-2016
VISVA-BHARATI Annual Report 2015-2016 Santiniketan 2016 YATRA VISVAM BHAVATYEKANIDAM (Where the World makes its home in a single nest) “ Visva-Bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best ” -Rabindranath Tagore Contents Chapter I ................................................................i-v Department of Biotechnology...............................147 From Bharmacharyashrama to Visva-Bharati...............i Centre for Mathematics Education........................152 Institutional Structure Today.....................................ii Intergrated Science Education & Research Centre.153 Socially Relevant Research and Other Activities .....iii Finance ................................................................... v Kala Bhavana.................................................157 -175 Administrative Staff Composition ............................vi Department of Design............................................159 University At a Glance................................................vi Department of Sculpture..........................................162 Student Composition ................................................vi Department of Painting..........................................165 Teaching Staff Composition.....................................vi Department of Graphic Art....................................170 Department of History of Art..................................172 -
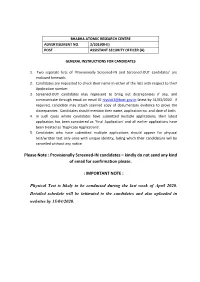
Please Note : Provisionally Screened-IN Candidates – Kindly Do Not Send Any Kind of Email for Confirmation Please
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE ADVERTISEMENT NO. 2/2019(R-II) POST ASSISTANT SECURITY OFFICER (A) GENERAL INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES 1. Two separate lists of ‘Provisionally Screened-IN and Screened-OUT candidates’ are enclosed herewith. 2. Candidates are requested to check their name in either of the lists with respect to their Application number. 3. Screened-OUT candidates may represent to bring out discrepancies if any, and communicate through email on email ID [email protected] latest by 31/03/2020. If required, candidate may attach scanned copy of documentary evidence to prove the discrepancies. Candidates should mention their name, application no. and date of birth. 4. In such cases where candidates have submitted multiple applications, their latest application has been considered as ‘Final Application’ and all earlier applications have been treated as ‘Duplicate Applications’. 5. Candidates who have submitted multiple applications should appear for physical test/written test only once with unique identity, failing which their candidature will be cancelled without any notice. Please Note : Provisionally Screened-IN candidates – kindly do not send any kind of email for confirmation please. : IMPORTANT NOTE : Physical Test is likely to be conducted during the last week of April 2020. Detailed schedule will be intimated to the candidates and also uploaded in websites by 15/04/2020. List of candidates provisionally Screened - IN for the post of Assistant Security Officer (A) against advertisement No. 02/2019(R-II) Sl No Appl No Title -

Infinitydraftfinal 110712.Pub
2 Editor Mr.Dilip Kumar Sen, Head, Dept. of English Joint Convener - Ms. Leena Sarkar Bhaduri ,Dept. of English Ms. Barnali Goswami, Dept. of CA Member - Mr. Sajal Saha, Dept. of CA Mr. Arindam Chatterjee, Registrar(Acting) Ms.Rumpa Saha, Dept. of EE Dr. Subhasis Biswas, Dept. of Chemistry Dr. Sumit Nandi,Dept. of Chemistry Students - Sourav Majumdar EE2A Arittra Pramanick IT2 Souradeep Sinha EE2A Indranil Samanta IT2 Bhaswati Chatterjee ECE1A Bhaglyalakshmi Mishra IT2 Arsi Chatterjee CSE2A 3 infi NIT y Vol-1 No. 2 May2012 Narula Institute of Technology Achievements Inside this issue: The Other Tagore 3 Department of Computer Application published the inaugural issue “International Journal of Frontier Computing (IJFC)”. The inaugural Tagore Remixed: Moderniza- 5 issue contains 10 high quality peer reviewed paper. tion or Vandalism? Department of Electrical Engineering organized one day workshop on Reflection on Paintings of 7 “Electrical Energy and Future” on 11.02.12 Rabindranath Tagore NIT organized an event on the occasion of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda on 25.04.12 lh£¾cÊe¡b J ¢h‘¡e 9 NIT organizes a blood donation camp on 09.02.12 Event 12 JIS Group organizes an inter college cricket tournament where JIS college of engineering, Kalyani won the trophy and Narula institute of Photo ultimo 13 Technology was the runners up. English department organized interdepartmental power point presenta- Sketch 12 tion competition 03.05.12 Department of ECE organized national level workshop “Antenna model- An Initiative of Literary Committee, ing using HFSS and it’s Application” on 22nd-23rd June, 2012. Narula Institute of Technology.