Annales Historiques De La Révolution Française
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE BRITISH ARMY in the LOW COUNTRIES, 1793-1814 By
‘FAIRLY OUT-GENERALLED AND DISGRACEFULLY BEATEN’: THE BRITISH ARMY IN THE LOW COUNTRIES, 1793-1814 by ANDREW ROBERT LIMM A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY. University of Birmingham School of History and Cultures College of Arts and Law October, 2014. University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT The history of the British Army in the French Revolutionary and Napoleonic Wars is generally associated with stories of British military victory and the campaigns of the Duke of Wellington. An intrinsic aspect of the historiography is the argument that, following British defeat in the Low Countries in 1795, the Army was transformed by the military reforms of His Royal Highness, Frederick Duke of York. This thesis provides a critical appraisal of the reform process with reference to the organisation, structure, ethos and learning capabilities of the British Army and evaluates the impact of the reforms upon British military performance in the Low Countries, in the period 1793 to 1814, via a series of narrative reconstructions. This thesis directly challenges the transformation argument and provides a re-evaluation of British military competency in the French Revolutionary and Napoleonic Wars. -

Member of the House of Assembly, and of St
WHO WAS WHO, 1897-1916 HORDES Sir William 5th Bt. 3rd BOOTH, Henry Gore-, ; Secretary 1884 ; 2nd Secretary 1888 ; 1760 D.L. ; Arctic traveller ; served at cr. ; J.P., Athens, , Brussels, Lisbon, Rome, ' Chairman of Sligo, Leitrim, and Northern Vienna, Munich, and Paris ; Acting Charge" Counties Railway, Ireland; b. 1843; S. d'Affaires and 1st Secretary Rio de Janeiro o. d. of late Col. father 1876 ; m. Georgina, (retired) ; 1st Secretary at Tokio, 1901- C. J. Hill, of Tickhill Castle, Yorks, 1867. 1902 ; Secretary of Legation, Brussels, acres 1902-5 Educ. : Eton. Owned about 32,000 ; Councillor of Embassy at Vienna, in Ireland, and property in Salford, Man- 1905-7. Heir: b. Charles, b. 22 June 1858. chester. Publications : Whaling (Badmin- Address : British Embassy, Santiago. Clubs : St. ton Library) ; Basking Sharks (Longman's James's, Travellers'. in 1913. Mag.) ; Shark and Whaling Encyclopaedia [Died 22 Jan. : of Sport. Recreations shooting, fishing, BOOTHBY, Guy Newell, novelist ; b. Adelaide, life Heir : South *. of yachting, and in early hunting. Australia, 13 Oct. 1867 ; e. : s Josslyn b. 1869. Address Lissadel, ] Thomas Wilde Boothby, for some time Sligo. Clubs : Carlton, Windham, Royal I member of the House of Assembly, and of St. George Yacht. [Died 13 Jan. 1900. g.-s. Mr. Justice Boothby ; m. Rose Alice, General 3rd d. of William Bristowe of Champion BOOTH, Rev. William, D.C.L. Oxon. ; and Commander-in-Chief of Salvation Army Hill. Educ. : Salisbury. In 1891 crossed Australia from north to south travelled and director of its social institutions for ; classes in the East, etc. Publications : On the destitute, vicious, and criminal ; 1894 In 1894 formerly Minister of the New Connection Wallaby, ; Strange Company, ; The of Lost 10 1829 Marriage Esther, 1895 ; A Church'; b. -

Wellington's Two-Front War: the Peninsular Campaigns, 1808-1814 Joshua L
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2005 Wellington's Two-Front War: The Peninsular Campaigns, 1808-1814 Joshua L. Moon Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES WELLINGTON’S TWO-FRONT WAR: THE PENINSULAR CAMPAIGNS, 1808 - 1814 By JOSHUA L. MOON A Dissertation submitted to the Department of History In partial fulfillment of the Requirements of the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded Spring Semester, 2005 The members of the Committee approve the Dissertation of Joshua L. Moon defended on 7 April 2005. __________________________________ Donald D. Horward Professor Directing Dissertation ____________________________________ Patrick O’Sullivan Outside Committee Member _____________________________ Jonathan Grant Committee Member ______________________________ Edward Wynot Committee Member ______________________________ Joe M. Richardson Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named Committee members ii ACKNOWLEDGMENTS No one can write a dissertation alone and I would like to thank a great many people who have made this possible. Foremost, I would like to acknowledge Dr. Donald D. Horward. Not only has he tirelessly directed my studies, but also throughout this process he has inculcated a love for Napoleonic History in me that will last a lifetime. A consummate scholar and teacher, his presence dominates the field. I am immensely proud to have his name on this work and I owe an immeasurable amount of gratitude to him and the Institute of Napoleon and French Revolution at Florida State University. -

National Identity and the British Common Soldier Steven Schwamenfeld
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2007 "The Foundation of British Strength": National Identity and the British Common Soldier Steven Schwamenfeld Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE ARTS AND SCIENCES “The Foundation of British Strength:” National Identity and the British Common Soldier By Steven Schwamenfeld A Dissertation submitted to the Department of History In partial fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Fall Semester, 2007 The members of the Committee approve the dissertation of Steven Schwamenfeld defended on Dec. 5, 2006. ___________________ Jonathan Grant Professor Directing Dissertation _____________ Patrick O’Sullivan Outside Committee Member _________________ Michael Cresswell Committee Member ________________ Edward Wynot Committee Member Approved: ___________________ Neil Jumonville, Chair History Department The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii TABLE OF CONTENTS List of Tables iv Abstract v Introduction 1 I. “Thou likes the Smell of Poother” 13 II. “Our Poor Fellows” 42 III. “Hardened to my Lot” 63 IV. “…to Conciliate the Inhabitants” 92 V. Redcoats and Hessians 112 VI. The Jewel in the Crown of Thorns 135 VII. Soldiers, Settlers, Slaves and Savages 156 VIII. Conclusion 185 Appendix 193 Bibliography 199 Biographical Sketch 209 iii LIST OF -

The History of Napoleon Buonaparte
THE HISTORY OF NAPOLEON BUONAPARTE JOHN GIBSON LOCKHART CHAPTER I BIRTH AND PARENTAGE OF NAPOLEON BUONAPARTE—HIS EDUCATION AT BRIENNE AND AT PARIS—HIS CHARACTER AT THIS PERIOD—HIS POLITICAL PREDILECTIONS—HE ENTERS THE ARMY AS SECOND LIEUTENANT OF ARTILLERY—HIS FIRST MILITARY SERVICE IN CORSICA IN 1793. Napoleon Buonaparte was born at Ajaccio on the 15th of August, 1769. The family had been of some distinction, during the middle ages, in Italy; whence his branch of it removed to Corsica, in the troubled times of the Guelphs and Gibellines. They were always considered as belonging to the gentry of the island. Charles, the father of Napoleon, an advocate of considerable reputation, married his mother, Letitia Ramolini, a young woman eminent for beauty and for strength of mind, during the civil war— when the Corsicans, under Paoli, were struggling to avoid the domination of the French. The advocate had espoused the popular side in that contest, and his lovely and high-spirited wife used to attend him through the toils and dangers of his mountain campaigns. Upon the termination of the war, he would have exiled himself along with Paoli; but his relations dissuaded him from this step, and he was afterwards reconciled to the conquering party, and protected and patronised by the French governor of Corsica, the Count de Marbœuff. It is said that Letitia had attended mass on the morning of the 15th of August; and, being seized suddenly on her return, gave birth to the future hero of his age, on a temporary couch covered with tapestry, representing the heroes of the Iliad. -

War of the Fourth Coalition 1 War of the Fourth Coalition
War of the Fourth Coalition 1 War of the Fourth Coalition The Fourth Coalition against Napoleon's French Empire was defeated in a war spanning 1806–1807. Coalition partners included Prussia, Russia, Saxony, Sweden, and the United Kingdom. Many members of the coalition had previously been fighting France as part of the Third Coalition, and there was no intervening period of general peace. In 1806, Prussia joined a renewed coalition, fearing the rise in French power after the defeat of Austria and establishment of the French-sponsored Confederation of the Rhine. Prussia and Russia mobilized for a fresh campaign, and Prussian troops massed in Saxony. Overview Napoleon decisively defeated the Prussians in a lightning campaign that culminated at the Battle of Jena-Auerstedt on 14 October 1806. French forces under Napoleon occupied Prussia, pursued the remnants of the shattered Prussian Army, and captured Berlin on October 25, 1806. They then advanced all the way to East Prussia, Poland and the Russian frontier, where they fought an inconclusive battle against the Russians at Eylau on 7–8 February 1807. Napoleon's advance on the Russian frontier was briefly checked during the spring as he revitalized his army. Russian forces were finally crushed by the French at Friedland on June 14, 1807, and three days later Russia asked for a truce. By the Treaties of Tilsit in July 1807, France made peace with Russia, which agreed to join the Continental System. The treaty however, was particularly harsh on Prussia as Napoleon demanded much of Prussia's territory along the lower Rhine west of the Elbe, and in what was part of the former Polish–Lithuanian Commonwealth. -

PRIN Decennio Francese in Calabria
yg La nave di Odisseo e la campagna francese nelle Terre dello Stretto* Rosario Giovanni Brandolino, Andrea Gioco, Rosina Giovanna Maione, Leonardo Strati Mi succede di non avere più voglia di uscire da questo mondo di miti e di non sapere più nemmeno dov’è il mondo reale Hugo Pratt1 PALCOSCENICO BINARIO Per terre e per mari. Questo è un testo anfibio, in parte saggio, in parte racconto. Si rivolge ad un ascolto doppio, o meglio polimorfo. Non solo ad un creativo che si fa lettore, ma ad un lettore che sia anche creativo2. È una lettura che si esprime su alcune considerazioni di voci narranti, tra mito e leg- genda, su personaggi che non hanno solcato il suolo ma appartengono al dizionario del mito. Un parallelo senza identità, posto tra le figure di Ulisse e Napoleone Bonaparte. Un discorso tra Epica ed Epopea, che cerca di legare indissolubilmente alcune pagine che, in Calabria e nell’Area dello Stretto, si relazionano. Il poema immaginario e la dimensione del reale, si propongono come intermediari di un proces- so comune. Avvenimenti appartenenti entrambi a due latitudini latine, espresse sia dal tempo che da un fugace parallelo mediterraneo, e che incontrano storia e vicende di un territorio che coesiste, in modo marginale, tra il periplo di Ulisse e le conquiste di Napoleone Bonaparte. Fig. 1. Kehinde Wiley, Napoleon Leading The Army Fig. 2. Jacques-Louis David, Bonaparte Crossing the Letteratura e storia, alla ricerca di un mito, poste nella terra di mezzo, in cui vicine Over The Alps, 2005. Alps at Grand-Saint-Bernard, 1800-1801. -

The Nelson Collection Factsheet 2
The Nelson Collection factsheet 2 The Nelson Collection is a display of prized artefacts, letters and valuable silverware from an important period in history. It vividly recalls the exciting times following the Revolution, and a series of brilliant naval victories, ending with Trafalgar. Lord Nelson & Lloyd’s The Nelson Collection at Lloyd’s vividly recalls the long war with France following the French Revolution, and the brilliant series of naval victories ending with Trafalgar. It is also a reminder that this was a relatively dramatic era for Lloyd’s. From a disorganised coffee house, the Society had emerged as a powerful fraternity of underwriters who were playing a leading part in supporting the nation’s war efforts. Lloyd’s links with Horatio Nelson date from the first of his great victories, the Battle of the Nile, 1798. A fund of over £38,000 was raised at Lloyd’s to relieve the suffering of the wounded and bereaved. The fund’s management committee under the great John Julius Angerstein, also voted Nelson £500 ‘...to be laid out in plate in such a manner as you will be pleased to direct, as a small token of their gratitude...’ Nelson’s ‘Nile Dinner Service’ was later augmented with a similar gift from the Lloyd’s fund raised after the Battle of Copenhagen in 1801. These silver dinner services formed the nucleus of the Nelson Collection. Vice Admiral Horatio Lord Nelson KB The son of a Norfolk rector, Horatio Nelson was born at Burnham Thorpe on 29th September 1758. When he was 12 years old he joined the Royal Navy and three years later was on an expedition to the Arctic. -

The Contribution of the Irish Soldier to the British Army During the Peninsula Campaign 1808 – 1814
The Journal of Military History and Defence Studies Volume 1 Issue 1 (January 2020) The contribution of the Irish soldier to the British Army during the Peninsula campaign 1808 – 1814 James Deery The majority of the historiography concerning the Irish contribution to the British army during their campaign on the Iberian Peninsula (1808 -1814) has focused on the Irish regiments and their service with Wellington in Portugal, Spain and France. While the significance of research into these regiments is undeniable it has unintentionally resulted in an under appreciation of the true extent of the Irish soldier’s contribution. The purpose of this paper is to add to the existing historiography by examining the wider Irish contribution in order to arrive at an empirical based assessment as to the criticality of the Irish soldier to Wellington’s victory during the Peninsula war. The majority of Irish soldiers who served in the Peninsula did so in English and Scottish infantry regiments. Their abilities and crucially their integration into the British army were key success factors for Wellington during the Peninsula campaign. An examination of how this was achieved forms a key part of this paper which finds that the capabilities of the Irish soldier and the British army organisational structure and system mutually supported each other. Furthermore, the Irish officer’s contribution has only been assessed based on individual accounts and narratives in the absence of any in-depth evaluation of their actual numbers. With over 30 per cent of Wellington’s officers being Irish an analysis of their levels of command was undertaken to demonstrate their significance to the overall conduct and operation of the Peninsula army. -

Napoleonic Wars Communication Game
Napoleonic Wars Communication Game This game is about the difficulties of communicating information on the battlefield. A successful military strategy is completely dependent on conveying information to the right people at the right time. Without this, troops cannot be coordinated successfully, and generals cannot strategise. For a message to travel quickly every one of these links in the chain must successfully convey a message to the next. In the pages that follow you will find 7 characters, each representing a rank in the chain of command. Will your message reach its destination? SPY/SCOUT Lieutenant-Colonel Colquhoun Grant I am a spy, but not a spy like we think of them today. I always ride in full uniform including when I am behind enemy lines! Before the Battle of Waterloo, I worked in France sending reports about Napoleon's strengths and weaknesses but I managed to return to Belgium to fight on the day of the Battle of Waterloo! I get information from anyone I can. I give information to the MILITARY SECRETARY MILITARY SECRETARY Lieutenant-Colonel Lord Fitzroy Somerset I go everywhere with the Duke of Wellington, the Commander-in-Chief, as his personal secretary. If you need to get a message to Wellington you talk to me! I know everything that is going on, so when Wellington is unavailable, I pass on his messages. I get information from the SPY/SCOUT I give information to the COMMANDER-IN-CHIEF COMMANDER- IN-CHIEF Field-Marshal The Duke of Wellington I make the final decision about everything in the Battle and need to get my orders out as fast and quickly as possible. -
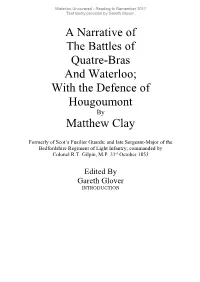
Matthew Clay
Waterloo Uncovered - Reading to Remember 2017 Text kindly provided by Gareth Glover. A Narrative of The Battles of Quatre-Bras And Waterloo; With the Defence of Hougoumont By Matthew Clay Formerly of Scot’s Fusilier Guards; and late Sergeant-Major of the Bedfordshire Regiment of Light Infantry; commanded by Colonel R.T. Gilpin, M.P. 31st October 1853 Edited By Gareth Glover INTRODUCTION Waterloo Uncovered - Reading to Remember 2017 Text kindly provided by Gareth Glover. This eighth booklet in my series of previously unpublished or scarce memoirs, is a full transcription of the narrative of the Waterloo campaign by Private Matthew Clay 2nd Battalion 3rd [Scots Fusilier] Foot Guards, published in Bedford in 1853. This particular memoir is perhaps well known as it is often quoted in general histories of this most famous of battles, but rather surprisingly is virtually never seen in its full unadulterated form, as it has rarely been reprinted and is thus extremely scarce. Indeed I had to refer to the British Library to obtain a copy of the original work (British Library catalogue no. W2-4640) who were then kind enough to grant me permission to publish the same. I chose to publish this narrative simply because it is so rare and having sought a copy for so long I wanted fellow students of the battle to be able to obtain ready access to it. Much of the text will not be new to the reader, as it has been quoted ad infinitum by historians when referring to the Battle of Waterloo. However, a closer examination of the complete text does produce some small nuances in our understanding of those three fateful days and one completely new and significant 2 Waterloo Uncovered - Reading to Remember 2017 Text kindly provided by Gareth Glover. -

The Nafziger
THE NAFZIGER ORDERS OF BATTLE COLLECTION FINDING AID Updated: June 2012 This collection was provided through the generous donation of George Nafziger to the Combined Arms Research Library. The Nafziger Orders Of Battle Collection contains a compilation of 7985 individual orders of battle from 1600 to 1945. It began with George Nafziger’s interest in Napoleonic Wars, and steadily grew to other areas because of the gaming public's interest in these highly detailed historical orders of battle. Sources range from published works to actual archival documents, which represent the largest single source. Nearly all orders of battle break down to the regimental level. The availability of strength figures and artillery equipment varies from period to period. Orders of Battle are available in PDF format using this finding aid. Use the search function to locate the Order of battle by title or file name. The corresponding link will take you to the Order of Battle. The American Civil War portion of the Nafziger Collection contains 812 individual orders of battle from 1861-1865. Brett Schulte scanned the American Civil War orders of battle for George Nafziger. They are available here due to their generosity. Mr. Schulte writes a blog which is available at http://www.brettschulte.net/CWBlog. The American Civil War, 1861-1865 portion of the Nafziger Orders Of Battle Collection is also available for searching on the CARL Digital Library at: http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/landingpage/collection/p15040coll6 FILE NAME: DOCUMENT TITLE: ITEM URL: 625XAA