Jury : 28.08.2019 Nombre De Pages : 161
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Revue De La Ffve N°27
LA REVUE DE LA FFVE N°27 - SPÉCIAL 50 ANS L’AUTHENTIQUE N°27 - SPÉCIAL 50 ANS L'authentique-2017_Mise en page 1 05/12/2017 11:51 Page 1 DEVIS IMMEDIAT 01 42 46 52 52 L’assurance [email protected] de vos passions Assurance autos, motos, cyclos, véhicules militaires, tracteurs… Tarifs dégressifs flottes Assurance clubs et associations de véhicules anciens www.iccassurances.fr 92 rue de Richelieu 75002 Paris PARIS - LYON - VALENCE RCS Paris 652 044 249 - Orias n° 07 000 004 - www.orias.fr Partenaire Officiel Sommaire N°27 - SPÉCIAL 50 ANS $ LE MOT DU PRÉSIDENT $ SUR LE TERRAIN Cinquante ans, ce n’est qu’un début…. .4 La Locomotion en Fête. 46 $ EN IMAGES 7e Vichy Classic . .50 50 ans au Service des Collectionneurs. .6 $ HISTOIRE DE LA FFVE Traversée de Paris Hivernale (P.20) $ VU, LU, ENTENDU Pour que Le Passé ait un Avenir . .52 Des livres, des news. .8 $ TÉMOIGNAGE $ SUR LE BUREAU DE LA FFVE Quand Les jeunes se rappellent les Anciens. .56 Les dossiers en cours . .10 $ SUR LE TERRAIN $ SUR LE TERRAIN Des Chevaux sous Le Capot. 60 Arts & Élégance à Chantilly (P.78) 50 ans, tout un programme ! . .14 100 Autos sur La Nationale 7. .62 1re Journée Nationale 11e Mécaniques en Flandres . .66 des Véhicules d’Époque . .16 17e Traversée de Paris Hivernale . .20 $ INTERVIEW 50 ans du Musée de Vendée. .22 Claude Delagneau. .70 Grand Prix du Puy-Notre-Dame (P.74) $ ÉTAT DES LIEUX $ SUR LE TERRAIN Les Grandes Victoires de la FFVE. .26 21e Grand Prix Rétro du Puy-Notre-Dame. -

RÉTROMOBILE 2018 by Artcurial Motorcars Sale 10 February 2018 17:00 N°3279 Auctioneer: Hervé Poulain Result: 31,815,566 €
RÉTROMOBILE 2018 by Artcurial Motorcars Sale 10 february 2018 17:00 Auctioneer: N°3279 Hervé Poulain Result: 31,815,566 € View E-Catalogue Download PDF Order the Catalogue Contact Anne-Claire Mandine Phone +33 1 42 99 20 73 [email protected] Amount MIN MAX OK 1 1966 Mini Cooper MKI No reserve Sold 19,720 € [$] 2 1943 Willys Jeep No reserve Sold 27,416 € [$] 3 1942 NSU HK 101 (SdKfz 2) "Kettenkrad" No reserve Sold 69,136 € [$] 4 1955 Jaguar XK 140 3.4 L Cabriolet No reserve Sold 107,280 € [$] 5 1960 Lotus Elite série 2 No reserve Sold 83,440 € [$] 6 1957 Facel Vega FV3 No reserve Sold 196,680 € [$] 7 1972 Citroën SM Carburateurs No reserve Sold 113,240 € [$] 8 1974 Citroën DS 23ie Pallas No reserve Sold 53,640 € [$] 9 1932 Delage D8S Coach par Chapron Sold 274,160 € [$] 10 1938 Delage D8 120 Cabriolet par Chapron Sold 536,400 € [$] 11 1912 Panhard Levassor X14 20 CV torpédo Vanvooren Sold 298,000 € [$] 12 1935 Alvis Speed Twenty SD cabriolet Vanvooren Sold 226,480 € [$] 13 1937 Horch 853 Sport Cabriolet Sold 631,760 € [$] 14 1938 Bentley 4 1/4 L Coupé Vanvooren Sold 278,400 € [$] 15 1937 Hispano Suiza K6 berline sans montants Vanvooren Sold 286,080 € [$] 16 Bugatti Type 57 Cabriolet Vanvooren Unsold 17 1928 Avions Voisin C11 Conduite intérieure Vanvooren Sold 137,080 € [$] 18 1950 Delahaye 135 M coach Vanvooren Sold 286,080 € [$] 19 1939 Rolls-Royce Wraith faux cabriolet Vanvooren Sold 143,040 € [$] 20 c. 1898 Gig Hippomobile Vanvooren Sold 13,112 € [$] 21 1938 Mercedes-Benz 170 V Cabriolet B No reserve Sold 64,368 € [$] 22 1936 -

France Historical AFV Register
France Historical AFV Register Armored Fighting Vehicles Preserved in France Updated 24 July 2016 Pierre-Olivier Buan Neil Baumgardner For the AFV Association 1 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION....................................................................................................4 ALSACE.................................................................................................................5 Bas-Rhin / Lower Rhine (67)........................................................5 Haut-Rhin / Upper Rhine (68)......................................................10 AQUITAINE...........................................................................................................12 Dordogne (24) .............................................................................12 Gironde (33) ................................................................................13 Lot-et-Garonne (47).....................................................................14 AUVERGNE............................................................................................................15 Puy-de-Dôme (63)........................................................................15 BASSE-NORMANDIE / LOWER NORMANDY............................................................16 Calvados (14)...............................................................................16 Manche (50).................................................................................19 Orne (61).....................................................................................21 -
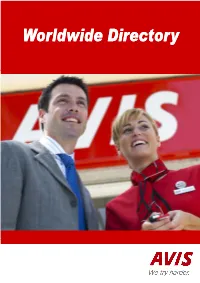
Worldwide Directory
Worldwide Directory Worldwide Directory Contents 1) Africa 2) Asia / Pacific 3) Canada 4) Caribbean 5) Europe 6) Latin America 7) Middle East 8) United States This page is intentionally left blank. March 2006 Africa Yaounde Apt, Bp 1740 YAO/6127 Nkrumah Road Opposite Dhl, Next To ANGOLA % 237 2 23 36 46 % 237 2 23 17 10 GABON Consolidated Bank MM1/4369 * 237 2 23 30 10 % 25441220465 LUANDA LAD/3377 HEADQUARTERS OFFICE YA5/9428 FRANCEVILLLE MVB/4171 † 254412224485 Luanda Airport Bonaberi Bp 1217, , Douala Mwengue Airport, P.O Box 10 NAIROBI NB1/4350 % 244 2 22321551 % 237 3 39 80 56 % 237 3 39 76 55 % 241 677172 College House, University Way † 244 222323515 * 237 3 39 66 56 † 241 677172 % 254 20 336704 * ZA-745330 * 5602 † 254 20 339111 Luanda Airport TK9/3377 LIBREVILLE LBV/4167 Nairobi Airport, Po Box 45456 NBO/4342 % 244 2 323182 CENTRAL AFRICAN International Airport, Leon Mba % 254 2 0722834168 † 244 2 321620 % 241 724251 † 254 20 339111 * ZA-745330 REPUBLIC † 241 740041 HEADQUARTERS OFFICE YB8/9442 HEADQUARTERS OFFICE AJ3/7529 * 5602 Ngong Road, Po Box 45456, Nairobi Avenue Che Gevara 250, Maculusso, BANGUI QN3/1408 Meridien Hotel, Box 2181 PW2/2670 % 254 20 336704 Luanda Cfao Agence Centrale, Bp 853 % 241 765328 † 254 20 339111 % 244 2 321551 % 61 32 78 † 241 740041 † 244 2 323515 † 61 73 64 * 5602 * 5286 RC Zone Oloumi, Box 2181 LB4/4168 LESOTHO HEADQUARTERS OFFICE HQ1/7828 % 241 724251 BENIN Avenue Du Tchad, Bp 853, Bangui, BP 387 † 241 740041 MASERU MSU/4701 % 236 61 44 55 % 236 61 32 78 * 5602 Moshoeshoe International Apt, Masenod -
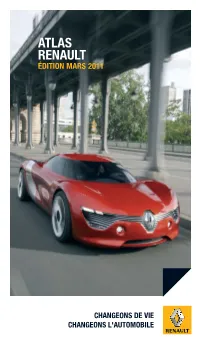
Atlas Renault Édition Mars 2011
COUV-ATLAS2011-fr 16/02/11 13:23 Page 1 ATLAS RENAULT ÉDITION MARS 2011 (www.renault.com) (www.media.renault.com) CHANGEONS DE VIE CHANGEONS L'AUTOMOBILE Concept couverture : Angie - Conception/Réalisation : Scriptoria - Impression : Jouve ATLAS RENAULT ÉDITION MARS 2011 01 SOMMAIRE 02 CHIFFRES CLÉS 03 FAITS MARQUANTS 2010 04 RENAULT 2016 DRIVE THE CHANGE L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN 08 Structure 10 Coopérations 12 Ventes mondiales et implantations industrielles LE GROUPE RENAULT 16 Organigramme 18 Le groupe Renault, 3 marques et 1 partenaire stratégique 20 Véhicule électrique 22 Les gammes véhicules 26 Les gammes moteurs et boîtes de vitesses 30 Renault sport 31 Renault Tech 32 Pièces de rechange et accessoires 33 RCI Banque 34 Informations financières 36 Effectifs 37 Responsabilité sociale et environnementale CONCEVOIR, FABRIQUER ET VENDRE 40 Implantations mondiales 44 Recherche & développement 46 Chiffres clés de production 47 Production mondiale 52 Achats 53 Supply chain 54 Réseau commercial 55 Ventes mondiales 58 Ventes région Europe 65 Ventes région Euromed & Eurasie 66 Ventes région Asie-Afrique 67 Ventes région Amériques 68 Renault, 112 ans d’histoire Ce document est également accessible sur les sites www.renault.com et www.media.renault.com ATLAS RENAULT ÉDITION MARS 2011 02 / 03 (1) durable pour tous : véhicule électrique, OCTOBRE CHIFFRES CLÉS nouvelles énergies, futurs moteurs Dans le cadre du Mondial de Paris 2010, thermiques moins polluants. Renault présente : I sa gamme complète de véhicules élec- 38 971 millions d’euros JUILLET triques : Fluence Z.E., Kangoo Express Renault dévoile en avant-première de chiffre d’affaires en 2010 Z.E., Twizy et ZOE Preview et son du Mondial de Paris, le concept-car DeZir, concept-car DeZir qui marque le coup d'envoi de la nouvelle GROUPE RENAULT 2009 2010 I sa gamme renouvelée dans les vision du Design de Renault. -

Atlas Renault 2015 March Edition 2016
ATLAS RENAULT 2015 MARCH EDITION 2016 CONTENTS 02 / GROUPE RENAULT 04 / Key figures 05 / One Group, three brands 06 / Highlights 2015 07 / Launches 2015 08 / Highlights for the Europe region 10 / Highlights for the Africa, Middle East, India region 11 / Highlights for the Eurasia region 12 / Highlights for the Asia-Pacific region 1 13 / Highlights for the Americas region 14 / Strategic plan 15 / Simplified structure/Ownership structure 16 / Organization chart 18 / Financial information 19 / Workforce 20 / Corporate social responsibility 21 / Milestones, over 116 years of history 22 / MANUFACTURING AND SALES 24 / Industrial sites 26 / Global production 31 / Global sales 34 / Sales in the Europe region 2 38 / Sales in the Africa, Middle East, India region 40 / Sales in the Eurasia region 42 / Sales in the Asia-Pacific region 44 / Sales in the Americas region 46 / PRODUCTS AND BUSINESS 48 / Vehicle range 54 / Powertrain range 56 / Motorsport Automotive 58 / Research and Development 61 / Light Commercial Vehicles 62 / Electric Vehicles 3 64 / Purchasing 65 / Supply Chain 66 / Sales Network 67 / RCI Banque 68 / After-Sales 69 / Renault Tech 70 / RENAULT-NISSAN ALLIANCE 72 / Overview 73 / Highlights 74 / Synergies 75 / Organization chart of shared departments 76 / Partnerships 4 78 / Alliance sales 01 Renault Kadjar in the streets of Wuhan (China) GROUPE Renault Renault has been making cars since 1898. Today it is an international group with global sales of over 2.8 million vehicles in 2015. The success of new products in 2015, the numerous launches planned and the development of international business all confirm Renault’s growth ambitions for 2016. KEY FIGURES 2015 45,327 MILLION EUROS IN REVENUES IN 2015 GROUPE RENAULT 2015 2014 Revenue 45,327 41,055 € million Net income 2,960 1,998 € million 2015 2014 Workforce 120,136 117,395 Number of vehicles sold (1) 2,801,592 2,712,432 (1) All PC/LCV sales figures in the Atlas exclude Twizy. -

Paris Rétromobile Sales 2018
PARIS RÉTROMOBILE SALES 2018 Auction Day Lot Year Make Model Price with premium Artcurial FRI 98 1968 Abarth 1000 SP Barchetta Not Sold Bonhams THU 425 2011 Abarth 500 Assetto Corse € 19,550 RM WED 107 1950 AGS Panhard Monomill € 32,200 Artcurial FRI 57 1962 Alfa Romeo 2600 Spider € 87,000 Artcurial FRI 104 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Series 3 by Zagato Withdrawn Artcurial FRI 61 1942/1946 Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet Pinin Farina Speciale Not Sold RM WED 144 1951 Alfa Romeo 6C 2500 S Berlina by Pinin Farina € 143,750 Artcurial FRI 50 2008 Alfa Romeo 8C Competizione € 232,000 RM WED 136 2009 Alfa Romeo 8C Competizione € 230,000 Bonhams THU 353 1964 Alfa Romeo Giulia 1600 Spider Withdrawn Artcurial FRI 56 1965 Alfa Romeo Giulia GTC € 77,720 RM WED 170 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Not Sold Bonhams THU 389 1961 Alfa Romeo Giulietta Spider with hardtop € 51,750 Artcurial FRI 49 1956 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce 'Alleggerita" € 208,800 RM WED 117 1957 Alfa Romeo Giulietta TI € 41,400 Artcurial FRI 59 1968 Alfa Romeo Spider 1300 Duetto Withdrawn Artcurial FRI 123 1977 Alpine Renault 1600 SX € 168,200 Artcurial FRI 129 1975 Alpine Renault Berlinette 1600 SC € 110,200 Artcurial FRI 102 1970 Alpine-Renault 1600 S Gp. 4 Compétition Client ex Agostini € 174,000 RM WED 112 1974 Alpine-Renault A110 1600 S € 138,000 RM WED 163 1974 Alpine-Renault A110 B 'Team Vialle' € 149,500 RM WED 171 1973 Alpine-Renault A310 1600 VF € 57,500 Artcurial FRI 117 1984 Alpine-Renault GTA Prototype by Berex Not Sold Bonhams THU 308 1936 Alta 2-Litre Sports € -

Estudio Económico De Utilización De Embalajes Retornables En La Industria Del Automóvil
Proyecto Fin de Carrera Ingeniería Técnica Industrial de Mecánica Estudio Económico de Utilización de Embalajes Retornables en la Industria del Automóvil Autor: Ángel Luis del Rincón García Tutor: Miguel Ángel Martínez Estudio Económico de Utilización de Embalajes Retornables en la Industria del Automóvil Resumen Este proyecto tiene como objetivo demostrar, desde el punto de vista económico, la utilización de embalajes retornables frente a embalajes perdibles (cartón y plástico) en la industria del automóvil. Para ello, se ha seleccionado 8 piezas de plástico fabricadas por la empresa Mecaplast pertenecientes al proyecto "Moka" que corresponde al Renault Twizy. Se ha hecho un estudio económico de los embalajes retornables y perdibles que se utilizarán durante toda la vida de proyecto (5 años) con una cadencia diaria prevista antes de proyecto. Y para demostrar la importancia de dicha cadencia se vuelven a hacer los mismos cálculos con una cadencia más baja y se analizan las diferencias. Abstract This project aims to demonstrate, from an economic point of view, the use of returnable packaging instead of "lost packaging" (cardboard and plastic) in the automotive industry. We selected 8 plastic parts manufactured by the company Mecaplast belong to "Moka" project (Renault Twizy). The project is an economic study of returnable and "lost" packagings to be used throughout the project life (5 years) with a rate of manufactured per day predicted before the project. We demonstrate the importance of this rate because we do the same calculations with lower rate and finally we analize the results. 3 Universidad Carlos III de Madrid Estudio Económico de Utilización de Embalajes Retornables en la Industria del Automóvil INDICE 1 Capítulo1: Introducción ........................................................................................... -

Page 1 1 2000 1000 2 3000 2000 3 800 600 4 2000 1000 5 500 300 6 150 100 7 350 250 8 2000 1000 9 1000 800 10 500 300 11 300
Ordre Désignation Estimation Estimation Haute Basse 1 - COLLECTION DU BARON PETIET (Lot 1 à 9) BRONZE représentant « 2000 1000 le couronnement de l’Automobiliste ». Signé E. PINCHON (Fondeur Alexis RUDIER Paris). 2 -BRONZE Signé FIX-MASSEAU (Pierre Félix), représentant le Tank 3000 2000 RENAULT FT 17 (Fondeur Alexis RUDIER, Paris). 3 -BRONZE 1914 « Le Réveil » , Coq Signé A.CAIN (Fondeur SUSSE 800 600 Frères Edts Paris) Avec une plaque dédicacée : « Au capitaine PETIET, Ses amis de la société « L’aster », 3 Janvier 1917 ». 4 -HISPANO SUIZA : Mascotte « Cigogne » signée F BAZIN. Grand 2000 1000 modèle. La cigogne adoptée par Hispano Suiza est celle de la SPAD 3, escadrille de Georges Guynemer qui, avec les SPAD 103, 26 et 73 formait le groupe de chasse des Cigognes. Réf 888 du livre de 5 -Plaque en bronze avec l’inscription : «Société des Automobiles ARIES, A 500 300 l’effort de l’industrie française pour la défense du pays. En souvenir de la lutte commune et en reconnaissance du témoignage de sympathie de ses collègues. (signée) Louis Renault 19 6 -Lot de 5 coupes : Vème Circuito San Sebastian Copa « Gecalse » , 150 100 Coupe des Six Heures de Bourgogne 1927 Catégorie Sport 3 litres , Coupe Meeting Automobile de Boulogne Sur Mer 1927 Coupe Tetart , Coupe Circuit des routes pavées 1924 , Coupe Circuit des r 7 -Lot de médailles dans son cadre comprenant : -Médaille en Bronze 350 250 Dorée de L’ACT, signée PILLET -Médaille République Française Signée S.E VERNIER. -Médaille représentant une scène de course, signée L. PATRIARCHE -Médaille « Concours international de vé 8 Moteur ARIES avec un carburateur ZENITH. -

Dossier Pédagogique
Dossier pédagogique Commissariat de l’exposition : Ann Hindry Elaboration du dossier pédagogique : Estelle Onema sommAiRE 1. RENAULT : UN dEmi-siècLE dE coLLAboratioN AvEc LEs artisTEs 1.1 LA FIRME RENAULT, 120 Ans d’HISTOIRE 3 1.2 LE PROJET DE COLLABORATION 4 1.3 leS ÉTAPES DE LA COLLABORATION 5 1.4 UNE COLLECTION DE 350 œuvrES 6 1.5 LE RÔLE DES ENTREPRISES, FONDATIONS, FONDS DE DOTATION 6 2. LA coLLEcTioN Renault ExposéE à LA FoNdatioN cLémENT 2.1. AvAnt-propos d’Ann Hindry directriCE eT CONSERVATRICE DE LA COLLECTION RENAULT 7 2.2. LEs ArtistEs face à L’univErs industriEL Et face Au mondE du trAvAiL 8 2.3. BiogrApHiEs dEs ArtistEs dE L’Exposition pAr Ann Hindry 9 3. LEs gRANds moUvEmENTs artisTiqUEs REpRésENTés dANs L’ExposiTioN (1960 -1980) pLAcés dANs LEUR coNTExTE 3.1. UN CONTEXTE SOCIÉTAL ET INTELLECTUEL DE RUPTURE ET DE REVENDICATION 14 3.2. LES PRINCIPALES TENDANCES ARTISTIQUES 16 3.3 MoDERNISME / POSTMODERNISME 20 3.4 CHronoLogiE récapituLAtivE dEs fAits (fAits dE soCiété, fAits HistoriquEs, événEmEnts ArtistiquEs) 21 4. PRépARER LA visiTE 4.1. LE PARCOURS ET L’ENCHAÎNEMENT DES SÉQUENCES 23 4.2. ProgrAmmEr unE visitE : informAtions prAtiquEs (HorAirEs/Tarif/visitEs) 24 5. TRAvAiLLER AUToUR dE L’ExposiTioN 5.1. PRÉSENTATION DE QUELQUEs œuvrES 26 5.2. ACTIVITÉS À FAIRE EN LIEN AVEC LA VISITE 35 6. GLossAiRE 40 7. BIBLiogRApHiE/ FiLmogRApHiE/ REssoURcEs EN LigNE 42 8. RENsEigNEmENTs pRATiqUEs 44 9. PRogRAmmE 45 en couverture : Jean Tinguely (1925-1991). Requiem pour une feuille morte, 1967. (détail) RENAULT - l’art de la collection — dossier PÉDAGoGiQUe 2 UN DEMI-SIÈCLE 1 DE COLLABORATION AVEC LES ARTISTES 1.1. -

Mise En Page 1
ARIS FONTAINEBLEAU § l Dimanche 14 octobre 2012 00 EXPERTS / SPÉCIALISTES Expert Expert Mario MONTANARO Alexis DELICOURT Expert pour les lots 311, 342, 343, +33 (0)6 10 01 53 43 353, 355 et 363 +33 (0)6 71 27 36 01 [email protected] Spécialistes Automobiles Patrice MOREAU +33 (0)6 80 72 72 75 [email protected] Canots Automobiles Patrick DEVILLARS +33 (0)6 13 33 33 47 Miniatures Cédric CASUBOLO Nouveau consultant au sein de notre équipe, aux +33 (0)6 63 14 51 52 côtés de Mario Montanaro Alexis Delicourt, expert automobile, côtoie le milieu de la voiture ancienne depuis sa plus tendre enfance grâce à son père et son grand père Auguste Delicourt qui commença à acheter des vieilles auto mobiles dès le milieu des années 50’. Du coupé doc teur Ford T à l'Hispano du président Herriot, sans oublier les deux Peugeot 402 Consultez nos catalogues et laissez Darl'mat ou la Potez Spéciale de course : ce sont près des ordres d’achat sur www.osenat.com de 500 modèles différents qui sont passés entre ses mains, avec néanmoins un goût particulier pour les CONDITIONS DE VENTE belles de Molsheim. Alexis Delicourt a su associé sa La vente est soumise aux conditions générales passion avec son métier d'expert automobile spécia - imprimées en fin de catalogue lisé en véhicules de collection et sa venue enrichira notre équipe de son expérience. Catalogue sur www.osenat.com Osenat 14 octobre 2012 2 AUTOMOBILES, dont Collection de Monsieur P. CANOTS AUTOMOBILES DE COLLECTION CONTACT VENTE EXPOSITIONS PUBLIQUES +33 (0)1 80 81 90 10 Dimanche 14 octobre 2012 Espace Automobiles à 14 heures 30 107, avenue Georges Clemenceau 5, rue Royale 77250 MORET-SUR-LOING Jean-Pierre OSENAT 77300 FONTAINEBLEAU Du jeudi 11 au samedi 13 octobre Président de 10 h à 19 h Commissaire-Priseur Dimanche 14 octobre de 9 h à 12 h Stéphane PAVOT Tél. -
02 06 17 Dinky Trains
1 CLASSIFICATION DES PIECES BE : Modèle en état d'origine, avec éclats ou Rayures NB : Neuf en boîte modèle pouvant avoir d'infimes éclats ou rayures dans une EM : Modèle en état d'origine ayant de nombreux belle boîte d'origine éclats ou rayures N : Neuf idem ci-dessus, mais ans boîte ME : Mauvais état RPT : Modèle repeint TBEB : Modèle en très bon état d'origine avec Quelques petits éclats ou rayures dans une CLASSIFICATION DES BOITES Boîte en bon état. B. 1 : Boîte neuve ou proche du neuf TBE : Très bon état idem ci-dessous mais sans 2 : Boîte très bon tat, légèrement fatiguée boîte 3 : Boîte fatiguée, déchirée ou incomplète AUTOMOBILES 1/437 VENTE DU VENDREDI 2 JUIN 2017 le matin à 9 h (n° 1 à 306) Estimations 1 D.T.F. - SIMCA VERSAILLES, bleu très clair, toit ivoire, jantes légèrement rouillées, 2è variante, plaque de base avec découpe - 1956 - REF : 24 Z. Long. : 105 mm (N.B1) 80/100 2 D.T.F. - TAXI SIMCA ARIANE, noir, toit rouge, taxi sur le toit, compteur à gauche, glaces 1959. REF 24 ZT et 542 (double référence sur la boîte) 100/120 Long. : 105 mm (N.B1) 3 D.T.T. - SIMCA VEDETTE CHAMBORD , deux tons de vert, avec glaces, jantes convexes, toit strié 1959 - REF 24 K. Long. : 110 mm (N.B1) 80/100 4 D.T.F. - SIMCA ARONDE P 60, brique, toit crème, avec glaces, jantes chromées, pneus blancs, 1959. REF 544. Long. : 98 mm (NB1) 80/100 5 D.K.F . - RENAULT FLORIDE COUPE , vert bronze métal, avec glaces, jantes chromées, pneus blancs (une trace d'adhésif sur le bord de la boîte) 1960 - 63 REF 543.