Approche Écogéographique D'une
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin n° 25 Mars 2016 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale : page 1 Situation éco-météorologique : page 3 Ministère de l’agriculture Situation acridienne : page 6 Situation antiacridienne : page 13 Synthèse : page 17 Annexes : page 19 SITUATION GÉNÉRALE Selon Fews-net, le mois de mars 2016 semble avoir été marqué par une forte pluviosité (supérieure à 150 mm) au nord du 18ème parallèle et une pluviosité moyenne, variant de 50 à 150 mm, au sud. Les relevés du Centre national antiacridien (CNA) indiquaient que la pluviosité était supérieure aux besoins du Criquet migrateur malgache dans l’Aire grégarigène transitoire Est et Centre, l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation du compartiment Nord. Elle était favorable pour son développement dans l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation des compartiments Centre et Sud. Les températures minimales et maximales moyennes restaient toujours favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito dans toute la Grande-Île. Aire grégarigène. Les compartiments Nord et Centre étaient colonisés par des populations groupées du Criquet migrateur malgache. Le compartiment Nord, où des pullulations larvaires, assorties d’une transformation phasaire, ont été observées sur deux principaux foyers (partie orientale du bassin de Manja et région de Befandriana-Sud), était moyennement infesté. Un phénomène similaire était en place dans le compartiment Centre mais, globalement, l’ampleur et l'étendue étaient moindres. Ce mois a été caractérisé par la fin du développement de la R2 du Criquet migrateur malgache et le début de celui de la R3. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Liste Candidatures Conseillers Ihorombe
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS IAKORA BEGOGO 1 MAJAVAJIRO (Iindépendant Majavajiro) SOJA Renault GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA BEGOGO 1 RASOLOMANDIMBY Martin Miaraka @ Andry Rajoelina) INDEPENDANT HERMAN (INDEPENDANT IAKORA IAKORA 1 RASANJIFERAHASINA Andrianony Simon Herman HERMAN) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA IAKORA 1 RANDRIANANTENAINA Clara Jean Christophe Miaraka @ Andry Rajoelina) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA RANOTSARA NORD 1 MANAMBELO Dolphe Miaraka @ Andry Rajoelina) IAKORA RANOTSARA NORD 1 MMM (Antoko Malagasy Miara-miainga) RAHAJARIMANANA Rivoarisoa Myriame INDEPENDANT ADELAIDE (Independant IAKORA RANOTSARA NORD 1 KAMARA Adelaide Adelaide) INDEPENDANT FERNAND (Independant IAKORA ANDRANOMBAO 1 FERNAND Fernand) IAKORA ANDRANOMBAO 1 MMM (Antoko Malagasy Miara-miainga) TARILY GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA ANDRANOMBAO 1 ROGER Miaraka @ Andry Rajoelina) IAKORA VOLAMBITA 1 INDEPENDANT PAUL (INDEPENDANT PAUL) PAUL GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA VOLAMBITA 1 RAZAFINJAZA Herimanana Miaraka @ Andry Rajoelina) Total IAKORA 12 NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS IHOSY AMBATOLAHY 1 INDEPENDANT RAMOSE ZARA (Ramose Zara) ZARA Farassel GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IHOSY AMBATOLAHY 1 BETA Tsikohony André Miaraka Amin'ny Andry Rajoelina) IHOSY AMBIA 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RAMANANDAFY Dieu Donne GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IHOSY AMBIA 1 FENOHASINA Julien Elie Miaraka Amin'ny -

Mission D'observation Du Second Tour Des Élections Présidentielles À Madagascar Lhosy : Scrutin Du IO Février 1993
Ir II 'I 9@!c Mission d'observation du second tour des élections présidentielles à Madagascar lhosy : scrutin du IO février 1993 ES précédentes élections présidentielles malgaches, organisées en 1989, avaient reconduit l'amiral Didier Ratsiraka, aux comman- Ldes depuis 1975, pour un nouveau mandat de sept ans. A la suite des grèves qui, en 1991, avaient paralysé le pays pendant huit mois, et de la niarclie pour la paix des manifestants de Tananarive vers le Palais présidentiel de lavoloha, dont la répression dans le sang, le 10 août 1991, fut un véritable tournant politique, le processus de démocratisation de Madagascar fut officiellement mis sur les rails avec la signature, le 31 octobre 1991, d'une convention constitutionnelle qui suspendait la Constitution de 1975, installait des institutions provisoi- res, et établissait un calendrier pour l'adoption d'une nouvelle Consti- tution et la mise en place des nouvelles institutions. L'adoption d'une nouvelle Constitution par le r$érendum du 19 aozit 1992 a ouvert la voie à la IIIeRépublique de Madagascar. Malgré les vives tensions qui avaient été entretenues par les e Fédéralistes B et leurs bandes armées dans pbisieiirs chef-lieux de provinces (Tuléar à l'ouest, Tamatave à l'Est, Diego-Suarez au Nord), le scrutin a pu se dérouler régulièrement sur presque tout le territoire, avec une très forte participation, grâce notamment à l'important travail d'éducatìon civique et de contrôle des élections déployé par le Comité national d'observation des élections, et à la présence d'observateurs -
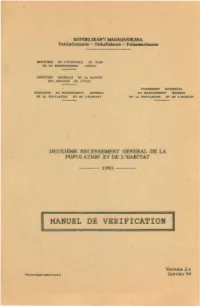
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

Mémoire De Fin D'etudes
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT MINES - PARCOURS : GEO-ENERGIE - Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme de Master d’Ingénierie PROJET D’AMENAGEMENT DE MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LOABATO DANS LA COMMUNE RURALE DE SATROKALA Présenté par : RATEFINJANAHARY José Pascal Date de soutenance : 28 Août 2015 Promotion 2014 Mémoire de fin d’études UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT MINES PARCOURS : GEO-ENERGIE MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER D’INGENIERIE PROJET D’AMENAGEMENT DE MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LOABATO DANS LA COMMUNE RURALE DE SATROKALA Présenté par : RATEFINJANAHARY José Pascal Membres du jury : Président : Monsieur RANAIVOSON Léon Félix, Chef de Département Mines et Maître de Conférences à l’ESPA Rapporteurs : Monsieur ANDRIANAIVO Lala, Professeur à l’ESPA Monsieur RANOARIVONY Andrianjoelimahefa Honoré, Maître de conférences à l’ESPA Examinateurs : Monsieur RAKOTONINDRAINY, Professeur titulaire à l’ESPA Monsieur RAZAFINDRAKOTO Boni Gauthier, Maître de Conférences à l’ESPA Date de soutenance : 28 Août 2015 Promotion 2014 Mémoire de fin d’études REMERCIEMENTS Avant tout, j’adresse mes vifs remerciements à Dieu tout puissant de m’avoir donné l’initiative, le courage et la persévérance durant mes études. Ainsi je tiens à présenter ici, mes vifs remerciements à : Monsieur ANDRIANARY Philipe Antoine, Professeur et Directeur de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA) d’avoir assuré le bon déroulement de mes études dans cette école. Monsieur Alessandro Vallerani, Gérant de la Société TOZZI GREEN, qui a bien voulu accepter d’être mon Encadreur professionnel et de nous avoir accordé comme stagiaire dans son établissement. -

Liste Candidatures Maires Ihorombe
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS IAKORA BEGOGO 1 MAJAVAJIRO (Iindépendant Majavajiro) TSAKOTO Jules GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA BEGOGO 1 LONGO Alson Jules Miaraka @ Andry Rajoelina) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA IAKORA 1 RAMBOLAMANANA Joseph Miaraka @ Andry Rajoelina) IAKORA IAKORA 1 INDEPENDANT HERMAN (INDEPENDANT HERMAN) RAKOTONDRAIBE Tatavily Ruphin GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA RANOTSARA NORD 1 TERAVAO Miaraka @ Andry Rajoelina) IAKORA RANOTSARA NORD 1 MMM (Antoko Malagasy Miara-miainga) ANDRIANAMBININA Max Delphin Fidèle IAKORA ANDRANOMBAO 1 MMM (Antoko Malagasy Miara-miainga) REKAJY IAKORA ANDRANOMBAO 1 INDEPENDANT FERNAND (Independant Fernand) TSIMANOSOTRA GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA ANDRANOMBAO 1 MAROVAVY Philomene Miaraka @ Andry Rajoelina) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IAKORA VOLAMBITA 1 TIAVA Theophile Ramarosoatoky Miaraka @ Andry Rajoelina) IAKORA VOLAMBITA 1 INDEPENDANT PAUL (INDEPENDANT PAUL) RAKOTOZAFY Fridolin Gothard Nombre IAKORA 11 NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS IHOSY AMBATOLAHY 1 INDEPENDANT RAMOSE ZARA (Ramose Zara) RANDRIANARISON Tarisson Hervien GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IHOSY AMBATOLAHY 1 MAHAVONJY Bernard Miaraka Aminin' Andry Rajoelina) IHOSY AMBIA 1 INDEPENDANT TSAMBANY (Tsambany) RANDRIAMIHAJA Patrick GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra IHOSY AMBIA 1 RAZAFIMAMONJY Miaraka Aminin' Andry Rajoelina) IHOSY AMBIA 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RAKOTO -

Le Developpement Local Dans Le Cadre Du Programme Acords, Moyen Pour La Mise En Place De La Decentralisation
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Faculté de Droit - d’Economie - de Gestion et de Sociologie DEPARTEMENT ECONOMIE Mémoire de fin d’études pour l’obtention du « Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées » Option : Développement Local et Gestion de Projets. --------------------------- Appui aux Communes et Organisations GTZ Programme « Protection et Gestion Rurales pour le Développement du Sud Durable des Ressources Naturelles » LE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACORDS, MOYEN POUR LA MISE EN PLACE DE LA DECENTRALISATION CAS DES CINQ COMMUNES RURALES : Analaliry, Analavoka, Iakora, Soamatasy, Tolohomiady Appui aux Communes et Organisations Rurales pour le Développement du Sud ACORDS Unité d’Appui pour le Développement Local UADEL/IHOROMBE REGION IHOROMBE Présenté par : Mademoiselle Nathalie RAKOTONIRINA Encadreur académique : Professeur Mamy RAVELOMANANA Encadreur professionnel : Madame Ute NUBER Date de soutenance : 10 Mars 2008 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Faculté de Droit - d’Economie - de Gestion et de Sociologie DEPARTEMENT ECONOMIE Mémoire de fin d’études pour l’obtention du « Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées » Option : Développement Local et Gestion de Projets. ______________ LE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACORDS, MOYEN POUR LA MISE EN PLACE DE LA DECENTRALISATION CAS DES CINQ COMMUNES RURALES : Analaliry, Analavoka, Iakora, Soamatasy, Tolohomiady Appui aux Communes et Organisations Rurales pour le Développement du Sud ACORDS Unité d’Appui pour le Développement Local UADEL/IHOROMBE REGION IHOROMBE -

Indicateurs De Coûts Et De Risque Par Stratégie À Fin 2023
STRATEGIE DE LA DETTE A MOYEN-TERME 2021-2023 Annexe 8 : Résultats des 4 stratégies Annexe 8a : Indicateurs de coûts et de risque par stratégie à fin 2023 2020 S1 S2 S3 S4 Dette nominale (% du PIB)* 41,4 46,7 46,8 46,8 46,8 Valeur actualisée de la dette (% du PIB) 28,7 31,5 32,1 32,7 34,1 Intérêts (% du PIB) 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Taux d´intérêt moyen pondéré (%) 2,1 1,9 2,1 2,4 2,8 Dette amortie dans un an (% du total) 12,0 9,5 9,5 9,8 9,9 Dette amortie dans un an (% du PIB) 5,0 4,4 4,5 4,4 4,6 Risque de refinancement ATM Dette extérieure (ans) 14,4 13,5 12,9 12,3 12,0 ATM Dette intérieure (ans) 3,1 2,2 2,2 2,2 2,2 ATM Dette totale (ans) 12,1 11,9 11,3 10,9 10,6 ATR Dette totale (ans) 11,4 10,9 10,1 9,8 9,5 Dette à refixer dans un an (% du total) 22,4 24,2 28,4 29,7 22,4 Interest rate risk2 Dette à taux d´intérêt fixe (% du total) 89,2 84,3 80,2 78,9 78,2 BTA (% du total) 4,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Dette en devises (% du total) 79,1 85,8 85,8 85,8 85,8 FX risk Dette à court-terme (% des réserves) 6,9 8,5 8,7 9,6 10,0 *L’encours des BTA n’inclut pas les intérêts précomptés. -

REPOBLIKAN'i MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ————— LOI N°
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ————— LOI N° 2014-020 Relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. EXPOSE DES MOTIFS Consécutivement à l’adoption de la loi organique régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, qui définit les principes généraux en matière de décentralisation, il s’avère utile de clarifier certaines de ses dispositions. La présente loi détermine les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux pouvoirs, aux compétences et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées, qui se fondent sur le principe de la libre administration. La Constitution prévoit trois niveaux de Collectivités Territoriales Décentralisées. A cet effet, des nouvelles répartitions s’imposent afin d’harmoniser les attributions des organes des Collectivités Territoriales Décentralisées. La décentralisation effective visant la responsabilisation de la population dans la gestion des affaires locales, la présente loi intègre le système de redevabilité sociale dans le mode de gestion des Collectivités. Page 1/168 Dans ce sens, l’article 3 de la Constitution dispose que "la République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées composées de Communes, de Régions et de Provinces", et le Fokonolona, conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, "organisé en Fokontany est la base du développement et de la cohésion socioculturelle et environnementale". Les responsables des Fokontany participent à l’élaboration du programme de leur Commune. -

Ministere De L'environnement, Des Forets Et Du Tourisme
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

04642 20110218 Mdg A2 Gl
MOCIMBOA DA PRAIA PRINCE SAID IBRAHIM INTL MORONI Moroni 45°0'0"E 50°0'0"E MORONI Anjiabe C o m o r o s ANTSIRANANA IBO ANDRAKAKA Antseranana Antanifatsy Antsorokaka Ankorefo ARRACHART PEMBA Mamoudzou DZAOUDZI-PAMANDZI Anivorano-du-Nord AIRPORT PEMBA DZAOUDZI Ambondrofe PORT Ampanakana Andrevokely M a y o t t e SAINT-LOUIS Ambilobe (FR) FASCENE Daraina AMBILOBE Bobamakotrahely Vohemar NOSSI-BE AMPAMPAMENA Ampondra VOHIMARINA Ambaliha Tsarafasy Ambohibado Ambohimena Maromokotra Fanambana Anaborano Androtra Ambodivoara Ambanja Ambakirano Maromontreka AMBANJA Anorotsangana Mandrorohabe Diana Sava Ampanefena Marovato MEMBA Belambo Ambatolalaka Madirotelo Maromandia SAMBAVA Bejongoro Antanambao Bejofo Anefitrabe Sambava NACALA Andrafialava Matsaborimadio AMbararatabe-Nord Ambohimitsinjo SAMBAVA AIRPORT Andriambe NACALA Ambodimanga DOANY Maroambihi Antanambao Bealanana Farahalana Ambaliha Ambodisantrankely Marotaolana Ambatoharanana ANALALAVA Ambodisatrana Ambodipont-Sahana Ampandrana ANDAPA Andapa Ampitily Ambararata-Sofia Andranofotsy Antsahabe ANTALAHA MOCAMBIQUE Antalaha l Ankerika Andampimena Ambodiangezoka LUMBO 15°0'0"S Anjajavy Ankinganomby 15°0'0"S AMBALABE Matsoandakana ANTSIRABATO Ambararata Antsakabary Anjiamangirana Ambodisikidy Mahavedaka Androhofontsy Ambodimotso Antakotaka e Tsianinkiro Bas Tsinjorano Fizoana Ambohitralanana Mahadrodroka AVARATRA Tanambao Amboaboaka Sofia Betsilendry Antanambao Maroantsetra Binara MAROANTSETRA Ratsianarana n Port-Bergé Sarahandrana AMBOROVY Ambohimalandy PORT BERGE BemanevikaAmbatomay MAROANTSETRA