Universite D'aix-Marseille
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
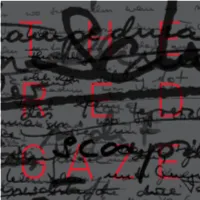
Theredgaze.Pdf
1 1 Edited by A.S. Bruckstein Çoruh together with / zusammen mit Lotte Laub Istanbul: Istiklal Cad. Mısır Apt. No:163, K. 2 & 3 D. 5 & 10 34433 Beyoglu/Istanbul, Turkey t: +90 212 251 1214 f: +90 212 251 4288 Berlin: Goethestraße 82, 10623 Berlin/Germany t: +49 (0) 30 31809900 f: +49 (0) 30 31809901 zilbermangallery.com 4 5 5 CONTENTS / INHALT For Beral Madra 04 Prefaces: Lotte Laub, A.S. Bruckstein Çoruh and the 5th International Çanakkale Biennial 2016 which has been cancelled due to political pressure three weeks 18 The rats may feast where they want / Die Ratten sie mögen before the opening schmausen wo sie wollen (Pablo Picasso) Für Beral Madra Artists: Sarkis, Memed Erdener a.k.a. Extramücadele, Imran Qureshi, Rebecca Raue, Erkan Özgen With texts by Uwe Fleckner, Tobias Nöbauer & Işın Önol, Erkan Özgen der 5. Internationalen Çanakkale Biennale 2016 gewid- met, die im September 2016 unter politischem Druck abgesagt wurde 44 If at all the word martyr means anything today / Wenn der Begriff des Märtyrers heute eine Bedeutung habe (Navid Kermani) Artists: Arnold Schoenberg, Ali Kaaf, Memed Erdener a.k.a. Extramücadele, With a text by Sarkis 53 As long as wars are still being waged in the name of religion / Solange im Namen der Religion noch Kriege geführt werden (Şükran Moral) Artists: Memed Erdener a.k.a. Extramücadele, Şükran Moral, Aisha Khalid 57 I am just one protest, I am just one artist / Ich bin nur ein Protest, ich bin nur ein Künstler (Erdem Gündüz) Artists: Aisha Khalid, unknown Flemish artist, Ahmet Elhan, Eşref Yıldırım With texts by Daniel Boyarin, Naz Cuguoğlu 72 Appendix 6 7 LOTTE LAUB Being Witness Zeuge-Sein On June 18, 2013, Erdem Gündüz stood motionless for were, a closely woven carpet of relations intertwining in Am 18. -

Streets Songs from the Syrian Protests
Orient-Institut Studies 2 (2013) Simon Dubois Streets songs from the Syrian protests <1> Since March 2011, the Syrian uprising has created spaces for popular expression that were restricted during the preceding four decades of dictatorship. Numerous productions of texts, poems, caricatures, and songs began to appear on social media sites, and activists then gathered them onto networks providing local alternative information. These networks included websites, blogs, YouTube channels, Facebook and Twitter accounts. They often contained sections titled "Art of the Revolution" or the like, which listed the cultural production of the protests. <2> This article is part of a study conducted online via networks (for instance, F.N.N,1 Deir Press2) and websites or YouTube channels that focused on the revolution©s music, such as "Music from the great or Dndne Indesasye.4 An initial survey of protest 3,( موسيقى الثورة العربية الكبرى) "Arab revolution songs, conducted between October 2011 and March 2012, revealed a vast production of protest music. This research presents some of the results of a global analysis carried out on a collection of material composed exclusively of demonstration chants, which represented cultural production in the service of protest. Videos of the demonstrations that frequently accompany these chants have a special status, since they are evidence that the protest rallies really took place, a fact that was repeatedly denied by the regime at the beginning of the protest movement. <3> In this research, demonstration chants are determined by two criteria. First, there must be interaction between the public and the singer; that is to say, the audience has to be active, repeating some lyrics that constitute the chorus. -

Arab Reform Brief
Arab Reform Brief 51 October 2011 The Dynamics of the Uprising in Syria Hassan Abbas* Most people interested in Syrian affairs used to believe that the country was extremely stable. The regime’s media fed this belief, constantly reiterating the assertion that Syria was the most secure and stable country in the world. In fact, however, this stability was merely a veneer. In reality, cracks and rifts appeared that damaged the Syrian society, undermined its cohesion, and created numerous social problems, generating frustration and anger that grew to unbearable proportions among broad sections of the population. The incident that took place in the emboldening the market traders to break the commercial market in Damascus on 19 barrier of fear that had held Syrians in a February 2011 was the first symptom of this stranglehold for forty years. underlying frustration. On that day, a traffic policeman reprimanded the son of one of the A few days after this incident, a number of traders. The young man rose up to defend his young men working in the culture field dignity and cursed the policeman, while other gathered in front of the Libyan embassy to traders gathered round to support him. The protest in solidarity with the martyrs in Libya. situation escalated, requiring the Minister of However, the political security forces swiftly Interior to intervene to persuade the traders to intervened to break up the gathering by force. end their protest. While the incident may Such gatherings recurred, however, once in appear unremarkable, the citizens’ response front of the Egyptian embassy to celebrate the was unprecedented and came as a surprise to ousting of the Egyptian president, for a the regime. -

KT 16-11-2016 .Qxp Layout 1
SUBSCRIPTION WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016 SAFAR 16, 1438 AH www.kuwaittimes.net Former MP US Muslim Berlin’s wild Saudi fury Nisef welcomes lawmaker, charms make it as Japan boycotters’ Sanders ally vies first choice for boost World return to3 polls to lead 7Dems Syrian40 artists Cup20 hopes Amir reiterates commitment Max 32º to combat climate change Min 13º High Tide 13:37 Ban calls for ‘elimination’ of fossil fuel subsidies Low Tide 07:08 & 19:10 40 PAGES NO: 17052 150 FILS MARRAKECH: HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al- Barred candidate Jaber Al-Sabah yesterday reiterated Kuwait’s commit- ment to supporting the efforts exerted by the UN to claims election combat the phenomenon of climate change. Addressing the 22nd Conference of the Parties to the United Nations could be delayed Framework Convention on Climate Change, also known as COP 22 in Marrakech, the Amir said Kuwait has partici- Campaigning intensifies pated effectively and constantly in the negotiations aimed to limit the negative impact of By B Izzak this phenomenon, based upon the prin- ciples and provisions and the implemen- KUWAIT: Lawyer Hani Hussein, whose candidacy for tation of the UN Framework Convention the parliamentary polls was rejected by the appeals on Climate Change, and the subsequent court yesterday, said a “big surprise” could delay the provisions until the Paris Agreement, Nov 26 election. Writing on his Twitter account, since they constitute the legally binding Hussein declined to reveal the nature of the surprise, instruments and the basis of joint coop- but said it relates to a provision in the election law, eration. -

Is It Possible to Understand the Syrian Revolution Through the Prism of Social Media? Juliette Harkin University of East Anglia
WESTMINSTER PAPERS VOLUME 9 ISSUE 2 / APRIL 2013 IS IT POSSIBLE TO UNDERSTAND THE SYRIAN REVOLUTION THROUGH THE PRISM OF SOCIAL MEDIA? Juliette Harkin University of East Anglia Juliette Harkin, M.Phil Oxon, is a researcher and consultant on the Arab media and a PhD student undertaking research on Syria in the School of Political, Social and International Studies at the University of East Anglia. Her M.Phil thesis (2009) focused on the changing practice of journalism in Syria. The aim of this article is to explore a renewed and radical ‘media culture’ that has developed in the extraordinary conditions of the Syrian revolution. The article quickly dismisses the focus on the technology and platforms while using small-scale ethnography to examine social networking sites like Facebook and to underscore the diversity of content being produced by Syrians. It notes how the Syrian media revolution is clearly well under way and how radical, alternative forms of media production are flourishing. KEYWORDS media, radical alternative media, revolt, semi-published, social media, social networking sites, Syria JULIETTE HARKIN: University of East Anglia 92 93 IS IT POSSIBLE TO UNDERSTAND THE SYRIAN REVOLUTION THROUGH THE PRISM OF SOCIAL MEDIA? Juliette Harkin University of East Anglia The Arab revolutions have reminded the world that radical change can be effected by the people, rather than by top-down regime change or ‘transitology’ models that have prevailed in much academic literature (see critique in the Latin American context by Sparks, 2010). For Syrians irreversible transformations happened in the maelstrom of the revolt; they did not wait for the regime to fall or for discussion to commence about media reform blueprints. -

SYRIA ALERT XIII Forced Ceasefires: the Case of Barzeh and Qaboun
SYRIA ALERT XIII Forced ceasefires: The case of Barzeh and Qaboun June 20th, 2014 Over the few past months, the Assad regime has been negotiating ceasefires with opposition forces in several neighbourhoods and suburbs of Damascus. This Syria Alert looks into the ceasefire negotiations in Barzeh and Qaboun, on the basis of a longer forthcoming paper prepared by PAX’s Syrian partner Etana1. The Free Syrian Army (FSA) was forced into these negotiations as the Assad regime starved and threatened civilians while systematically destroying their neighbourhoods. The regime was not able to get all their demands as the FSA was only willing to negotiate a ceasefire and release of prisoners. The regime’s claims of victory contradict the facts on the ground, because in reality, the Assad regime did not regain control inside the neighbourhoods, but rather had only control of certain points on the outskirts and made it appear as if they had regained control. This Syria Alert concludes that the ceasefires between the Assad regime and FSA are temporary, tactical agreements as part of a military strategy and have nothing to do with political agreements. This underscores the urgency for the international community to genuinely search for a new political framework to address the conflict, after the failure of the Geneva 2 talks. Secondly, the case of Barzeh and Qaboun illustrates how the Assad regime has misrepresented the ceasefires in its public relations for Geneva 2 and the presidential elections, purporting it had gained control of certain neighbourhoods, when in fact it only gained control of some key strategic points. -

Sarah Rogers — Histories in the Making: the Khalid Shoman Collection and Darat Al Funun Fig
1 Sarah Rogers Saleem Al-Bahloly Sarah Rogers A pioneering private foundation, the Abdul Hameed Shoman Foun- 27 Histories in the 255 Art History outside — Histories in the Making: dation was established in Amman in 1978 and Making: The Khalid the History of Art The Khalid Shoman Collection named after Abdul Hameed Shoman (1890– Shoman Collection and Darat al Funun 1974), the founder of the Arab Bank and father of and Darat al Funun Ulrich Loock The Khalid Shoman Collection represents one of the earliest Khalid Shoman (1931– collections dedicated exclusively to contemporary art of the Arab 2002). Dedicated to the promotion of knowledge, 305 Transitions and world. Begun in the early eighties, the collection reflects the research, and develop- shifts and transformations of artistic practices in the region. It ment in the fields of Faisal Darraj Translations now represents over 100 modern and contemporary artists and a sciences and humanities, range of media, including works on paper, oil painting on canvas, the foundation expanded 81 The Peculiarities of its patronage to the arts photography, artist’s books, sculpture, video, and installation. in 1988 when it began Arab Modernity Stephen Sheehi Moreover, the collection is historically unconventional in its hosting exhibitions and mission. For husband and wife Khalid and Suha Shoman, the talks on Arab art. 361 Before Painting: act of collecting was about neither tracking down the next best artist nor documenting a regional comprehensiveness, if such a Anneka Lenssen Nicola Saig, project were even possible. The artwork is less an object to be acquired and more an investment in the artist and support of his 93 Distances greater Painting, and or her practice. -
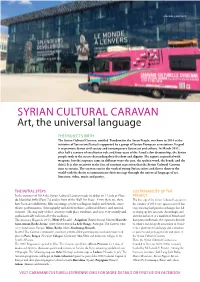
SYRIAN CULTURAL CARAVAN Art, the Universal Language
Marseille, juillet 2014 SYRIAN CULTURAL CARAVAN Art, the universal language THE PROJECT’S BIRTH The Syrian Cultural Caravan, entitled ‘Freedom for the Syran People, was born in 2014 at the initiative of Syrian intellectuals supported by a group of Syrian-European associations. Its goal is to promote Syrian civil society and contemporary Syrian art and culture. In March 2011, after half a century of totalitarian rule and forty years of the Assad’s clan dictatorship, the Syrian people took to the streets demanding their freedom and dignity. The regime responded with weapons, but the response came in different ways: the pen, the spoken word, the brush, and the chisel. It is this creativity in the face of constant repression that the Syrian Cultural Caravan aims to sustain. The caravan carries the work of young Syrian artists and shows them to the world with the desire to communicate their message through the universal language of art, literature, video, music and poetry. THE INITIAL STEPS SUStaINABILIty OF THE In the summer of 2014 the Syrian Cultural Caravan made its debut on 12 July at Place PROJECT du Maréchal Joffre (Paris 7e) and in front of the Wall For Peace. From there on, there The first trip of the Syrian Cultural Caravan in have been art exhibitions, film screenings, poetry readings in Arabic and French, street the summer of 2014 our organisers noted that theatre performances, choreography and modern dance, political debates, and musical every meeting had positive exchanges that led concerts. The majority of these activities took place outdoors, and were very warmly and to setting up new activities. -

Chapter 2: the Idea of Strategic Depth
B i l g i (27 ) , 2 0 1 3 Kış / Winter : 32- 55 Viral Voices: Revolutionary Song, Social Media, and Youth Culture in the Arab Spring Victor A. Vicente1 Abstract: Focusing on three popular “anthems” of the Arab Revolutions (“Rais Lebled” by El Général, “#Jan25 Egypt” by Omar Offendum, and “Yalla Erhal Ya Bashar” by “Ibrahim Qashoush”) this article critically as- sesses the ways in which song has come to serve as a force for instigating so- cio-political and cultural change in the contemporary Arab World, particular- ly in Tunisia, Egypt, and Syria. The appeal and efficacy of these songs of the “Arab Spring,” as well as their characterization as “revolutionary,” are under- stood in aesthetic and technological terms. Hence, the article untangles a complex of interconnected, musically-related themes and issues at the core of the discourse on the recent uprisings; namely, those of self-expression and the power of the Arab youth “voice,” those of transitional dissemination via social media and information and communication technology, and those of documentation and representation through music, specifically through the genre of rap. Analysis of the songs and the themes surrounding them demon- strates substantive advancements in contemporary Arab musical, social, and political life, but also exposes serious shortcomings, naïve misconceptions, and willful exaggerations. Keywords: Arab Spring, Revolutionary Song Aesthetics, Social Media, Cul- tural Politics Prelude: On “Revolutions” The word “revolution” is a peculiar one. In a literal sense, it means a turn- ing back on oneself, implying a return or a recurrence, or perhaps even a 1 The Chinese University of Hong Kong V i r a l V o i c e s : Revolutionary Song… ▪ 33 repetition. -

Political Humor As a Confrontational Tool Against the Syrian Regime a Study Case: Syria, 15Th March 2011 – 15Th May 2012
ICIP WORKING PAPERS: 2012/8 Political Humor as a confrontational tool against the Syrian regime A study case: Syria, 15th March 2011 – 15th May 2012 Blanca Camps-Febrer Political Humor as a confrontational tool against the Syrian regime A study case: Syria, 15th March 2011 – 15th May 2012 Blanca Camps-Febrer Institut Català Internacional per la Pau Barcelona, December 2012 Institut Català Internacional per la Pau Gran Via de les Corts Catalanes 658, baixos · 08010 Barcelona T. +34 93 554 42 70 | F. +34 93 554 42 80 [email protected] | http://www.icip.cat Editors Javier Alcalde and Rafael Grasa Editorial Board Pablo Aguiar, Laia Balcells, Alfons Barceló, Gema Collantes-Celador, Caterina Garcia, Abel Escribà, Tica Font, Antoni Pigrau, Xavier Pons, Alejandro Pozo, Mònica Sabata, Jaume Saura, Josep Maria Terricabras and Léonie Van Tongeren Typesseting and printing Ātona, S.L. / gama, sl ISSN 2013-5793 (online edition) 2013-5785 (paper edition) DL B-34.514-2012 THE AUTHOR Blanca Camps-Febrer is a political scientist, Master in International Relations, Security and Development. She has worked and lived in Morocco as development and human rights project coordinator for a Catalan NGO and has been engaged in human rights projects in Alge- ria, Palestine, Kurdistan and Syria. Contact: [email protected] ABSTRACT The aim of this working paper is to analyze the inclusion of political humor into the set of actions used by opponents to the Syrian regime during the first year of a state-wide uprising in 2011. The research ar- gues that although political humor has traditionally been seen mainly as a concealed voice against dominant elites, it can nevertheless take a confrontational stance and challenge a regime. -

PEN INTERNATIONAL Writers in Prison Committee
PEN INTERNATIONAL Writers in Prison Committee HalF-YearlY CASELIST To 31 December 2011 PEN International Writers in Prison Committee 50/51 High Holborn London WC1V 6ER United Kingdom Tel: + 44 020 74050338 Fax: + 44 020 74050339 e-mail: [email protected] web site: www.pen-international.org.uk PEN INTERNATIONAL Writers in Prison Committee PEN International is the leading voice of literature worldwide, bringing together poets, novelists, essayists, historians, critics, translators, Contents editors, journalists and screenwriters. Its members are united in a common concern for the craft and art of writing and a commitment to The Writers in Prison Committee of Pen International records of persecuted writers are updated daily. For up-to-date information on a freedom of expression through the written word. Through its Centres, PEN operates on all five continents with 144 centres in 102 countries. particular country (or countries), contact the Writers in Prison Committee headquarters in London. Founded in London in 1921, PEN connects an international community of writers. It is a forum where writers meet freely to discuss their work. It is also a voice speaking out for writers silenced in their own countries. The Writers in Prison Committee of Pen International was set up in 1960 as a result of mounting concern about attempts to silence critical voices around the world through the detention of writers. It works on behalf of all those who are detained or otherwise persecuted for their List of cases by country opinions expressed in writing and for writers who are under attack for their peaceful political activities or for the practice of their profession, provided that they did not use violence or advocate violence or racial hatred. -

Dictatorship Is Democracy: the Persuasive Power Of
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by The University of Utah: J. Willard Marriott Digital Library DICTATORSHIP IS DEMOCRACY: THE PERSUASIVE POWER OF PERFORMANCE, REPETITION, AND SILENCE IN ARABIC POLITICAL SPEECHMAKING IN ASSAD’S SYRIA by Kellie Stirling A thesis submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Middle East Studies: Arabic and Linguistics College of Humanities The University of Utah December 2014 Copyright © Kellie Stirling 2014 All Rights Reserved The University of Utah Graduate School STATEMENT OF THESIS APPROVAL The thesis of Kellie Stirling has been approved by the following supervisory committee members: Thomas N. Huckin , Chair 08/22/2014 Date Approved Asaad Al-Saleh , Member 08/22/2014 Date Approved Peter von Sivers , Member 08/22/2014 Date Approved and by Johanna Watzinger-Tharp , Chair of the Department of Middle East Center and by David B. Kieda, Dean of The Graduate School. ABSTRACT This thesis is an analysis of performance, linguistic repetition, and silence in Syrian President Bashar al-Assad’s March 30, 2011 speech to the People’s Assembly given 2 weeks after riots erupted in the Syrian province of Deraa on March 15, 2011. Various types of repetition including syntactic parallelism, word strings, lexical repetition, and phonological and morphological repetition particular to Arabic syntax and its root and pattern system of morphology are analyzed along with manipulative silence and performance aspects of the speech. This examination reveals that these features were employed intentionally in order to support political strategies and have a certain degree of persuasive or influential power over speech receivers.