Philippe Adrien
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'avare La Recette Tombe Rapidement
25 juin 2009 dossier de presse La troupe de la Comédie-Française présente Salle Richelieu en alternance du 19 septembre 2009 au 21 février 2010 L’Avare de Molière mise en scène de Catherine Hiegel Avec Frosine Dominique Constanza, Maître Simon et le Commissaire Christian Blanc, Harpagon Denis Podalydès, Maître Jacques Jérôme Pouly, La Flèche Pierre Louis-Calixte, Ansel me Serge Bagdassarian, Mariane Marie-Sophie Ferdane, Cléante Benjamin Jungers, Valère Stéphane Varupenne, Élise Suliane Brahim, Et Dame Claude Camille Blouet, Brindavoine Christophe Dumas, La Merluche Florent Gouëlou, le Clerc Renaud Triffault, Assistant à la mise en scène, Serge Bagdassarian Scénographie, Goury Costumes, Christian Gasc Lumières, Dominique Borrini Musique originale, Jean-Marie Sénia Chorégraphie, Cécile Bon Maquillages et coiffures, Véronique Nguyen Nouvelle mise en scène Avec le soutien d’Air France Représentations Salle Richelieu, matinée à 14h, soirées à 20h30. Prix des places de 5 à 37 € € Renseignements et location : tous les jours de 11h à 18h aux guichets du théâtre et par téléphone au 0825 10 16 80 (0,15 , sur le site internet www.comedie-francaise.fr € la minute) Spectacle accessible aux personnes handicapées sensorielles, en partenariat avec Accès Culture (représentations indiquées sur les calendriers de l’alternance). Contact presse et partenariats médias Vanessa Fresney : Tél 01 44 58 15 44 - Email [email protected] 1 L’Avare secrétaire général de la Comédie-Française Par Pierre Notte, Harpagon. Ô, fils impertinent ! as-tu envie de me ruiner ? Acte III, scène 9 Pour Catherine Hiegel, « Harpagon court, rit, danse. Il fête son argent ! L’avare est le personnage heureux d’une farce horrible ! ». -

DP Mille Francs.Qxp
de Victor Hugo 11 mai - 5 juin 2011 mise en scène Laurent Pelly Théâtre de l'Odéon 6e Location 01 44 85 40 40 / www.theatre-odeon.eu Tarifs 32 € - 24€ - 14€ - 10€ (séries 1, 2, 3, 4) Horaires du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h relâche le lundi Odéon-Théâtre de l'Europe Théâtre de l'Odéon Place de l'Odéon Paris 6e Métro Odéon - RER B Luxembnourg Service de presse Lydie Debièvre, Camille Hurault 01 44 85 40 73 / [email protected] Dossier et photographies également disponibles sur www.theatre-odeon.eu Mille francs de récompense] / 11 mai > 5 juin 2011 1 de Victor Hugo 11 mai - 5 juin 2011 mise en scène Laurent Pelly Théâtre de l'Odéon 6e dramaturgie Agathe Mélinand scénographie Chantal Thomas costumes Laurent Pelly maquillages & coiffures Suzanne Pisteur masques Jean-Pierre Belin lumière Joël Adam son Aline Loustalot avec Vincent Bramoullé Scabeau, huissier de saisie, un masque Christine Brücher Etiennette, un masque Emmanuel Daumas Monsieur de Pontresme, un recors Rémi Gibier Le Baron de Puencaral, un inspecteur de police, un masque, un recors Benjamin Hubert Edgar Marc Jérôme Huguet Glapieu Pascal Lambert Un huissier du tribunal, un masque, un recors Eddy Letexier Le major Gédouard, un afficheur, un huissier du tribunal / gendrame Laurent Meininger Rousseline Jean-Benoît Terral Monsieur Barutin, un recors, un huissier du tribunal/ gendarme, un huissier d'appartement Émilie Vaudou Cyprienne avec la participation de François Bombaglia dans le rôle du fripier production TNT – Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées créé le 14 janvier 2010 au TNT – Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées Mille francs de récompense] / 11 mai > 5 juin 2011 2 Extrait GLAPIEU Je suis très pensif, savez-vous ? Aucun moyen de gagner le toit par là-haut ; Tout est fermé. -

Théâtre De Grammont
Andromaque de Racine Photo © B.M Palazon mise en scène Philippe Adrien Saison 06-07 Théâtre de Grammont mardi 23 janvier à 20h45 mercredi 24 janvier à 19h00 jeudi 25 janvier à 19h00 vendredi 26 janvier à 20h45 samedi 27 janvier à 20h45 durée : 2h tarif général : 20€ réduit : 12,50€ (hors abonnement) Location – réservations 04 67 99 25 00 Andromaque de Racine mise en scène Philippe Adrien décors Olivier Roset lumières Pascal Sautelet assisté de Nadine Sarric musique Ghédalia Tazartès costumes Claire Belloc direction technique Martine Belloc Photo © B.M Palazon maquillages Faustine-Léa Violleau avec Anne Agbadou-Masson Céphise Jenny Bellay Cléone Marc-Henri Boisse Phoenix Rencontre avec Christine Braconnier Hermione l’équipe artistique Jean-Marc Herouin Pylade Catherine Le Henan Andromaque après la représentation Bruno Ouzeau Oreste François Raffenaud Pyrrhus le jeudi 25 janvier Production ARRT/Philippe Adrien, compagnie subventionnée par le ministère de la Culture et la Ville de Paris. Spectacle créé en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête Création du 13 septembre au 30 octobre 2005 L’action d’Andromaque se situe après la légendaire guerre de Troie, remportée par les Grecs. Pyrrhus, « le fils d’Achille et le vainqueur de Troie » est tombé amoureux de sa prisonnière Andromaque, la veuve du chef troyen Hector, tué par Achille. Il délaisse Hermione, qu’il doit épouser. Oreste, de son côté, aime d’un amour fou Hermione. Andromaque est partagée entre sa fidélité à la mémoire de son mari et son désir de sauver son fils, également prisonnier. Soumise aux pressions de Pyrrhus, elle finit par accepter de l’épouser, avec le projet secret de se tuer aussitôt. -
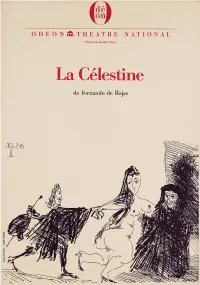
Odeonîîîithe at R E NATIONAL Direction Antoine Vitez La
ODEONîîîiTHE AT R E NATIONAL Direction Antoine Vitez La Célestine de Fernando de Rojas 1 Vagenende 1900 La Célestine La Brasserie du Présent de Fernando de Rojas Version française de Florence Delay HUITRES COQUILLAGES 1111 FOIE GRAS Mise en scène d'Antoine Vitez Décor et costumes de Yannis Kokkos Musique originale de Georges Aperglns Lumière de Patrice Trottier Avec, par ordre d'entrée en scène : Calixte Lambert Wilson Mélibée Valérie Dréville* Sempronio Roger Mirmont* La Célestine Jeanne Moreau Elicie Christine Fersen* Crito Olivier Cru veiller Parmeno Jean-Yves Dubois* Lucrèce Elisabeth Catroux A lis a Catherine Ferran* A ré use Muriel Mayette* CUISINE TRADITIONNELLE Pleberio Jean-Luc Boutté* BRASSERIE Sosie Olivier Cruveiller Tristan Eric Frey Trombone: Michel Barbier Bande sonore enregistrée par Martine Viard soprano, Sylvie Su lié mezzo-soprano, Philippe Devime basse. DEJEUNERS - DINERS - SOUPERS TOUS LES JOURS JUSQU'A 1 H DU MATIN Illl Pour vos réservations * de la Comédie-Française 142. boulevard Saint-Germain - Paris 66 1 Assistant à la mise en scène Éloi Recoing L'U A P est le sponsor exclusif de la Célestine de Fernando de Rojas, mise en scène Assistante au décor Muriel Trembleau d'Antoine Vitez. Assistante à la musique Martine Viard Assistant à la lumière Jean-Paul Macé Répétitrice Nathalie Chemelny Réalisation des costumes Mine Barral-Vergez Sculptures de Francis Poirier et Sylvie de Meurville Peintures de Dorothée Crosland, Martina Seeber et Martin Didier assistés de Pierre-Alexis Mestre Coiffures de Fernando Mendes Perruques -

Tout Est Fumée Libre Interprétation Des Paroles De Qohèlèt, Dit L’Ecclésiaste
Tout est fumée libre interprétation des paroles de Qohèlèt, dit L’Ecclésiaste Adaptation et interprétation : Jean O’Cottrell Mise en musique et accompagnement au piano : Jean-Marie Sénia Mise en scène : Philippe Adrien Scénographie : Olivier Roset Lumières : Pascal Sautelet Costumes : Claire Belloc SPEDIDAM Les droits des interprètes Coréalisation D'un Acteur, l'Autre / ARRT-Philippe Adrien / Théâtre de la Tempête Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France et de la Spedidam Production / diffusion : D’un Acteur, l’Autre – 01 69 49 32 09 / 06 81 91 45 08 Siège social : 19 rue des Lilas – 91330 Yerres – [email protected] Adresse postale : 6 rue des Bosquets – 91330 Yerres Tout est fumée libre interprétation des paroles de Qohèlèt, dit L’Ecclésiaste Les textes qui interrogent l’homme depuis des millénaires sont comme des galets polis par les eaux et le temps. Ils ont perdu leur forme brute pour se parer d’abstractions et de sens obscurs. Un homme surgit du néant. Il est toute l’humanité. Il a connu et considéré toutes les activités humaines et il en dénonce les illusions et les aliénations. En examinant tout ce qui nous importe, nous enflamme et nous questionne durant notre existence, il nous montre comme il est compliqué d’être un sage, ballotté entre notre soif d’éternité et le temps qui passe. Face à la violence, à l’intolérance et au crime qui continuent imperturbablement leurs cycles, sachant que, quoiqu’on fasse, tout finira, le Qohèlèt nous dit de nous efforcer à la sagesse mais sagement car trop de sagesse confine à la folie. -

FRANK CASTORF Bajazet En Considérant Le Théâtre Et La Peste D’Après JEAN RACINE Et ANTONIN ARTAUD
FRANK CASTORF Bajazet En considérant Le théâtre et la peste d’après JEAN RACINE et ANTONIN ARTAUD FRANK CASTORF Bajazet Considering The Theater and the Plague RACINE/ARTAUD © Esquisse de la scénographie, Aleksandar Denic © Mathilda Olmi/Théâtre Vidy-Lausanne THÉÂTRE VIDY LES THÉÂTRES MC93 LAUSANNE AIX-EN-PROVENCE AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS Du 30 octobre au 10 novembre Du 20 au 22 novembre Du 5 au 14 décembre FRANK CASTORF BAJAZET CONTACTS GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE/LES THÉÂTRES DIRECTION : DOMINIQUE BLUZET THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE PRESS : EMMANUELLE CANCE DIRECTION: [email protected] VINCENT BAUDRILLER +33 (0)4 91 24 35 24 / +33 (0)6 25 85 48 40 MARIE LANZAFAME PRODUCTION: [email protected] DIRECTOR OF ARTISTIC AND +33 (0)4 42 91 69 51 / +33 (0)6 64 76 91 08 INTERNATIONAL PROJECTS CAROLINE BARNEAUD [email protected] *EXTRAPÔLE RÉGION SUD T +41 (0)21 619 45 44 With the creation of ExtraPôle, the Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur is demonstrating its confi- TECHNICS: dence in the arts sector and its ability to build synergies TECHNICAL DIRECTION in the service of artists and their projects. ExtraPôle CHRISTIAN WILMART / SAMUEL MARCHINA helps extend the reach and influence of our region, [email protected] reflecting its artistic and cultural vibrancy. T +41 (0)21 619 45 16 / 81 Producing major works and disseminating them widely, encouraging their performance to a broad audience in PRESS: the region, bringing together stakeholders in a collabo- rative effort : these are the objectives that have been DIRECTOR OF AUDIENCES AND COMMUNICATION established by seven production companies, the Friche ASTRID LAVANDEROS la Belle de Mai, and the Région SUD. -

En Attendant Les Barbares Nouvelle Production D’Après J
Suliane Brahim, Didier Sandre, photographie de répétition En attendant les barbares Nouvelle production D’après J. M. Coetzee 17 JUIN > Adaptation et mise en scène 3 JUIL 2021 Camille Bernon et Simon Bourgade INVITATIONS PRESSE avec la troupe de la Comédie-Française à partir du 19 juin Stéphane Varupenne, Suliane Brahim, Didier Sandre, Christophe Montenez, Élissa Alloula, Clément Bresson et Étienne Galharague CONTACT PRESSE Marine Faye 01 44 39 87 18 [email protected] ÉDITO D ’ÉRIC RUF Comme souvent, impressionné ou passionné par le travail d’une ou d’un metteur en scène que je désire inscrire dans la saison, je lui demande ce qu’il ou elle aimerait monter avec la Troupe, ce que sa besace recèle de projets en jachère, ce qui résonnerait le plus entre sa pratique et celle de la Comédie-Française. Il en ressort presque toujours des propositions singulières. J’ai eu la chance d’assister à la maquette d’un spectacle de Camille Bernon et Simon Bourgade, tous deux issus du Conservatoire. Il s’agissait d’une première ébauche de Change me, spectacle dont on a beaucoup parlé depuis. Ce travail m’avait intrigué par sa polysémie, son mélange rare de stylistiques, de jeu de miroirs incessants entre les époques, des mythes aux tragédies contemporaines. Il me rappelait que le travestissement, même au théâtre, n’est pas une question de ravissants catogans mais bien, d’Isaac de Benserade à un sombre fait divers des années 1990 dans le Nebraska, d’une nécessité impérieuse et d’un risque absolu. Impressionné, je leur ai posé la question. -

LE ROI LEAR JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015 | 20H00 Durée 2H45 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 | 20H30 Salle JACQUES AUDIBERTI
LE ROI LEAR JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015 | 20H00 durée 2h45 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 | 20H30 salle JACQUES AUDIBERTI anthéa - théâtre d’antibes www.anthea-antibes.fr 260, avenue Jules Grec 06600 Antibes - Tél. 04 83 76 13 00 - contact@anthea- antibes.fr LE ROI LEAR de William Shakespeare traduction et mise en scène Olivier Py avec Jean-Damien Barbin, Moustafa Benaïbout, Amira Casar, Céline Chéenne, Eddie Chignara, Matthieu Dessertine, Émilien Diard-Detœuf, Joseph Fourez, Philippe Girard, Damien Lehman, Thomas Pouget, Laura Ruiz Tamayo, Jean-Marie Winling scénographie, décor, costumes et maquillage Pierre-André Weitz lumière Bertrand Killy production Festival d’Avignon coproduction anthéa - théâtre d’Antibes, France Télévisions, Les Célestins - Théâtre de Lyon, Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux, National Performing Arts Center - National Theater & Concert Hall (Tapei), La Criée - Théâtre National de Marseille avec le soutien de la Région Île-de-France, de l’Adami et de la Spedidam avec la participation artistique du Jeune Théâtre National résidence à la Fabrica du Festival d’Avignon remerciements à la Comédie- Française création dans la Cour d’honneur du Palais des papes le 4 juilllet 2015 en ouverture de la 69ème édition du Festival d’Avignon l’histoire Le vieux roi Lear sentant sa mort prochaine fait venir ses trois fi lles qui auront à se partager le royaume. En échange, il leur demande de lui exprimer au mieux leur amour. Si Goneril et Régane se lancent dans la course aux louanges, Cordélia, la cadette, craignant par cette mise en scène de dénaturer l’amour qu’elle voue à son père choisit de se taire. -

Savannah TALK: (No Intermission) Program
Brooklyn Academy of Music Alan H. Fishman, Chairman of the Board William I. Campbell, Savannah Vice Chairman of the Board Adam E. Max, Vice Chairman of the Board Katy Clark, Bay President Joseph V. Melillo, Executive Producer By Marguerite Duras Théâtre de l’Atelier, Paris Directed by Didier Bezace DATES: NOV 11—14 at 7:30pm LOCATION: BAM Fisher (Fishman Space) RUN TIME: Approx 1hr 10min (no intermission) Season Sponsor: TALK: On Truth (and Lies) in Suicide With Kay Redfield Jamison and Andrew Solomon Major support for Savannah Bay Hosted by Simon Critchley provided by Co-presented by BAM and the The Florence Gould Foundation Onassis Cultural Center NY with additional support provided by Part of the Hellenic Humanities Laura Pels Program Sat, Nov 14 at 5pm Major support for theater at BAM BAM Fishman Space provided by The Francena T. Harrison Foundation Trust Donald R. Mullen Jr. The Morris and Alma Schapiro Fund #SAVANNAHBAY The SHS Foundation #BAMNextWave The Shubert Foundation, Inc. BAM Fisher Savannah Bay ABOUT Savannah Bay NY Premiere DIRECTOR’S NOTE Two women in a pristine white room: The overarching subject of Savannah In French with English titles one young, one old. “Who was she?” Bay is the union of two women and one asks the other, referring to a third the role play in which they engage— DIRECTOR who had long ago met a boy, fallen in perhaps daily—to recognize one Didier Bezace love, and bore his child before drown- another. Stemming from a hidden and ing herself. buried traumatic event, which they ARTISTIC MANAGEMENT bring to the surface from a shred of Dyssia Loubatière Unfolding in the melancholic half- memory, they attempt to win each light of memory, Savannah Bay is a other over, to recognize and to love PERFORMERS mesmerizing two-character drama one another. -

Programme L'opéra De Quat'sous 10/11
L’Opéra de quat’sous En couverture : Léonie Simaga, Thierry Hancisse. Ci-dessus : Sylvia Bergé. © Brigitte Enguérand Salle Richelieu B. Coll. / Enguérand Comédie-Française, Marcel , Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française © M. C. Coll. / Magliocca Comédie-Française Hartmann / Getty Image, P. Gely, J. Mingot et D.Meas. J. Gely, Getty Image, P. / Hartmann 3H -VUKH[PVU 1HJX\LZ ;VQH WV\Y SL ;Oto[YL LZ[ OL\YL\ZL L[ ÄuYL KL ZV\[LUPY l’entrée au répertoire de L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Laurent 7LSS`WYv[LZVU[HSLU[L[ZVUNV[KLSHY\W[\YLnSHTPZLLUZJuULKLJLZWLJ[HJSL Cahier n°1Bernard-Marie KOLLTÈSTÈS | Cahier n°2 BEAUMARCHAIS | Cahier n°3 Ödön von HORVVÁÁÁTTH | Cahier n°4 Alfred de MUSSETMUSSE | e Cahier n°5 Alfred JARRY | Cahier n°6 Dario FO | Cahier n°7 Georges FYE DEAU | Cahier n°8 TTennesseeennessee WILLIAMS emblématique du XX ZPuJSL Ces publications sont disponibles en librairie ou dans les boutiques de la Comédie-Française. Prix de vente 10 €. Cette intervention portera à 13 le nombre des spectacles de la Comédie-Française soutenus depuis 2003 par la Fondation. L’interdisciplinarité et l’ouverture au répertoire européen ont toujours été au cœur de cette collaboration. 7YLTPuYLMVUKH[PVUYLJVUU\LK»\[PSP[tW\ISPX\Lnµ\]YLYL_JS\ZP]LTLU[LUMH]L\YKL Les Éditions L’avant-scène théâtre présentent l’art dramatique, elle MtKuYLSLZKVUZK»LU[YLWYPZLZL[KLWHY[PJ\SPLYZet permet ainsi deux nouveaux volumes de la collection Anthologie de L’avant-scène théâtre K»HWWVY[LY\ULHPKLWYtJPL\ZLnSHJYtH[PVUKLnWPuJLZJOHX\LZHPZVU Le théâtre français Le théâtre français Attachée à la YLUHPZZHUJLKLWPuJLZK\YtWLY[VPYL, la Fondation Jacques Toja pour du XVIIe siècle du XVIIIe siècle le Théâtre participe aussi activement à la découverte d’auteurs contemporains tels direction Christian Biet direction Pierre Frantz, Sophie Marchand qu’Emmanuelle Marie, Jon Fosse, Yasmina Reza, Serge Kribus, Wladimir Yordanoff ou Cyril Gely. -
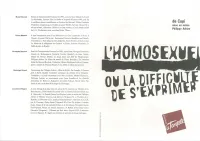
Philippe Adrien De J
Margot Abascal Sortie du Conservatoire National en 1994, a tourné avec Claude Lelouch L~s tl/isirabùs, Laurent Tuel u Rocher d' Ampu/co (Cannes 1995, prix de la meilleure jeune comédienne au pestival de Béziers), Didier Kaminka de Copi P!Yi1l1otion contlpi, Jacques Doillon u jtlllle IVe/ther, Sylvain r-Ionod 011 {/ mise en scène très peu d'tIIllis , Sebastien Lifshitz us Co/ps ouvnts, et joué Simple suiàde Philippe Adrien de j. G. Nordmann, mise en scène r-Iarie Tikova. Thierry Mettetal A joué notamment avec Guy Alloucherie et Eric Lacascade A la vie, li l'AIIIOIII; à lalIIo/t (De 10 vie) , Emmanuel Genvrin Baudelaire {/II Paradis, Yves Babin Le Petit cheval est bim faligui de Annie r-lercier, Eric Louviot La tl/Ollie de 10 villigiature de Goldoni et Pierre Etienne Heymahn Le Dibit de poill de Brecht. Christophe Reymond Sorti du Conservatoire National en 199~, a joué avec Georges Lavaudant lIallllet de Shakespeare, Stanislas Nordey Spmdid's de Jean Genet, CillleJlt de Heiner r-lüller, Le SOllge d'ulle IllIit d'ité de Shakespeare, Philippe Adrien Lo Alisère du 1I10llde de Pierre Bourdieu, Eu attmd{lIIt Godot de Samuel Beckett, Catherine r-larnas tl/atériaux Kollès et Fell/llles, gue17-e, [{)lIIidie de Thomas Brasch, Irina Dalle Le Chant du toumeso/. Dominique BoisseI Dramaturge de Philippe Adrien: Rêves de Ka/l'a, Des Avmgles, L'AIIIIOlla faite li A/tllie, Ha1l1let. Conseiller artistique du théâtre de la Tempête. Comédien, il a joué notamment avec r-larc Liebens, Michel Dezoteux, Philippe Adrien et récemment avec Jean Jourdheuil La Ba/aille d'Arminius de Kleist et Robespien-e de Gilles Aillaud, David Géry Ulle El/vie de luer sur le bout de la lallgue de Durringer. -

Dossier De Presse La Vie De Galilée
LA VIE DE GALILÉE Bertolt Brecht texte français Éloi Recoing mise en scène Jacques Lassalle Théâtre National de la Colline 15, rue Malte-Brun 75020 Paris Location 01 44 62 52 52 Grand Théâtre du 24 février au 9 avril 2000 du mercredi au samedi 20h00 mardi 19h30 dimanche 15h00 - relâche lundi Les mardis de la Colline les mardis à 19h30 - tarif unique 110 F Production Compagnie pour Mémoire / Théâtre National de la Colline en coproduction avec le Centre Dramatique National de Nice - Côte d’Azur. Avec la participation d’Atelier Théâtre Actuel et du Jeune Théâtre National. Le texte est publié à L’Arche Éditeur Presse Nathalie Godard Tél 01 44 62 52 25 Fax 01 44 62 52 91 1 décor Rudy Sabounghi costumes Renato Bianchi lumière Franck Thevenon avec Françoise Bette Thomas Blanchard Bernard Bloch Nicolas Bonnefoy Audrey Bonnet Loïc Corbery Pascal Elso Jérôme Huguet Nicolas Moreau Johanna Nizard Jean Pennec Michel Peyrelon Rodolphe Poulain Bernard Spiegel Jacques Weber Bernard Yannotta en alternance avec Stuart Patterson (distribution en cours) 2 « En l’an de grâce seize cent neuf à Padoue La clarté du savoir jaillit d’un pauvre bouge. Galileo Galilei calcula tout : Ce n’est pas le soleil mais la terre qui bouge. » La Vie de Galilée, I, « Galileo Galilei, professeur de mathématique à Padoue, veut démontrer le nouveau système du monde de Copernic » , Epigraphe La Vie de Galilée occupe une place privilégiée dans l’œuvre de Bertolt Brecht. Composée en 1938, peu avant Mère Courage et ses enfants, elle ne prit une forme à peu prés définitive qu’en 1955, lors de sa première publication, et la mort inter - rompit son auteur quand il travaillait à sa réalisation scénique par le Berliner Ensemble.