Les Mailly-Fauverney
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Le « Petit Baillou » De Longchamp
Juin 2016 Carla Paul du CP de Mme Etienney Thème : Animaux de la forêt Le « Petit Baillou » de Longchamp Chloé Rebeix classe CE1-CE2 de Mme Guichard. Thème la forêt 1 2 LE MOT DU MAIRE…… SOMMAIRE Merci aux enfants des écoles pour la couverture de ce Petit Baillou, le conseil Le mot du Maire ………… P 1 La période des vœux……... P 2 municipal Jeunes a sélectionné cinq dessins parmi 100 propositions. Ils méritaient tous Budget de la commune & Communauté de communes. P 3 d'être retenus. La fraîcheur qu'ils dégagent agit sur nous comme un bain de jouvence. Vie de l’Ecole……………... P 4 Conseil municipal « Jeunes » P 5 Nous en avons bien besoin face aux événements internationaux, Les Trophées des Maires… P 6 nationaux et locaux notamment avec la communauté de communes Participation Citoyenne….. P 7 qui prendra encore de nouvelles compétences qui lui sont imposées Elagage, désherbage……… P 8 par la loi. Journée Propreté, Déblaiement Longchamp s'est vu attribuer le trophée des Maires de Côte d'Or au Ex-faïencerie…………….. P 9 Fleurissement, Embelliss… P 10 titre de la citoyenneté pour sa fresque ; je remercie encore son initiatrice Madame Antemi. Elle nous quitte en compagnie de Histoire de l’Eau Athée….. P 11 Portrait Souad Souhary….. P 12 Madame Guichard, nous les voyons partir avec regret. Le cinquantième anniversaire du jumelage marque à jamais la Portrait d’une centenaire….P 13 fraternité entre nos deux peuples, entre nos deux localités. J'adresse Bibliothèque Municipale….. P14 ma gratitude aux artisans de ce jumelage (Président, adhérents, & P 15 familles, comité des fêtes et cyclistes). -

Viol D'une Fillette À Genlis
PAGE 7 PORTES OUVERTES ENQUÊTE Samedis 24 et 31 mars Viol d’une fillette à Genlis : € -500 € Tous les 5000 la gendarmerie dessaisie d’achat* MTM • Fenêtres PVC • Volets roulants • Vérandas CHENÔVE & 03.80.52.14.15 855224600 Édition Région dijonnaise 21C Vendredi 23 mars 2018 - 1,10 € CHARREY-SUR-SAÔNE SOCIAL Le centre d’action sociale a été dissous Une première PAGE 18 COLLONGES-LÈS-PREMIÈRES charge D’importants travaux bientôt terminés ■ Photo Philippe PINGET PAGE 15 SELONGEY Le Département partenaire de la commune ■ La manifestation a réuni, hier à Dijon, près de 3 000 personnes. Photo Stéphane RAK PAGES 2, 3, 26 ET 27 PAGE 20 3e EDITION Marché couvert rue Thurot Mah Jong. Design Hans Hopfer. 24 25 MARS Habillé de tissus dessinés par Kenzo Takada. 5, rue du Platane - DIJON/QUETIGNY 873220400 880652900 02 VENDREDI 23 MARS 2018 LE BIEN PUBLIC CÔTE-D’OR SOCIAL Près de 3 000 personnes pour défendre la fonction publique Hier après-midi, dans les rues de Dijon, entre 2 800 et 3 400 personnes ont manifesté pour défendre les services publics, l’emploi et le pouvoir d’achat. algré la pluie, ce sont entre M2 800 personnes (selon la poli- ce) et 3 400 (selon la CGT) qui ont manifesté, hier, à partir de 14 h 30, place de la Libération à Dijon, pour la défense de la fonction publique. Ceci à l’appel de l’intersyndicale CFTC-CGC-CGT-FAFP-FO-FSU- Solidaires. Ce mouvement faisait suite à la mobilisation du 10 octo- bre, qui avait réuni entre 2 000 et 2 100 personnes à Dijon. -

RAA31082004.Pdf
R.A.A. - 2004 N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR n° 131 Août 30 Janvier 2004 n° 2 27 Février Liberté Égalité Fraternité n° 3 31 Mars N° 9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE n° 4 30 Avril n° 5 28 Mai PREFECTURE DE LA COTE D'OR n° 6 30 Juin 31 Août 2004 n° 7 30 Juillet n° 8 Spécial Dél. Sign. 2 Août n° 9 31 Août RECUEIL DES SECRETARIAT GENERAL SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE - Bureau de la Logistique - Atelier P.A.O. ACTES Jean-Marc LAVINA 03.80.44.65.28 [email protected] ADMINISTRATIFS La version intégrale de ce recueil peut être consultée sur simple demande à partir du 31 août 2004 aux guichets d'accueil de la Préfecture et des Sous-Préfectures, à l'atelier P.A.O. de la Préfecture et sur le site internet de la préfecture : http://www.cote-dor.pref.gouv.fr - Rubrique Préfecture S O M M A I R E PREFECTURE DE LA REGION CENTRE Arrêté n° 04.184 du 27 juillet 2004 portant délégation de signature à M. Paul RONCIERE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or en sa qualité de préfet du département de la Côte d’Or en matière d’ordonnancement secondaire pour la mission interrégionale de mise en oeuvre du Plan Loire Grandeur Nature .................................................................................................. 5 SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE Arrêté du 9 août 2004 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de NUITS SAINT GEORGES ................................................................................................................................................................................... -

Foires, Marchés Et Manifestations Commerciales Annuelles En Côte-D'or
Foires, marchés et manifestations commerciales annuelles en Côte-d'Or CHATILLON-SUR-SEINE CHATILLONNAIS MONTBARD SELONGEY SEINE & TILLES EN BOURGOGNE AUXOIS-MORVAN MIREBEAU-SUR-BÈZE CÔTE D'ORIEN PLAINE DE SAONE VINGEANNE DIJON DIJONNAIS AUXONNE BEAUNOIS BEAUNE Réussir ensemble www.cci21.fr 2 FOIRES, MARCHES ET MANIFESTATIONS COMMERCIALES ANNUELLES EN COTE - D'OR JUIN 2012 Vous trouverez dans ce document la périodicité des manifestations, leur emplacement, les coordonnées des responsables à contacter, le coût approximatif des places ainsi que le nombre de commerçants y participant. Ces informations sont données à titre purement indicatif et ne sauraient en aucun cas engager l’Institution sur un plan juridique. Si vous constatez des erreurs ou des omissions, nous vous saurions gré de bien vouloir le signaler à la Direction Développement des Territoires de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or – 2, Avenue de Marbotte – B.P. 17440 – 21074 DIJON CEDEX – Tél. 03.80.65.91.12. – Fax 03.80.65.37.09 – E.mail : [email protected]. ------------------------------------- Dépôt légal 2ème trimestre 2012 CCI Côte-d'Or – Direction Développement des Territoires Juin 2012 – Réactualisation des informations sur http://www.cci21.fr/infos-economiques/etudes-et-documents/commerce-et-distribution 3 QUELQUES RAPPELS : Pour exercer le commerce sur les marchés, vous devez avoir accompli un certain nombre de formalités administratives. VOUS DEVEZ : demander votre immatriculation au Registre du Commerce, ou au Répertoire de Métiers si votre activité -

Partenaires Passtime Côte D'or - Edition 2021 ETABLISSEMENTS VILLES Découv
Partenaires PassTime Côte d'Or - Edition 2021 ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. LE BORY DIJON -50% -20% LE FAUVERNEY LODGE FAUVERNEY -50% -20% LA DAME D'AQUITAINE DIJON -50% -20% AU CLOS NAPOLEON FIXIN -50% -20% LE CHANOINE DIJON -50% -20% L'AUBERGE DE L'AIGUILLON BINGES -40% -20% BISTROT DES TRAMWAYS DIJON -50% -20% LE BISTROT DE L'AMIRAL DIJON -50% -15% LA TABLE DU ROCHER MARSANNAY LA COTE -40% -20% L'ECHAPEE BELLE FONTAINE LES DIJON -50% -20% LE PANORAMA BEAUNE -50% -15% LE MAHARAJA DIJON -40% -20% COMPTOIR JOA SANTENAY -50% -20% LA GREMELLE LADOIX SERRIGNY -50% -15% BENGALE PALACE DIJON -40% -20% LE BOUF'TARD BEAUNE -50% -20% L'ILE DE LA REUNION DIJON -50% -15% MEMPHIS COFFEE CHENOVE -30% -10% LE BŒUF BLANC DIJON -50% -20% LE CELLIER D'CLEM AHUY -50% -15% LE BUREAU DIJON -30% -10% LE PALMIER DIJON -50% -20% LE TIRE BOUCHON QUETIGNY -50% -15% IL RISTORANTE QUETIGNY -30% -10% LE COIN REPAS DIJON -50% -20% LE CHAMOIS DIJON -50% -15% L'EMBARGO NUITS SAINT GEORGES -30% -10% LE PHARAON DIJON -50% -20% LE BISTINGO DIJON -50% -15% QUICK DIJON -50% -20% GUIDE ET APPLICATION* offres valables MARCO POLO DIJON -50% -20% QUETIGN'EAT QUETIGNY -50% -15% SUBWAY (4 adresses) Beaune - Chenove - Dijon -50% -20% jusqu'à 6 personnes LE CARPE DIEM DIJON -50% -20% LE MACARENA POUILLENAY -50% -15% A LA BONNE HEURE (3 adresses) Chenove-Dijon-Fontaine les D. -30% -10% NOUVEAUTE LE PLAISANCIA PLOMBIERE LES DIJON -50% -20% SALSA PELPA DIJON -50% -15% ETABLISSEMENTS VILLES Découv. -
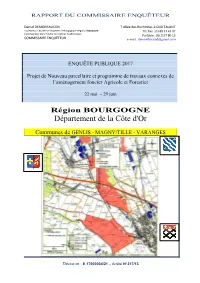
Rapport-Genlis.Pdf
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Daniel DEMONFAUCON 7 Allée des Ruchottes 21240 TALANT Inspecteur d’Académie Inspecteur Pédagogique Régional Honoraire Tél. fixe : 03 80 57 43 07 Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques Portable : 06 1177 80 13 COMMISSAIRE ENQUÊTEUR e-mail : [email protected] ENQUÊTE PUBLIQUE 2017 Projet de Nouveau parcellaire et programme de travaux connexes de l’aménagement foncier Agricole et Forestier 22 mai – 29 juin Région BOURGOGNE Département de la Côte d'Or Communes de GENLIS - MAGNY/TILLE - VARANGES Décision : E 17000034/21 – Arrêté N°217/13 Dossier : E 17000034/21 ENQUÊTE PUBLIQUE AFAF-projet de nouveau parcellaire SOMMAIRE Programme de travaux connexes 22/05/2017 AU 29/05/2017 GENLIS-MAGNY/TILLE-VARANGES tw9aL:w9 t!w L9 w!tthw 5 /haaL!Lw9 9bv < 9 w t L h.W9 59 [9bv < 9 / t L h ! "# ! $ % w'! "# $ ( t ! )! * + / ! * h /, ! - LL 5;wh [9a9b 59 [9bv < 9 . "# / 0 . 1 ! "# /# 0 t ! "# 2 ! % a ! ( 4 % + a ! ! ! % t ! "# ( $ /!' ! "# ( -5 ( LLL h.9w! Lhb w9/ 9L[[L9 ! /h w 59 [9bv < 9 bha.w, ! ( t ) ! ! ( 4 "# ! ! /. $ % / ! "# * 59 L:a9 t!w L9 /hb/[ Lhb 9 !L 5 /haaL!Lw9 9bv < 9 w 4 hwL,b545Lhb 89b9w4:, - . .9wh;:,a,b5 ., :,bv;=5, / /hbChwaL59 4;? .L@th@L5Lhb@ w98:,a,b54Lw,@ . 4b4:A@, .,@ h.@,w245Lhb@ .; w,8L@5w, .,bv;=5, % , Lb/L.,b/, ., :42L@ ., :4;5hwL5, ,b2Lwhbb,a,b54:, @;w :, twhB,5 C 42L@ .; /haaL@@4Lw, ,bv;,5,;w % t !" #$%&!" C 4bb,?,@ . -

Liste Des Entreprises De COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT Immatriculées Au Registre National
Dernier rafraichissement le : 27/09/21 Liste des entreprises de COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT immatriculées au registre national Pour effectuer une recherche d'entreprise (ou de commune), pressez et maintenez la touche “Ctrl “ tout en appuyant sur la touche “F”. Saisissez alors tout ou partie du mot recherché. 21 - COTE D OR SIRET Raison sociale Catégorie juridique Code Commune Siège Attestataire de capacité postal professionnelle 49171814400018 ALEXANDER AND CO SARL unipersonnelle 21330 VERTAULT O SIMONIN ALEXANDRE ALLIANCE HEALTHCARE 42121813200130 Société par actions simplifiée (SAS) 21600 LONGVIC N PAOLOZZI PATRICK REPARTITION 53582052600189 ALPHONSE CHARPIOT ET CIE Société par actions simplifiée (SAS) 21220 BROCHON N VINCENT OLIVIER PASCAL CHARLOT 53582052600205 ALPHONSE CHARPIOT ET CIE Société par actions simplifiée (SAS) 21600 LONGVIC N 42863514800029 ALTAVIA OPTITRANS Société par actions simplifiée (SAS) 21250 SEURRE N BON EPSE SEPREZ PATRICIA ASSOCIATION AUTONOME DE 34270642100423 Autre société à responsabilité limitée 21000 DIJON N FERNANDES GUALTER FRANCISCO CAMIONAGE GLOBE EXPRESS 80166717100020 AZ EXPRESS SARL unipersonnelle 21000 DIJON O ALIANI SALIM THOMAS ANTOINE GERALD 46420036900146 BALGUERIE Société par actions simplifiée (SAS) 21200 BEAUNE N JACQUES 50780859000024 BEAUNE LOGISTIQUE SERVICES Autre société à responsabilité limitée 21200 VIGNOLES O LEGAY YOANN 55208853600123 BOLLORE LOGISTICS Société européenne 21600 LONGVIC N EHRENBOGEN THIERRY JOSEPH BOURGEY MONTREUIL RHONE- 95750214900140 Société par actions simplifiée -

Annexes 7-9-Modif Du 31-10-17
ANNEXE 7 : IMPLANTATION DES COLONNES A VERRE ET TEXTILE COMMUNE LIEU VERRE TEXTILES AISEREY PLACE DE LA MAIRIE 1 ROUTE D'ECHIGEY 1 PARKING "ATAC" 1 2 POTANGEY 1 SALLE "LE CHAUDRON" 1 ARC SUR TILLE DECHETERIE 2 2 RUE JEAN BAPTISTE LEGROS 2 (services techniques) BEIRE LE FORT PASSAGE A NIVEAU 1 BESSEY LES C. STADE 2 SERVICES TECHNIQUES 1 RUE D'AVAL 1 CESSEY S/T DECHARGE MUNICIPALE 2 CHAMBEIRE RUE DE VAUX SUR CROSNE 1 COLLONGES SALLE POLYVALENTE (rue de la gare) 2 RUE DE LA GRANDE CHARRIERE 1 COUTERNON RUE DU CHÂTEAU D'EAU 1 MILLE CLUB (rte de Bressey) 2 1 ECHIGEY RUE DU CHÂTEAU 1 FAUVERNEY SALLE MUNICIPALE DE CHASSAGNE 1 DEVANT L'ANCIENNE DECHARGE 2 CENTRE DE FORMATION (rte de Magny-sur-Tille) 1 sous-total : 45 7 COMMUNE LIEU VERRE TEXTILES GENLIS SALLE AGORA 2 RUE DU VERCORS 2 STADE DE RUGBY (av. de Sprendlingen) 2 PLACE DE L'ESPOIR (route de Cessey-sur-Tille) 2 INTERMARCHE (rue de la Gare) 2 2 RUE CLAUDE PROTEAU 2 PLACE DES DROITS DE L'HOMME (rue Marcel Paul) 3 2 RUE DE FRANCHE COMTE 1 PLACE DU CHÂTEAU (rue du Château) 1 2 THOMSON 1 RUE AMPERE 2 DECHETERIE 3 HUCHEY 2 IZEURE ROUTE DE TARSUL 2 IZIER STADE (route de Magny) 2 1 DECHETERIE 2 LABERGEMENT RUE DE CESSEY 2 LONGCHAMP LA POSTE 1 PLACE DU CHÂTEAU (rue du Lycée) 1 1 RUE DES FAÏENCIERS 1 LONGEAULT PLACE DE LA MAIRIE 1 RUE DU STADE 1 LONGECOURT DECHETERIE 3 ECLUSE (route de Genlis) 1 RUE NEUVE 1 SALLE DES FETES (route de Dijon) 1 " LA FERME " (rue Sainte Marguerite) 2 1 MARLIENS SALLE POLYVALENTE (route d'Echigey) 1 LOT. -

Règlement Régional Des Transports Scolaires De
RÈGLEMENT RÉGIONAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE CÔTE-D’OR TITRE I - CHAMP D'APPLICATION Article 1 - Définition des transports scolaires Les transports scolaires concernent les trajets effectués par les élèves domiciliés en Côte-d’Or entre leur domicile et l’établissement scolaire de secteur, lorsque celui-ci est situé sur une autre Commune. Article 1.1 - Création d’un point d’arrêt Une Commune est desservie ou un point d’arrêt est créé si : le nombre d’élèves en âge de scolarisation obligatoire à transporter est au moins de quatre, la distance à parcourir entre la Commune et l’établissement, ou entre deux points d’arrêts, est au moins de deux kilomètres à vol d’oiseau. En règle générale, un seul point d’arrêt est créé par Commune. La distance minimale entre deux points d'arrêt est fixée à deux kilomètres. Plusieurs points d’arrêts peuvent être mis en place au sein d’une même Commune pour des trajets intercommunaux. L’opportunité de création d’un point d’arrêt est appréciée au regard du nombre d’élèves qu’il dessert. Le seuil à partir duquel un point d’arrêt peut être créé est fixé à quatre élèves. La création d’un point d’arrêt dans une Commune pour desservir une école privée sous contrat avec l’État peut être accordée, s’il n’y a pas d’incidence financière et si le temps de trajet global n’est pas excessif. Chaque création de point d’arrêt des circuits scolaires est sollicitée par le Maire de la Commune concernée, puis examinée au regard de la sécurité par les Services Régionaux, l'entreprise de transport, le gestionnaire de voirie et le Maire de la Commune. -

J'agis Prévention : « J'achète D'occasion
GENLIS SUD (HUCHEY) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 jeu. 14 jeu. 11 jeu. 11 jeu. 8 jeu. 6 jeu. 3 jeu. 1 jeu. 12 jeu. 9 jeu. 7 jeu. 4 jeu. 2 jeu. 13 jeu. 28 jeu. 25 jeu. 25 jeu. 22 jeu. 20 jeu. 17 jeu. 15 jeu. 26 jeu. 23 jeu. 21 jeu. 18 jeu. 16 jeu. 27 jeu. 29 jeu. 30 IZIER, COUTERNON Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 ven. 15 ven. 12 ven. 12 ven. 9 ven. 7 ven. 4 ven. 2 ven. 13 ven. 10 ven. 8 ven. 5 ven. 3 ven. 14 ven. 29 ven. 26 ven. 26 ven. 23 ven. 21 ven. 18 ven. 16 ven. 27 ven. 24 ven. 22 ven. 19 ven. 17 ven. 28 ven. 30 ven. 31 COLLONGES‐LÈS‐PREMIÈRES, TART (TART‐L’ABBAYE et TART‐LE‐HAUT), TART‐LE‐BAS, ECHIGEY Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 lun. 4 lun. 1 lun. 1 lun. 12 lun. 10 lun. 7 lun. 5 lun. 2 lun. 13 lun. 11 lun. 8 lun. 6 lun. 3 lun. 18 lun. 15 lun. 15COLLECTE lun. 26 2021jeu. 27DES BACSlun. 21 JAUNESlun. 19 ETlun. BLEUS 16 DElun. 27TRI SÉLECTIFlun. 25 lun. 22 lun. 20 lun. 17 lun. 29 lun. 30 lun. 31 CESSEY-SUR-TILLE, ARC-SUR-TILLE CESSEY‐SUR‐TILLE, ARC‐SUR‐TILLE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 mar. -
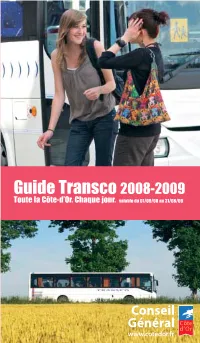
Guide Transco 2008-2009 2007 Sept
Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 L 1 M 1 S 1 L 1 J 1 D 1 D 1 M 1 V 1 L 1 M 1 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 S 3 M 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V 3 L 4 J 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S 4 M CALENDRIER SCOLAIRE 5 V 5 D 5 M 5 V 5 L 5 J 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D 5 M 6 S 6 L 6 J 6 S 6 M 6 V 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L 6 J 2008/2009 7 D 7 M 7 V 7 D 7 M 7 S 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 8 L 8 M 8 S 8 L 8 J 8 D 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M 8 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J 9 D ZONE B 10 M 10 V 10 L 10 M 10 S 10 M 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V 10 L 11 J 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 M 11 S 11 L 11 J 11 S 11 M 12 V 12 D 12 M 12 V 12 L 12 J 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D 12 M Jours fériés 13 S 13 L 13 J 13 S 13 M 13 V 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L 13 J 14 D 14 M 14 V 14 D 14 M 14 S 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V Vacances scolaires 15 L 15 M 15 S 15 L 15 J 15 D 15 D 15 M 15 V 15 L 15 M 15 S 16 M 16 J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J 16 D Période scolaire 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 M 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V 17 L 18 J 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S 18 M 19 V 19 D 19 M 19 V 19 L 19 J 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D 19 M 20 S 20 L 20 J 20 S 20 M 20 V 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L 20 J 21 D 21 M 21 V 21 D 21 M 21 S 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 22 L 22 M 22 S 22 L 22 J 22 D 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M 22 S 23 M 23 J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J 23 D 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 24 M 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 25 J 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S 25 M 26 V 26 D 26 M 26 V 26 L 26 J 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D 26 M 27 S 27 L 27 J 27 S 27 M 27 V 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L 27 J 28 D 28 M 28 V 28 D 28 M 28 S 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 29 L 29 M 29 S 29 L 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M 29 S 30 M 30 J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J 30 D 31 V 31 M 31 S 31 M 31 D 31 V 31 L buissonnière ! buissonnière l’école Faites Avec leTicket Côte-d'Or Ticket Côte-d’Or et par téléphone. -

Arrete Prefectoral
PRÉFET DE LA DEPARTEMENT Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bourgogne-Franche-Comté Unité Départementale de Côte-d'Or ARRETE PREFECTORAL autorisant la société L.MAGGIONI SA à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires et ses installations annexes sur le territoire des communes de TRECLUN et de CHAMPDOTRE. LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre National du Mérite VU - le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V, - le code minier, - la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R 511-9 du code de l’environnement, - le titre II du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive, - l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, - l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, - l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées, - l’arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives, - le schéma départemental des carrières de Côte d’Or approuvé le 5 décembre 2000 et mis à jour le 21 novembre 2005, - l’arrêté