Fantasque Time Line | 1940
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Men at Arms Books
Osprey Men-at-Arms PUBLISHING German Army Elite Units 1939-45 Gordon Williamson * Illustrated by Ramiro Bujeiro CONTENTS INTRODUCTION ‘GROSSDEUTSCHLAND’ ‘FELDHERRNHALLE* GORDON WILLIAMSON was INFANTERIE-REGIMENTER 119 & 9 ‘LIST’ born in 1951 and currently works for the Scottish Land Register. He spent seven years with the Military Police PANZERGRENADIER-DIVISION TA end has published a ‘BRANDENBURG* number of books and articles on the decorations of the Third Reich and their winners. KAVALLERI E-REGIMENT 5 He is author of a number of World War II titles for Osprey. ‘FELDMARSCHALL VON MACKENSEN’ 44. REICHSGRENADIER-DIVISION ‘HOCH UND DEUTSCHMEISTER’ 116. PANZER-DIVISION {‘Windhund’) 21. PANZER-DIVISION 24. PANZER-DIVISION (130.) PANZER-LEHR-DIVISION RAMIRO BUJEIRO has illustrated many Osprey titles including Warrior 23; US 3. GEBIRGS-DIVISION Afanne in Vietnam and Men- at-Arms 357: Allied Women's 5. GEBIRGS-DIVISION Service. He is an experienced commercial artist who lives and works in his native city THE TIGER TANK BATTALIONS of Buenos Aires, Argentina. His main interests are the political and military history THE PLATES of Europe in the first half of the 20th century. INDEX first published In Great Britain In 2002 by Osprey Publishing. Artist’s Note Qms Court. Chapel Way. BotJay, Oxford 0X2 9LB United Kingdom GERMAN ARMY ELITE UNITS Email] info® osprey publishing, com Readers may care to note that the original paintings from which the colour plates in this book were prepared are available for private © 2002 Osprey Publishing Ltd. sale. All reproduction copyright whatsoever is retained by the 1939-45 Publishers, All enquiries should be addressed to: All rights reserved- Apart From any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs end Ramiro Sujeiro, GC 28, 1602 Florida, Argentina Patents Act, 1983. -

Scientific Contributions of the First Female Chemists at the University of Vienna Mirrored in Publications in Chemical Monthly 1
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (2019) 150:961–974 https://doi.org/10.1007/s00706-019-02408-4 ORIGINAL PAPER Scientifc contributions of the frst female chemists at the University of Vienna mirrored in publications in Chemical Monthly 1902–1919 Rudolf Werner Soukup1 · Robert Rosner1 Received: 29 November 2018 / Accepted: 1 March 2019 / Published online: 29 April 2019 © The Author(s) 2019 Abstract In 1897, the frst female students were admitted at the Faculty of Philosophy at Vienna University. The frst dissertation in chemistry was approved in 1902. In the following years, only one or two women were annually enrolled, while the number of male students of chemistry continuously fuctuated around 22. Whereas four women completed their doctorate in the frst year of WWI, six followed in 1917, and ten more in 1919. Strikingly, in that year the number of female students even exceeded that of male colleagues. Margarethe Furcht, the daughter of a Jewish stockbroker, was the frst female chemist with a doctoral degree certifcate in the Austro-Hungarian Empire. Her paper “Über die Veresterung von Sulfosäuren…”, which she published in 1902 together with her academic supervisor Rudolf Wegscheider, was one of the frst scientifc chemical publications of women in Austria. However, of all female graduates, only a small number worked as chemists within the next two decades. After the occupation of Austria by German Troops in March 1938, seven of the Jewish women managed to emigrate, four were murdered in the Holocaust. Given the importance of this period within the landscape of European scientifc history, we here aim to provide the frst comprehensive overview of the history of women studying chemistry at the University of Vienna. -

World War II at Sea This Page Intentionally Left Blank World War II at Sea
World War II at Sea This page intentionally left blank World War II at Sea AN ENCYCLOPEDIA Volume I: A–K Dr. Spencer C. Tucker Editor Dr. Paul G. Pierpaoli Jr. Associate Editor Dr. Eric W. Osborne Assistant Editor Vincent P. O’Hara Assistant Editor Copyright 2012 by ABC-CLIO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, except for the inclusion of brief quotations in a review, without prior permission in writing from the publisher. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data World War II at sea : an encyclopedia / Spencer C. Tucker. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-59884-457-3 (hardcopy : alk. paper) — ISBN 978-1-59884-458-0 (ebook) 1. World War, 1939–1945—Naval operations— Encyclopedias. I. Tucker, Spencer, 1937– II. Title: World War Two at sea. D770.W66 2011 940.54'503—dc23 2011042142 ISBN: 978-1-59884-457-3 EISBN: 978-1-59884-458-0 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 This book is also available on the World Wide Web as an eBook. Visit www.abc-clio.com for details. ABC-CLIO, LLC 130 Cremona Drive, P.O. Box 1911 Santa Barbara, California 93116-1911 This book is printed on acid-free paper Manufactured in the United States of America To Malcolm “Kip” Muir Jr., scholar, gifted teacher, and friend. This page intentionally left blank Contents About the Editor ix Editorial Advisory Board xi List of Entries xiii Preface xxiii Overview xxv Entries A–Z 1 Chronology of Principal Events of World War II at Sea 823 Glossary of World War II Naval Terms 831 Bibliography 839 List of Editors and Contributors 865 Categorical Index 877 Index 889 vii This page intentionally left blank About the Editor Spencer C. -

Corazzata ROMA ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA
ROMA CAPITALE EUREKR PRESIDENZA Assemblea Capitolina COOP€RRTIVR SOCIRLE ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA Domenico Carro CORAZZATA ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA Ricerca storica e schede fuori testo a cura di Gennaro Barretta Cooperativa Eureka Roma, 2011 PREFAZIONE Inserito in un progetto culturale del Comune di la memoria delle grandi navi italiane e degli equipaggi che Roma questo libro vuole illustrare e commemorare uno morirono per la Patria. dei tanti esempi di eccellenza, abnegazione, eroismo legati La storia del ROMA è narrata in prima persona da un al nome della città di ROMA. personaggio immaginario, un giovane guardiamarina di La corazzata ROMA è stata una delle migliori — se prima nomina imbarcato sulla nave, che in maniera "apo- non la migliore - nave da battaglia schierata nel corso della crifa, ma veritiera" vive, giorno dopo giorno, una pagina secondi guerra mondiale. Non ha mai partecipato ad azio- drammatica della storia d'Italia. ni offensive e la storia le ha riservato un terribile destino. La scelta degli autori ha permesso di integrare le tante te- Questo libro, ben documentato ed avvincente come un stimonianze esistenti in una narrazione scorrevole, senza romanzo, si pone come obiettivo quello di mantenere viva mai derogare dalla puntigliosa esattezza storica. Il volume fa parte del progetto "Una città di eroiche memorie", realizzato con il contributo di Roma Capitale ed è distribuito gratuitamente Coordinamento editoriale Andrea Sciascia Progetto grafico e impaginazione Giovanni Morelli Testo Domenico -

La Notte Di Taranto
Capitolo diciottesimo La notte di Taranto L’11 novembre 1940 è un giovedì. A Taranto, una delle maggiori basi navali della flotta italiana, sembra tutto calmo: sul lungomare è sceso un tiepido crepuscolo e la consueta folla dei curiosi e dei marinai in libera uscita si è diradata e poi dispersa. Nel Mar Grande, protette dalle reti parasiluri e dai palloni di sbarramento, ci sono alla fonda sei corazzate (Littorio, Vittorio Veneto, Giulio Cesare, Cavour, Duilio, Doria), tre grandi incrociatori (Gorizia, Zara, Fiume) e otto cacciatorpediniere; nel Mar Piccolo, attorno ai sei incrociatori (Trieste, Bolzano, Abruzzi, Garibaldi, Pola, Trento) i caccia sono disposti «a pettine»; accanto a loro dondola all’ancora la nave appoggio Miraglia. Nel buio dell’oscuramento totale passano le ronde a controllare i moli, le calate, gli imbocchi della base. Tutto è tranquillo. Attorno ai due Mari ci sono ventuno batterie contraeree con 101 cannoni, 68 complessi di mitragliere (con un totale di 84 canne) e 110 mitragliere leggere. Quando un mese prima l’Italia ha attaccato la Grecia, Badoglio ha suggerito di spostare la flotta da Taranto perché c’è da aspettarsi un attacco inglese, ma i due Mari di Taranto, almeno dai rapporti ufficiali, risultano ben difesi: oltre alle batterie antiaeree ci sono ottantasette palloni aerostatici (una trentina dei quali lungo la diga della Tarantola); quasi tredici chilometri di reti parasiluri che, scendendo alla profondità di dieci metri, proteggono a distanza ravvicinata (2000 metri) le navi ormeggiate mentre tredici stazioni aerofoniche ascoltano in continuazione i suoni provenienti dal cielo e dal mare. Il comando della base, però, è in stato di preallarme. -

Battle of Cape Matapan HMS AJAX and the Battle of Cape Matapan
Battle of Cape Matapan HMS AJAX and the Battle of Cape Matapan: 28th – 29th March 1941 By Clive Sharplin (Associate Member) The sea fight of the Second World War known as the “Battle of Matapan” was actually the second of that name to occur in naval history. The first occurred on 19th July 1717 when a mixed force of fifty-seven ships and galleys, Spanish, Portuguese, Venetian and Papal were attacked off Cape Matapan by a Turkish squadron of about the same size. After a fierce fight with losses on both sides the Turks withdrew. The ship HMS Ajax was a Leander Class light cruiser, the seventh ship to bear the name, relatively young having been launched in 1934, first commissioned in 1935. Displacing 9,563tons fully laden, her main armament consisted of 8 x 6”guns mounted in pairs over four turrets with 8 x 21 “ torpedo tubes in two quadruple mountings, steam turbine driven, with a wartime crew of 680. After participating in the first major sea battle of the second World War, the Battle of the River Plate in December 1939 and defeating the German battleship Admiral Graf Spee she returned to Chatham Dockyard for a 7 month long repair and refit during which my Father, Bob, joined her on 10th February 1940 as a Petty Officer Mechanician, he was to be a crew member for more` than a year until September 1941 when he was drafted to the battleship Valiant, thus enduring one of the Royal Navy’s most hostile periods. Ajax emerged back into the fleet on September 30th 1940 being deployed to the 7th Cruiser Squadron in the Mediterranean. -

LXIX. Armeekorps Zbv (LXIX Army Corps) Hi
LXIX. Armeekorps z.b.V. (LXIX Army Corps) Hi- LXIX. Armeekorps z.b.V. (LXIX Array Corps for Special Em~ "Schach," "Schlusselblume," and "Rouen" (action against large p.1 - yment) was formed in Vienna, Wehrkreis XVII, on July 13, 1943, units of partisans and Communists in Croatia), including various e~ the LXIX. Reservekorps, and transferred to Zagreb, Croatia, on other antipartisan operations with the aid of Croatian units and A.1 just 11, 1943. The Corps was responsible for maintenance and the 1. Kosaken-Division. On January 9, 1944, the LXIX. Reserve- security of roads and railroad lines in Croatia and northern korps was redesignated Generalkommando LXIX. Armeekorps z.b.V. Serbia, training of Croatian troops, and antipartisan warfare. During March 1944 the Corps also participated in Operation D. ring September 1943, it participated in the disarming of "Lechfeld" (the occupation of Budapest and nearby airfields and Italian troops and in the occupation of the Adriatic coast. the disarming of Hungarian troops) and in Operation "Margarets" From October 1943 until August 1944, the Corps was engaged in (the occupation of Hungary). Operations "Herbst II," "Ferkel," "Wildsau," "Cannae," "Ungewitter," Item Dates Item No. Roll 1st Frame la, Kriegstagebuch 1. War journal concerning activation of the Corps in Vienna, transfer to Croatia, and antipartisan operations in the area north of the Sava River. Also, a register of officers. The Corps was subordinate to Pz.AOK 2 during this period under the command of Gen.d.Inf. Ernst Dehner from Jul 15, 1943 to Apr 1, 1944. Jul 13 - Dec 31, 1943 46521/1 1544 la, Anlage 3 z. -

Jahrbuch 2002
okumentationsarchiv de österr 1chisch Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes JAHRBUCH Redaktion: Christine Schindler INHALT FRITZ V ERZETNITSCH Festvortrag anlässlich der Jahresversammlung des DÖW, Wien, 13. März 2001 5 PETER STEINBACH/ JOHANNES TUCHEL Der Einzeltäter Georg Elser Interpretationen und Missdeutungen des Attentats auf Hitler vom 8. November 1939 9 SIEGWALD ÜANGLMAIR Feldwebel Anton Schmid 25 KARL ÜLAUBAUF Oberst i. G. Heinrich Kodre Ein Linzer Ritterkreuzträger im militärischen Widerstand ' 41 MICHAEL GEHLER © 2002 by Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), Wien Anpassung, Mittun, Resistenz und Widerstand Printed in Austria Charakteristika, Probleme und Ambivalenzen von Umschlaggestaltung: Atelier Fuhrherr, Wien Oppositionsverhalten am Beispiel des Layout: Christa Mehany-Mitterrutzner Karl Gruber 1934-1945 69 Hersteller: Plöchl-Druck Ges. m. b. H„ 4240 Freistadt DANIEL HEINZ ISBN 3-901142-48-7 Der Widerstand der Reformadventisten im „Dritten Reich" 88 FRITZ VERZETNITSCH FESTVORTRAG ANLÄSSLICH DER ANTOON HULLEN JAHRESVERSAMMLUNG DES Erinnerungen an Karl Hilferding, DÖW, Opfer von Nazi-Judenhass 99 WIEN, 13. MÄRZ 2001 PETER HILFERDING-MrLFORD Karl Hilferding und Sir Karl R. Popper Eine Anmerkung zum Gedenkartikel von „Die Verkennung und Missachtung der Menschenrechte hat zu Akten der Bar Frater Antoon Hullen 118 barei geführt, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben", heißt es in der Präambel zur 1948 erfolgten Allgemeinen Erklärung ebendieser Menschen rechte. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes beschäf• HARTMUT MEHRINGER / ALBERT A. FEIBER tigt sich genau mit diesen „Wunden im Gewissen der Menschheit". „Eine gelungene Ausstellung über eine schreckliche Zeit" Eine Beschäftigung auch im Sinne eines Arztes, der die Krankheit und ihre Die Dokumentation Obersalzberg bei Berchtesgaden 119 Ursachen erforscht, um der Gesellschaft zu ennöglichen, sie zu bekämpfen und Heilung und Gesundheit zu ermöglichen. -

Battle of Monte Cassino
Battle of Monte Cassino 17 January thru 18 May 1944 Monte Cassino Abbey in November 2004 The Battle of Monte Cassino (also known as the Battle for Rome and the Battle for Cassino) was a costly series of four assaults by the Allies against the Winter Line in Italy held by the Germans and Italians during the Italian Campaign of World War II. The intention was a breakthrough to Rome. At the beginning of 1944, the western half of the Winter Line was being anchored by Germans holding the Rapido, Liri, and Garigliano valleys and some of the surrounding peaks and ridges. Together, these features formed the Gustav Line. Monte Cassino, a historic hilltop abbey founded in AD 529 by Benedict of Nursia, dominated the nearby town of Cassino and the entrances to the Liri and Rapido valleys, but had been left unoccupied by the German defenders. The Germans had, however, manned some positions set into the steep slopes below the abbey's walls. 1 Fearing that the abbey did form part of the Germans' defensive line, primarily as a lookout post, the Allies sanctioned its bombing on 15 February and American bombers proceeded to drop 1,400 tons of bombs onto it. The destruction and rubble left by the bombing raid now provided better protection from aerial and artillery attacks, so, two days later, German paratroopers took up positions in the abbey's ruins. Between 17 January and 18 May, Monte Cassino and the assaulted four times by Allied troops, the last involving twenty divisions attacking along a twenty-mile Gustav defenses were front. -
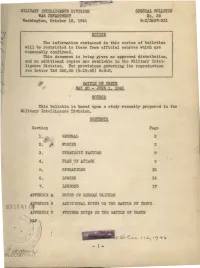
Oct 18 !41 Appendix C Further Notes on the Battle of Crete
MILITARY INTELLIG~~CE DIVISION SPECIAL BULLETIN W.AR DEPARTMENT No. 35 Washington. October 15, 1941 G-2/ 2657-231 NOTICE The information contained in this series of bulletins will be restricted to items from official sources which are . reasonably confirmed. This document is being given an approved distribution, and no additional copies are available in the Military Intel ligence Division. For provisions governing its reproduction see Letter TAG 350.05 (9-19-40) M-B-M. BATTLE OF CRETE MAY 20 - JUNE l, 1941 SOURCE This bulletin is based upon a stud~r recently prepe..red in the Military Intelligence Division. CONTENTS Section Page l. GENERAL 2 2. FORCES 3 r 3. STRAT~GIC FACTORS 8 4. PLAN OF ATTACK 9 5. OPERATIONS 10 6. LOSSES 16 ?. LESSONS 17 APPENDIX A NOTES ON GEPJ·IAN GLIDERS PENDIX B ADDITIONAL NOTES ON THE BATTLE OF CRETE OCT 18 !41 APPENDIX C FURTHER NOTES ON THE BATTLE OF CRETE - l- ·' . -- .- - _.,._·~-·: ·~;;; .... ·~ . ~;.; ,.,-, ··;. ::--·_ ~ . -- 13A'l'TLE OF CBET.E* MAY 20 - JUliE 1, 1941 1. G.ElmBAL The German conquest of Crete, effected bet\v-een Hay 20 and June 1, 1941, constitutes the first occasion in history \V"hen an ex peditionary force tr~~sported by air and e~ air fleet conquered a distant island protected by an overwhelmingly superior navy and a land garrison \IThich was considerably stronger, numerically, th~~ the invading force. Such an outcome would have been ~thinkable two years ago. Today, however, the result of that campaign a\ITakens among soldiers merely a mild feeling of surprise; the importance of air po\'ler has been brought home to the world since 1939. -

Documento Della Convenzione Del 1900 in Qualità Di Preparatore Della Documentazione Preliminare
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Storia SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN : Scienze Storiche INDIRIZZO: Storia CICLO XXI TITOLO TESI “Quando il timore vince l’abilità” Formazione e professionalità dell’ufficialità della Marina Militare italiana nell’età giolittiana. 1895-1910 Direttore della Scuola : Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina La Rocca Supervisore : Ch.mo Prof. Pietro Del Negro Supervisore : Ch.mo Prof. Enrico Francia Dottorando : Antonio Burrasca 1 Presentazione Nei quindici anni compresi tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX la formazione degli ufficiali della Regia Marina Italiana venne profondamente modificata, in seguito all’azione legislativa del ministro Costantino Enrico Morin. A seguito dell’applicazione dei Regi Decreti 28 gennaio 1894 n. 33, “Nuovo Ordinamento della Regia Accademia Navale” e Regio Decreto 17 dicembre 1896 n. 589, “Riordinamento dell’accademia navale”, conosciuti come “Riforma Morin”, il mondo culturale italiano di carattere navale conobbe una spaccatura e vide aprirsi un lungo scontro tra i fautori e gli oppositori della riforma. Il nocciolo della questione venne individuato nell’eccessivo spostamento dell’asse formativo verso le discipline scientifiche in generale e matematiche in particolare. Gli oppositori obiettarono che la formazione matematica non fosse utile alla creazione di comandanti ed ammiragli e lamentarono un profondo e pericoloso disinteresse verso il lato umano ed emotivo della professione di ufficiale. Nel contempo in campo civile le correzioni del sistema educativo spinsero gli istituti tecnici – tra cui figuravano anche i nautici – verso una sempre maggiore presenza delle materie umanistiche, come la storia e la letteratura, nei curricola così da rafforzare la preparazione “umana” e “liberale” degli studenti. -

8 Settembre Il Dramma Della Flotta Italiana
1 Otto Settembre Il dramma della Flotta Italiana di Francesco Mattesini 2 LA FLOTTA E L’ARMISTIZIO L’ARMISTIZIO DELL’8 SETTEMBRE 1943 E IL DRAMMA DELLE FORZE NAVALI DA BATTAGLIA di Francesco Mattesini Le ragioni dell’armistizio unilaterale Il 19 luglio 1943, il Capo del Governo italiano Benito Mussolini e il Cancelliere della Germani Adolf Hitler s’incontrarono a Villa Pagani Gaggia presso San Fermo di Belluno (l’episodio più no- to come incontro Feltre), per discutere quale aiuto poteva dare la Germania all’Italia per evitarne il tracollo, dopo che nella notte del 10 luglio gli anglo-americani, con sbarco dal mare, avevano inizia- to l’invasione della Sicilia. Deluso dal comportamento tenuto in Sicilia dalle divisioni del Regio Esercito, che dopo due soli giorni di combattimento, abbandonando le più munite posizioni come quella della piazzaforte di Augusta, si erano letteralmente liquefatte d’avanti al nemico, lasciando soltanto le tre divisioni tedesche presenti nell’isola (Göring, 15 a e 29 a) rinforzate da due reggimenti della 1 a Divisione paracadutisti, a combattere contro gli Alleati, il Führer, con un lunghissimo soli- loquio nei confronti di un mortificato Duce, accusò gli italiani di essere combattenti mediocri e non più affidabili. Sostenne apertamente che erano buoni soltanto a sollecitare aiuti senza dare nulla in cambio neppure per proteggere adeguatamente i propri aeroporti sui quali i dislocati gruppi di volo germanici, soprattutto quelli avanzati della caccia, riportavano, per gli attacchi aerei del nemico, perdite gravissime. Durante la discussioni fu portata ai due statisti, e al loro seguito di rappresentanti politici e milita- ri, la notizia del bombardamento di Roma, realizzato ad ondata successive, sugli obiettivi ferroviari e aeroportuali della Capitale, da 662 bombardieri statunitensi B.