Stratégie Biodiversité
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Conflict About Scattered Islands in the Indian Ocean
Sentinel Vision EVT-699 Conflict about Scattered Islands in the Indian Ocean 23 July 2020 Sentinel-1 CSAR SM acquired on 08 December 2014 at 15:41:52 UTC Sentinel-1 CSAR IW acquired on 24 September 2018 at 14:54:32 UTC ... Sentinel-2 MSI acquired on 30 March 2020 at 06:43:41 UTC Author(s): Sentinel Vision team, VisioTerra, France - [email protected] 2D Layerstack Keyword(s): Archipelago, national park, biodiversity, atoll, coral reef, lagoon, mangrove, fishing, oil, France, Madagascar Fig. 1 - S1 - Location of the Scattered Islands in the Indian Ocean. 2D view Fig. 2 - S2 (14.02.2020) - Europa Island, it encompasses a lagoon and a mangrove forest. 2D view / The Scattered Islands in the Indian Ocean consist of four small coral islands, an atoll, and a reef in the Indian Ocean. It is administrated by France though sovereignty over some or all of the Islands is contested by Madagascar, Mauritius, and the Comoros. None of the islands has ever had a permanent population. Fig. 3 - S1 (08.12.2014) - Europa Island at high tide. It is the southernmost island of the group. 2D view In Madagascar, the question of national sovereignty remains sensitive in public opinion. Especially when it comes to litigation with the former colonial power. The claim of the Scattered Islands is therefore the subject of a broad consensus. French side, even if the subject is more unknown, however, there has always been reluctance to give up any territory whatsoever. In a similar case, the co-management agreement of Tromelin Island with Mauritius, dated 2010, is still blocked in the National Assembly. -

Journal Officiel
République Française Liberté - Égalité - Fraternité Terres australes et antarctiques françaises ISSN 1292-802X JOURNAL OFFICIEL DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES N° 72 (4ème trimestre 2016) 31 décembre 2016 - Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises n° 72 SOMMAIRE ACTES EMANANT D’AUTORITÉS AUTRES QUE LE PRÉFET, ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR 7 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) ..................................................................... 7 Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils (1).............. 7 Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (1) .................................................................................................................................................................................... 9 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1) .......................................................................................................................... 9 Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) .................................................................................................................................................................... 9 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, -

Spectrhabent-OI Acquisition Et Analyse De La Librairie Spectrale Sous-Marine
Ifremer – Délégation de La Réunion Agence des aires marines protégées Rapport Ifremer n°: RST-Délégation Réunion/2010-02-1 Pascal MOUQUET – AAMP Jean-Pascal QUOD – ARVAM Spectrhabent-OI Acquisition et analyse de la librairie spectrale sous-marine 1/2. Rapport de synthèse AVRIL 2010 Partenaire scientifique et technique : Partenaires financiers : Spectrhabent-OI Cartographie des habitats benthiques littoraux et subtidaux des îles françaises de l’océan Indien à partir de données hyperspectrales Phases 1 & 2 Acquisition et analyse de la librairie spectrale sous-marine 1/2. Rapport de synthèse 5/98 FICHE DOCUMENTAIRE Numéro d'identification du rapport : date de publication : Avril 2010 Diffusion : libre : restreinte : interdite : nombre de pages : 98 bibliographie : Oui Validé par : R. LEGOFF (IFREMER) – P. WATREMEZ (AAMP) illustration(s) : Oui Adresses électroniques : [email protected] langue du rapport : Français [email protected] Titre et sous-titre du Rapport : Spectrhabent-OI : Cartographie des habitats benthiques littoraux et subtidaux des îles françaises de l’océan Indien à partir de données hyperspectrales Phases 1 & 2 : Acquisition et analyse de la librairie spectrale sous-marine 1/2. Rapport de synthèse Rapport intermédiaire Rapport définitif Auteurs principaux : Organisme / Direction / Service, laboratoire Pascal MOUQUET Agence des aires marines protégées Jean-Pascal QUOD ARVAM Autres collaborateurs : Organisme / Direction / Service, laboratoire Hugues Evano Ifremer Stéphanie Bollard Université de la Réunion Cadre de la recherche : Convention cadre entre la Préfecture de la Réunion, les TAAF, l’Agence des AMP et l’Ifremer. Référence : 09-1217795 Résumé : Dans le cadre des projets Litto3D et Spectrhabent-OI, des campagnes de vérités-terrains ont été menées sur les récifs coralliens du sud-ouest de l’océan Indien (Glorieuses, Geyser, Mayotte et la Réunion). -

Des Îles Eparses Tromelin, Glorieuses, Juan De Nova, Europa Et Bassas Da India
Livret de découverte des îles Eparses Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India LOGOTYPES TAAF 1.a - Le logo avec la Marianne 1.b - Le logo TAAF 1.c - Edition spéciale pour les personnels TAAF 1.d - Version une couleur Terres australes et Terres australes et Terres australes et TAAF TAAF TAAF antarctiques françaises antarctiques françaises antarctiques françaises 1.b’ - Le logo TAAF avec cartouche noir 1.c’ - Edition spéciale avec cartouche noir Terres australes et Terres australes et TAAF TAAF antarctiques françaises antarctiques françaises 2.a - L’archipel de Crozet 2.a’ - L’archipel de Crozet 2.b - L’archipel de Crozet 2.b’ - L’archipel de Crozet Terres australes et antarctiques françaises Terres australes et antarctiques françaises Terres australes et antarctiques françaises Terres australes et antarctiques françaises 46°25’ S TAAF 46°25’ S TAAF 46°25’ S TAAF 46°25’ S TAAF District de Crozet District de Crozet District de Crozet District de Crozet 3.a - L’archipel des Kerguelen 3.a’ - L’archipel des Kerguelen 3.b - L’archipel des Kerguelen 3.b’ - L’archipel des Kerguelen Terres australes et antarctiques françaises Terres australes et antarctiques françaises Terres australes et antarctiques françaises Terres australes et antarctiques françaises 49°21’ S 49°21’ S 49°21’ S 49°21’ S TAAF TAAF TAAF TAAF District de Kerguelen District de Kerguelen District de Kerguelen District de Kerguelen 4.a - Les îles Saint-Paul et Amsterdam 4.a’ - Les îles Saint-Paul et Amsterdam 4.b - Les îles Saint-Paul et Amsterdam 4.b’ - Les -

European Union Overseas Coastal and Marine Protected Areas
European Union Overseas Coastal and Marine Protected Areas Overview of coastal and marine conservation efforts in the European Union’s Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Carole Martinez, Sylvie Rockel, Caroline Vieux IUCN GLOBAL MARINE AND POLAR PROGRAMME European Union Overseas Coastal and Marine Protected Areas Overview of coastal and marine conservation efforts in the European Union’s Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Carole Martinez, Sylvie Rockel, Caroline Vieux This publication has been made possible by funding from the French Development Agency (AFD). The designation of geographical entities in this document and the presentation of the materials do neither imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN. Published by: IUCN, Gland, Switzerland Copyright: © 2017 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. Citation: Martinez, C., Rockel, S., Vieux, C. European Overseas coastal and -

Public Comment Draft Report CFTO Indian Ocean Purse Seine Skipjack
Marine Stewardship Council (MSC) Public Comment Draft Report CFTO Indian Ocean Purse Seine Skipjack fishery On behalf of Compagnie Française du Thon Océanique S.A.S. (CFTO) Prepared by Control Union UK Ltd. November 2020 Authors: Chrissie Sieben Jo Gascoigne Sophie des Clers Control Union UK Ltd. 56 High Street, Lymington, Hampshire, SO41 9AH United Kingdom Tel: 01590 613007 Fax: 01590 671573 Email: [email protected] Website: https://uk.controlunion.com Contents CONTENTS ...................................................................................................................................... 1 QA AND QC PCDR STAGE ................................................................................................................. 3 GLOSSARY ...................................................................................................................................... 4 1 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................ 6 2 REPORT DETAILS ....................................................................................................................... 9 2.1 Authorship and Peer Reviewers .............................................................................................. 9 2.2 Version details ....................................................................................................................... 10 3 UNIT(S) OF ASSESSMENT AND CERTIFICATION ................................................................................ -
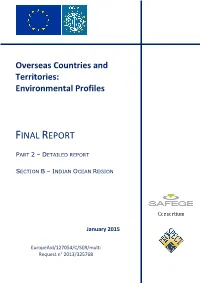
Final Report
Overseas Countries and Territories: Environmental Profiles FINAL REPORT PART 2 – DETAILED REPORT SECTION B – INDIAN OCEAN REGION Consortium January 2015 EuropeAid/127054/C/SER/multi Request n° 2013/325768 DISCLAIMER This report has been prepared with the financial assistance of the European Commission. The views expressed herein are those of the consultants and therefore in no way reflect the official opinion of the European Commission Authors of the Report Contractor’s name and address Jose de Bettencourt Safège Consortium Helena Imminga-Berends Gulledelle 92 B-1200 Brussels - BELGIUM Project manager Camille Vassart on behalf of Prospect C&S Please consider the environment before printing this document Page 2 / 56 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ACAP Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels ACOR Association Française pour les Récifs Coralliens ACP Africa Caribbean and the Pacific ACS Association of Caribbean States AEPS Arctic Environmental Protection Strategy AFD French Development Agency AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme AMOC Atlantic Meridional Overturning Circulation AOSIS Alliance of Small Island States APEC Asia–Pacific Economic Cooperation BAS British Antarctic Survey BEST EU Voluntary Scheme for Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières CAFF Conservation of Arctic Flora and Fauna CANARI Caribbean Natural Resources Institute CARICOM Caribbean Community CARIFORUM Caribbean Forum CBD Convention on Biological Diversity CCAMLR -

International Schedule of Territories
IFTA® INTERNATIONAL SCHEDULE OF TERRITORIES IMPORTANT: The following IFTA® Schedule of Territories outlines individual countries, groups of countries and territories, and groups of territories as they are often used for purposes of granting distribution rights for films or television programs. When referenced in the Deal Terms of the IFTA® International Multiple Rights Agreement, the Schedule is incorporated by reference. However, the Schedule may not be appropriate for all media due to the method of distribution. The Schedule is organized in the following three ways: 1) Alphabetical Listing, 2) Geographical Listing, and 3) Language Group Listing. Users should note that the terms in bold refer to and are comprised of all the countries, territories and/or islands listed in the succeeding definition. Users should also note that some of the definitions overlap. The information appearing in this Schedule is based on the most current information available as of the publication date of this Version 2018. IFTA does not assume legal responsibility for the accuracy or completeness of the information in this Schedule. This is not intended to and cannot replace the need to consult legal counsel. These definitions are subject to change as developments in national boundaries occur. IFTA reserves the right in its sole discretion to change the following definitions at any time as conditions may require. ALPHABETICAL LISTING Africa – Algeria; Angola; Benin (Dahomey); Botswana; Burkina Faso (Upper Volta); Burundi; Cameroon; Cape Verde Islands; Central -

National Action Plan for Marine Turtles in French Southwest Indian Ocean Territories 2015-2020 Mayotte, Reunion, Scattered Islands
Mayotte, Reunion, Scattered Islands Scattered Reunion, Mayotte, Ministry ofEcology, SustainableDevelopment andEnergy National ActionPlan National Ocean Territories Territories Ocean in French Southwest Indian Indian Southwest in French Information Brochure Information for Marine Turtles Marine Turtles for Green turtle. © J.-S. Philippe 2015-2020 * Resources, Territories and Habitats Energy and Climate * Sustainable Development Risk Prevention Infrastructures, Transport and Sea Acting Now for the Future National Action Plan for the Conservation of Marine Turtles on French Southwest Indian Ocean Territories 2015-2020 - Information Brochure Contents 1. THE NATIONAL ACTION PLAN (NAP) ...........................................3 2. SOUTHWEST INDIAN OCEAN TERRITORIES . 5 3. THE 5 SPECIES OF MARINE TURTLES............................................7 4. OPERATIONAL STRATEGIES AND GUIDELINES ....................................13 5. THE 4 ACTION PLANS . 15 6. IMPLEMENTING AND FINANCING THE NAP . 23 Green turtle. © J. Bourgea/Ifremer Ifremer Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy I. THE NATIONAL ACTION PLAN (NAP) I.1 WHAT IS AN NAP? The aim of a National Action Plan (NAP) is to preserve endangered species and foster collective interest in stopping the loss of biodiversity. It is set up for one or several animal or plant species and determines the actions to be implemented in order to restore or maintain those species in a favourable preservation condition. Sponsored and managed by the Ministry of Environment, Sustainable Development and Energy, it is designed and implemented in consultation with all relevant stakeholders: Government services, local authorities, scientists, socio- professional actors, park managers, associations, users, and so on. An NAP is a non-binding guideline document implemented for a period of 5 years, at the end of which it is evaluated and, as the case may be, renewed. -
Coast Guards of the World
COAST GUARDS OF THE WORLD AND EMERGING MARITIME THREATS Dr Prabhakaran Paleri OCEAN POLICY RESEARCH FOUNDATION i COAST GUARDS OF THE WORLD AND EMERGING MARITIME THREATS COAST GUARDS OF THE WORLD AND EMERGING MARITIME THREATS Dr Prabhakaran Paleri OCEAN POLICY RESEARCH FOUNDATION (Ship and Ocean Foundation) ii ᶏᵗ╷⎇ⓥ ․ภ Map on the Cover Page: World Coast Guards. The map is not to scale and as per exact locations. The map is subject to change. For general reference only. Disclaimer: The views expressed in this publication are exclusively that of the author and do not represent the policies and opinions of any government or organisation. iii COAST GUARDS OF THE WORLD AND EMERGING MARITIME THREATS This publication is dedicated to the valiant men and women of the coast guards of the world who work in the service of humanity. iv ᶏᵗ╷⎇ⓥ ․ภ Key Words Chapter 1 Geostrategic entity, ocean, ocean based land view, military approach, geoproperty rights, capability limitations, maritime, global common, transnational ocean crimes, ocean divisions, landlocked, islands, unlawful activities, coastal, global warming, disputes, fractal, United Nations, collective security, geopolitical gravity, incidents at sea, supranational, protectorates, maritime threats, vantage points, ocean property, legal continental shelf, exclusive economic zone, territorial waters, win-win game strategy, transnational crimes, coastal population, geometrics, sea line of communication, ocean dependency. Chapter 2 Coast guards, maritime force, combat navy, intentional law, warfighting, -

The World Factbook
The World Factbook Antarctica :: French Southern and Antarctic Lands (overseas territory of France) Introduction :: French Southern and Antarctic Lands Background: In February 2007, the Iles Eparses became an integral part of the French Southern and Antarctic Lands (TAAF). The Southern Lands are now divided into five administrative districts, two of which are archipelagos, Iles Crozet and Iles Kerguelen; the third is a district composed of two volcanic islands, Ile Saint-Paul and Ile Amsterdam; the fourth, Iles Eparses, consists of five scattered tropical islands around Madagascar. They contain no permanent inhabitants and are visited only by researchers studying the native fauna, scientists at the various scientific stations, fishermen, and military personnel. The fifth district is the Antarctic portion, which consists of "Adelie Land," a thin slice of the Antarctic continent discovered and claimed by the French in 1840. Ile Amsterdam: Discovered but not named in 1522 by the Spanish, the island subsequently received the appellation of Nieuw Amsterdam from a Dutchman; it was claimed by France in 1843. A short-lived attempt at cattle farming began in 1871. A French meteorological station established on the island in 1949 is still in use. Ile Saint Paul: Claimed by France since 1893, the island was a fishing industry center from 1843 to 1914. In 1928, a spiny lobster cannery was established, but when the company went bankrupt in 1931, seven workers were abandoned. Only two survived until 1934 when rescue finally arrived. Iles Crozet: A large archipelago formed from the Crozet Plateau, Iles Crozet is divided into two main groups: L'Occidental (the West), which includes Ile aux Cochons, Ilots des Apotres, Ile des Pingouins, and the reefs Brisants de l'Heroine; and L'Oriental (the East), which includes Ile d'Est and Ile de la Possession (the largest island of the Crozets). -

The Incidence of Marine Toxins and the Associated Seafood Poisoning Episodes in the African Countries of the Indian Ocean and the Red Sea
toxins Review The Incidence of Marine Toxins and the Associated Seafood Poisoning Episodes in the African Countries of the Indian Ocean and the Red Sea Isidro José Tamele 1,2,3 , Marisa Silva 1,4 and Vitor Vasconcelos 1,4,* 1 CIIMAR/CIMAR—Interdisciplinary Center of Marine and Environmental Research, University of Porto, Terminal de Cruzeiros do Porto, Avenida General Norton de Matos, 4450-238 Matosinhos, Portugal; [email protected] (I.J.T.); [email protected] (M.S.) 2 Institute of Biomedical Science Abel Salazar, University of Porto, R. Jorge de Viterbo Ferreira 228, 4050-313 Porto, Portugal 3 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Eduardo Mondlane University, Av. Julius Nyerere, n 3453, Campus Principal, Maputo 257, Mozambique 4 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Porto, Rua do Campo Alegre, 4619-007 Porto, Portugal * Correspondence: [email protected]; Tel.: +35-122-340-1817; Fax: +35-122-339-0608 Received: 27 November 2018; Accepted: 10 January 2019; Published: 21 January 2019 Abstract: The occurrence of Harmful Algal Blooms (HABs) and bacteria can be one of the great threats to public health due to their ability to produce marine toxins (MTs). The most reported MTs include paralytic shellfish toxins (PSTs), amnesic shellfish toxins (ASTs), diarrheic shellfish toxins (DSTs), cyclic imines (CIs), ciguatoxins (CTXs), azaspiracids (AZTs), palytoxin (PlTXs), tetrodotoxins (TTXs) and their analogs, some of them leading to fatal outcomes. MTs have been reported in several marine organisms causing human poisoning incidents since these organisms constitute the food basis of coastal human populations. In African countries of the Indian Ocean and the Red Sea, to date, only South Africa has a specific monitoring program for MTs and some other countries count only with respect to centers of seafood poisoning control.