Analyseprospective
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
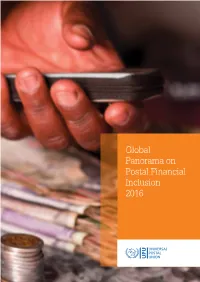
Global Panorama on Postal Financial Inclusion 2016
Global Panorama on Postal Financial Inclusion 2016 Published by the Universal Postal Union (UPU) Berne, Switzerland Printed in Switzerland by the printing services of the International Bureau of the UPU Copyright © 2016 Universal Postal Union All rights reserved Except as otherwise indicated, the copyright in this publication is owned by the Universal Postal Union. Reproduction is authorized for non-commercial purposes, subject to proper acknowledgement of the source. This authorization does not extend to any material identified in this publication as being the copyright of a third party. Authorization to reproduce such third party materials must be obtained from the copyright holders concerned. AUTHORS: Nils Clotteau Bsrat Measho TITLE: Global Panorama on Postal Financial Inclusion 2016 ISBN: 978-92-95025-87-5 DESIGN: UPU graphic arts Unit CONTACT: Nils Clotteau, UPU EMAIL: [email protected] TELEPHONE: +41 31 350 35 66 The boundaries used on the maps in this publication do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations or the UPU Global Panorama on Postal Financial Inclusion 2016 Nils Clotteau Bsrat Measho AKNOWLEDGEMENTS This report was written by Mr Nils Clotteau and Ms Bsrat Measho, from the Financial Inclusion team within the Development Cooperation Directorate of the Universal Postal Union. We would like to thank Ms Nadine Chehade and Ms Alice Negre, from the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), and Ms Mehrsa Baradaran, Associate Professor of Law at University of Georgia School of Law, for their time and expertise during the external peer review process. We are also very grateful to Mr José Ansón, UPU Economist, for his comments during the preparation of the questionnaire and the internal peer review as well as the UPU colleagues involved in the preparation of this book, particularly Ms Sonja Denovski and Mr Rémy Pedretti for the final layout. -

The African Postal Financial Services Initiative a Success Story on Remittances at the Post Office in Africa
The African Postal Financial Services Initiative A success story on remittances at the post office in Africa Implemented by: In partnership with: UNIVERSAL POSTAL UPU UNION The opinions expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily represent those of the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and its partners, or the governments they represent. IFAD and its partners do not guarantee the accuracy of the data included in this report. The boundaries, colours, denominations and other information shown on any map in this publication do not imply any judgement on the part of IFAD and its partners concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. The designations “developed” and “developing” countries are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgement about the stage reached by a particular country or area in the development process. © by the International Fund of Agricultural Development (IFAD) March 2018 Table of contents Abbreviations ............................................................................................... 2 Acknowledgements ....................................................................................... 3 Foreword .................................................................................................... 4 1 Introduction ............................................................................................ 7 2 Results achieved: Highlights .................................................................... -

Cash Country Service Listing April 2014
® WorldLink Payment Services Cash Country Service Listing April 2014 WorldLink® Cash payments is currently offered through Western Union and is thus required to follow the requirements and regulations of within the destination country of your beneficiary. Failure to meet those requirements will result in the payment being rejected. The information provided in the WorldLink Cash Country Service Listing includes updates sent to Western Union prior to:April 2014. The material contained in this Cash Country Service Listing is for informational purposes only, and is provided solely as a courtesy by WorldLink. Although WorldLink believes this information to be reliable, WorldLink makes no representation or warranty with respect to its accuracy or completeness. The information in this Cash Country Service Listing does not constitute a recommendation to take or refrain from taking any action, and WorldLink is not providing any tax, legal or other advice. Citigroup and its affiliates accept no liability whatsoever for any use of this material or any action taken based on or arising from anything contained herein. The information in this Cash Country Service Listing is subject to change at any time according to changes in local law. WorldLink is not obligated to inform you of changes to local law. Citibank Europe plc (“Citibank Europe”) may, at its discretion, reasonably modify or amend this Cash Country Service Listing from time to time, which modification or amendment will become binding when your organization receives a copy of it. These materials are confidential and proprietary to Citigroup or its affiliates and no part of these materials should be reproduced, published in any form by any means, electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the materials be disclosed to third parties without our express written authorization. -
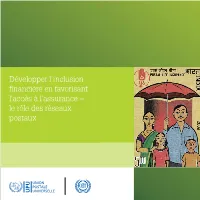
Développer L'inclusion Financière En Favorisant L'accès À L'assurance
Développer l'inclusion financière en favorisant l'accès à l'assurance – le rôle des réseaux postaux Publié par l’Union postale universelle (UPU) Berne (Suisse) et l'Organisation internationale du travail (OIT) Genève (Suisse) Imprimé en Suisse par le Bureau international de l’Union postale universelle Copyright © 2016 Union postale universelle Tous droits réservés Sauf mention contraire, l’Union postale universelle détient les droits de propriété intellectuelle de la présente publication. La reproduction est autorisée à des fins non commerciales, sous réserve d’indication des sources en bonne et due forme. Cette autorisation ne couvre pas les éléments de cette publication identifiés comme étant la propriété intellectuelle d’un tiers. Pour reproduire ces derniers, il est nécessaire d’obtenir l’au- torisation des détenteurs des droits de propriété intellec- tuelle concernés. AUTEUR: Guilherme Suedekum TITRE: Développer l'inclusion financière en favorisant l'accès à l'assurance – le rôle des réseaux postaux ISBN: 978-92-95025-84-4 DESIGN: UPU Graphic Unit CONTACT: Nils Clotteau, UPU, [email protected] Craig Churchill, ILO, [email protected] PHOTO DE COUVERTURE: © 2009 Indian Post La présente étude est le fruit des efforts conjoints déployés par l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Union postale universelle (UPU). Elle a été élaborée par Guilherme Suedekum, consultant indépendant spécialisé dans l'inclusion financière, qui a pu compter sur le soutien et les conseils de Craig Churchill, responsable d'équipe au programme Impact -

World Bank Document
69463 Public Disclosure Authorized The Role of Postal Networks in Expanding Access to Financial Services Worldwide Landscape of Postal Financial Services Africa Region Public Disclosure Authorized The World Bank Group Global Information and Communication Technology Postbank Advisory, ING Bank Postal Policy Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Author’s Note This section discusses the landscape of postal networks in the African region1 and their current role of postal networks in providing access to financial services. The landscape is intended to serve as a basis to assess the potential role to expand access to financial services. For some aspects and some countries data did not seem to be available or was available only to a limited extent. In particular, this was the case for data on the role of the postal networks in cashless payment systems, the significance of the postal financial services compared to monetary aggregates, and the details of the financial services rendered through the post offices. For several countries—Sudan, Central African Republic, Mali, and Sierra Leone—data on the services and their organizations was not yet available. On the other hand, in the course of the desk research in 2004, other countries that were not included in the list of 24 countries were found to have postal networks with an active role in financial services, e.g., Angola, Burundi, Mozambique, Ethiopia, and Madagascar. While this African regional landscape can stand alone, it is an integral part of this large study of the potential of postal networks to coordinate with financial service providers in 5 regions (Africa, Asia, Eastern Europe and Central Asia, Latin America and the Caribbean, and the Middle East and Northern Africa) and 7 countries (Egypt, Kazakhstan, Namibia, Romania, Sri Lanka, Uganda, and Vietnam). -
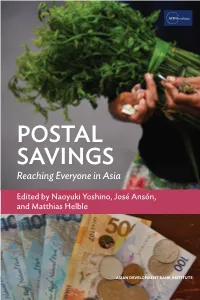
POSTAL SAVINGS Reaching Everyone in Asia
POSTAL SAVINGS Reaching Everyone in Asia Edited by Naoyuki Yoshino, José Ansón, and Matthias Helble ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE Postal Savings - Reaching Everyone in Asia Edited by Naoyuki Yoshino, José Ansón, and Matthias Helble ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE © 2018 Asian Development Bank Institute All rights reserved. First printed in 2018. ISBN: 978 4 89974 083 4 (Print) ISBN: 978 4 89974 084 1 (PDF) The views in this publication do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank Institute (ADBI), its Advisory Council, ADB’s Board or Governors, or the governments of ADB members. ADBI does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. ADBI uses proper ADB member names and abbreviations throughout and any variation or inaccuracy, including in citations and references, should be read as referring to the correct name. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “recognize,” “country,” or other geographical names in this publication, ADBI does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area. Users are restricted from reselling, redistributing, or creating derivative works without the express, written consent of ADBI. ADB recognizes “China” as the People’s Republic of China. Note: In this publication, “$” refers to US dollars. Asian Development Bank Institute Kasumigaseki Building 8F 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-6008, Japan www.adbi.org Contents List of illustrations v List of contributors ix List of abbreviations xi Introduction 1 Naoyuki Yoshino, José Ansón, and Matthias Helble PART I: Global Overview 1. -
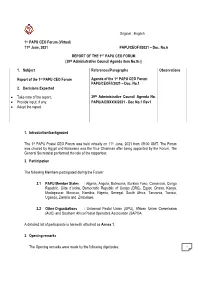
Forum (Virtual) 11Th June, 2021 PAPU/CEOF/I/2021 – Doc
Original : English 1st PAPU CEO Forum (Virtual) 11th June, 2021 PAPU/CEOF/I/2021 – Doc. No.6 REPORT OF THE 1ST PAPU CEO FORUM (39th Administrative Council Agenda item No.9c)) 1. Subject References/Paragraphs Observations Report of the 1st PAPU CEO Forum Agenda of the 1st PAPU CEO Forum PAPU/CEOF/I/2021 – Doc. No.1 2. Decisions Expected Take note of the report; 39th Administrative Council Agenda No. Provide input, if any; PAPU/AC/XXXIX/2021 - Doc No.1 Rev1 Adopt the report. 1. Introduction/background The 1st PAPU Postal CEO Forum was held virtually on 11th June, 2021 from 09:00 GMT. The Forum was chaired by Egypt and Botswana was the Vice Chairman after being appointed by the Forum. The General Secretariat performed the role of the rapporteur. 2. Participation The following Members participated during the Forum: 2.1 PAPU Member States : Algeria, Angola, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Congo Republic, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo (DRC), Egypt, Ghana, Kenya, Madagascar, Morocco, Namibia, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia and Zimbabwe. 2.2 Other Organizations : Universal Postal Union (UPU), African Union Commission (AUC) and Southern Africa Postal Operators Association (SAPOA. A detailed list of participants is herewith attached as Annex 1. 3. Opening remarks The Opening remarks were made by the following dignitaries: 1 3.1 The Pan African Postal Union (PAPU) Secretary General, Mr. Younouss Djibrine; 3.2 Director General of the Universal Postal Union (UPU), Mr. Bishar Hussein; 3.3 The African Union Representative (AUC), Mr. Christian Minoungou; 3.4 The Chairman of Egypt Post, Dr. -

Remittance Markets in Africa
Public Disclosure Authorized DIRECTIONS IN DEVELOPMENT Public Disclosure Authorized Finance Remittance Markets in Africa Sanket Mohapatra and Dilip Ratha Editors Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Remittance Markets in Africa Remittance Markets in Africa Sanket Mohapatra and Dilip Ratha Editors © 2011 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC 20433 Telephone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org All rights reserved 1 2 3 4 14 13 12 11 This volume is a product of the staff of the International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The bound- aries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgement on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank encourages dissemination of its work and will normally grant permission to reproduce portions of the work promptly. For permission to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with com- plete information to the Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com. -

Interim Report
Interim Report Submitted to African Union Commission Consultancy services on elaboration of a model and guidelines on Universal Postal Service (UPS) for Africa With support of European Union Procurement No.: 32/IED/11 Date of submission 25 February 2012 Table of Contents 1. ACRONYMS ................................................................................................................................... 4 2. Background to Interim Report ......................................................................................................... 6 2.1. Terms of Reference for the Study ............................................................................................ 6 2.1.1. African Union rationale for postal sector development ................................................... 6 2.1.2. Harmonization Study Postal Sector African Union .......................................................... 7 2.1.3. Harmonization Decision EX.CL/435(XIII) ...................................................................... 8 2.2. Structure of Interim report ...................................................................................................... 10 3. Diagnostics ..................................................................................................................................... 11 3.1. Definition, purpose and scope of UPS (Beijing 1999) ........................................................... 11 3.2. Analysis of the current situation in Africa ............................................................................ -

GFRID 2017 Agenda
PROGRAMME Global Forum on Celebrating the Remittances, Investment and Development 2017 United Nations Headquarters, New York 15 – 16 June 2017 In collaboration with www.ifad.org/gfrid2017 Table of contents Table of contents ........................................................... 3 Ten years of Global Forums .............................................. 4 The GFRID2017 ............................................................ 5 Overview ..................................................................... 6 International Day of Family Remittances – 16 June 2017 ............ 8 Private sector day – 15 June ........................................... 10 Family Remittances Day – 16 June .................................... 15 The RemTECH Awards .................................................. 20 The Remittance Marketplace ........................................... 21 List of speakers ........................................................... 22 List of participants ........................................................ 28 Useful information ........................................................ 32 The organizers ............................................................ 33 3 Ten years of Global Forums The Global Forum on Remittances, Investment 2017 2015 2013 and Development (GFRID) is part of a series Global Forum on Remittances, Global Forum on Remittances Global Forum on | | | of ground-breaking and inclusive international Investment and Development GLOBAL and Development EUROPE Remittances ASIA Global coverage will focus -

Association for Postal Commerce
Association for Postal Commerce "Representing those who use or support the use of mail for Business Communication and Commerce" "You will be able to enjoy only those postal rights you believe are worth defending." 1800 Diagonal Rd., Ste 320 * Alexandria, VA 22314-2862 * Ph.: +1 703 524 0096 * Fax: +1 703 997 2414 Postal News for June 2014 June 30, 2014 Roll Call: The White House is throwing in the towel on a comprehensive immigration bill this year, after Speaker John A. Boehner told President Barack Obama last week that he will not allow a vote in the House, according to a White House official. [EdNote: In this environment, can postal reform have even a hair's breadth of a chance?] Financial: A new draft law on postal service that has established the Georgian Post monopoly is not meeting either EU regulations or general conditions of a competitive business environment, said Malkhaz Papelashvili, General Manager at Georgian Express, official representative of DHL Georgia. The company sees huge opportunity in expanding its business in complex logistic and domestic transportation during 2014. Georgia’s express industry showed only 3-4% growth during 2013. The United States Postal Service is planning to resume the rationalization of our network of mail processing facilities which began in 2012. To provide adequate time for planning and preparation, the Postal Service is providing this six-month advance notice of consolidations, for up to 82 facilities, which will begin early January 2015 and be completed by the fall mailing season. The Postal Service will provide detailed information about its network rationalization planning in the coming weeks. -

African Conference on Remittances and Postal Networks
UNIVERSAL POSTAL UPU UNION OFFICIAL REPORT African Conference on Remittances and Postal Networks 4-5 March 2015 – Cape Town, South Africa Africa UNIVERSAL POSTAL UPU UNION African Conference on Remittances and Postal Networks 4-5 March 2015 – Cape Town, South Africa OFFICIAL REPORT For additional information please contact: Pedro De Vasconcelos, Manager Financing Facility for Remittances International Fund for Agricultural Development Via Paolo di Dono, 44 - 00142 Rome, Italy Tel: +39 06 5459 2012 - Fax: +39 06 5043 463 E-mail: [email protected] www.ifad.org/remittances www.RemittancesGateway.org This publication or any part thereof may be reproduced without prior permission from IFAD, provided that the publication or extract therefrom reproduced is attributed to IFAD and the title of this publication is stated in any publication and that a copy thereof is sent to IFAD. © 2015 by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) Printed September 2015 Table of contents Acronyms ................................................................................ 4 Introduction .............................................................................. 5 4 March Session I | Welcoming remarks .......................................................... 6 Session II | Sending money home to Africa via the post office .......................... 8 Remittance market in Africa: Opportunities and challenges ............................... 8 Linking remittances and financial inclusion: Postal solutions .............................10 Postal