Mémoire DESS Eiex
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tsiry Polytech1
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DEPARTEMENT MINES ~~~ °O° ~~~ Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des Mines EEVVAALLUUAATTIIOONN QQUUAALLIITTAATTIIVVEE,,, QQUUAANNTTIITTAATTIIVVEE EETT MMIISSEE EENN VVAALLEEUURR DDEESS RROOCCHHEESS OORRNNEEMMEENNTTAALLEESS DD’’AAMMBBOORROOMMAANNEENNOO TTOOLLIIAARRAA Présenté par : RANARISON Tsiriry Encadré par : - Mme. ARISOA Rivah Kathy - Mr. RAKOTOARIMANANA Pamphile Année Universitaire : 2008-2009 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DEPARTEMENT MINES ~~~ °O° ~~~ Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des Mines EEVVAALLUUAATTIIOONN QQUUAALLIITTAATTIIVVEE,,, QQUUAANNTTIITTAATTIIVVEE EETT MMIISSEE EENN VVAALLEEUURR DDEESS RROOCCHHEESS OORRNNEEMMEENNTTAALLEESS DD’’AAMMBBOORROOMMAANNEENNOO TTOOLLIIAARRAA Présenté par : RANARISON Tsiriry Soutenu publiquement le 12 Mai 2010 devant les membres de jury : Président : - Professeur RANDRIANJA Roger, Enseignant-chercheur au Département Mines à l’ESPA Rapporteurs : - Madame ARISOA Rivah Kathy, Chef de Département Mines à l’ESPA - Monsieur RAKOTOARIMANANA Pamphile Julien Andrianatoandro, Enseignant au Département Mines à l’ESPA Examinateurs : - Monsieur Yves-Marc CHARVET représentant de la société RED Graniti Madagascar - Madame SAHOLIARIMANANA Voahanginiaina Enseignant au Département Mines à l’ESPA Année Universitaire : 2008-2009 REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS Tout d’abord, je tiens à exprimer avec toute ma reconnaissance, l’expression -

Boissiera 71
Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -
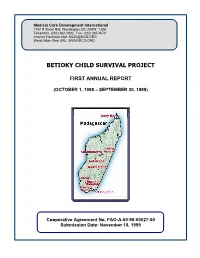
M C D I World Wide Web URL
Medical Care Development International 1742 R Street NW, Washington, DC 20009 * USA Telephone: (202) 462-1920; Fax: (202) 265-4078 Internet Electronic Mail: [email protected] M C D I World Wide Web URL: WWW.MCD.ORG BETIOKY CHILD SURVIVAL PROJECT FIRST ANNUAL REPORT (OCTOBER 1, 1998 – SEPTEMBER 30, 1999) Cooperative Agreement No. FAO-A-00-98-00027-00 Submission Date: November 18, 1999 Betioky Sud Child Survival Project Annual Report FY 1999 Translation of French original The staff of Medical Care Development International wish to thank BHR/PVC, CSTS Project, USAID Mission personnel as well as MOH staff for their counsel and support during Fiscal Year 1999. MEDICAL CARE DEVELOPMENT INTERNATIONAL 1 Betioky Sud Child Survival Project Annual Report FY 1999 Translation of French original TABLE OF CONTENTS 1- EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................... 4 2- BACKGROUND INFORMATION AND OVERVIEW OF PLANNED ACTIVITIES........................................................................................... 5 2.1 REORIENTATION OF MCDI’S STRATEGY ...............................................................5 2.2 PROJECT CONTEXT .........................................................................................6 2.3 PLANNED ACTIVITIES/REVISED PLAN ...................................................................7 3- RESULTS AND COMMENTS .................................................................. 13 3.1 BIRTH SPACING ...........................................................................................13 -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Liste Candidatures Maires Atsimo Andrefana
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 VAKISOA (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 INDEPENDANT SOLO (INDEPENDANT SOLO) BESADA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 AVI (ASA VITA NO IFAMPITSARANA) TOVONDRAOKE AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) REMAMORITSY AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) SORODO INDEPENDANT MOSA Jean Baptiste (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 FOTOTSANAKE MOSA Jean Baptiste) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 TOVONASY (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 ESOLONDRAY Raymond (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) LAHIVANOSON Jacques AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 MMM (MALAGASY MIARA MIAINGA) KOLOAVISOA René INDEPENDANT TSY MIHAMBO RIE (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EMANINTSINDRAZA TSY MIHAMBO RIE) INDEPENDANT ESOATEHY Victor (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EFANOMBO ESOATEHY Victor) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 ZOENDRAZA Fanilina (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) INDEPENDANT TAHIENANDRO (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 EMAZINY Mana TAHIENANDRO) AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) RASOBY AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) MAHATALAKE ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST -

Madagascar Great South Droug
MADAGASCAR: Great South Responses to drought (As of May 2016) WATER, SANITATION AND EDUCATION NUTRITION FOOD SECURITY AND LIVELIHOODS HEALTH HYGIENE NUM COMMUNE Snapshot of the emergency REGION ANDROY DISTRICT AMBOVOMBE 1 Ambanisarika X X X X X X X Severe food insecurity Malnutrition by commune 2 Ambazoa X X X X X X X X X X % by district 3 Ambohimalaza X X X X X Severe acute malnutrition> 2% 4 Ambonaivo X X X X X X X X X X X X 50 - 60% 5 Ambondro X X X X X X X X X X X X X Moderate acute malnutrition between 10% - 15% 6 Ambovombe X X X X X X X X X 7 Ampamata X X X X X X X X X X X X 25 - 49% 8 Analamary X X X X X Moderate acute malnutrition >15% 9 Andalatanosy X X X X X X X X X <25% 10 Anjeky Ankilikira X X X X X X X X 11 Antanimora Atsimo X X X X X X X X X X X District boundaries 12 Erada X X X X X X X X X X X X 13 Imanombo X X X X X X 14 Jafaro X X X X X X X X X X 15 Maroalomainty X X X X X X X X X 45% 16 Maroalopoty X X X X X 17 Marovato Befeno X X X X X 169 33 18 Sihanamaro X X X X X X X X X X 19 Tsimananada X X X X Betioky DISTRICT DE BEKILY X X X X X X X X 20 Ambahita 125 21 Ambatosola X X X X X X X X X X 22 Anivorano Mitsinjo X X X X X X 21 X X X X X X X X 23 Anja Nord 115 24 Ankaranabo Nord X X X X X X X 37 28 25 Antsakoamaro X X X X X X 35 26 Bekitro X X X X X X X X X 8 27 Belindo Mahasoa X X X X X X X X X 34 50% 28 Beraketa X X X X X X X 29 Besakoa X X X X X X 30 Beteza X X X X X 122 LEGEND 31 Bevitiky X X X X X X X X Bekily X X X X X X 32 Manakompy 27 25% X X X X 33 Maroviro 129 121 130 34 CU Bekily X X X X X 49% 7 EDUCATION -

La Biodiversité À Madagascar
SergeSerge TostainTostain La biodiversité à Madagascar Les ignames sauvages du Sud Université de Toliara (Madagascar) Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Serge Tostain est chargé de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) au centre IRD de Montpellier (France) dans l’Unité mixte de recherche Diversité et adaptation des plantes cultivées (DIA-PC). Courriel : [email protected] / [email protected] Sites web : http://www.mpl.ird.fr/ignames-madagascar Université de Toliara Faculté des Sciences Maninday BP 185, 601 Toliara Tél. : 00 261 (20) 94 417 73 Site web : http://www.univ-toliara.mg/ Centre IRD de Montpellier Représentation IRD à Madagascar 911 avenue Agropolis Ambatoroka - route d’Ambohipo BP 64501 - 34394 Montpellier cedex 5, France BP 434 , 101 Antananarivo, Madagascar Tél. : 00 33 (0)4 67 41 61 00 Site web : http://www.ird.mg/ Fax : 00 33 (0)4 67 41 63 30 Courriel : [email protected] Site web : www.mpl.ird.fr Tél. : 00 261 (20) 22 330 98 DIA-PC : site web : http://www.diapc.org/ 00 261 (0)32 02 617 53 Fax : 00 261 (20) 22 369 82 Remerciements : Nous remercions le Centre de Tsimbazaza pour avoir donné l’accès aux planches d’herbier des Dioscorea de Madagascar et l’arboretum d’Antsokay (Toliara) qui garde en dépôt les planches d’herbier réalisées au cours des différentes missions. Nous remercions également le projet international CWR coordonné par le FOFIFA pour son aide précieuse. Ce projet GEF du PNUD et de Bioversity international étudie à Madagascar les plantes apparentées aux plantes cultivées dont les ignames sauvages. -

World Bank Document
Ministry of Transportation and Meteorology World Bank Ministry of Public Works E524 Volume 1 Public Disclosure Authorized Rural Transportation Project Environmental and Social Public Disclosure Authorized Impact Assessment Public Disclosure Authorized December 2001 Prepared by Transport Sector Project (TSP) NGO Lalana Basler & Hofmann Based on the preliminary designs of the following consulting firms: Public Disclosure Authorized DINIKA (Tananarive) MICS - ECR - AEC - SECAM (Fianarantsoa) ESPACE - MAHERY (Taomasina) EC PLUS - JR SAINA (Mahajanga) 4 A OSIBP - SOMEAH (Toliary) F CO PY EIIRA - ANDRIAMBOLA - BIC (Antsiranana) Projet de Transport Rural, Madagascar - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux Table of Contents 1 Summary of Environmental and Social Assessment .................................................. 1 1.1 Proposed Project ........................................ 1 1.2 Transport Sector Environmental Assessment ...................................... 1 1.3 Environmental Assessment for APL 2 ...................................... 1 1.4 Policy and Legislative Framework ....................................... 1 1.5 Methodology ...................................... 2 1.6 Participatory approach ...................................... 2 1.7 Rural transport rehabilitation component ....................................... 3 1.8 Potential environmental impacts ...................................... 3 1.9 Resettlement and cultural heritage ....................................... 4 1.10 Rail and port infrastructure rehabilitation -

6305 Betioky
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 630501010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBATSY SALLE 1 dfggfdgffhCommune: AMBATRY MITSINJO dfggfdgffhDistrict: BETIOKY SUD dfggfdgffhRegion: ATSIMO-ANDREFANA dfggfdgffhProvince: TOLIARY Inscrits : 310 Votants: 135 Blancs et Nuls: 8 Soit: 5,93% Suffrages exprimes: 127 Soit: 94,07% Taux de participation: 43,55% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 107 84,25% 25 RAVALOMANANA Marc 20 15,75% Total voix: 127 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 630501020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBATSY SALLE 2 dfggfdgffhCommune: AMBATRY MITSINJO dfggfdgffhDistrict: BETIOKY SUD dfggfdgffhRegion: ATSIMO-ANDREFANA dfggfdgffhProvince: TOLIARY Inscrits : 146 Votants: 103 Blancs et Nuls: 15 Soit: 14,56% Suffrages exprimes: 88 Soit: 85,44% Taux de participation: 70,55% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 71 80,68% 25 RAVALOMANANA Marc 17 19,32% Total voix: 88 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I -

ELOY Nicolas FIRDOS Zoyah Naaz GOULAMHOUSSEN Nizan ANNEE
ELOY Nicolas FIRDOS Zoyah Naaz GOULAMHOUSSEN Nizan ANNEE-SCOLAIRE : 2011-2012 1 I. Les patrimoines naturels du sud-ouest de Madagascar : 1. Le parc naturel de Tsimanampetsotsa ................................................... 3 2. La plage d’Andavadoaka ......................................................................... 4 3. L’aire protégée de Zombitse .................................................................... 5 4. La plage de Lavanono .............................................................................. 6 5. La baie de saint-Augustin ....................................................................... 7 6. Les mangroves ......................................................................................... 8 II. IHSM (institut halieutique des sciences marines) .............. 9 III. Aepyornis Madagascar....................................................... 12 IV. Répertoire de quelques sites naturels du sud-ouest de Madagascar ............................................................................... 13 V. Répertoire de quelques villages du sud-ouest de Madagascar ............................................................................... 17 2 I. Les patrimoines naturels du sud- ouest de Madagascar : La réserve naturelle intégrale du lac Tsimanampetsotsa ou Tsimanampetsotsa a été créée en 1927 pendant la colonisation française sur 17 500 ha (limites sur la carte ci-dessous). Depuis, elle a été classée site RAMSAR (1998) puis transformée en parc national et agrandie. Ce parc national se trouve -

Toliara Regional Expanded Impact Project Atsimo Andrefana Region, Madagascar Annual Report Fiscal Year 2007 October 2006
TOLIARA REGIONAL EXPANDED IMPACT PROJECT ATSIMO ANDREFANA REGION, MADAGASCAR ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2007 OCTOBER 2006 – SEPTEMBER 2007 MADAGASCAR Cooperative Agreement#: GHS-A-00-06-00007 Submitted: November 29, 2007 Medical Care Development International 8401 Colesville Rd., Suite 425 Silver Spring, MD 20910, USA Telephone: (301) 562-1920 Fax: (301) 562-1921 Internet Electronic Mail: [email protected] World wide web Url: www.mcd.org 1 Contributing Writers and Editors Madagascar Field Office: Josea Ratsirarson, Chief of Party Madagascar (Principal Author) Washington, DC Home Office: Dr. Luis Benavente (Child Survival Coordinator) Dr. Yaikah Jeng-Joof, International Health Program Officer Marie-Louise Orsini, International Health Program Associate Sabriya Linton MPH, International Health Program Associate Patricia High MHS, International Health Program Associate 2 ACRONYMS ACT : Artemisinin-based Combination Therapy AME : Allaitement Maternel Exclusif/ Exclusive Maternal Breastfeeding ARI : Acute Respiratory Infections ASB : Agent de Santé de Base/ Basic Health Agent ASBC : Agent de Service à Base Communautaire/ Community Service Agent AVBC : Agent de Vente à Base Communautaire/ Community Sales Agent BASICS : Basic Support for Institutionalizing Child Survival CCC : Communication pour le Changement de Comportement/ Behavior Change Communication (BCC) CCD : Comité Communal de Développement/ Community Development Committee CCM : Community Case Management CDS : Comité de Développement Social/ Social Development Committee CPN : Consultation -
Réhabilitation Et Appui À La Gestion Des Réseaux D'eau D'atsimo
28.01.2019 Réhabilitation et appui à la gestion des réseaux d’eau d’Atsimo Andrefana, Madagascar (Mai 2018 – Mai 2021) Communes Ankazoabo, Manombo, Anakao, Soalary Mairie d’Ankazoabo Une coopération décentralisée du SEDIF Jean-Pierre Mahé, Camille Marconnet Experts-Solidaires Bat B1, Parc Scientifique Agropolis II, 2196 Bvd de la Lironde, 34980 Montferrier sur Lez, France. Tel : 06 04 18 26 94, [email protected] 1 RESUME Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération décentralisée entre le SEDIF et les communes de la province d’Atsimo Andrefana, dans le Sud Ouest de Madagascar. Cette coopération dure depuis 2008 avec le financement des réseaux de Saint Augustin, Manombo Sud, Ambahikily et Ankililoaka. En parallèle, a été mis en place un système de suivi technique et financier des réseaux d’eau sur la province d’Atsimo Andrefana, non seulement ceux financés par le SEDIF mais tous les réseaux d’AEP de la région. Les activités présentées ci après sont développés en collaboration entre les communes de la région Atsimo Andrefana et la DREAH de la région. Le présent projet soumis au financement consiste en 4 parties : Partie 1 : La réhabilitation du réseau d’Ankazoabo Partie 2 : La réhabilitation du réseau de Manombo Partie 3 : La Réhabilitation des réseaux de Soalary et Anakao Partie 4 : Un renforcement du suivi technique et financier et un soutien aux délégataires pour tous les réseaux d’eau et aux communes Maitre d’Ouvrage de ces réseaux dans la région Atsimo Andrefana. Communes Ce projet concerne essentiellement les