Plan De Preservation Et D'interpretation De La Rnc
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rooting of African Mahogany (Khaya Senegalensis A. Juss.) Leafy Stem Cuttings Under Different Concentrations of Indole-3-Butyric Acid
Vol. 11(23), pp. 2050-2057, 9 June, 2016 DOI: 10.5897/AJAR2016.10936 Article Number: F4B772558906 African Journal of Agricultural ISSN 1991-637X Copyright ©2016 Research Author(s) retain the copyright of this article http://www.academicjournals.org/AJAR Full Length Research Paper Rooting of African mahogany (Khaya senegalensis A. Juss.) leafy stem cuttings under different concentrations of indole-3-butyric acid Rodrigo Tenório de Vasconcelos, Sérgio Valiengo Valeri*, Antonio Baldo Geraldo Martins, Gabriel Biagiotti and Bruna Aparecida Pereira Perez Department of Vegetable Production, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Prof. Acess Road Paulo Donato Castellane, s/n, Jaboticabal,SP, Brazil. Received 24 February, 2016; Accepted 23 April, 2016 Vegetative propagation were studied in order to implement Khaya senegalensis A. Juss. wood production, conservation and genetic improvement programs. The objective of this research work was to establish the requirement as well the appropriated concentration of indolbutiric acid (IBA) in the K. senegalensis leafy stem cuttings to produce new plants. The basal end of the leafy stem cuttings were immersed, at first subjected to the so called slow method, in a 5% ethanol solution with 0, 100, 200 and 400 mg L-1 of IBA for 12 h and, as another procedure, the so called quick method, to a 50% ethanol solution with 0, 3000, 6000, 9000 and 12000 mg L-1 of IBA for 5. The leafy stem cuttings were transferred to plastic trays filled with 9.5 L of medium texture expanded vermiculite in which the cuttings had their basal end immersed to a depth of 3 cm in an 8.0 x 8.0 cm spacing. -
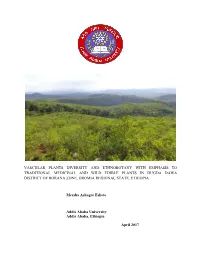
Vascular Plants Diversity and Ethnobotany With
VASCULAR PLANTS DIVERSITY AND ETHNOBOTANY WITH EMPHASIS TO TRADITIONAL MEDICINAL AND WILD EDIBLE PLANTS IN DUGDA DAWA DISTRICT OF BORANA ZONE, OROMIA REGIONAL STATE, ETHIOPIA Mersha Ashagre Eshete Addis Ababa University Addis Ababa, Ethiopia April 2017 VASCULAR PLANTS DIVERSITY AND ETHNOBOTANY WITH EMPHASIS TO TRADITIONAL MEDICINAL AND WILD EDIBLE PLANTS IN DUGDA DAWA DISTRICT OF BORANA ZONE, OROMIA REGIONAL STATE, ETHIOPIA Mersha Ashagre Eshete A Thesis Submitted to The Department of Plant Biology and Biodiversity Management Presented in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Plant Biology and Biodiversity Management) Addis Ababa University Addis Ababa, Ethiopia April 2017 i ADDIS ABABA UNIVERSITY GRADUATE PROGRAMMES This is to certify that the thesis prepared by Mersha Ashagre Eshete, entitled: “Vascular Plants Diversity and Ethnobotany with Emphasis to Traditional Medicinal and Wild Edible Plants in Dugda Dawa District of Borana Zone, Oromia Regional State, Ethiopia”, and submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Plant Biology and Biodiversity Management) complies with the regulations of the University and meets the accepted standards with respect to originality and quality. Signed by Research Supervisors: Name Signature Date 1. _____________________ _________________ _____________ 2.______________________ _________________ _____________ 3._____________________ _________________ ______________ 4.____________________ __________________ _______________ _____________________ -

Camel Forage Variety in the Karamoja Sub-Region, Uganda
Salamula et al. Pastoralism: Research, Policy and Practice (2017) 7:8 Pastoralism: Research, Policy DOI 10.1186/s13570-017-0080-6 and Practice RESEARCH Open Access Camel forage variety in the Karamoja sub- region, Uganda Jenipher Biira Salamula1*, Anthony Egeru1,2, Daniel Knox Aleper3 and Justine Jumba Namaalwa1 Abstract Camels have the potential to increase the resilience of pastoral communities to the impacts of climate variability and change. Despite this potential, there is limited documentation of the camel forage species, their availability and distribution. The study was conducted in Karamoja sub-region in Uganda and involved assessment of vegetation with intent to characterize the range of forage species available for camels in the region. The camel grazing area was stratified based on land cover types, namely woodland, bushland, grassland and farmland using the Amudat and Moroto district vegetation maps. Vegetation plots measuring 20 m × 20 m were mapped out among the land cover types where species identification was undertaken. In addition, a cross-sectional survey involving 52 camel herders was used to document the camel forage species preferences. Shannon and Simpson diversity indices as well as the Jaccard coefficient were used to measure the species richness, relative abundance, diversity and plant community similarities among the land cover types. Results showed high species richness and diversities in the bushland and woodland land cover types. Plant communities in the woodland and bushlands were found to be more similar. A wide range of plant species were reported to be preferred by camels in the study area, that is 63 in Amudat and 50 in Moroto districts. -

The Status of the Domestication of African Mahogany (Khaya Senegalensis) in Australia – As Documented in the CD ROM Proceedings of a 2006 Workshop
BOIS ET FORÊTS DES TROPIQUES, 2009, N° 300 (2) 101 KHAYA SENEGALENSIS EN AUSTRALIE / À TRAVERS LE MONDE The status of the domestication of African mahogany (Khaya senegalensis) in Australia – as documented in the CD ROM Proceedings of a 2006 Workshop Roger Underwood1 and D. Garth Nikles2 1Forestry Consultant 7 Palin Street Palmyra WA Australia 6157 2Associate, Horticulture and Forestry Science Queensland Primary Industries and Fisheries Department of Employment, Economic Development and Innovation 80 Meiers Rd, Indooroopilly Australia 4068 A Workshop was held in Townsville, Queensland, Australia in May 2006 entitled: “Where to from here with R&D to underpin plantations of high- value timber species in the ‘seasonally-dry’ tropics of northern Australia?” Its focus was on African Photograph 1. mahogany, Khaya senegalensis, and A chess table and chairs manufactured from timber obtained from some of the African followed a broader-ranging Workshop mahogany logs of Photogaph 2. This furniture setting won Queensland and national awards (Nikles et al., 2008). with a similar theme held in Mareeba, Photogaph R. Burgess via Paragon Furniture, Brisbane. Queensland in 2004. The 2006 Workshop comprised eight technical working sessions over two days preceded by a field trip to look at local trial plantings of African mahogany. The working sessions covered R&D in: tree Introduction improvement, nutrition, soils, silviculture, establishment, management, productivity, pests, African mahogany (Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.) was diseases, wood properties; introduced in Australia in the 1950s and was planted spas- and R&D needs and management. modically on a small scale until the mid-1970s. Farm forestry plantings and further trials recommenced in the late 1990s, but industrial plantations did not begin until the mid-2000s, based on managed investment schemes. -

Gabon): (Khaya Ivorensis A. Chev
Analysis and valorization of co-products from industrial transformation of Mahogany (Gabon) : (Khaya ivorensis A. Chev) Arsène Bikoro Bi Athomo To cite this version: Arsène Bikoro Bi Athomo. Analysis and valorization of co-products from industrial transformation of Mahogany (Gabon) : (Khaya ivorensis A. Chev). Analytical chemistry. Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2020. English. NNT : 2020PAUU3001. tel-02887477 HAL Id: tel-02887477 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02887477 Submitted on 2 Jul 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. THÈSE Présentée et soutenue publiquement pour l’obtention du grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR Spécialité : Chimie Analytique et environnement Par Arsène BIKORO BI ATHOMO Analyse et valorisation des coproduits de la transformation industrielle de l’Acajou du Gabon (Khaya ivorensis A. Chev) Sous la direction de Bertrand CHARRIER et Florent EYMA À Mont de Marsan, le 20 Février 2020 Rapporteurs : Pr. Philippe GERARDIN Professeur, Université de Lorraine Dr. Jalel LABIDI Professeur, Université du Pays Basque Examinateurs : Pr. Antonio PIZZI Professeur, Université de Lorraine Maitre assistant, Université des Sciences et Dr. Rodrigue SAFOU TCHIAMA Techniques de Masuku Maitre assistant, Université des Sciences et Dr. -

University of Copenhagen
Potential natural vegetation of Eastern Africa (Ethiopia, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia) Volume 4: Description and tree species composition for bushland and thicket potential natural vegetation types Kindt, R.; van Breugel, Paulo; Lillesø, Jens-Peter Barnekow; Bingham, M.; Demissew, Sebsebe; Dudley, C.; Friis, Ib; Gachathi, F.; Kalema, J.; Mbago, F.; Minani, V.; Moshi, H.N.; Mulumba, J.; Namaganda, M.; Ndangalasi, H.J.; Ruffo, C.K.; Jamnadass, R.; Graudal, Lars Ole Visti Publication date: 2011 Document version Early version, also known as pre-print Citation for published version (APA): Kindt, R., van Breugel, P., Lillesø, J-P. B., Bingham, M., Demissew, S., Dudley, C., ... Graudal, L. O. V. (2011). Potential natural vegetation of Eastern Africa (Ethiopia, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia): Volume 4: Description and tree species composition for bushland and thicket potential natural vegetation types . Forest & Landscape, University of Copenhagen. Forest & Landscape Working Papers, No. 64/2011 Download date: 07. Apr. 2020 FOREST & LANDSCAPE WORKING PAPERS 64 / 2011 Potential Natural Vegetation of Eastern Africa (Ethiopia, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia) VOLUME 4 Description and Tree Species Composition for Bushland and Thicket Potential Natural Vegetation Types R. Kindt, P. van Breugel, J.-P. B. Lillesø, M. Bingham, Sebsebe Demissew, C. Dudley, I. Friis, F. Gachathi, J. Kalema, F. Mbago, V. Minani, H.N. Moshi, J. Mulumba, M. Namaganda, H.J. Ndangalasi, C.K. Ruffo, R. Jamnadass and L. Graudal Title Potential natural vegetation of eastern Africa. Volume 4: Description and tree species composition for bushland and thicket potential natural vegetation types Authors Kindt, R., van Breugel, P., Lillesø, J.-P. -

Trees of Somalia
Trees of Somalia A Field Guide for Development Workers Desmond Mahony Oxfam Research Paper 3 Oxfam (UK and Ireland) © Oxfam (UK and Ireland) 1990 First published 1990 Revised 1991 Reprinted 1994 A catalogue record for this publication is available from the British Library ISBN 0 85598 109 1 Published by Oxfam (UK and Ireland), 274 Banbury Road, Oxford 0X2 7DZ, UK, in conjunction with the Henry Doubleday Research Association, Ryton-on-Dunsmore, Coventry CV8 3LG, UK Typeset by DTP Solutions, Bullingdon Road, Oxford Printed on environment-friendly paper by Oxfam Print Unit This book converted to digital file in 2010 Contents Acknowledgements IV Introduction Chapter 1. Names, Climatic zones and uses 3 Chapter 2. Tree descriptions 11 Chapter 3. References 189 Chapter 4. Appendix 191 Tables Table 1. Botanical tree names 3 Table 2. Somali tree names 4 Table 3. Somali tree names with regional v< 5 Table 4. Climatic zones 7 Table 5. Trees in order of drought tolerance 8 Table 6. Tree uses 9 Figures Figure 1. Climatic zones (based on altitude a Figure 2. Somali road and settlement map Vll IV Acknowledgements The author would like to acknowledge the assistance provided by the following organisations and individuals: Oxfam UK for funding me to compile these notes; the Henry Doubleday Research Association (UK) for funding the publication costs; the UK ODA forestry personnel for their encouragement and advice; Peter Kuchar and Richard Holt of NRA CRDP of Somalia for encouragement and essential information; Dr Wickens and staff of SEPESAL at Kew Gardens for information, advice and assistance; staff at Kew Herbarium, especially Gwilym Lewis, for practical advice on drawing, and Jan Gillet for his knowledge of Kew*s Botanical Collections and Somalian flora. -

Early Germination, Growth and Establishment of Khaya Senegalensis (DESR.) A
Journal of Energy and Natural Resources 2018; 7(3): 75-82 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/jenr doi: 10.11648/j.jenr.20180703.11 ISSN: 2330-7366 (Print); ISSN: 2330-7404 (Online) Early Germination, Growth and Establishment of Khaya senegalensis (DESR.) A. Juss in Middle-Belt Zone of Nigeria Zaccheus Tunde Egbewole 1, *, Odunayo James Rotowa 2, Emmanuel Dauda Kuje 1, Oluwasola Abiodun Ogundana 3, Hassan Haladu Mairafi 1, Ibrahim Yohanna 1 1Department of Forestry and Wildlife Management, Faculty of Agriculture, Nasarawa State University, Keffi, Nigeria 2Department of Forest Production and Products, Faculty of Renewable Natural Resources, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria 3Department of Forestry Technology, Federal College of Forestry, Ibadan, Nigeria Email address: *Corresponding author To cite this article: Zaccheus Tunde Egbewole, Odunayo James Rotowa, Emmanuel Dauda Kuje, Oluwasola Abiodun Ogundana, Hassan Haladu Mairafi, Ibrahim Yohanna. Early Germination, Growth and Establishment of Khaya senegalensis (DESR.) A. Juss in Middle-Belt Zone of Nigeria. Journal of Energy and Natural Resources . Vol. 7, No. 3, 2018, pp. 75-82. doi: 10.11648/j.jenr.20180703.11 Received : July 18, 2018; Accepted : August 29, 2018; Published : November 19, 2018 Abstract: A study was carried out to investigate the early growth and establishment of Khaya senegalensis in three different locations (Markurdi, Benue State, Lafia, Nasarawa state and Kwali, Abuja) within the middle belt zone of Nigeria in October 2014 with the aim to mass raising mahogany at economic scale. The study was carried out at the Department of Forestry, Wildlife and Ecotourism Nursery, Nasarawa State University Keffi, Shabu- Lafia Campus. The seeds were separately broadcasted on three different nursery beds and watered effectively. -

Gaoue2007bc.Pdf
BIOLOGICAL CONSERVATION 137 (2007) 424– 436 available at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/biocon Patterns of harvesting foliage and bark from the multipurpose tree Khaya senegalensis in Benin: Variation across ecological regions and its impacts on population structure Orou G. Gaoue*, Tamara Ticktin Department of Botany, University of Hawaii at Manoa, 3190 Maile Way, Honolulu, HI 96822, USA ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Non-timber forest products (NTFPs) represent important resources for millions of commu- Received 11 October 2006 nities worldwide. Concerns over NTFP overexploitation has led to a growing number of Received in revised form studies on the ecological impacts of harvest. Few studies however, have addressed species 27 February 2007 harvested for multiple parts or investigated how spatial variation affects harvest patterns Accepted 28 February 2007 and their impacts. We documented rates and patterns of pruning and debarking and their Available online 23 April 2007 impacts on density and population structure, for 12 populations of the multiuse tree, Khaya senegalensis (Meliaceae) in two ecological regions (Sudano-Guinean versus Sudanian) of Keywords: Benin, West Africa. Half of the populations had low or no harvest and half were highly har- Ecological variation vested. Patterns of pruning and debarking were size-specific, with harvesters tending to Non-timber forest products prefer larger trees. Foliage harvest pressures were very high across both regions, with Harvest >70% of trees harvested for 100% of their crowns. A significantly greater proportion of trees Size-class distribution were harvested for foliage in the wetter Sudano-Guinean region than in Sudanian region. West Africa The reverse was true for the proportion of foliage and bark-harvested per tree. -

Variabilité De L'environnement Et Du Climat Du Sahel À La Fin De La
Variabilité de l’environnement et du climat du Sahel à la fin de la Période Humide Holocène Kévin Lemonnier To cite this version: Kévin Lemonnier. Variabilité de l’environnement et du climat du Sahel à la fin de la Période Humide Holocène : analyse palynologique d’une carotte de sondage dans la région des Niayes du Sénégal. Sciences de l’environnement. 2020. hal-03086096 HAL Id: hal-03086096 https://hal-ephe.archives-ouvertes.fr/hal-03086096 Submitted on 22 Dec 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Sciences de la Vie et de la Terre MÉMOIRE Présenté par LEMONNIER Kévin pour l’obtention du Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études TITRE : Variabilité de l’environnement et du climat du Sahel à la fin de la Période Humide Holocène : analyse palynologique d’une carotte de sondage dans la région des Niayes du Sénégal. Soutenu le 11/12/2020 devant le jury suivant : SANCHEZ GONI Maria – Président LEZINE Anne Marie – Tuteur scientifique HELY Christelle -

The Occurrence of Hypsipyla Shoot Borer on Species of Exotic Meliaceae Planted in the Northern Territory
“where to from here with R&D to underpin plantations of high-value timber species in the ‘seasonally-dry’ topics of northern Australia?” Townsville 9th-11th May 2006. _____________________________________________________________________ DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRY, FISHERIES AND MINES Private Forestry North Queensland Association Inc & Queensland Department of Primary Industries and Fisheries Workshop Townsville 9-11 May 2006 “Where to from here with R&D to underpin plantations of high-value timber species in the ‘seasonally-dry’ tropics of northern Australia?” The occurrence of Hypsipyla shoot borer on species of exotic Meliaceae planted in the Northern Territory D.F. Reilly, R.M. Robertson & H. Brown Agroforestry and Entomology – DPIFM Berrimah, Northern Territory. SUMMARY African mahogany Khaya senegalensis is the favoured species for high-value plantations in the Top End of the Northern Territory because it has outperformed others in extensive trials over 40 years. Despite its vigour, Khaya is characterised by poor form that may be related to its genetics, nutrition or chronic low level pest attack. However few pests and diseases have been recorded locally for Khaya or the other species tested. The Meliaceous shoot borer or tip moth Hypsipyla robusta Pyralidae (Phycitinae) was first observed attacking Khaya in March 2004; this was was recorded on recently grafted plants at Berrimah. Subsequent attack has been observed in the field on both Khaya (Howard Springs) and Chukrasia (Berry Springs). Identification has been confirmed by ANIC and DPIFM. Source of attack may be from the indigenous mangrove species Xylocarpus granatum (Meliaceae) known to be susceptible to shoot borer. Keywords: African mahogany, shoot borer, Khaya, Chukrasia, Xylocarpus, Hypsipyla, Northern Territory _________________________________________________________________________ The occurrence of Hypsipyla shoot borer on species of exotic Meliaceae planted in the Northern Territory – D.F. -

Perennial Edible Fruits of the Tropics: an and Taxonomists Throughout the World Who Have Left Inventory
United States Department of Agriculture Perennial Edible Fruits Agricultural Research Service of the Tropics Agriculture Handbook No. 642 An Inventory t Abstract Acknowledgments Martin, Franklin W., Carl W. Cannpbell, Ruth M. Puberté. We owe first thanks to the botanists, horticulturists 1987 Perennial Edible Fruits of the Tropics: An and taxonomists throughout the world who have left Inventory. U.S. Department of Agriculture, written records of the fruits they encountered. Agriculture Handbook No. 642, 252 p., illus. Second, we thank Richard A. Hamilton, who read and The edible fruits of the Tropics are nnany in number, criticized the major part of the manuscript. His help varied in form, and irregular in distribution. They can be was invaluable. categorized as major or minor. Only about 300 Tropical fruits can be considered great. These are outstanding We also thank the many individuals who read, criti- in one or more of the following: Size, beauty, flavor, and cized, or contributed to various parts of the book. In nutritional value. In contrast are the more than 3,000 alphabetical order, they are Susan Abraham (Indian fruits that can be considered minor, limited severely by fruits), Herbert Barrett (citrus fruits), Jose Calzada one or more defects, such as very small size, poor taste Benza (fruits of Peru), Clarkson (South African fruits), or appeal, limited adaptability, or limited distribution. William 0. Cooper (citrus fruits), Derek Cormack The major fruits are not all well known. Some excellent (arrangements for review in Africa), Milton de Albu- fruits which rival the commercialized greatest are still querque (Brazilian fruits), Enriquito D.