CHERUBINI Par Marc VIGNAL
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

103 the Music Library of the Warsaw Theatre in The
A. ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA, MUSIC LIBRARY OF THE WARSAW..., ARMUD6 47/1-2 (2016) 103-116 103 THE MUSIC LIBRARY OF THE WARSAW THEATRE IN THE YEARS 1788 AND 1797: AN EXPRESSION OF THE MIGRATION OF EUROPEAN REPERTOIRE ALINA ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA UDK / UDC: 78.089.62”17”WARSAW University of Warsaw, Institute of Musicology, Izvorni znanstveni rad / Research Paper ul. Krakowskie Przedmieście 32, Primljeno / Received: 31. 8. 2016. 00-325 WARSAW, Poland Prihvaćeno / Accepted: 29. 9. 2016. Abstract In the Polish–Lithuanian Common- number of works is impressive: it included 245 wealth’s fi rst public theatre, operating in War- staged Italian, French, German, and Polish saw during the reign of Stanislaus Augustus operas and a further 61 operas listed in the cata- Poniatowski, numerous stage works were logues, as well as 106 documented ballets and perform ed in the years 1765-1767 and 1774-1794: another 47 catalogued ones. Amongst operas, Italian, French, German, and Polish operas as Italian ones were most popular with 102 docu- well ballets, while public concerts, organised at mented and 20 archived titles (totalling 122 the Warsaw theatre from the mid-1770s, featured works), followed by Polish (including transla- dozens of instrumental works including sym- tions of foreign works) with 58 and 1 titles phonies, overtures, concertos, variations as well respectively; French with 44 and 34 (totalling 78 as vocal-instrumental works - oratorios, opera compositions), and German operas with 41 and arias and ensembles, cantatas, and so forth. The 6 works, respectively. author analyses the manuscript catalogues of those scores (sheet music did not survive) held Keywords: music library, Warsaw, 18th at the Archiwum Główne Akt Dawnych in War- century, Stanislaus Augustus Poniatowski, saw (Pl-Wagad), in the Archive of Prince Joseph musical repertoire, musical theatre, music mi- Poniatowski and Maria Teresa Tyszkiewicz- gration Poniatowska. -
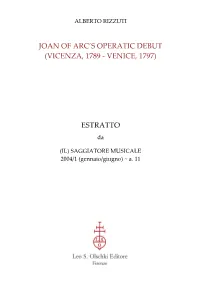
Joan of Arc's Operatic Debut
ALBERTO RIZZUTI JOAN OF ARC’S OPERATIC DEBUT (VICENZA, 1789 - VENICE, 1797) ESTRATTO da (IL) SAGGIATORE MUSICALE 2004/1 (gennaio/giugno) ~ a. 11 HMiiw Anno XI, 2004,2004, n.n. 11 >M?S; Leo S. Olschki Firenze Rivista semestrale di musicologia Anno XI, 2004, n. 1 Al lettore – Una stella e il suo futuro ........................... pag. 3 ARTICOLI REINHARD STROHM, ‘‘Les Sauvages’’, Music in Utopia, and the Decline of the Courtly Pastoral ....................................... » 21 ALBERTO RIZZUTI, Joan of Arc’s Operatic Debut (Vicenza, 1789 - Venice, 1797) » 51 MASSIMO DI SANDRO, Come Haydn prevede l’ascoltatore. Inganno e umorismo nei Quartetti op. 76 ..................................... » 77 DANIELA TORTORA, «Le voci del mondo»: genesi, scrittura e interpretazione dei ‘‘Canti del Capricorno’’ ................................... » 111 INTERVENTI DANIELE SABAINO, Musica, discipline musicali e formazione degli insegnanti. Note a margine d’una questione culturale ...................... » 143 I beni musicali: verso una definizione ............................ » 157 RECENSIONI FL.ALAZARD, Art vocal / Art de gouverner (S. Lorenzetti), p. 181 – G. ROSTIROLLA, Il ‘‘Mondo novo’’ musicale di Pier Leone Ghezzi (L. Lindgren), p. 189 – G. MORELLI, Very Well Saints; ST.WATSON, Prepare for Saints (G. Guanti), p. 204. SCHEDE CRITICHE A. Rusconi, R. Grisley, A. Chegai, Gr. Harwood, S. Ricciardi e D. Osmond-Smith sul Laudario di Cortona (p. 211), B. JANZ (p. 213), M. R. BUTLER (p. 215), C. SORBA (p. 216), J. ROSSELLI (p. 219) e F. ABBRI (p. 222). NOTIZIE SUI COLLABORATORI .................................. » 227 LIBRI RICEVUTI ............................................ » 229 La redazione di questo numero e` stata chiusa il 30 settembre 2004 Redazione Dipartimento di Musica e Spettacolo - Universita` di Bologna Via Barberia 4 - 40123 Bologna - Tel. 0512092000 - Fax 0512092001 E-mail: [email protected] Amministrazione CASA EDITRICE LEO S. -

Musik in Venedig Und Mailand Im Zeichen Napoleons
Musik in Venedig und Mailand im Zeichen Napoleons Kompositionen von und um Giovanni Simone Mayr Musik- und Kulturleben im Spannungsfeld politischer Macht Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia Legendi für das Fach Musikwissenschaft der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt vorgelegt von Iris Winkler aus Bochum Prof. Dr. Wolfgang Schönig Dekan der Philosophisch-Pädagogische Fakultät Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Mitglieder des Fachmentorats: Prof. Dr. Peter Brünger, Vors. Musikpädagogik und Musikdidaktik Philosophisch-Pädagogische Fakultät Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Prof. Dr. Heinz Hürten Geschichtswissenschaft Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Prof. Dr. Christoph Louven Musikwissenschaft Fachgebiet Musik und Musikwissenschaften Universität Osnabrück Prof. Dr. Reinhard Wiesend Musikwissenschaft Universität Mainz Prof. Dr. Michael Zimmermann Kunstgeschichte Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 2 In memoriam John Stewart Allitt 3 Inhalt Einleitung 6 I. Einführung in die Thematik 13 Napoleon-Rezeption und Napoleons Musikrezeption: Die Basis der Bewertung 13 Napoleon und die Kunst der Repräsentation 18 Napoleon und die Gewalt der Musik – Chantons du nouvel Alexandre 19 II. Facetten des kulturellen Lebens im „napoleonischen“Venedig 30 Politische Verhältnisse 38 Huldigungen, Huldigungsmusiken, Huldigungsprogramme 43 Huldigungskantaten in Venedig vor, nach und um Napoleon 48 -

Sarti's Fra I Due Litiganti and Opera in Vienna
John Platoff Trinity College March 18 2019 Sarti’s Fra i due litiganti and Opera in Vienna NOTE: This is work in progress. Please do not cite or quote it outside the seminar without my permission. In June 1784, Giuseppe Sarti passed through Vienna on his way from Milan to St. Petersburg, where he would succeed Giovanni Paisiello as director of the imperial chapel for Catherine the Great. On June 2 Sarti attended a performance at the Burgtheater of his opera buffa Fra i due litiganti il terzo gode, which was well on its way to becoming one of the most highly successful operas of the late eighteenth century. At the order of Emperor Joseph II, Sarti received the proceeds of the evening’s performance, which amounted to the substantial sum of 490 florins.1 Fra i due litiganti, premiered at La Scala in Milan on September 14, 1782, had been an immediate success, and within a short time began receiving productions in other cities. It was performed in Venice under the title I pretendenti delusi; and it was the third opera produced in Vienna by the newly re-established opera buffa company there in the spring of 1783. By the time of Sarti’s visit to the Hapsburg capital a year later, Fra i due litiganti was the most popular opera in Vienna. It had already been performed twenty-eight times in its first season alone, a total unmatched by any other operatic work of the decade. Thus the Emperor’s awarding 1 Link, National Court Theatre, 42 and n. -

"Ei, Dem Alten Herrn Zoll' Ich Achtung Gern'"
Christine Siegert, Kristin Herold Die Gattung als vernetzte Struktur Überlegungen zur Oper um 1800 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bildete sich ein Repertoire vor allem ita- lienischer Opern heraus, die in ganz Europa gespielt wurden. Dabei wurden sie bekanntermaßen an die jeweiligen Aufführungsbedingungen angepasst. Dass die so zustande gekommenen Bearbeitungen als konstitutiv für die Gattung Oper gelten können und dass Opern in jener Zeit daher als Werke angesehen werden müssen, die sich aus der Gesamtheit ihrer Quellen konstituieren, wurde an anderer Stelle zu zeigen versucht. Ein wesentliches Moment bei der Anpassung waren die sogenannten Einlagearien, die zusätzlich oder als Ersatz für andere Arien in die Opern eingefügt wurden. Es konnte sich sowohl um eigens für den neuen Kontext komponierte Arien handeln als auch um Arien, die ursprünglich aus anderen Opern stammten. Diese Arien wanderten also von einem Bühnenwerk in ein anderes – sei es auf der Basis des Notentextes, der verbreitet wurde, sei es auf der Basis des Materials, indem eine Arie einer Opernpartitur entnommen und in eine andere wieder eingefügt wurde. Gerade der letztere Vorgang zeigt, dass die Arien im Resultat beiden Opern zugehörten, der Oper, aus der sie ursprünglich stammten, und der Oper, der sie später angehören. Die Arien schaffen also eine Verbindung zwischen verschiedenen Werken der Gattung. Die Erforschung solcher Verbindungen hat sich bislang auf den Einzelfall beschränkt, etwa indem Einlagearien einer Oper als aus einer anderen Oper stammend identifiziert wurden. Indes wurde unseres Wissens noch nicht versucht, das Phänomen umfassend zu untersuchen. So haben auch wir bei unseren Recherchen zunächst begonnen, solche Einzelbeobachtungen zu sammeln. -

Late Eighteenth-Century Italian Opera: from Text to Performance
International Conference Giuseppe Sarti and Late Eighteenth-Century Italian Opera: From Text to Performance The Jerusalem Academy of Music and Dance Campus Givat-Ram, 91904, Jerusalem, Israel March 3-4 2015 1 Giuseppe Sarti (1729–1802), recognized in his lifetime as one of the central figures of his generation, nowadays belongs to the category of virtually neglected eighteenth-century Italian composers: he is scarcely remembered except for “providing” his famous younger contemporaries Salieri and Mozart with sparkling melodies, quoted in their operas. The international conference “Giuseppe Sarti and Late Eighteenth-Century Italian Opera: From Text to Performance” aims at partially filling this lacuna by exploring Sarti’s contribution in the framework of Italian opera. Sarti’s most successful opera seria, Giulio Sabino (Venice, 1781), will be performed by the Jerusalem Academy of Music and Dance Vocal Department on March 3 and March 4 at 19:00, in the New Dance Studio (Jerusalem Academy Building, 3d floor). The opera production is accompanied by an international conference that features 13 lectures by invited speakers who are the prominent scholars in the field of Italian opera and operas by Sarti, their dramaturgy and musical style, reception, editing and performance. The conference is organized in collaboration and with support of the Musicology Department, Hebrew University, Jerusalem Istituto Italiano di cultura, Tel-Aviv Einstein Stiftung/ Universität der Künste, Berlin Israel Musicological Society 2 Program march 3, Jerusalem academy, 231 Hall 14:00 - Convergence, light refreshments (patio) 14:30 - Opening and greetings (231 Hall): − Dr. Bella Brover-Lubovsky, conference organizer − Prof. Yinam Leef, President, Jerusalem Academy of Music and Dance − Dr. -

Sull'autorialità Di Un Melodramma Di Tardo
DI CHI È LA PENELOPE? SULL’AUTORIALITÀ DI UN MELODRAMMA DI TARDO SETTECENTO Eleonora Di Cintio [email protected] Pescara Who Composed the Penelope? On the Authoriality of a Late-18th-Century Melodrama Abstract The textual tradition of Penelope, tralto Giuseppina Grassini (1779- an opera seria written in 1795 1850) who sang the title role by Giuseppe Maria Diodati and several times between 1795 and Domenico Cimarosa, refl ects not 1803. Reconstructing some of the only the creative project of the changes effected by her, I seek to original authors, but also those explain why this singer should of others who modifi ed the score herself be considered one of the over time. Particulary notable in main authors of Penelope. this sense is the case of the con- 1. Premessa In tempi relativamente recenti, la letteratura musicologica dedicata al melodramma del Settecento ha insistito a più riprese sul fatto che tale oggetto artistico sia piuttosto distante, in termini ontologici, dal concetto di opera ideale di ascendenza ottocentesca. Si è cioè concordi nel ritenere priva di fondamento l’idea secondo cui l’opera musicale, a quell’altezza cronologica, corrisponda unicamente alla versione licenziata dal primo librettista e dal primo compositore, essendo essa invece coincidente con le proprie performances e dunque oggetto artistico non defi nito una volta per tutte.1 Dando seguito alle posizioni testé avanzate, chi scrive ha a sua volta dedicato alcune rifl essioni a tale specie di melodramma, proponendone 1 Sulle metamorfosi del concetto di opera, in particolare tra Sette e Ottocento cfr. soprat- tutto Goehr 1992. -

The Paradigm of Antonio Salieri's Prima La
Philomusica on-line 9/2 – Sezione I/245-259 Atti del VI Seminario Internazionale di Filologia Musicale. «La filologia musicale oggi: il retaggio storico e le nuove prospettive» Editing musical quotations: the paradigm of Antonio Salieri’s Prima la musica e poi le parole (1786) Thomas Betzwieser Universität Bayreuth Musikwissenschaft [email protected] § Il contributo affronta la questione § The paper is dealing with the issue delle citazioni musicali e del loro of musical quotations and their trattamento all’interno di un’edizione implementation into a critical critica. L’opera di Salieri Prima la edition. Salieri’s Prima la musica e musica e poi le parole (1786) è poi le parole (1786) can be regarded paradigmatica in questo senso, dato as a paradigm in this respect, since che questo “metamelodramma” è this metamelodramma consists of a costellato da un ampio numero di larger quotations, making up nearly a citazioni, che rappresentano circa un sixth of the whole opera. The issue is sesto dell’intera opera. L’argomento discussed in two directions: First, the viene qui discusso in due direzioni. In special technique of quotation is primo luogo viene indagato il peculiare illustrated in Salieri’s score, trattamento della citazione nella unfolding the quoted contexts of partitura di Salieri, identificando le various composers. Second, the varie citazioni provenienti da contesti question is considered from the autoriali differenti. In secondo luogo la practical side, i.e. in which way the questione è affrontata nel suo aspetto procedure of quotations could be pratico, cioè in quale modo il tratta- made transparent within the mento della citazione possa essere framework of a critical edition. -

Museo Internazionale E Biblioteca Della Musica Di Bologna Progetto Di
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna Progetto di digitalizzazione di libretti per musica italiani relativi a prime rappresentazioni degli anni 1770-1799 in collaborazione con il Dipartimento di Storie e metodi per la conservazione dei beni culturali dell'Università di Bologna, sede di Ravenna Ottobre 2008 Anno Titolo Luogo Segnatura 1770 Armida. Dramma per musica da rappresentarsi nel nuovo Pubblico Teatro di Bologna Lo.02813 Bologna nella primavera dell'anno 1770. - In Bologna : nella Stamperia del Sassi, [1770]. 1770 La Nitteti. Dramma per musica da rappresentarsi nel nuovo pubblico Teatro Bologna Lo.03181 di Bologna nella primavera dell'anno 1770. In Bologna, nella stamperia del Sassi, s.d. (1770). 1770 Le contadine astute. Farsetta in musica a quattro voci da rappresentarsi nel Roma Lo.00009 teatro di Tordinona nel carnevale dell’anno 1770... In Roma, per Ottavio Puccinelli, s.d. (1770). 1770 Il finto cavaliere. Farsetta in musica a quattro voci da rappresentarsi Roma Lo.00011 nell’antico teatro Pace l’anno 1777. In Roma, nella stamperia di Ottavio Puccinelli, 1770. 1770 L’astuta cameriera. Dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel teatro Torino Lo.00322 di S. A. Serenissima il signor Principe di Carignano l’autunno dell’anno 1770. In Torino, a spese d’Onorato Derossi, s.d. (1770). 1770 La schiava amorosa. Farsetta in musica a quattro voci da rappresentarsi nel Roma Lo.00633 Teatro Capranica nel carnevale dell’anno 1770. – In Roma : nella stamperia di Ottavio Puccinelli, [1770]. 1770 Le orfane svizzere. Dramma giocoso per musica, da rappresentarsi nel Teatro Venezia Lo.00668 Giustiniani di S. -

Paolo Fabbri: Rossini, Donizetti E La Malanotte
Paolo Fabbri: Rossini, Donizetti e la Malanotte. La carriera del primo Tancredi Schriftenreihe Analecta musicologica. Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 46 (2010) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative- Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Rossini, Donizetti elaMalanotte. La carrieradel primo Tancredi Paolo Fabbri Ciò che resta del patrimonio di cimeli, documenti edotazioni bibliografiche di un cantante del primo Ottocento èdisolito disperso in musei ebiblioteche.Inqualche caso,però–adesempio,quelli di Giuditta Pasta, Giovanni BattistaVelluti, Giovanni Battista Rubini –, esso ci ègiunto ancora più omeno sufficientemente compatto in quanto trasmesso per asse ereditario oraccolto da collezionisti. Ad essi può aggiun- gersi quello di un’importante interprete rossiniana quale Adelaide Malanotte,lecui carte confluirono per -

Il Teatro Di Antonio Simone Sografi Tra Cultura Dell'illuminismo E Suggestioni Della Rivoluzione
Eurostudium3w ottobre-dicembre 2014 Il teatro di Antonio Simone Sografi tra cultura dell’Illuminismo e suggestioni della Rivoluzione di Pietro Themelly La figura di Antonio Simone Sografi (1759-1818)1, uno degli autori teatrali più eclettici e di maggiore successo della Serenissima nell’ultimo decennio del Settecento sino ai primi anni dell’occupazione asburgica, non ha goduto fino ad oggi di una grande considerazione da parte degli studiosi della storia delle idee di quell’epoca così importante per l’intera vicenda europea. La sua produzione letteraria tra l’età dei Lumi e quella della Rivoluzione giunta fino a Venezia è stata considerata subordinata, anche dagli studiosi più recenti, a superficiali esigenze di gusto, se non opportunistiche, più che a consapevoli motivazioni 1 Su A.S. Sografi vedi: G. Vedova, Biografia degli scrittori padovani, Minerva, Padova, 1836, v. II, pp. 292-98; G. Bonfio, Cenni biografici di Antonio Sografi, Bianchi, Padova, 1854; L. Bigoni, Quattro commedie inedite di S.A. Sografi, Gallina, Padova, 1891; Id., Simone Antonio Sografi, Un commediografo padovano del secolo XVIII, in «Nuovo archivio veneto», 1894, VII, pp. 107-47; B. Brunelli, Un commediografo dimenticato: S.A. Sografi, in «Rivista Italiana del Dramma», 1937, I, pp. 171-88; C. Goldoni, Opere con appendice del teatro comico nel Settecento, a cura di F. Zampieri, Ricciardi, Milano-Napoli, 1954, pp. 1119 e ss.; N. Mangini, voce Sografi, in «Enciclopedia dello Spettacolo» Le Maschere, Roma, 1962, pp. 99 e ss.; C. De Michelis, Il teatro patriottico, Marsilio, Venezia, 1966, pp. 19-29; Id., Antonio Simone Sografi e la tradizione goldoniana in Letterati e lettori nel Settecento veneziano, Olschki, Firenze, 1979, pp. -

Antonio Salieri Lieder
ANTONIO SALIERI LIEDER Ilse Eerens Sopran Annelie Sophie Müller Mezzosopran Ulrich Eisenlohr Hammerflügel 02 Antonio Salieri (1750 – 1825) Lieder und Duette mit Klavier 03 1 Sonetto – Il Genio degli Stati Veneti [02:58] Antonio Salieri war längst auf dem Höhepunkt Einen durchweg unterhaltenden Charakter weisen incanto 11 . Einzelne Nummern der Sammlung seines europaweiten Ruhmes als Opernkomponist die 1803 beim Wiener Verleger Thadé Weigl veröf- rücken in Opernnähe, etwa die von einem Rezita- Divertimenti vocali [38:26] angekommen, als er begann, sich mit kleineren fentlichten Divertimenti vocali auf. Diese 28 kur- tiv eingeleitete, ausdrucksstarke Szene der kartha- 2 12 Deutsch V. Pastorella io giurerei [01:46] Formen der Vokalmusik zu beschäftigen. Dem Bio- zen Arien, Duette und Terzette mit schlichter Kla- gischen Königin Dido oder die Duette Spiegarti 3 X. Ch’io mai vi possa [02:05] graphen Ignaz von Mosel zufolge hatte er „bereits vierbegleitung basieren fast alle auf Texten des non poss’io 10 und Niso, che fa il tuo core? 16 , die 4 II. Già la notte [02:28] seit dem Jahre 1794 angefangen, jene, theils liebli- einstigen Wiener Hofpoeten Pietro Metastasio, man durchaus als Opern en miniature bezeichnen 5 VII. Bei labbri [02:59] chen, theils launigen kleineren, selbstständigen von dem Salieri als Jugendlicher persönlich in der könnte. 6 XXVI. Abbiam pennato, è ver [02:40] Gesangstücke zu componiren, welche als Duette, Deklamation italienischer Verse geschult worden 7 XXII. Caro, son tua così [02:41] Terzette, Canons u. dergl. mancher Gesellschaft war. Auch Salieris Schüler Ludwig van Beethoven Einer „echten“ Oper entstammt die Cavatine Pensi- 8 XIV.