Avant-Propos De L'édition Numérique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

National Action Plan for Human Rights in Lebanon
Copyright © 2013 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the United Nations Development Programme. The analyses and policy recommendations in this report do not necessarily reflect the views of the United Nations Development Programme-Technical Support to the Lebanese Parliament. حقوق الطبع © 2013 جميع حقوق �لطبع حمفوظة. وﻻ يجوز ��شتن�ش�خ ّ�أي جزء من هذ� �ملن�شور �أو تخزينه يف نظ�م �إ�شرتج�ع �أو نقله ب�أي �شكل �أو ب�أية و�شيلة، �إلكرتونية ك�نت �أو �آلية، �أو ب�لن�شخ �ل�شوئي �أو ب�لت�شجيل، �أو ب�أية و�شيلة �أخرى، بدون �حل�شول على �إذن م�شبق من برن�مج �ﻻأمم �ملتحدة �ﻻإمن�ئي. ّ�إن �لتحليﻻت و�لتو�شي�ت ب�ش�أن �ل�شي��ش�ت �لو�ردة يف هذ� �لتقرير، ﻻ ّتعب ب�ل�شرورة عن �آر�ء برن�مج �ﻻأمم �ملتحدة �ﻻإمن�ئي- م�شروع تقدمي �لدعم �لتقني ملجل�س �لنو�ب �للبن�ين. Contents Foreword 5 Executive Summary 6 Chapter (1): General Framework 20 I. Methodology and Executive Measures for Follow Up and Implementation 20 II. Issues and general executive measures 25 General Executive Measures 32 Chapter (2): Sectoral Themes 33 1. The independence of the judiciary 33 2. The principles of investigation and detention 39 3. Torture and inhuman treatment 42 4. Forced disappearance 47 5. Prisons and detention facilities 51 6. Death penalty 61 7. Freedom of expression, opinion and the media 65 8. -

Aging Politicians of Lebanon Aging Politicians of Lebanon
issue number 154 |May 2015 STATE EMPLOYMENT IN 2014: 69% MUSLIMS VS. 31% CHRISTIANS THE WOMEN OF LEBANON IN STATISTICS THE MONTHLY INTERVIEWS POET JOUMANA CHAHOUD NAJJAR www.monthlymagazine.com Published by Information International sal AGING POLITICIANS OF LEBANON FOUAD BOUTROS: 98 MICHEL EDDEH: 87 ABDUL LATIF ZEIN: 85 MICHEL EL-MURR: 84 Lebanon 5,000LL | Saudi Arabia 15SR | UAE 15DHR | Jordan 2JD| Syria 75SYP | Iraq 3,500IQD | Kuwait 1.5KD | Qatar 15QR | Bahrain 2BD | Oman 2OR | Yemen 15YRI | Egypt 10EP | Europe 5Euros May INDEX 2015 4 AGING POLITICIANS OF LEBANON 10 STATE EMPLOYMENT IN 2014: 69% MUSLIMS VS. 31% CHRISTIANS 12 45 VACANCIES ON BOARDS OF DIRECTORS 15 WHEN WILL MPS ATTEND SESSION ON ELECTIONS? 17 VICTIMS OF GUNFIRE ON OCCASIONS OF JOY OR SORROW 18 PORT OF BEIRUT: PUBLIC SECTOR RUN BY A PROVISIONAL COMMITTEE FOR 25 YEARS P: 30 P: 20 20 THE WOMEN OF LEBANON IN STATISTICS 24 THE NATIONAL ARCHIVES CENTER BUILDING 25 A STAR FROM MY COUNTRY AND WRITERS FROM MY COUNTRY 26 THE EXTENSION OF PARLIAMENT’S TERM SPREADS FROM LEBANON TO YEMEN 27 GEORGE FRAM (1934-2006) P: 18 29 ETHICS AND DEEDS: ANTOINE BOUTROS 30 INTERVIEW: POET JOUMANA CHAHOUD NAJJAR 32 ANERA 45 THIS MONTH IN HISTORY- LEBANON ISRAEL’S WARS ON LEBANON: OPERATION GRAPES 34 POPULAR CULTURE OF WRATH 35 DEBUNKING MYTH#92: WILL SWALLOWED GUM 46 THIS MONTH IN HISTORY- ARAB WORLD STAY IN YOUR SYSTEM FOR YEARS? EXECUTION OF ELI COHEN, THE MOST THREATENING DANGEROUS SPY PLANTED IN SYRIA BY ISRAEL 36 MUST-READ BOOKS: BEIRUT: IMAGES IN MY MEMORY 48 TERRORIST GROUPS PRETENDING TO PIERRE MAADANJIAN STAND FOR ISLAM (4) THE ARMED ISLAMIC GROUP IN ALGERIA 37 MUST-READ CHILDREN’S BOOK: ..WA YAJI’OU YAWMON AKHAR 49 REAL ESTATE PRICES - MARCH 2015 38 LEBANON FAMILIES: TABEEKH FAMILIES 50 DID YOU KNOW THAT?: TOP FIVE LOST TREASURES OF THE WORLD 39 DISCOVER LEBANON: HAZMIEH 50 RAFIC HARIRI INTERNATIONAL AIRPORT 40 DISCOVER THE WORLD: AUSTRIA TRAFFIC - MARCH 2015 41 MARCH 2015 HIGHLIGHTS 51 LEBANON’S STATS |EDITORIAL THE DAWN OF A NEW ERA IN SYRIA Excerpts from chapters 15 and 16 of Margaret Mc. -

Revisiting the Path of Lebanon Over the Past 100 Years
REVISITING THE PATH OF LEBANON OVER THE PAST 100 YEARS Analysis of Different Constitutional Aspects of the State REVISITING THE PATH OF LEBANON OVER THE PAST 100 YEARS This book is licensed under Creative Commons Attribution - Non Commercia - Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Please be notified that the book has been released under a Creative Commons license to allow optimal accessibility while preserving attribution to the contributors and the editor’s work, as long as it is not used for commercial purposes. We would like to provide equal opportunities for anyone who wants to disseminate, write and search on the topic. You can share and adapt the content by remixing, transforming, building and redistributing the material in any medium or format as long as you attribute it and properly credit the authors under the same license as the original. For more information, a copy of this license is available at URL: https://creativecommons.org/licenses/by- nc-sa/4.0/ REVISITING THE PATH OF For more information, a copy of this license is available at URL: https:// creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ LEBANON OVER THE PAST 100 YEARS Analysis of Different Constitutional Aspects of the State REVISITING THE PATH OF LEBANON OVER THE PAST 100 YEARS Notre Dame University-Louaize NDU Press© First published: 2020, Lebanon ISBN 978-614-475-009-4 Zouk, Kesrwan, P.O.Box 72 Cover design: Department of Creative Design www.ndu.edu.lb | [email protected] P.O. Box: 72, Zouk, Keserwan Phone: +961 9 208 994/6 REVISITING THE PATH OF LEBANON OVER THE PAST 100 YEARS – ANALYSIS OF DIFFERENT CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE STATE ©2020Notre Dame University - Louaize (NDU) and Rule of Law Programme Middle East and North Africa, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. -

Théorie Juridique Des Régimes Parlementaires Mixtes Constitution Libanaise Et Pacte National En Perspective Comparée
Théorie juridique des régimes parlementaires mixtes Constitution libanaise et Pacte national en perspective comparée Antoine Nasri Messarra Théorie juridique des régimes parlementaires mixtes Constitution libanaise et Pacte national en perspective comparée Beyrouth Librairie Orientale 2009 3 Table Introduction Le Liban : mode d’emploi, 1. Les six articles de la Constitution libanaise qui classifient le régime constitutionnel libanais, 2. La Constitution libanaise dans la foire des classifications, Art. 9 et 10 de la Constitution 3. Principe de personnalité et principe de territorialité en fédéralisme comparé. Expérience du Liban et perspective pour demain au Proche-Orient, 4. Le fédéralisme en perspective comparée. Expérience du Liban dans le contexte moyen-oriental, 5. Retheoriser le fédéralisme, 6. La gouvernance du pluralisme communautaire. Approche comparative. Art. 49 de la Constitution 7. Le chef de l’Etat, gardien du principe de légalité, Art. 65 de la Constitution 8. Majorité qualifiée et processus de la décision dans le régime constitutionnel libanais, 9. Le principe majoritaire et ses variantes, 10. L’accord de Doha du 21 mai 2008 : Arrangement politique conjoncturel en situation de nécessité et sans changement constitutionnel, Art. 95 de la Constitution 11. Partage du pouvoir : Dilemme et perspectives d’évolution. Concilier partage du pouvoir et séparation des pouvoirs, 12. Académisme et confessionnalisme, 13. Comment étudier le confessionnalisme ? Conclusion Qui sont les libanologues ? Introduction 5 Introduction 7 Le Liban: Mode d’emploi* Quand on participe à des débats sur le régime constitutionnel libanais, dans des rencontres spécialisées ou dans des réunions de salon, on est pris de vertige si on essaie de cibler le débat, de lui donner un niveau minimal de cohérence et d’opérationnalité. -

The Municipal Elections
Speaker Hussein al-Husseini Cost of renting airplanes for the presidency July 2010 | 96 The Monthly interviews Ambassador Tomasz Niegodzisz issue number www.iimonthly.com • Published by Information International sal Ministry of Interior: $554 M and 40,000 employees A search for the missing $11 billion MUNICIPALITIES OF FIVE REPUBLICS Lebanon 5,000LL | Saudi Arabia 15SR | UAE 15DHR | Jordan 2JD| Syria 75SYP | Iraq 3,500IQD | Kuwait 1.5KD | Qatar 15QR | Bahrain 2BD | Oman 2OR | Yemen 15YRI | Egypt 10EP | Europe 5Euros INDEX 4 Interview: Speaker Hussein Al-Husseini 5 LEADER: Municipal and Ikhtiariah Elections 2010 14 A search for the missing $11 billion 18 Ministry of Interior and Municipalities 24 Cost of renting airplanes for the presidency 26 Divorce 28 Blasphemy, apostasy and disdain of religions 29 Lycée des Arts 31 The innate human resistance to evidence by Dr. Hanna Saadah Page 18 32 Is intelligence a single entity independent from the brain? by Antoine Boutros 33 Your facial muscles, your emotions by Dr. Samar Zebian 34 The Monthly interviews Ambassador Tomasz Niegodzisz Page 24 Page 4 36 Popular culture 47 Real estate index in Lebanon- 37 Myth #35: Argileh: ‘Safer’ than Cigarettes? May 2010 38 Must-read books: Orientalism 48 Food Price Index - May 2010 39 Must-read children’s book: “Caterpillars can’t fly” 50 Highest Taxes in the World 40 Lebanon Families: Saba Families 50 Beirut Rafic Hariri International Airport - 41 Discover Lebanon: Zan May 2010 42 Aoun-Geagea (2/2) 51 Lebanon stats 43 May 2010 Timeline in Lebanon 45 New York’s Failed Bomb Plot 46 Women in Arab governments Editorialﹺ | 3 WHEN THE “SUNNI” COUNT THEIR DEAD In memory of the victims of the army and refugees of Nahr Al-Bared we re-publish this article which was published in The Monthly issue number 63 of October 2007. -

Durham Research Online
Durham Research Online Deposited in DRO: 15 May 2006 Version of attached le: Published Version Peer-review status of attached le: Peer-reviewed Citation for published item: Stoten, D. (Ed.) (1992) 'A state without a nation.', Working Paper. University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, Durham. Further information on publisher's website: http://www.dur.ac.uk/sgia/ Publisher's copyright statement: Additional information: Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in DRO • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full DRO policy for further details. Durham University Library, Stockton Road, Durham DH1 3LY, United Kingdom Tel : +44 (0)191 334 3042 | Fax : +44 (0)191 334 2971 https://dro.dur.ac.uk b....I~uij ~I,_ .b.. :LL...J-,.II L.I,,,.J. n.\:TRE FOR ~ttDDLE [ASTE~~ :HW ISLAMIC SHIDIES A STATE WITHOUT A NATION edited by D. 5tot8n - 8 OCT 1996 Occasional Paper Serle!;; No 41 (1m, ISSN 0307 0654 \ @ Centre for Middle Eastern and Islamic Studies University of Durham, 1992 ISBN 0 903011 255 • The view. and interpretations in this paper are tho•• of the author. and should not be attributed to the Centre tor Middl. -
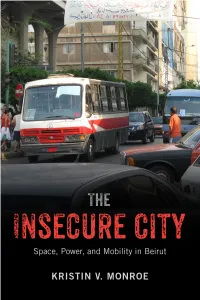
The Insecure City
THE INSECURE CITY THE INSECURE CITY Space, Power, and Mobility in Beirut Kristin V. Monroe Rutgers University Press New Brunswick, New Jersey, and London Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Monroe, Kristin V., 1974– author. Th e insecure city : space, power, and mobility in Beirut / Kristin V. Monroe. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978–0–8135–7463–9 (hardcover : alk. paper) — ISBN 978–0–8135–7462–2 (pbk. : alk. paper) — ISBN 978–0–8135–7464–6 (e-book (epub)) — ISBN 978–0–8135–7465–3 (e-book (web pdf)) 1. Sociology, Urban —Lebanon—Beirut. 2. Public spaces—Lebanon— Beirut. 3. City traffi c—Lebanon—Beirut. 4. Violence—Lebanon—Beirut. 5. Urban anthropology—Lebanon—Beirut. 6. Beirut (Lebanon)—Social conditions. I. Title. HT147.L4M66 2016 307.76095692′5—dc23 2015021869 A British Cataloging-in-Publication record for this book is available from the British Library. Copyright © 2016 by Kristin V. Monroe All rights reserved No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, or by any information storage and retrieval system, without writt en permission from the publisher. Please contact Rutgers University Press, 106 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08901. Th e only exception to this prohibition is “fair use” as defi ned by U.S. copyright law. Visit our website: htt p://rutgerspress.rutgers.edu Manufactured in the United States of America For my mother, Ann CONTENTS List of Figures ix Acknowledgments xi Note on Language xv Introduction 1 1 Th e Privatized City 18 2 Th e Space of War 35 3 Politics and Public Space 56 4 Securing Beirut 79 5 Th e Chaos of Driving 101 6 “Th ere Is No State” 121 Conclusion 139 Notes 145 References 165 Index 177 vii FIGURES Figure I.1 Internal Security Forces billboard 15 Figure 1.1 Map of Beirut in Lebanon and the region 19 Figure 1.2 Neighborhood map of Beirut 20 Figure 1.3 Cafe at a Beirut public garden during the late Ott oman period, ca. -

VALUATING URBAN HERITAGE in a DEVELOPMENT PERSPECTIVE the Roles of Designation and Appropriation for Heritage Policy Design in Lebanon
Sciences Po PSIA – Paris School of International Affairs Master in International Development VALUATING URBAN HERITAGE in a DEVELOPMENT PERSPECTIVE The roles of designation and appropriation for heritage policy design in Lebanon Elisabetta Pietrostefani Master’s thesis supervised by Vincent Geronimi, Senior Lecturer at the University Versailles-St Quentin and Sciences Po. Academic Year 2013/2014 The copyright of this Master's thesis remains the property of its author. No part of the content may be reproduced, published, distributed, copied or stored for public or private use without written permission of the author. All authorisation requests should be sent to [email protected] Elisabetta Pietrostefani Sciences Po – PSIA Valuating Urban Heritage in a Development Perspective 2013-2014 Abstract For development policies, cultural heritage is seen as an asset on account of its historic, cultural and socio-economic significance in contemporary society, particularly in relation to the identity of cities and their economies. The World Bank, the French Development Agency and the EU have in fact executed international aid projects integrating urban heritage to their development strategies. These projects are particularly relevant in light of the changing nature of urban areas presenting high risks for heritage because of urban growth. In developing countries, however, urban heritage is often an under-employed and under-protected asset. Lebanon presents such an example, where urban heritage is in particular danger despite previous urban heritage and development projects such as the World Bank’s Cultural Heritage and Development Project (CHUD). This thesis has adopted Lebanon as a case study to illustrate urban heritage valuation as the first essential step for the design of effective urban heritage policies or renovation projects aiming for local development. -

Lebanon's Experience with Dialogue
issue number 159 |October 2015 PRODUCTIVITY OF LEBANON’S SELF-EXTENDING PARLIAMENT: 8 SESSIONS AND 63 LAWS DEMOGRAPHIC IMBALANCE IN LEBANON CHRISTIANS: FROM 60% TO 12%? THE MONTHLY INTERVIEWS www.monthlymagazine.com Published by Information International sal PROTESTERS IN THE MARTYRS SQUARE LEBANON’S EXPERIENCE WITH DIALOGUE 1975-2015 Lebanon 5,000LL | Saudi Arabia 15SR | UAE 15DHR | Jordan 2JD| Syria 75SYP | Iraq 3,500IQD | Kuwait 1.5KD | Qatar 15QR | Bahrain 2BD | Oman 2OR | Yemen 15YRI | Egypt 10EP | Europe 5Euros October INDEX 2015 4 LEBANON’S EXPERIENCE WITH DIALOGUE 1975-2015 GENUINE DIALOGUE OR FUTILE DEBATE? 21 PRODUCTIVITY OF LEBANON’S SELF-EXTENDING PARLIAMENT 8 SESSIONS AND 63 LAWS 23 DEMOGRAPHIC IMBALANCE IN LEBANON CHRISTIANS: FROM 60% TO 12%? 25 1018 MUNICIPALITIES IN LEBANON 26 KUVENDI: PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA P: 28 27 SALIM HAIDAR (1911-1980) 28 INTERVIEW: PROTESTERS IN THE MARTYRS SQUARE: MODEST NUMBERS AND GREAT DEMANDS 30 COLLECTIVE FOR RESEARCH AND TRAINING ON DEVELOPMENT-ACTION 32 POPULAR CULTURE 33 DEBUNKING MYTH#98: DOES UNHEALTHY FOOD CAUSE ACNE? 34 MUST-READ BOOKS: MY CHILDHOOD WITH MY FATHER 35 MUST-READ CHILDREN’S BOOK: OLIVE, SOAP, HAMMAM 36 LEBANON FAMILIES: AL-RIF FAMILIES P: 4 37 DISCOVER LEBANON: ZGHARTA EL-MTEWLI 38 DISCOVER THE WORLD: TAJIKISTAN 39 AUGUST 2015 HIGHLIGHTS 49 REAL ESTATE PRICES - AUGUST 2015 43 THIS MONTH IN HISTORY- LEBANON 50 DID YOU KNOW THAT?: PLASTIC OCTOBER 28, 1975: SURGERIES AROUND THE WORLD ONE OF THE BLOODIEST DAYS OF THE CIVIL WAR 50 RAFIC HARIRI INTERNATIONAL -

Reconciliation, Reform and Resilience Positive Peace for Lebanon
Accord Logo using multiply on layers 24 2012 issue issue Logo drawn as Editors seperate elements Accord with overlaps an international review of peace initiatives coloured seperately Elizabeth Picard and Alexander Ramsbotham 2012 Reconciliation, reform and resilience Positive peace for Lebanon Reconciliation, reform and resilience: and resilience: reform Reconciliation, Positive peace for Lebanon for peace Positive 24 Accord issue an international review of peace initiatives Reconciliation, reform and resilience Positive peace for Lebanon June 2012 // Editors Elizabeth Picard and Alexander Ramsbotham Accord // IssuE 24 // www.c-r.org Published by Conciliation Resources, to inform and strengthen peace processes worldwide by documenting and analysing the lessons of peacebuilding Published by Acknowledgements Conciliation Resources Conciliation Resources would like to give 173 upper street, London N1 1RG particular thanks to specialist editorial advisers: www.c-r.org Sune Haugbølle, Karam Karam, Marie-Joëlle Zahar and Aaron Griffiths; as well as Sami Atallah Telephone +44 (0) 207 359 7728 and The Lebanese Centre for Policy Studies. Fax +44 (0) 207 359 4081 Email [email protected] We also extend grateful thanks to authors, interviewers and interviewees, and the UK charity registration number 1055436 many other expert contributors to this Accord publication: Editors Elizabeth Picard and Alexander Ramsbotham Ahmad Beydoun, Aïda Kanafani-Zahar, Alistair Crooke, Are Knudsen, Armen Balian, Ben Executive Director Stevenson, Bernard Rougier, Beverley -

Lebanon 1982-1984
The London School of Economics and Political Science From Peacemaking to ‘Vigorous Self-Defense’: US Foreign Policy and the Multinational Force in Lebanon 1982-1984 Corrin Varady A thesis submitted to the Department of International History of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, March 2015. 1 Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of 100,326 words. Statement of use of third party for editorial help I can confirm that my thesis was copy edited for conventions of language, spelling and grammar by Ms Demetra Frini. 2 Abstract This thesis is a study on the use of military force in United States peacemaking in Lebanon between 1982 and 1984. It argues that the failure of the Reagan Administration to understand accurately the complex political landscape of the Lebanese Civil War resulted in the US and the Multinational Force in Beirut becoming intertwined in the broader Lebanese conflict. -

Use of Theses
Australian National University THESES SIS/LIBRARY TELEPHONE: +61 2 6125 4631 R.G. MENZIES LIBRARY BUILDING NO:2 FACSIMILE: +61 2 6125 4063 THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY EMAIL: [email protected] CANBERRA ACT 0200 AUSTRALIA USE OF THESES This copy is supplied for purposes of private study and research only. Passages from the thesis may not be copied or closely paraphrased without the written consent of the author. THE LEBANESE CONFLICT A Sociological Study of its Causes and Resolution Latif Abul-Husn A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy The Australian National University November 1992 Declaration Except where otherwise indicated this thesis is my own work November 1992 ACKNOWLEDGEMENTS This thesis could not have been written without the assistance and support of a number of people. My main debt is to my supervisors, Dr. Lawrence Saha and Dr. Amin Saikal for the time they have generously given me and the guidance and counselling they persistently provided. I would like to express my thanks to my adviser, Dr. Robert Springborg for his many pertinent comments and helpful suggestions. I am thankful also to Dr. William Harris for his editorial help and valuable comments. My warm thanks to Mrs. Susan DeMarco for undertaking the difficult task of typing the first draft of this manuscript despite the illegibility of my handwriting. I am thankful also to Ms Betty Pilgrim who continued, cheerfully, to type and retype and print this thesis. None of those mentioned here are responsible for errors or deficiencies of my work. I would like to thank in particular my wife Samira and two daughters, Roula and Ranya, for their tolerance, encouragement and support during the painful process of producing this thesis.